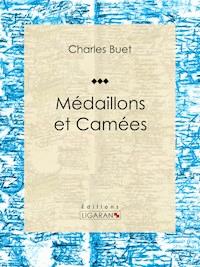
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Lamartine a caractérisé d'un mot l'écrivain dont nous inscrivons le nom glorieux en tête de cette étude : il a appelé M. Jules Barbey d'Aurevilly le duc de Guise de la littérature. C'est en effet un jouteur et un lutteur. C'est un soldat de la plume, ayant flamberge au vent et feutre sur l'oreille..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050059
©Ligaran 2015
À MON AMI
Vous connaissez la manie que j’ai d’entasser les documents : j’en ai encombré plusieurs armoires, et ce sont des archives que je fouille souvent. C’est la manie du siècle, il faut la flatter. Et c’est pourquoi, sous une même couverture, j’ai réuni quelques études jusqu’ici éparses çà et là, un peu partout, dans les Revues, – ces tombeaux ! – dans les journaux, ces éphémères papiers qui meurent en naissant. Il y a, je le crois, un intérêt réel à rassembler ainsi des jugements inspirés par le caprice, l’actualité, la passion, par des colères ou des enthousiasmes dont il ne reste pas trace.
Je le fais, et ce n’est peut-être pas sans regrets, car enfin nos jugements ne sont pas stables : les années les modifient quand même. Les opinions d’un homme de quarante ans ont passé par bien des laminoirs. On les a fortement combattues, on les a ridiculement louées. Je les donne, telles qu’elles étaient quand je les avais, et sincères, car on est toujours sincère, sur le moment.
J’aurais pu compléter ce que j’appelle mes « Camées », en faire des « Médaillons », et, qui sait ? peut-être des statues. Je ne l’ai pas voulu. Qui, par exemple, aurait mieux connu que moi Maurice Rollinat dont la réputation, jusque-là restreinte aux cénacles pu quartier latin, est éclose en mon modeste logis, où pendant cinq années, il nous charmait chaque mercredi, – il vous en souvient ? – par ses poésies d’un si haut vol, et sa musique si étrangement pénétrante ? Et le philosophe Ernest Hello, si profond, si aigu, si subtil, vous rappelez-vous ses audacieuses conversations avec Barbey d’Aurevilly ?…
Mais j’ai voulu garder à ces courts chapitres la saveur de mes premières impressions, si saveur il y a. Je ne suis pas un critique : je suis un passionné : je vois vite, et j’ai la fatuité de croire que je vois bien. Ces Camées sont comparables à l’esquisse, au premier coup de crayon : incorrect, sans doute, hésitant un peu, mal venu parfois, mais presque toujours attrapé, comme disent les peintres.
Je les ai laissés tels qu’ils furent écrits, en des temps anciens, lorsque personne ne pensait qu’un jour Alphonse Daudet refuserait d’être de l’Académie, et que Sarah Bernhardt jouerait Théodora, et qu’Émile Zola écrirait Germinal.
Et pourquoi, maintenant, ai-je choisi ceux-là, et non pas d’autres ? Ceci est le secret de ce livre, et je n’ai pas besoin de vous le dévoiler, puisque vous le connaissez. Parce que Barbey d’Aurevilly est mon maître et mon ami, une des plus hautes personnalités littéraires de ce temps, le plus noble caractère qui soit, chevaleresque, vaillant, tendre aux faibles, cruel aux forts… Parce que Paul Féval m’a appris le métier de romancier, – et que je le lui pardonne… Parce que Léon Gautier fut longtemps, à mes yeux, l’idéal de l’écrivain catholique, et que ce n’est ni de sa faute ni de la mienne si les illusions s’envolent, et si les intérêts mesquins troublent les plus douces amitiés. Parce que Louis Veuillot fut mon héros, dès le collège et surtout au collège, où notre professeur nous lisait le Parfum de Rome au lieu de nous détailler les splendeurs du quadrupedante putrem sonitu… Parce que George Sand a raffiné mes instincts d’artiste, en m’apprenant la musique avec Consuelo, le théâtre avec la Floriani et le Château des Désertes… Parce que j’ai vu le Père Monsabré à Notre-Dame, et dans sa cellule de moine, comme j’ai vu Sarah Bernhardt dans sa gloire, au théâtre, à son atelier, au bord de la mer.
Or je n’ai dit que ce que j’ai vu, ou ce que j’ai pensé, loyalement, sans détours. J’aurais le droit de rééditer pour la millième fois le « livre de bonne foy » de Montaigne. Je m’en abstiens, me contentant d’offrir ce livre au public sous votre patronage, à vous qui, le premier avez arboré le drapeau du « Naturalisme catholique », deux mots qui semblent, ainsi accouplés, hurler l’un contre l’autre ; mais vous et moi nous savons bien qu’ils se peuvent accorder.
Vous m’avez dédié votre premier livre, mon cher ami. Agréez que je vous dédie celui-ci, comme un gage de notre amitié, vieille déjà, et que rien de ce qui aurait pu l’abattre n’a jamais ébranlé, et ne découragera jamais.
CHARLES BUET.
Paris, ce 22 décembre 1884.
LES VIVANTS
Lamartine a caractérisé d’un mot l’écrivain dont nous inscrivons le nom glorieux en tête de cette étude : il a appelé M. Jules Barbey d’Aurevilly le duc de Guise de la littérature.
C’est en effet un jouteur et un lutteur. C’est un soldat de la plume, ayant flamberge au vent et feutre sur l’oreille. C’est une des intelligences les plus profondes, les plus complètes et les plus complexes de ce temps-ci, que cet homme qui aurait pu être à son gré un condottiere comme Carmagnola, un politique comme César Borgia, un rêveur à la Machiavel, un corsaire comme Lara, et qui s’est contenté d’être un solitaire, écrivant des histoires pour lui-même et pour ses amis, faisant bon marché de l’argent et de la gloire et, prodigue éperdu, semant à tous les vents assez de génie pour laisser croire qu’il en a le mépris.
Cet homme est un Protée qui revêt cent formes et apparaît toujours beau, toujours herculéen comme le géant auquel je le compare, mais avec des physionomies si diverses, qu’il faudrait pour le peindre tour à tour Zurbaran et Vanloo, Largillière et Goya, ou mieux encore les admirables primitifs de l’école florentine, dont les figures conservent la grandeur farouche des héros du XVe siècle.
« Il y a du Normand dans M. d’Aurevilly, a dit Paul Bourget, du pirate épris du combat. Catholique intransigeant jusqu’à soutenir qu’il aurait fallu brûler Luther, il a dans les veines du sang d’une famille qui a chouanné. À Valognes, sa ville, où il passe tous les ans les quatre à cinq mois d’automne, après les vignes, il n’a qu’à regarder les pierres des vieux hôtels pour se rappeler le souvenir des vieilles figures de soldats des landes, qu’il a connues durant son enfance. Il erre le long des rues pour ramasser ses souvenirs, et de temps à autre il coule ces impressions d’une histoire qui fut héroïque dans le moule de quelque roman, beau comme une épopée, qui s’appelle l’Ensorcelée ou le Chevalier des Touches.
À Paris, le maître loge en plein faubourg Saint-Germain, rue Rousselet. Il cause, racontant des anecdotes avec une tournure de style qui vaut ses articles, chargeant la lâcheté contemporaine avec une furie de vieux ligueur, et, au demeurant, aussi finement et doucement aimable à ceux qu’il aime, – « il n’y a pas de foule, », comme disait Stendhal, – qu’il est âprement et cruellement sévère à ceux qu’il hait.
Là sont venus tour à tour, attirés par le prestigieux feu d’artifice de mots de ce diable d’homme, Charles Baudelaire, qui l’appelait le « mauvais sujet » dans ses jours d’amitié, et le « vieux mauvais sujet », dans ses jours de mauvaise humeur ; Théophile Silvestre, qui le surnommait « le laird », et lui amenait un jeune avocat du nom de Gambetta ; Amédée Pommier et Hector de Saint-Maur, César Daly et le comte de Gobineau, François Coppée et Paul de Saint-Victor, Maurice Bouchor et Boussès de Fourcaud ; combien d’autres encore ! »
Les autres étaient et sont encore Armand Hayem, Zacharie Astruc, Émile Levy, Maurice Rollinat, Léon Bloy, Georges Landry et celui qui signe ces pages.
Je ne parle pas d’un immonde bohême, qui publia naguère un livre effrayant de perversité contre la plupart des contemporains célèbres, et qui triture sans doute, dans l’ombre où il végète, – champignon sur son fumier, – quelque venimeux libelle contre celui qui le fit vivre quinze ans du pain de l’aumône. Ce Thersite, bien connu des gens de lettres, qui le reçoivent à l’antichambre, aura sa place dans une autre galerie, non pas celle des « artistes mystérieux », mais celle des « affamés ». Ce stipendié de la littérature n’a produit qu’une seule chose dans sa vie : la légende de Barbey d’Aurevilly, c’est-à-dire un chapitre plagié des mémoires de Casanova, et mis au point avec une certaine habileté. La calomnie, disait M. Viennet, est un charbon qui noircit tout ce qu’il ne brûle pas. Le triste hère que je ne prends pas la peine de nommer a débité beaucoup de charbon.
La biographie de M. Barbey d’Aurevilly ne sera point faite de son vivant. Il est né, quelque part, à Saint-Sauveur-le-Vicomte ou à Valognes, au fond de cette belle Normandie qu’il aime tant, et peu importe en quelle année. Il débuta, m’a-t-on dit mais je ne saurais l’affirmer, en 1825, par une brochure intitulée : Aux héros des Thermopyles, qui est du reste introuvable.
Il publiait en 1843 son premier roman : l’Amour impossible. Deux ans plus tard il donnait son fameux livre du Dandysme et de Georges Brummel, qui lui valait une lettre d’Alfred de Vigny, que voici :
« Je ne veux pas attendre que je vous revoie pour vous remercier de cette visite que j’ai reçue par vous de ce vieux fat de Brummel, que vous avez enterré dans son Dandysme, qui lui sert de linceul. Vous vous moquez de tous les deux avec un esprit charmant, et vous faites leur éloge à peu près comme Hamilton quand il louait les vertus des filles d’honneur de la reine d’Angleterre et surtout celles de mademoiselle Hyde, duchesse d’York, immédiatement après la confession de ses jeux innocents avec les jeunes lords ses amis.
Vous connaissez l’Angleterre, ce me semble, aussi bien qu’Hamilton connaissait la France, et ni sa langue ni ses mœurs n’ont de mystère pour vous. Vous venez de vous amuser à donner une sorte d’importance à cet homme qui, j’en suis sûr, ne fut guère à vos yeux qu’un laquais pour accompagner le violon du prince de Galles avec le sien, et l’aider à dessiner la forme de l’habit du lendemain et des grosses cravates du soir, une sorte de poupée de cire, comme j’en ai vu beaucoup à Londres, se posant pour aller à Hyde Park (comme se pose le portrait d’Alfred d’Orsay, fait par lui-même), la canne sur le genou et n’osant pas plus se déranger qu’un horse-guard en vedette ne dérange sa carabine et la direction de son regard ; – du reste, muet dans le monde et dans l’intimité, faute d’idées et de sentiments.
En vérité, je crois que vous aimez encore mieux le maussade cant, qui du moins ressemble, d’un peu loin, à une idée religieuse et sérieuse ; – haineuse, il est vrai par-dessus tout, mais enfin pouvant animer un être humain de quelque chose et d’autre chose que la froide manie de poser, en pivotant sur soi-même, comme un Curtius de cire, sous les glaces d’une boutique de coiffeur.
Cet éloge moqueur que vous faites du Dandysme est le plus heureux persiflage du monde contre cette froide vanité de l’attitude, ce rôle de princes dédaigneux et de millionnaires blasés joué par des sots, qui n’ont ni naissance, ni richesse, ni talent, ni esprit, ni cœur.
Cette nuit j’aime à causer ainsi d’avance, un peu, avec vous.
Le vautour est parti ou endormi et n’a fait que m’éveiller à quatre heures, par une morsure comme à l’ordinaire.
Puisque vous ne cessez d’être bon et d’envoyer, à un ami connu de vous, ce que vous écrivez aux amis inconnus, voyez s’il ne vous est pas possible de venir le voir mardi (27 mai à 2 heures après-midi).
Si je cache mal quelque crise que je ne puis prévoir, vous me pardonnerez pour l’amour du grec qui a produit ce joli nom de gastralgie et qui m’a fait bien du mal dans ces quinze jours, et surtout quinze nuits, il faut que je l’avoue.
Je désigne mardi, afin que vous ayez le temps d’en choisir un autre, si celui-là vous est pris pour quelque affaire ou quelque plaisir.
Avec les plus véritables sentiments de sympathie et d’amitié, croyez-moi bien
Tout à vous,
ALFRED DE VIGNY. »
Quelques années plus tard, M. Barbey d’Aurevilly publiait, dans le Nain jaune, une série de portraits à la plume, sous ce titre : les Quarante médaillons de l’Académie française. Quand on en aura lu quelques-uns, on ne sera point étonné qu’il n’ait pas franchi le seuil du palais Mazarin. Il n’est pas de ceux qui sacrifient leur indépendance à leurs ambitions.
Voici quelques-unes de ces esquisses burinées à l’eau-forte :
M. COUSIN. – Marionnette effrénée.
M. SAINTE-BEUVE, dont la conversation est le contraire de ses livres, flatte dans ses livres M. Cousin, qu’il abîme dans sa conversation.
M. Sainte-Beuve attend la mort de M. Cousin pour aller, selon son usage, lever la jambe contre son tombeau et faire ainsi la seule oraison funèbre qui convienne à cet homme.
M. SAINT-MARC GIRARDIN. – Il fait son cours le chapeau sur la tête. Est-ce que, par hasard, il se croirait grand d’Espagne en littérature ?
M. DE RÉMUSAT. – En France, maintenant, quand un esprit est sur le point de ne pas être, on dit qu’il est fin.
M. de Rémusat a vu jouer le billard chez madame de Staël et il s’est pris pour son coup de queue.
M. de Rémusat est un des ministres sans emploi internés à l’Académie, cette Salpêtrière de ministres tombés.
M. DUPIN. – La petite vérole est la seule ressemblance qu’il ait avec Mirabeau.
M. THIERS. – À fait son Histoire de la Révolution et une révolution qui n’aura jamais d’histoire. Niché sur les faits colossaux de ce temps, le petit homme a paru aussi grand que les faits aux bourgeois qui ne sont pas forts en perspective.
M. AMPÈRE. – Il n’a qu’un moyen d’être Tacite, c’est de se taire.
M. VIENNET. – À fait un poème de douze mille vers ; il faudrait vingt-quatre mille hommes pour l’avaler.
M. EMPIS. – On voit jouer une pièce qui est de tout le monde ; eh bien ! elle est de M. Empis.
M. E. AUGIER. – Un peu plus de gaieté en aurait fait un vaudevilliste.
M. LEBRUN. – Comme Ponsard il a fait sa Lucrèce. Seulement, il l’a intitulée : Marie Stuart.
M. PATIN. – On lit ses œuvres par le dos.
M. ERNEST LEGOUVÉ :
Tombe aux pieds de ce sexe…
a dit son père. Le fils a obéi : il y est tombé.
La Vieille Maîtresse fut publiée en 1851 ; l’Ensorcelée en 1854 ; le Chevalier des Touches et le Prêtre marié en 1864.
M. Joséphin Peladan a excellemment apprécié l’auteur de ces merveilleux romans, qui se délassait des œuvres d’imagination par les œuvres plus stériles du journalisme.
« Ses débuts de polémiste littéraire, dit-il, furent d’un fracas incroyable ; sa plume avait des éclairs d’épée. Homme d’action, né pour combattre à la Massoure, il écrit parce qu’il est dans un siècle de papier, où il n’y a plus rien de grand à faire que l’impossible enrayement de l’évolution moderne. Sa plume est tout, hors une plume : colichemarde embrochant les quarante médaillons de l’Académie, lourde épée à deux mains fauchant gallicans et libres penseurs ; masse d’arme rebondissant sur la dure tête des hégéliens ; stylet creusant férocement le cœur humain et y cherchant les fibres encore inconnues ; cravache comme dans Goethe et Diderot, où les phrases courtes et cinglantes se succèdent avec des sifflements de lanières. Paladin réduit à la plume, il arrache des étincelles au papier, il guerroie toujours sans regarder si l’adversaire vaut le combat. Théodore de Banville me disait : « Barbey foudroie indifféremment un mauvais acteur ou un hérétique. » Cela est vrai, sa main ne peut se faire au manche court de l’ironie bienveillante, cette fine dague de la polémique dédaigneuse et calme ; il frappe formidablement par nature, par besoin d’héroïsme. Quoique le rapprochement doive paraître étrange, certains éreintements me font penser à ce passage du Petit Roi de Galice, où Roland frappe comme la fatalité même, avec la majesté d’un devoir à accomplir. Il a eu des cris de Juvénal furieux, tels que le fameux : Silence à l’orgie ! Dernier nabi catholique, il était bien l’écrivain des Prophètes du passé, où l’intolérance dogmatique a une allure à la Bossuet, et la foi, un accent papal de parole urbi et orbi. C’est du de Maistre avec autant de logique et une fougue de Bridaine. Le terrible Old Noll des Quarante médaillons de l’Académie, l’anonyme du Musée des antiques et des Vieilles actrices se retrouve dans les cinq volumes de Les Hommes et les Œuvres. Avec beaucoup de style endiablé et le caractère d’un Saint-Simon, il fait défiler romanciers, historiens, poètes, bas-bleus ; et comme en ces danses macabres, que le Moyen Âge peignait aux murs des cimetières, où un moine dans une chaire dit à tous ceux qui passent devant lui, au pape et au mendiant, ses péchés et ses crimes, Barbey, avec le ton d’un justicier, fait une critique où passe le vent d’une chevauchée guerrière. Sur sa toge est écrite cette devise, à laquelle il n’a jamais failli : « À outrance ! »
Mais que pense de M. Barbey d’Aurevilly, M. Barbey d’Aurevilly lui-même ? Je ne crois pas me tromper en disant que le portrait qu’il a tracé de Rollon Langrune, dans l’introduction d’Un Prêtre marié, n’est autre que le sien. En tout cas, il me paraît ressemblant, et le voici :
« Rollon Langrune avait la beauté âpre que nos rêveries peuvent supposer au pirate-duc qu’on lui avait donné pour patron, et cette beauté sévère passait presque pour la laideur, sous les tentures en soie des salons de Paris, où le don de seconde vue de la beauté vraie n’existe pas plus qu’à la Chine ! D’ailleurs il n’était plus jeune. Mais la force de la jeunesse avait comme de la peine à le quitter. Le soleil couchant d’une vie puissante jetait la dernière flamme fauve à cette roche noire.
Dispensez-moi de vous décrire minutieusement un homme chez qui le grandiose de l’ensemble tuait l’infiniment petit des détails, et dressez devant vous, par la pensée, le majestueux portrait du Poussin, le Nicolas normand, vous aurez une idée assez juste de ce Rollon Langrune. Seulement l’expression de son regard et celle de son attitude étaient moins sereines… Et qui eût pu s’en étonner ? Quand le peintre des Andelys se peignait, il se regardait dans le clair miroir de sa gloire, étincelante devant lui, tandis que Rollon ne se voyait encore que dans le sombre miroir d’ébène de son obscurité. De rares connaisseurs auxquels il s’était révélé, disaient qu’il y avait en lui un robuste génie de conteur et de poète, un de ces grands talents genuine qui renouvellent, d’une source inespérée, les littératures défaillantes, – mais il ne l’avait pas attesté, au moins au regard de la foule, dans une de ces œuvres qui font taire les doutes menteurs ou les incrédulités de l’envie.
Positif comme la forte race à laquelle il appartenait, ce rêveur, qui avait brassé les hommes, les méprisait, et le mépris l’avait dégoûté de la gloire. Il ne s’agenouillait point devant cette hostie qui n’est pas toujours consacrée, et que rompent ou distribuent tant de sots qui en sont les prêtres !
D’un autre côté, en vivant à Paris quelque temps, il avait appris bien vite ce que vaut cette autre parlotte qu’on y intitule la Renommée, et il n’avait jamais quémandé la moindre obole de cette fausse monnaie à ceux qui la font. À le juger par l’air qu’il avait, ce n’était rien moins que le Madallo du poème de Shelley, c’est-à-dire la plus superbe indifférence des hommes, appuyée à la certitude du génie autochtone, le génie du pays où il était né, et qui, jusqu’à lui, avait été à peu près incommunicable.
Quelque jour Rollon Langrune devait être, disaient les jugeurs, le Walter Scott ou le Robert Burns de la Normandie, – d’un pays non moins poétique à sa façon et non moins pittoresque que l’Écosse. »
Il l’est devenu, le Walter Scott de sa Normandie, et même il est quelque chose de plus, car il est lui-même. C’est un paroxyste, et des plus raffinés qui soient parmi les ciseleurs et les joailliers de notre littérature.
« Doué d’une puissance dramatique extraordinaire, il a poussé l’intensité de l’anxiété et de l’épouvante plus loin peut-être que Balzac. Il y a du Dante dans sa descente aux enfers passionnels ; il y a du mage dans son intuition des lois psychiques, dit encore M. Peladan. « Loin d’être un esprit paradoxal, c’est un logicien qui déduit simplement, mais en partant des principes absolus qui étonnent notre époque sans principe ; son style magnétise et produit une sorte d’hypnotisme. Sa phrase, ou se tord en un escalier à vis qui essouffle et fait anxieuse l’attention du lecteur, ou, comme un boa ses anneaux, enroule ses incidentes autour de votre esprit. C’est de la fascination. Saint-Victor, qui se connaissait en écrivains, lui trouvait le paroxysme le plus fier, tour à tour-brutal et exquis, violent et délicat, amer et raffiné ». Cela ressemble, concluait-il, « à ces breuvages de la sorcellerie où il entrait à la fois des fleurs et des serpents, du sang de tigre et du miel. Le nom de J. Barbey d’Aurevilly, qui est écrit sur le tombeau de Guillaume le Conquérant, l’est aussi sur le livre d’or du génie français ».
Cet écrivain si fécond, si laborieux et si admirable dans ses écrits est en même temps un des causeurs les plus spirituels de ce temps, qui en compte si peu. Sa conversation étincelante, semée à profusion de mots charmants, d’une finesse pénétrante, ou d’une rudesse à la Rivarol, qui emporte la pièce, est de celles dont on ne se lasse jamais. Il ne se répète point, et il parle volontiers.
Il est assurément la bienveillance même, car on trouve auprès de lui l’accueil le plus cordial, et ses amis savent qu’il n’a point l’amitié banale. Mais quand il cause, l’esprit de charité lui dicte rarement ses jugements, qui sont brefs, rapides et sans appel.
On ferait un volume des mots de Barbey d’Aurevilly. Le plus beau est celui qu’il dit chez moi, un soir qu’on devisait au coin du feu d’une androgyne presque fameuse, déjà célèbre par ses démêlés avec la police correctionnelle : « Ne me parlez pas de cette femme, s’écria tout à coup M. d’Aurevilly : elle déshonore l’impudeur ! » – Une autre fois un journaliste fort connu lui disait à souper : « Je n’ai connu dans la littérature que deux hommes d’esprit… – Et quel est l’autre » ? interrompit M. d’Aurevilly en se caressant la moustache par un geste familier.
Il se trouvait un jour, dans un dîner, le voisin de table d’un jeune astronome d’une taille exiguë, qui s’avise, au dessert, de vouloir lui expliquer, le crayon en main, le secret de la science céleste.
D’Aurevilly qui l’écoutait patiemment depuis deux heures, l’interrompit tout à coup et, de cette voix calme et majestueuse qu’on lui connaît :
« Je ne vous dissimulerai pas, cher monsieur, que vous m’ennuyez con-si-dé-ra-ble-ment.
– Monsieur… fit le petit homme furieux, en jetant là son crayon et se disposant à sortir.
– Dites-donc, cher monsieur, reprit d’Aurevilly en désignant le porte-mine, vous oubliez votre canne !
Un fantaisiste, – racontait un jour M. Albert Delpit, – avait voulu un jour faire se toucher les deux pôles : réunir dans un dîner un légitimiste-ultrà et un ancien membre de la Commune ! C’est une idée qui pouvait seulement venir à un détraqué. Donc, Barbey d’Aurevilly et M. Jules Vallès s’assoient un beau soir à la même table. Celui-ci veut étonner le preux royaliste. Il s’écrie tout à coup :
« Il me faut quatre-vingt mille têtes de bourgeois ! » Et Barbey d’Aurevilly répond froidement :
« Moi, monsieur… celle de Sarcey me suffirait ! » Causeur de premier ordre, M. d’Aurevilly est un épistolier des plus originaux. Mais il n’aime point que l’on publie ses lettres, aussi me contenterai-je d’en citer deux qui ont été rendues publiques. Dans la première, il se défend de répondre à M. Zola, qui l’avait très violemment attaqué, et qui lui infligeait, comme Flaubert, la ridicule épithète de bourgeois.
« Je vous remercie de mettre votre Triboulet à ma disposition, pour le cas où je voudrais répondre à l’article de M. Zola publié hier dans le Figaro, écrivait M. d’Aurevilly.
Mais je ne profiterai pas de votre offre obligeante : je ne répondrai point à M. Zola. J’ai pour cela des raisons plus hautes que lui. Pourquoi lui répondrais-je ? Il ne discute pas mes idées sur Gœthe. Ce n’est plus Gœthe qui l’intéresse : c’est sa personne à lui, M. Zola, et la mienne ; la sienne pour la surfaire, la mienne pour la blesser. Seulement, il ne l’a pas blessée. Je suis de bonne humeur après l’avoir lu, et aussi calme que Frédéric de Prusse, qui disait d’un placard imbécile contre lui : « Mettez-le donc plus bas, on le lira mieux ».
« Je n’ai pas à me défendre des ridicules que M. Zola me trouve. Être ridicule aux yeux de M. Zola c’est mon honneur, à moi ! Je ne suis pas dégoûté !… Parbleu ! je ne suis pas du tonneau qu’il aime ! je sens autre chose que ce qu’il brasse. Cul-de-plomb qui a de bonnes raisons pour haïr la souplesse, il me reproche d’être une espèce de clown en littérature, et il ne sait pas combien il me fait plaisir, en me comparant à un clown !
Les clowns, il ne sait pas combien je les aime, moi habitué des samedis du Cirque, et qui trouve le Cirque beaucoup plus spirituel que le Théâtre-Français. Il ne sait pas combien je les admire ces gaillards-là, qui écrivent avec leurs corps des choses charmantes de tournure, d’expression, de précision et de grâce, que M. Zola avec son gros esprit ne décrirait jamais.
Je refuse donc la passe d’armes dont vous m’offrez le terrain. Je ne veux pas renouveler la scène de Vadius et de Trissotin chez Philaminte, que refait toujours plus ou moins un auteur, quand il défend son amour-propre. Il n’y a que le public qui gagne à ces spectacles, parce qu’il se moque des acteurs. Ces combats de coqs des amours-propres, je les ai toujours haïs et méprisés. L’honneur, la dignité des duels, c’est le silence dont on les enveloppe. La galerie n’y vaut rien, et elle diminue toujours un peu ceux qui se sont battus pour elle. »
La seconde lettre met à la raison un critique assurément fort honorable, mais qui, vivant très loin de Paris, n’apprécie plus avec exactitude les hommes et les choses. La lettre que lui attira son feuilleton sur l’Histoire sans nom est trop curieuse pour n’être point citée dans ces pages.
Un journal avait publié un article signé l’Ensorcelé. M. d’Aurevilly le remercia en ces termes :
« C’est une flatterie ; mais l’article signé ainsi n’en était pas une… Il répondait à un article de la Gazette de France, signé Pontmartin, qui a paru je ne sais quel jour. D’habitude, je lis peu M. de Pontmartin, mais je n’ai été nullement étonné de l’attaque d’un homme qui, quand il s’agit de littérature, se met à parler politique, – comme il se mettrait à parler politique s’il s’agissait de littérature ! – Tout ce que je sais, c’est que, hors de propos d’un article, lointain déjà, publié par le Gil-Blas sur Mgr de Chambord, et dans lequel mon royalisme, absolument désespéré, exprimait le plus respectueux des regrets sur la politique qui a, depuis trente ans, cloué au fourreau une épée qu’une autre politique aurait pu en tirer, M. de Pontmartin ait eu la logique de me reprocher de n’avoir pas été zouave pontifical ou franc-tireur dans la guerre de 1870, comme si, littérairement, c’était là la question ! M. de Pontmartin n’est pas plus logicien qu’il n’est diable… Seulement, puisqu’il tient à savoir ce que j’ai fait en 1870, faites-lui dire par un de vos garçons de bureau, qu’alors j’étais à Paris, le fusil sur l’épaule : faisant mon service de garde national volontaire, sous les obus, qui ne manquaient pas dans mon quartier.
On ne se vante pas de ces choses-là. C’est par trop simple. Je ne demande pas, moi, à M. de Pont-martin ce qu’il a fait en 1870. Cela ne m’importe pas, ni à la France non plus !
Quant à la littérature de M. de Pontmartin, je n’en ai, jusqu’ici, parlé nulle part encore. J’ai pourtant publié déjà six volumes de critique intitulés les Œuvres et les Hommes, et dans lesquels, en attendant les autres qui vont suivre, j’ai relevé les hommes et les œuvres du XIXe siècle… M. de Pontmartin n’y est pas. Pour l’y mettre, je lui ai donné le temps de croître, mais il n’a pas profité de la patience que j’y mettais. Aujourd’hui, les gens qui l’emploient lui trouvent du talent. Nous verrons, un jour, ce que c’est… Et, ma foi, puisque nous ne sommes jeunes ni l’un ni l’autre, et que la mort peut interrompre tous les comptes, je lui promets de ne pas le faire attendre bien longtemps… »
Ces anecdotes, ces mots, ces lettres, les citations que j’ai voulu faire, pour laisser à chacun la responsabilité de ses appréciations, peignent l’homme extraordinaire que le bohême Thersite s’amusera quelque jour à diffamer, au risque d’éprouver par lui-même ce que dit Victor Fournel dans un livre plein de verve du rôle des coups de bâton dans les relations sociales.
Depuis des années et des années qu’il est sur la brèche, M. Barbey d’Aurevilly n’a pas une mauvaise action à se reprocher. Rude aux forts, doux aux faibles, il a toujours offert aux jeunes l’appui de son expérience et de sa vigoureuse critique. Il n’est pas tendre, la plume à la main. Il est paternel quand il conseille, et s’il juge d’un trait un peu vif, il a souvent plus de patience qu’on n’en demanderait à un saint.
Que faudrait-il ajouter encore qui n’ait été dit ? Et à qui importe-t-il d’en savoir davantage ? L’écrivain se juge par ses œuvres, et ce sont les œuvres que nous allons maintenant feuilleter de concert, en nous rappelant, pour conclure, cette belle parole de Tertullien : « Une heure viendra où l’encre des écrivains sera payée le même prix que le sang des martyrs. »
Chacun des livres peu nombreux publiés par M. Jules Barbey d’Aurevilly a été un évènement littéraire ; la force, ou plutôt la violence de ce talent a soulevé des scandales.
Comment, dès lors, s’expliquer que M. Barbey d’Aurevilly, catholique ardent et l’un des critiques les plus hardis et les plus francs de notre époque, soit si peu connu et si peu aimé, surtout des catholiques ? Il y est parmi les oubliés ; ses admirateurs s’écartent de son chemin, et son école, si exclusive, mais si zélée aussi, ne compte qu’un petit nombre de fidèles. Il est parmi les dédaignés, car les journaux, qui ont de si beaux éloges pour tant de platitudes, parlent peu de ses livres audacieux.
Les œuvres capitales de M. Barbey d’Aurevilly sont l’Ensorcelée, le Chevalier des Touches, Un Prêtre marié, la Vieille maîtresse, l’Histoire sans nom et les Diaboliques.
L’Ensorcelée est la première en date. Ce roman est précédé d’une préface dans laquelle l’auteur voulant excuser certaines hardiesses, déclare que pour décrire les effets de la passion, il en a quelquefois gardé le langage. « Il a usé, dit-il, de cette grande largeur catholique, qui ne craint pas de toucher aux passions humaines, lorsqu’il s’agit de faire trembler sur leurs suites. Romancier, il a accompli sa tâche de romancier, qui est de peindre le cœur de l’homme aux prises avec le péché, et il l’a fait sans embarras et sans fausse honte. Les incrédules voudraient bien que les choses de l’imagination et du cœur, c’est-à-dire le roman et le drame, la moitié pour le moins de l’âme humaine, fussent interdits aux catholiques, sous le prétexte que le catholicisme est trop sévère pour s’occuper de ces sortes de sujets. À ce compte-là un Shakespeare catholique ne serait pas possible, et Dante même aurait des passages qu’il faudrait supprimer. »
M. Armand de Pontmartin réfuta avec une extrême vivacité la préface de l’Ensorcelée.
Mais on a bien le droit de ne pas admettre les théories jansénistes et gallicanes de cette école catholique soi-disant libérale, à laquelle appartient M. de Pontmartin. Les ravages des passions, l’étude psychologique profondément fouillée de leur influence sur l’âme et sur l’intelligence, sont un thème qui n’est pas interdit aux catholiques.
Il ne s’agit nullement de montrer la religion en accommodement avec la passion. La religion est le frein unique et nécessaire de la passion.
Est-il défendu de retracer les émotions d’un cœur que la conscience et la passion se disputent ? Est-ce que les catholiques n’ont pas, pour lire jusqu’au fond de l’âme humaine, la lumière supérieure qui, seule, éclaire ses mystérieuses ténèbres : la foi ? « Le catholicisme étant un système complet de répression des tendances dépravées de l’homme, est le plus grand élément d’ordre social, » a dit Balzac dans la préface générale de la Comédie humaine. Donc le catholicisme peut servir de base à une étude complète et parfaite de la société, et de même que le prêtre pour combattre le mal est obligé de le connaître, de même pour dompter le vice, il faut dévoiler ses tristes conséquences. Je crois que cette répulsion des catholiques pour ces œuvres puissantes où certains problèmes psychologiques sont expliqués et résolus, tient à un défaut d’optique.
L’Ensorcelée est un récit historique. En l’an VI de la République, le jour où le combat de la Force ruinait sans retour les espérances des Chouans, l’abbé Jehoël de la Croix-Jugan, ancien moine de l’abbaye de Blanchelande, qui se battait dans les rangs des royalistes se tire un coup de fusil dans le visage. Il est défiguré, mais il ne meurt pas. Une vieille paysanne le recueille, le soigne, panse ses affreuses plaies.
Quand on rouvrit les églises, l’abbé de la Croix-Jugan, absolument défiguré, mais guéri, revint à Blanchelande ; il reprit sa stalle dans le chœur de l’église paroissiale. Il avait versé le sang, violé la loi de la charité, il était interdit. « Sous ce masque de cicatrices, il gardait une âme dans laquelle, comme dans cette face labourée, on ne pouvait marquer une blessure de plus. » Le premier jour où il vint à l’église, il excita la curiosité de tous les fidèles. Une femme, Jeanne le Hardouey, issue de l’illustre maison de Feuardent et qui avait épousé un paysan parvenu, pour ne pas traîner aux portes sa misère, reçut une effroyable commotion à la vue de ce prêtre qui n’était désormais qu’un étranger dans la maison du Seigneur. Elle eut peur en voyant la terrible tête encadrée dans son capuchon noir, elle eut un frisson, un vertige, « un étonnement cruel qui lui fit mal comme la marque de l’acier. Elle eut enfin une sensation sans nom, produite par ce visage qui était aussi une chose sans nom. » Ce fut une possession instantanée, une possession dans le sens théologique, et dont son auteur n’eut pas conscience. Elle devint ensorcelée ; d’horribles perturbations physiques accompagnèrent le trouble et le désordre moral qui envahirent son âme : son visage s’empourpra, et les paysans qui la virent si subitement changée dirent qu’elle avait « le sang tourné ».
L’abbé de la Croix-Jugan n’aperçut rien, ne parla même pas à cette malheureuse et demeura impassible, morne, vivant dans la retraite la plus austère. Jeanne le Hardouey se mourait, broyée par une passion insensée ; elle cherchait des philtres, elle oubliait Dieu, et un jour, folle, épuisée par la souffrance, elle se réfugie dans la mort, elle se noie dans une mare. Ce suicide n’émeut pas le prêtre, qui garde la sérénité de sa conscience, et qui, fort de ses aveux, fort de la grâce, n’a pas daigné abaisser les yeux sur cette créature fascinée.
Quelques années plus tard, l’abbé de la Croix-Jugan, relevé de l’interdit, se prépare à célébrer la messe, pour la première fois, depuis bien longtemps. « Avec sa grande taille, la blancheur flamboyante de sa chasuble lamée d’or, que le soleil, tombant par une fenêtre du chœur, semble tout à coup embraser, il ne paraissait plus un homme, mais la colonne de flammes qui marchait en avant d’Israël et qui le guidait au désert. » Au moment où il élevait l’Hostie sans tache, de ses deux mains tendues vers Dieu, un coup de feu retentit : l’abbé de la Croix-Jugan tomba mort sur l’autel. L’assassin était le mari de Jeanne, Thomas le Hardouey.
Telle est, dépouillée de tous ses brillants accessoires, la fiction de ce livre : d’un côté, un prêtre chaste, pur, austère, repentant, pénitent ; de l’autre, une femme qui, mésalliée, n’aimant pas son mari, privée des joies de la maternité, pervertie par les pires influences, devient la proie d’une horrible maladie de l’âme.
Rien ne saurait rendre l’intensité dramatique du récit, l’épouvante qu’il produit, l’horreur qu’il inspire. Tous les personnages sont vivants, et tous sculptés dans le marbre, fouillés avec la patience du ciseleur, complets, absolus, logiques. On ne peut même analyser les diverses parties qui composent le récit, parler de chacune des scènes émouvantes et terribles qui se succèdent sans que le lecteur ait un instant de répit. Tout se tient, tout s’enchaîne avec une inexorable logique. On est séduit, invinciblement atterré, ensorcelé, – c’est le mot, – par ces pages ardentes, consacrées à des sentiments exceptionnels, à des situations anormales. Rien qu’au style de M. d’Aurevilly, – et abstraction faite des idées, – rien qu’au tour de sa phrase, à son emploi du mot, on le reconnaît tout de suite autoritaire : il prodigue les expressions hautaines, les comparaisons impitoyables ; – les substantifs, sous cette plume, prennent des airs souverains de commandement, et parfois de bravade. Quoique littéraire jusqu’au raffinement et ne versant jamais dans la banalité, il a l’emportement, le torrentiel de la parole oratoire. Il est vrai que le torrent se brise parfois contre des incidentes et des parenthèses qui le ralentissent mal à propos : cela vient de ce que l’auteur veut tout dire, fixer toutes les nuances. – Et à cela il est encouragé par la richesse d’analogies et de métaphores que lui fournit son imagination abondante. Mais il reste quand même un écrivain hors de pair pour ceux qui préfèrent le fier style de Saint-Simon, malgré ses rugosités, ses heurts et ses soubresauts, à la correction élégante et toujours égale de Buffon.
Ces défauts et ces qualités ne se retrouvent nulle part plus en vue que dans le Chevalier des Touches, œuvre moins tourmentée, moins passionnée que la précédente. « Le chevalier des Touches, gentilhomme d’une hardiesse, d’un sang-froid et d’un poignet incroyables, une des têtes, un des bras de la chouannerie, est tombé par trahison aux mains des républicains. Enfoui au plus profond de la prison d’Avranches, il n’en sortira que pour monter à la guillotine. Or la chouannerie tient au chevalier comme à sa tête : elle sent bien qu’elle serait guillotinée avec lui ! Donc il faut sauver des Touches, l’enlever, l’escamoter au nez des Bleus. Douze héros du parti se dévouent à cette besogne impossible. Une première tentative sur la prison de Coutances, où le chevalier vient d’être transféré, réussit. – Comment ? comme réussissent les coups de folie ! Ces deux expéditions, voilà tout le roman ou plutôt le poème de M. Barbey d’Aurevilly. De quelle plume emportée il a tracé cette petite épopée, avec quelle rapidité vertigineuse il a fait défiler devant nous les épisodes où les hercules royalistes accomplissent ces tours de force, cela ne se peut dire. Il est réellement grisé par son sujet. »
Un Prêtre marié est l’œuvre la plus discutée, la plus sombre et la plus difficile à bien comprendre et à bien juger, qu’ait produite cet apologiste de l’autorité et de la force, qui va devenir le juge inflexible d’une conscience. En voici l’analyse succincte. Jean Gourgue dit Sombreval, est le fils d’un paysan normand qui a eu l’ambition de faire de lui un monsieur : élevé dans un séminaire, Sombreval devint prêtre, et il donna de grandes espérances : il devait servir l’Église plus par le cerveau que par le cœur, un docteur plutôt qu’un apôtre. En 1789, il partit pour Paris ; il n’en revint pas. Le gouffre de la corruption, de la science, de l’athéisme le dévora. Il s’affola de chimie ; il épousa la fille d’un chimiste qui ne savait pas que cet homme était un prêtre apostat Le père de Sombreval mourut de cette nouvelle. Lorsque la femme de Sombreval apprit que celui qu’elle croyait son mari appartenait à Dieu, elle mourut, « n’osant plus regarder l’homme qui l’avait si scélératement trompée ; » elle mourut « dans une honte immense et le plus amer désespoir ». Elle lui laissait une enfant, chétive et mal venue, qui devait être l’expiation et le châtiment : sur son front s’était marquée une croix, « la croix méprisée, trahie, renversée par le prêtre impie et qui, s’élevant nettement entre les deux sourcils de sa fille, tatouait sa face, innocemment vengeresse, de l’idée de Dieu ».
Calixte fut élevée par ce père, en qui survivait un seul sentiment, l’amour paternel. Il eut pour sa fille et dans son corps, et dans son âme, et dans son esprit, tous les genres de sollicitudes… hors une seule, hors un point fatal qu’il n’eut jamais le courage de dépasser. Il n’osait lui parler de Dieu.
Mais le jour où Dieu fut révélé à cette jeune fille, le jour où les premiers rayons de la religion de sa mère tombèrent soudainement dans son cœur, elle eut, comme les apôtres, la divine ébriété de cette langue de feu qui descendit sur elle : elle devint chrétienne avec emportement.
Le démon de la perversité, l’orgueil poussent Sombreval à revenir dans le pays où on le connut ministre du Dieu qu’il a renié. Il achète, lui, paysan enrichi, un château délabré, où il passera désormais sa vie qu’il occupe à chercher des remèdes dans les ressources de la chimie pour guérir sa fille, atteinte d’un mal inexplicable, affreux, qui ne pardonne point. Calixte, qui porte un bandeau rouge sur le front, pour cacher la croix dont son front est stigmatisé, a voué sa vie à racheter l’âme de son père : elle suit les règles du Carmel, elle a prononcé les vœux, elle a fait tous les sacrifices.
Un jeune gentilhomme du voisinage, Néel de Nehou, nature passionnée, fougueuse, intrépide jusqu’à la démence, voit Calixte et ne tarde pas à l’aimer éperdument. Calixte lui accorde une affection fraternelle : elle n’est plus de ce monde, la céleste créature. Le drame s’engage donc entre ces trois personnages : Sombreval sait que sa conversion peut sauver sa fille en lui rendant la paix du cœur ; Calixte est résolue au sacrifice absolu de sa vie ; Néel, âme de feu, se brise contre l’obstacle insurmontable. Puis un jour que la fille est si gravement malade que la science de son père désespère du salut, l’athée muré dans son athéisme criminel jusqu’au bout et sans rémission, part pour Coutances où il va se soumettre à l’évêque ; il joue de parti pris, froidement, comme un histrion sur la scène, une comédie sacrilège ; il feint de retourner à Dieu, conversion si ardemment désirée de la fille de son péché. Mais cet homme, aveuglé par l’endurcissement et l’impénitence, a révélé ses desseins à Néel, et Néel se tait, parce qu’il sait bien que si Calixte soupçonnait l’étrange tromperie dont son père est coupable, elle mourrait, foudroyée par la honte et la douleur. Un prêtre saint et vénérable qui s’est cru l’agent de cette conversion miraculeuse, l’abbé Méautis est choisi par la Providence pour empêcher une seconde profanation, une seconde et plus scélérate apostasie.
Ici, M. Barbey d’Aurevilly n’a pas craint de faire intervenir directement l’action surnaturelle. Calixte, prosternée devant son crucifix, en voit jaillir du sang. L’abbé Méautis, qui assiste à cette vision, comprend tout, et, après un long et terrible combat, il révèle à Calixte l’épouvantable vérité.
L’enfant éperdue, aveuglée, embrasée, a la force d’écrire à Sombreval de revenir, puis elle s’affaisse, entre en agonie et meurt. Sombreval revient… il arrive le jour même où Calixte a été enterrée. Il croit à une léthargie… il viole la tombe de sa fille, saisit ce cadavre, reconnaît la mort, s’enfuit, fou de rage et de désespoir, et se précipite dans l’étang du Quesnay, où jamais son corps ne fut retrouvé.
Telle est la faible analyse de ce roman extraordinaire, qui arrache des larmes aux plus incrédules et qui laisse un souvenir ineffaçable d’angoisse et d’épouvante. Sombreval meurt dans l’impénitence finale, dans l’athéisme, dans sa rage contre Dieu. Il est conséquent avec son caractère. C’est une âme éperdue : ce n’est ni un fanfaron ni un lâche. Toute la contrée le méprise, le hait et l’outrage ; il se rend compte de l’effet de son infamie, du dégoût qu’il inspire, et qu’il est venu volontairement chercher ; il est formidable par la science et par la volonté ; il a épuisé la vie et les idées, et il est devenu un de ces indifférents de la terre dont parle Shakespeare ; il est l’orgueil incarné, l’orgueil jaloux et envieux ; mais il ressent toutes les douleurs de son apostasie. « Ce rocher de Golgotha qui pèse sur le monde, dit-il, et que je croyais avoir rejeté de ma vie comme un jonc brisé, y retombe, – et c’est la main de mon enfant qui le fait rouler sur mon cœur. » Cette figure farouche et sauvage, grandiose autant que celle d’un ange déchu, statue de bronze coulée tout d’une pièce ; cette âme noire, cette intelligence vaste, ce bourbier où rien ne surnage si ce n’est le sentiment physique de l’amour paternel ; ce caractère étrangement complexe et simple tout à la fois, ne se dément pas un instant.
Dans les œuvres de M. Barbey d’Aurevilly, les Diaboliques et l’Histoire sans nom ont été les plus contestées ; elles sont, en effet, dictées par une conception du mal excessive. Sans être janséniste, on peut souffrir de la violence des peintures que renferment ces deux livres, dont les beautés littéraires sont de premier ordre. Je ne connais rien, assurément, de plus terrible que Le plus bel amour de don Juan et le Bonheur dans le crime, qui renversent toute idée reçue, mais qui rappellent, malheureusement, des faits trop véridiques de la vie réelle.
On a reproché à M. d’Aurevilly d’avoir choisi pour héros principal de l’Histoire sans nom un capucin : le père Riculf, un de ces moines comme la fin du siècle dernier en vit naître, fatal et mystérieux personnage qui ne fait qu’apparaître, pour commettre le plus abominable et le plus inexplicable des crimes. On a dit que l’auteur commettait un outrage aux persécutés, et s’attaquait aux ordres religieux. C’est là une de ces bêtises comme il en échappe aux hommes de mauvaise foi.
M. Barbey d’Aurevilly n’aime point les femmes qui écrivent, il les traite avec un dédain fort cavalier. Cependant l’une d’elles, qu’on a souvent comparée pour l’esprit, la grâce et la vivacité du style, à ce spirituel vicomte de Launay qui s’appelait madame Émile de Girardin, l’une d’elles que je ne puis désigner que par son pseudonyme de Thilda, a écrit sur le maître une page que je veux citer tout entière.
« Voilà un homme à qui je dois beaucoup ; il m’a ouvert l’âme et il m’a appris à penser ; est-ce un grand écrivain ? Je l’ignore. J’ai toujours eu pour lui une admiration troublée, un sentiment fait de nerfs et quelquefois de larmes.
On dit que ses romans sont faux ; c’est possible, seulement ils entraînent dans des tourbillons d’émotions si violentes, qu’on reste comme brûlé après les avoir lus !
Son récit enflé est grandiose et superbe, un aigle qui, d’un vol lent, s’élève vers la lumière. Le mysticisme chrétien dont son âme est un tabernacle sincère, donne une saveur délicieuse à toutes ses héroïnes charmantes imbibées d’amour et marquées du fer rouge de la fatalité. Cœurs de vierges ou cœurs de filles, ce sont les mêmes désespérances, les mêmes flammes d’enfer. Qu’elles se tordent aux pieds du Christ ou aux pieds du diable, elles offrent leurs plaies saignantes, holocauste qui n’apitoie pas le romancier, pressé de les pousser dans l’abîme malgré le crucifix qu’il leur met sur les lèvres.
Les femmes, les voilà ! elles passent avec leurs yeux qui flambent, elles ne pleurent pas, elles n’ont plus de larmes, la passion a tout desséché, tout tordu.
C’est Jeanne, éprise de cette tête de prêtre labourée par les cicatrices ; le désir qui l’étouffe lui monte à la face comme un flot furieux ; elle en est à jamais tachée ! Le suicide seul éteindra cette rougeur brûlante et rompra l’exorcisme.
La touchante Hermangarde, ce lis au calice d’or, voit sa jeunesse fanée par la trahison de l’époux aimé trop religieusement ; elle meurt tous les jours, et moins heureuse que Martyre de Mendoze, ne peut se consumer jusqu’à perdre l’âme.
La rivale, c’est-à-dire le chef-d’œuvre, le type vrai, Vellini ! cette créature de chair portant au cou un collier comme une vassale d’Orient, c’est la succube antique, la magicienne dont les philtres donnent l’ivresse sans fin. L’impudique est hardie, sûre d’elle : son entêtement d’amour est adhérent à sa race bohême, au breuvage bu dans la même coupe ; pas de larmes, des coups de tonnerre, des éclairs qui montrent la passion entêtée, foudroyante.
Je n’aime pas la fille du farouche Sombreval. Cette carmélite agonisante de névrose nous apparaît comme sainte Thérèse, pâmée d’amour divin ; la croix sanglante qu’elle porte au front m’épouvante ; l’amour enragé, quand même, du jeune gentilhomme mourant de sa mort, fait comprendre, après les possédés du démon, les possédés du paradis ».
M. Barbey d’Aurevilly est un maître en étrangetés, ses romans appartiennent presque tous aux sentiments violents et torrides. La brutalité dans la tendresse, la force nerveuse au service des sentiments et des caractères, un pittoresque barbare un peu cherché, mais d’une originalité que l’art a marqué d’un sceau inaltérable. Cette appréciation d’une femme d’esprit, est une sorte de transition pour arriver aux bas-bleus que le maître pourchasse d’une haine féroce, que je me garderai de lui reprocher.
Cathos et Madelon sont de bien insupportables pécores !
Molière avait deviné le bas-bleu, et l’incarnant dans les filles du bonhomme Gorgibus, il le livra à la risée de son public de marquis, lesquels marquis riaient à se tordre des péronnelles et d’eux-mêmes, mal déguisés sous les figures de leurs laquais.
« L’histoire ne fait pas toujours aux hommes, dit M. d’Aurevilly, l’honneur d’être sévère… Il est des décadences qui ne méritent que le rire de son mépris. Tomber n’est pas toujours tragique. Il y a pour les nations comme pour les hommes des chutes grotesques. Toutes n’ont pas la grandeur du vice, la poésie de la monstruosité. Il y a des petites décadences, disait Galiani. Mais je ne crois pas que, dans l’histoire, il y en ait une plus petite que celle qui nous menace. Je ne crois pas qu’il y en ait de plus honteuse que celle d’un peuple qui fut mâle, et qui va mourir en proie aux femelles de son espèce… Rome mourut en proie aux gladiateurs ; la Grèce, aux sophistes ; Byzance, aux eunuques ; mais les eunuques sont encore des débris d’hommes : il peut rester à ces mutilés une tête virile, comme celle de Narsès, tandis que nous, nous mourons en proie aux femmes, et émasculés par elles, pour être mieux en égalité avec elles.
Beaucoup de peuples sont morts pourris par des courtisanes, mais les courtisanes sont dans la nature et les bas-bleus n’y sont pas ! Ils sont dans une civilisation dépravée, dégradée, qui meurt de l’être, et telle que dans l’histoire on n’en avait pas vu encore. Jusqu’ici les sociétés les plus avancées comme les plus sauvages avaient accepté ou subi les hiérarchies sans lesquelles les sociétés ne sauraient vivre, et maintenant on n’en supporte plus… C’est la gloire du progrès ! L’orgueil, ce vice des hommes, est descendu jusque dans le cœur de la femme, qui s’est mise debout pour montrer qu’elle nous atteignait, et nous ne l’avons pas rassise à sa place comme un enfant révolté qui mérite le fouet ! Alors, impunies, elles ont débordé… Ç’a été une invasion de pédantes au lieu d’une invasion de barbares. Du moins, les barbares apportaient un sang neuf et pur au sang corrompu du vieux monde ; mais les pédantes qui, dans la décrépitude de ce monde ont remplacé les barbares, ne sont pas capables, ces bréhaignes ! de le féconder. »
Et voilà pourquoi votre fille… n’est pas muette !
M. Barbey d’Aurevilly est terriblement dur aux malheureuses qui font argent de leur plume et vaniteux hochet de leur esprit. Cathos et Madelon n’étaient que bêtes et ridicules. Nos bas-bleus sont dangereuses, cyniques, flétries de vanité : elles débordent de fiel, de colère et d’envie. Mais toutes les femmes qui écrivent ne sont pas des bas-bleus, – heureusement, – et M. d’Aurevilly épargne du moins cette angélique Eugénie de Guérin, qui peut n’être pas du goût de tout le monde, mais qui, du moins, n’a pas de tache d’encre aux doigts.
Le bas-bleu, c’est madame George Sand, s’inspirant de Pierre Leroux, d’Agricol Perdiguier, d’Alfred de Musset, de beaucoup d’autres, hélas ! et se noyant, la triste déclassée, dans les flots de sa vie, qui découlèrent de ces lamentables romans ; Elle et Lui, Lui et Elle.
Que d’Elle, que de Lui se seraient reconnus dans ces pages effrayantes, où sont remués tant d’infâmes souvenirs, tant de douleurs honteuses, tant d’hypocrites repentirs et tant de larmes viles ! Voilà où le bas-bleu est odieux ; c’est quand il salit une grande gloire, en montrant celui qui mérita cette gloire abaissé au niveau des pécheurs. Madame George Sand vilipendant Musset, madame de Saman diffamant l’auteur des Martyrs,





























