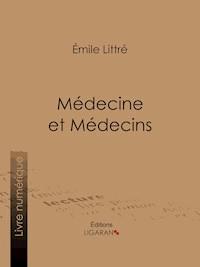
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Extrait : "Parmi les maladies, il en est qui sont aussi individuelles que les plaies et les fractures, et qui se remarquent dans tous les temps et dans tous les lieux ; il en d'autres qui sont spéciales à certaines contrées, sans qu'il soit possible d'expliquer par quel concours de circonstances locales elles naissent dans tel district, et pourquoi elles n'en sortent pas."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À LA MÉMOIRE DE M. LE DOCTEUR RAYER DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES ET DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE.
Une amitié de près de quarante ans nous a unis ; elle commença, moi humble étudiant, lui médecin déjà renommé ; elle a duré inaltérable, quelque diverses qu’aient été nos fortunes. Je survis ; mais je n’ai pas oublié.
Ceci, comme l’Histoire de la langue française et les Études sur les barbares et le Moyen Âge, est derechef ce que j’appelle un demi-livre, c’est-à-dire un recueil de fragments traitant d’un seul et unique objet. Le présent volume est consacré à la médecine. Mon intention est bien de ne pas clore cette courte préface sans indiquer brièvement quelles sont les idées générales qui ont inspiré et dirigé chacun des morceaux particuliers. Mon intention n’est pas, non plus, de la borner à cela ; et par une impulsion qui me vient au moment où je tiens la plume, et à laquelle je me laisse aller, je commence par une causerie, comme fait un vieillard qui, n’ayant plus que peu d’heures devant lui, les emploie à jeter un regard sur son passé.
J’ai beaucoup écrit sur la médecine : articles de journaux, articles de dictionnaires, monographie sur le choléra, édition d’Hippocrate ; j’ai vécu dix ans dans les hôpitaux comme externe, comme interne, comme disciple assidu à la visite de M. Rayer, et cependant je n’ai passé aucun examen, n’ai aucun titre médical, et ne suis pas docteur.
C’est une conduite bizarre, j’en conviens ; elle n’est pourtant pas sans explication. En 1827, j’avais mes seize inscriptions et me préparais à passer mes examens (il fallait alors avoir toutes ses inscriptions pour les passer), quand mon père mourut. Cet évènement que, pour me servir du langage du poète latin,
semper acerbum,
Semper honoratum, sic dii voluistis, habebo,
changea ma position, et m’obligea de pourvoir non seulement à ma subsistance, mais aussi à celle de ma mère, soin du reste que mon frère partagea avec moi. Alors je jugeai que l’avenir médical se fermait, et je n’eus pas la hardiesse de grever mon présent, en essayant de m’établir médecin, installation qui, à Paris, est toujours dispendieuse et toujours incertaine. Il est inutile de dire au lecteur ce que je devins ; mais, par une ténacité d’esprit qui m’a porté à ne pas vouloir perdre, en l’abandonnant, les fruits d’une étude commencée, je me mis, tout en gagnant ma vie, à suivre, en disciple bénévole, la clinique de M. Rayer à la Charité. Ce fut là que je me liai avec lui. Cette clinique était une excellente école : j’en profitai ; et de la sorte, tout en m’éloignant de la pratique ? je ne cessai de me rapprocher de la science.
Cette situation studieuse et précaire durait depuis quelque temps, lorsque M. Rayer, qui en fut, je ne sais comment, informé, m’offrit de m’avancer une somme d’argent pour me faire recevoir docteur. Très reconnaissant de cette offre spontanée et inattendue, je refusai. Un certain temps après, le libraire Hachette (nous avions été camarades de collège et nous étions excellents amis) me proposa de me faire, pendant quelques années, les fonds nécessaires pour mon installation médicale. Je refusai encore, par défiance de ne pouvoir rendre les sommes avancées, bien que, certainement, ni M. Rayer ni M. Hachette ne m’eussent, si je n’avais pu rendre, jamais rien redemandé.
C’est ainsi que, tout en me livrant studieusement à la médecine, je ne devins pas médecin. Les années passèrent ; pendant qu’elles passaient, je ne cessai de visiter le laboratoire de M. Rayer et de suivre ses travaux ; et, d’une autre part, je formai avec M. Hachette l’entreprise considérable du Dictionnaire de la langue française. Ce vieil ami n’en a pas vu la fin ; je la verrai peut-être ; peut-être… car qui, à soixante et onze ans tout à l’heure, peut se flatter de terminer quelque chose ?
Je viens de parler de camarades de collèges ; il y a aussi les camarades d’hôpitaux. Les jeunes gens qui arrivent à l’internat, triés par un examen, sont généralement studieux et désireux d’employer utilement les quatre années qui leur sont dévolues. On se lie, on étudie ensemble, on discute les cas et les méthodes, on juge les maîtres, et, la médecine offrant tant d’occasions de philosopher, on philosophe. C’est là que je contractai une intime amitié avec trois hommes, tous trois morts, et dont j’éprouve une douloureuse satisfaction à réunir ici autour de moi les souvenirs, Michon, Natalis Guillot et Costallat, de Bagnères de Bigorre ; l’un, capable d’écrire, mais plus désireux de faire, rangé pour son habileté et son savoir entre les premiers chirurgiens de Paris et se conciliant l’estime et l’attachement de tous par son honnête dévouement aux devoirs de sa profession ; l’autre, professeur distingué, esprit original, curieux de recherches anatomiques et pathologiques, et plein, pour tous ceux qui étaient autour de lui, d’un charme exquis ; le troisième, enfin, ardent au bien public, toujours en souci d’améliorer un service, d’être utile à sa ville, à ses concitoyens, et connu par ses travaux sur la pellagre et ses propositions, non encore essayées, de la supprimer absolument. Notre amitié, commencée dans les hôpitaux et à la salle de garde, a subi toutes les épreuves, même celle de la mort, et subsiste, dernier refuge, dans le cœur de celui qui va bientôt disparaître à son tour.
J’ai très peu pratiqué la médecine ; pourtant, dans mon village, pendant une vingtaine d’années, j’ai donné quelques soins aux paysans mes voisins. Prudent et suffisamment éclairé, je leur ai certainement été utile ; et, de cette utilité, j’ai obtenu la meilleure des récompenses dans leur reconnaissance, manifestée par un bon vouloir constant et, au besoin, par des services. Là aussi j’ai éprouvé, pour ma part, combien la médecine peut causer d’angoisses, quand, dans un cas grave où il va de la vie et de la mort, l’incertitude du diagnostic ou du traitement et la crainte de s’être trompé suscitent de cuisants regrets qui ressemblent à des remords. Il n’y a point de parité entre la responsabilité du médecin et son pouvoir ; l’une est grande, et l’autre est petit ; et c’est justement à cause des limites où ce pouvoir est resserré, que, bien qu’il soit trop facile d’en laisser perdre une parcelle, la moindre parcelle perdue cause une poignante anxiété.
Par un autre côté aussi, la pratique de la médecine est douloureuse, c’est par la prévision ; non pas pour soi, j’ai vu plus d’un médecin reconnaître en sa personne l’annonce d’un mal incurable et, longtemps à l’avance, se prononcer avec résignation l’arrêt de mort qu’un autre n’aurait connu qu’à toute extrémité ; non pas pour soi, mais pour de chères existences qu’un mal menaçant vient saisir. Prévoir alors est une torture épargnée à qui conserve longtemps un ignorant espoir ; mais les semaines, les mois, les années sont bien longs à celui qui ne peut les charmer par aucune illusion.
Malgré tout, et quoi que la médecine m’ait coûté, je ne voudrais pas qu’elle eût manqué à mon éducation générale. C’est, moralement et intellectuellement, une bonne école, sévère et rude, mais fortifiante. Moralement : je ne dirai pas que c’est un office secourable, car secourable aussi est l’office du paysan qui laboure le sol, du maçon qui taille la pierre, du forgeron qui bat le fer, et de tous les coopérateurs sociaux ; mais je dirai que, perpétuel témoin des souffrances et de la mort, elle inspire une profonde pitié pour la condition humaine. Intellectuellement : il est bon d’avoir vu l’amphithéâtre et l’hôpital, et de savoir par quel procédé organique la maladie se produit dans le corps vivant, quels troubles elle y cause, et comment elle vient à la guérison ou à la mort.
La médecine, au moment où j’en commençai l’étude, subissait dans sa doctrine un amendement considérable. Jusque-là, on avait considéré la pathologie comme un phénomène qui avait en soi sa raison d’être ; on entendait que la maladie, fièvre, inflammation, cancer, était quelque chose à existence indépendante et à lois propres. De la sorte, il n’existait aucune connexion entre l’état pathologique et l’état physiologique ; le premier était simplement superposé au second ; et l’on ne passait pas du second au premier. Cette manière de voir fut inévitable aussi longtemps que la physiologie n’était pas devenue positive ; mais elle le devint au commencement de ce siècle ; et, après l’intervalle de temps nécessaire pour que les grandes méthodes fassent subir leur influence, elle renouvela toute la doctrine médicale. Il fut établi qu’aucune loi nouvelle et particulière ne se manifeste dans la maladie ; que la pathologie n’est pas autre chose que de la physiologie dérangée, et que l’on passe de l’une à l’autre sans quitter un même domaine de phénomènes et d’actions. Rien n’a plus que cette notion essentielle contribué à l’affermissement et au progrès de la médecine.
Cette notion essentielle règne explicitement ou implicitement dans le présent volume. Aujourd’hui, grâce à une action latente de la philosophie qu’Auguste Comte a inaugurée, et qui est connue sous le nom de philosophie positive, de bons esprits ne se contentent plus d’être informés de la constitution intérieure d’une science ; ils demandent comment elle se rattache à la science totale ou générale. Il est de fait que cette même philosophie positive, que je viens de nommer, a seule le pouvoir de donner satisfaction à un tel désir. Je n’ai pas besoin de dire que la philosophie théologique ne s’occupe pas de pareilles questions, et qu’elle laisse flotter à leur gré les méthodes du savoir humain, sous la seule condition qu’il se soumette absolument à la foi. La philosophie métaphysique, de son côté, n’a fourni que des coordinations purement arbitraires et systématiques ; le lien y est toujours exclusivement subjectif ; et ce caractère subjectif lui ôte toute efficacité pour trouver la méthode générale de la science objective. Il n’en est pas de même de la philosophie positive ; et c’est justement en ce problème d’un ordre si élevé que se manifeste sa fonction essentielle. Pour elle, toute la science forme un long enchaînement où chaque science particulière a une place véritablement naturelle et absolument déterminée. À ce point de vue, la nature, la détermination d’une science gît dans le plus ou moins de complication qui lui appartient. La plus simple est la mathématique ; la plus compliquée est la sociologie. La physiologie, avec son annexe la médecine, précède la sociologie et succède à la chimie. Par le seul énoncé de sa place dans la hiérarchie, l’étudiant voit aussitôt qu’elle a besoin, pour se constituer, d’emprunter des lumières aux sciences inférieures ou moins compliquées et particulièrement à la chimie et à la physique, et qu’elle est d’un secours indispensable à la constitution de la sociologie. C’est cette lumière perpétuelle jetée sur les méthodes et les sciences particulières qui me rangea jadis sous la doctrine de la philosophie positive, et qui m’y retient.
Octobre 1871.
Parmi les maladies, il en est qui sont aussi individuelles que les plaies et les fractures, et qui se remarquent dans tous les temps et dans tous les lieux ; il en est d’autres qui sont spéciales à certaines contrées, sans qu’il soit possible d’expliquer par quel concours de circonstances locales elles naissent dans tel district, et pourquoi elles n’en sortent pas. Tel est le bouton d’Alep, qui attaque seulement les habitants de cette ville et les étrangers qui viennent y séjourner.
Enfin, une troisième classe de maladies a pour caractère d’envahir une immense étendue de pays ; et, ce qu’il y a de plus remarquable, c’est qu’elles n’ont pas une durée indéfinie ; je veux dire qu’elles ne sont pas aussi anciennes que les races humaines, que nos histoires en connaissent l’origine, que les unes sont déjà éteintes et ne sont pas arrivées jusqu’à nous, et que les autres, qui les remplacent, n’ont pas affligé nos aïeux et sont peut-être destinées à cesser à leur tour. Ce sont de grands et singuliers phénomènes. On voit parfois, lorsque les cités sont calmes et joyeuses, le sol s’ébranler tout à coup, et les édifices s’écrouler sur la tête des habitants ; de même il arrive qu’une influence mortelle sort soudainement de profondeurs inconnues et couche d’un souffle infatigable les populations humaines, comme les épis dans leurs sillons. Les causes sont ignorées, les effets terribles, le développement immense. Rien n’épouvante plus les hommes ; rien ne jette de si vives alarmes dans le cœur des nations ; rien n’excite dans le vulgaire de plus noirs soupçons. Il semble, quand la mortalité a pris ce courant rapide, que les ravages n’auront plus de terme, et que l’incendie, une fois allumé, ne s’éteindra désormais que faute d’aliments. Il n’en est pas ainsi ; les traits de l’invisible archer s’épuisent ; ces vastes épidémies restent toujours dans de certaines limites ; l’intensité n’en va jamais jusqu’à menacer d’une destruction universelle la race humaine. J’ai dit jamais, j’aurais dû dire dans l’intervalle des cinq ou six mille ans qui font toute notre histoire, ou, si l’on veut, des quelques milliers de siècles où figure l’homme préhistorique ; car qui peut répondre de ce que renferme l’avenir ? Des races d’animaux ont disparu du globe ; les découvertes de Cuvier sur les fossiles l’ont prouvé sans réplique. La pathologie a-t-elle joué quelque rôle dans ces extinctions ?
Les maladies universelles ont tout l’intérêt des grands évènements ; le médecin en étudie les symptômes et les rapports avec d’autres maladies, et cherche en même temps à entrevoir la place qu’elles occupent dans l’enchaînement des choses du monde, et le lien par lequel les existences humaines et la planète qui les porte semblent tenir ensemble.
Dans le cadre des influences considérables qui ont agi sur les destins des sociétés, il faut faire entrer, quelque étrange que cela puisse paraître au premier coup d’œil, la pathologie, ou, pour mieux dire, cette portion de la pathologie qui traite des vastes et universelles épidémies. Que sont vingt batailles, que sont vingt ans de la guerre la plus acharnée, à côté des ravages que causent ces immenses fléaux ? Le choléra a fait périr en peu d’années autant d’hommes que toutes les guerres de la révolution ; on compte que la peste noire du quatorzième siècle enleva à l’Europe seule vingt-cinq millions d’individus ; la maladie qui dévasta le monde, sous le règne de Justinien, fut encore plus meurtrière. En outre, nulle guerre n’a l’universalité d’une épidémie. Que comparer, pour prendre un exemple bien connu de nous, au choléra, qui, né dans l’Inde, a passé à l’est jusqu’en Chine, s’est porté à l’ouest en Europe, l’a parcourue dans presque toutes ses parties, et est allé jusqu’en Amérique ?
La première grande maladie dont l’histoire fasse mention est celle que l’on connaît sous le nom de peste d’Athènes, et dont Thucydide a donné une description célèbre. On se trompe grandement, lorsqu’on pense que la maladie fut bornée à la capitale même de l’Attique, et causée par l’encombrement des habitants qui s’y étaient réfugiés pendant l’invasion de l’armée lacédémonienne. Ce fléau venait de l’Orient, Thucydide dit qu’il était parti de l’Éthiopie et qu’il avait parcouru l’Égypte et la Perse ; les lettres d’Hippocrate, bien que supposées, attestent néanmoins les ravages qu’il exerça dans le reste de la Grèce, et les historiens en signalent l’apparition dans des troupes occupées à faire le siège de quelques villes de la Thrace. S’il est impossible de le suivre en Italie ou dans les Gaules, c’est que, à une époque aussi reculée que celle de la guerre du Péloponèse, les écrivains manquent en Occident partout ailleurs que dans la Grèce. On n’avait pas conservé le souvenir d’une pareille destruction d’hommes ; les médecins ne suffisaient pas à soigner les malades, et d’ailleurs ils furent surtout atteints par l’épidémie. Le mal se déclara d’abord dans le Pirée, et les habitants commencèrent par dire que les Péloponésiens avaient empoisonné les fontaines ; c’est ainsi que les Parisiens dirent, en 1832, que des misérables empoisonnaient la viande chez les bouchers et l’eau dans les fontaines. Puis l’épidémie gagna la ville avec un redoublement de fureur.
L’invasion était subite : d’abord la tête était prise d’une chaleur ardente, les yeux rougissaient et s’enflammaient, la langue et la gorge devenaient sanglantes ; il survenait des éternuements et de l’enrouement. Bientôt après, l’affection gagnait la poitrine et produisait une toux violente ; puis, lorsqu’elle était fixée sur l’estomac, il en résultait des vomissements, avec des angoisses extrêmes, des hoquets fréquents et de violents spasmes ; la peau n’était, au toucher, ni très chaude, ni jaune ; elle était légèrement rouge, livide et couverte de petits boutons vésiculeux et d’ulcérations. Mais la chaleur interne était si grande, que les malades ne pouvaient supporter aucun vêtement ; ils voulaient rester nus, et plusieurs, tourmentés par une soif inextinguible, allaient se précipiter dans les puits. La mort survenait vers le septième ou le neuvième jour ; plusieurs perdaient les mains ou les pieds par la gangrène ; d’autres, les yeux ; quelques autres éprouvaient une abolition complète de mémoire, et ne se connaissaient plus ni eux ni leurs proches.
Dans ce tableau, et quand on examine attentivement les détails et l’ensemble, il est impossible de retrouver aucune des maladies qui nous affligent maintenant. La peste d’Athènes est une des affections aujourd’hui éteintes.
Mais cette grande fièvre épidémique ne se montra pas une première fois, pour ne plus jamais reparaître ; on la retrouve dans les siècles postérieurs avec les mêmes caractères d’universalité et de gravité, qui avaient épouvanté la Grèce. Le règne de Marc-Aurèle, entre autres, fut signalé par un des retours de cette meurtrière maladie. Cette fois les relations historiques en indiquent le développement sur presque tous les points de l’empire romain. L’Orient encore fut le point de départ. C’est au siège de Séleucie qu’elle commença à infecter l’armée romaine ; partout où se porta le cortège de Lucius Verus, frère de l’empereur Marc-Aurèle, elle se déclara avec une nouvelle violence, et quand les deux frères entrèrent en triomphateurs dans la ville de Rome, le mal s’y développa avec une telle intensité, qu’il fallut renoncer aux enterrements habituels, et emporter les corps par charretées. En peu de temps la fièvre épidémique était arrivée des bords du Tigre jusqu’aux Alpes, et de là, franchissant ces montagnes, elle pénétra dans les Gaules et même au-delà du Rhin. Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans une explication purement médicale des symptômes que présentait la peste d’Athènes, reproduite si souvent dans les siècles qui suivirent ; je me contenterai de faire observer que cette fièvre était une fièvre éruptive, c’est-à-dire qu’elle se manifestait au dehors, comme la variole ou la rougeole, par une éruption caractéristique.
On trouve, dans les anciens auteurs, la description d’une maladie particulière qu’ils désignent sous le nom de maladie cardiaque (morbus cardiacus). On la nommait aussi diaphorèse, à cause de l’excessive sueur qui l’accompagnait. Les écrits d’Hippocrate n’en présentent aucune trace. Après Galien, le souvenir s’en efface de plus en plus, de sorte que cette maladie a dû naître sous les successeurs d’Alexandre, et cesser vers le second siècle de l’ère chrétienne.
Elle commençait par un sentiment de froid et de stupeur dans les membres et parfois dans tout le corps ; le pouls, prenant aussitôt le plus mauvais caractère, devenait petit, faible, vide, fréquent, plus tard, inégal et tremblotant, et il disparaissait même entièrement ; en même temps, les sens des malades se troublaient, une insomnie invincible les dominait, ils désespéraient de leur guérison, et, dans la plupart des cas, le corps tout entier ruisselait soudainement d’une sueur qui coulait par torrents dans le lit, de sorte que les malades semblaient se fondre ; la respiration était courte et pressée jusqu’à la syncope ; à chaque instant, ils craignaient d’étouffer ; dans leur anxiété, ils se jetaient çà et là, et d’une voix très faible et tremblante ils prononçaient quelques mots entrecoupés ; ils éprouvaient continuellement, au côté gauche ou même dans toute la poitrine, une intolérable oppression ; et, dans les accès qui commençaient par une syncope ou qui en étaient suivis, le cœur palpitait violemment, le visage prenait la pâleur de la mort, les yeux s’enfonçaient dans les orbites ; et, si la terminaison devait être fatale, la vue des malades s’obscurcissait de plus en plus, les mains et les pieds se coloraient eu bleu, le cœur, malgré le refroidissement de tout le corps, continuait à palpiter violemment ; la plupart conservaient leur raison jusqu’au bout, peu seulement en perdaient l’usage avant la mort. Enfin, les mains restaient froides, les ongles se courbaient, la peau se ridait, et les malades expiraient sans aucun relâchement dans leur souffrance. On reconnaît, dans ce tableau, beaucoup d’analogies avec la suette anglaise, qui a régné dans les quinzième et seizième siècles, et dont je parlerai plus loin.
Je n’ai pas la prétention de faire un tableau complet de tout ce que l’antiquité nous a laissé sur plusieurs autres maladies qui ont eu jadis un tout autre développement que de nos jours ; j’ai voulu seulement prendre deux exemples saillants d’affections considérables, mais éteintes ; et en rappelant la peste d’Athènes et la maladie cardiaque, qui sont sans analogues parmi nous, j’ai voulu inculquer cette vérité que les maladies changent avec les siècles, qu’une loi inconnue préside à la succession de pareils phénomènes dans la vie de l’humanité, et qu’ils sont dignes de toute l’attention, aussi bien du médecin que du philosophe et de l’historien. Mais on se tromperait, si l’on pensait que cette extinction d’un fléau épidémique est, si je puis m’exprimer ainsi, un don gratuit de la nature. Les races humaines, en laissant derrière elles une forme de maladies, ne tardent pas à en rencontrer une nouvelle sur leur chemin.
Au moment où ce typhus qui avait désolé l’antiquité quittait les hommes par une cause ignorée, un nouveau fléau vint le remplacer : la peste d’Orient, celle qui règne encore de nos jours en Égypte, et qui est caractérisée par l’éruption de bubons. Bien que, d’après le témoignage d’anciens auteurs conservé par Oribase, la peste ait existé dans l’antiquité en Égypte et en Syrie, cependant les historiens ni les médecins ne font aucune mention d’une grande épidémie de peste, et c’est sous le règne de Justinien que le mal prit pour la première fois le caractère pandémique. Rien ne fut plus épouvantable que les ravages qu’il causa dans le monde.
Naturellement il vint d’Orient, et se répandit vers l’Occident avec une extrême rapidité ; partout il dépeupla les villes et les campagnes, et certains historiens ont estimé à cent millions le nombre des hommes qu’il enleva. Cette maladie était signalée par les bubons pestilentiels, tels que ceux qu’on observe en Orient ; et, depuis le temps de Justinien, la peste n’a cessé de se montrer d’intervalles en intervalles dans différents pays. Durant une certaine époque, elle fut aussi commune en Europe qu’elle l’est aujourd’hui en Égypte. Paris ou Londres en étaient alors aussi souvent ravagés que l’est aujourd’hui Constantinople ou le Caire ; mais depuis assez longtemps elle a cessé de se montrer parmi nous. La peste de Marseille est le dernier exemple pour la France. Moscou et une grande partie de la Russie en ont horriblement souffert vers le milieu du siècle dernier, et aujourd’hui l’Autriche défend contre elle les villages croates qui sont limitrophes de l’empire ottoman.
De grands renseignements sur cette affreuse épidémie sont donnés par l’historien Procope. J’aime mieux réunir ici quelques détails moins connus sur les malheurs qu’elle causa dans notre Occident.
Dès l’an 540 après Jésus-Christ, la peste était arrivée à Paris. On lit dans le Livre des miracles de saint Jean : « Tandis que la peste ravageait les peuples de notre patrie, je sentis, à mon départ de Paris, où elle régnait alors, que la contagion du mal me gagna. Nul n’ignore, je pense, quelle épouvantable maladie dévasta à cette époque notre pays. »
Les historiens occidentaux du temps font souvent mention de cette maladie. Marseille en fut infectée violemment en 588. Un navire arriva de la côte d’Espagne avec des marchandises. Plusieurs citoyens ayant fait des achats, une famille, composée de huit membres, périt subitement. Le mal ne se propagea pas tout d’abord dans le reste de la ville ; mais il se passa un certain intervalle comme quand le feu couve quelque temps dans une maison ; puis tout à coup l’incendie s’étendit sur Marseille toute entière. L’évêque Théodore se tint pendant tout le temps de l’épidémie dans l’enceinte de la basilique de Saint-Victor, se livrant aux veillées et aux prières et implorant la miséricorde divine. La peste ayant enfin cessé en deux mois, le peuple, plein de sécurité, revint dans la ville ; mais il y eut une recrudescence et ceux qui étaient revenus périrent. Depuis ce temps, la peste fit plusieurs apparitions à Marseille.
Dans ce tableau tracé par Grégoire de Tours, on croirait lire une description moderne d’une invasion de la peste à Alexandrie ou à Smyrne.
À peu près vers la même date, la peste ravageait Rome ; le pape Pélage en fut la première victime, et un témoin oculaire rapporta à Grégoire de Tours avoir vu tomber, durant une supplication publique, en une heure de temps, quatre-vingts personnes qui expirèrent immédiatement.
À Clermont, en 571, le même auteur vit, un certain dimanche, dans la seule basilique de Saint-Pierre, trois cents corps de personnes mortes de la peste. Il se formait dans les aines ou dans les aisselles une plaie, et les malades succombaient en deux ou trois jours.
À peu près à l’époque où la peste d’Orient faisait sa première apparition dans l’Europe, on y vit aussi se développer une maladie non moins terrible et qui dure encore, quoique singulièrement affaiblie par les découvertes de la médecine moderne : je veux parler de la variole ou petite vérole.
Déjà nommée par Marius, évêque d’Avenches, dans la chronique de l’année 570, elle est décrite d’une manière très distincte par Grégoire de Tours, sous le nom de maladie dysentérique (morbus dysentericus), de peste valétudinaire (lues valetudinaria). Dans la description suivante qu’il en donne, liv. IV, à l’année 580, aucun médecin ne méconnaîtra la petite vérole : « La maladie dysentérique envahit presque toutes les Gaules. Ceux qu’elle attaquait étaient pris d’une forte fièvre avec des vomissements, d’une douleur excessive dans les reins, et de pesanteur de tête ; puis survenaient des pustules. Des ventouses appliquées aux épaules ou aux cuisses, procurant l’écoulement d’une grande quantité d’humeur avec le développement et l’éruption des boutons, sauvèrent beaucoup de malades ; de même, les herbes qui servent de contrepoison, prises en boisson, rendirent de grands services. Cette maladie, commencée au mois d’août, attaqua surtout les jeunes enfants. Le roi Chilpéric en fut atteint, et bientôt après le plus jeune de ses fils, qui venait d’être baptisé, la contracta ; enfin le frère aîné de celui-là, nommé Chlodobert, la gagna à son tour. » Frédégonde fut plongée dans la douleur à la vue de ses enfants malades, et, accusant de leur danger les vexations qu’avaient souffertes les peuples sous son gouvernement et sous celui de son mari, elle jeta dans le feu les registres de nouvelles taxes qui venaient d’être imposées. Ce qui n’empêcha pas ses enfants de mourir peu de temps après.
C’est donc tout à fait à tort qu’on rapporte ordinairement l’invasion de la petite vérole à l’irruption des Arabes dans l’Occident. Cette maladie s’établit dans nos contrées vers la fin du sixième siècle de l’ère chrétienne ; elle est à peu près contemporaine des pandémies de peste d’Orient.
Le Moyen Âge fut plus qu’aucune autre époque en proie à des calamités de ce genre. Certaines maladies, déjà connues de l’antiquité, prirent un effroyable développement. Tel fut l’éléphantiasis, connu vulgairement sous le nom de lèpre, et qui fit, pendant plusieurs siècles le désespoir de nos populations occidentales. Sans entrer dans le détail de toutes les souffrances corporelles de nos aïeux, je vais en rappeler quelques-unes au souvenir du lecteur.
Le mal des ardents se présente d’abord avec des caractères effrayants, et qui ne sont pas en contraste avec la sombre et rude époque où il se développa. Le plus ancien monument qui en fasse mention, est la chronique de Frodoard pour l’année 945.
« Quantité de monde, tant à Paris qu’en province, périt d’une maladie appelée le feu sacré ou les ardents. Ce mal les brûlait petit à petit, et enfin les consumait sans qu’on y pût remédier. Pour éviter ce mal ou pour en guérir, ceux de Paris quittaient la ville pour prendre l’air des champs et ceux de la campagne se réfugiaient dans Paris. Hugues le Grand fit alors éclater sa charité, en nourrissant tous les pauvres malades, quoique parfois il s’en trouvât plus de six cents. Comme tous les remèdes ne servaient à rien, on eut recours à la Vierge dans l’église Notre-Dame, qui, dans cette occasion, servit longtemps d’hôpital. »
Les auteurs ne font d’ailleurs mention d’aucune circonstance particulière relative aux aliments, à l’air ou aux eaux. On sait seulement que cela arriva dans le temps que ce Hugues, comte de Paris, faisait la guerre à Louis à Outremer, et après les courses des Normands, qui avaient plusieurs fois pillé et saccagé le territoire de Paris.
C’est à la même époque que Félibien rapporte une ancienne charte de l’église de Paris, par laquelle on établit qu’on allumerait six lampes toutes les nuits devant l’autel de la Vierge, en mémoire de cet évènement.
Rodulphus Glaber, dans son livre des Histoires, II, a un chapitre intitulé De incendiis et mortibus nobilium, où il rapporte qu’en 993, il régnait une mortalité parmi les hommes (clades pessima). C’était, dit-il, un feu caché, qui, dès qu’il avait atteint quelque membre, le détachait du corps après l’avoir brûlé. Plusieurs éprouvèrent l’effet de ce feu dans l’espace d’une nuit.
Depuis la fin du onzième siècle, c’est-à-dire depuis 1090 jusqu’au commencement du douzième, on observa en France les plus fortes attaques de cette maladie. On sait que c’était le temps de la plus grande ferveur pour les croisades ; qu’on abandonnait tout pour aller se signaler dans la Terre-Sainte ; que les guerres féodales continuelles et les courses des ducs de Normandie rendaient la partie septentrionale et la partie moyenne de la France le théâtre d’une infinité de misères de toute espèce, parmi lesquelles le mal dont il est question était peut-être un des moindres. La France se dépeuplait sensiblement ; les champs, l’agriculture, étaient abandonnés. Presque toute la France, le Dauphiné principalement, se ressentit de la maladie dont on parle : c’est ce qui détermina le pape Urbain II à fonder l’ordre religieux de Saint-Antoine, dans la vue de secourir ceux qui en étaient atteints, et à choisir Vienne en Dauphiné pour le chef-lieu de cet ordre. Cette fondation eut lieu l’an 1093. Vingt-cinq ans avant, le corps du saint de ce nom avait été transporté de Constantinople en Dauphiné, par Josselin, seigneur de la Mothe-Saint-Didier.
On croyait généralement, dans le onzième et le douzième siècle, que les malades que l’on conduisait à l’abbaye Saint-Antoine, où reposent les cendres de ce saint, étaient guéris dans l’espace de sept ou neuf jours. Ce bruit, répandu en Europe, attirait à Vienne un grand nombre de malades, dont la plupart y laissaient quelque membre. On trouve dans l’histoire des ordres monastiques qu’en 1702 on voyait encore dans cette abbaye des membres desséchés et noirs, que l’on conservait depuis ce temps.
L’auteur de la Vie d’Hugues, évêque de Lincoln, dit qu’il vit de son temps, au Mont-Saint-Antoine, en Dauphiné, plusieurs personnes de l’un et de l’autre sexe, des jeunes et des vieux, guéris du feu sacré, et qui paraissaient jouir de la meilleure santé, quoique leurs chairs eussent été, en partie, brûlées et leurs os consumés ; qu’il accourait de toutes parts en cet endroit des malades de cette espèce, qui se trouvaient tous guéris dans l’espace de sept jours ; que, si au bout de ce temps ils ne l’étaient pas, ils mouraient ; que la peau, la chair et les os des membres qui avaient été atteints de ce mal ne se rétablissaient jamais, mais que les parties qui en avaient été épargnées restaient parfaitement saines, avec des cicatrices si bien consolidées, qu’on voyait des gens de tout âge et de tout sexe, les uns privés de l’avant-bras jusqu’au coude, d’autres de tout le bras jusqu’à l’épaule, enfin d’autres privés d’une jambe ou de la jambe et de la cuisse jusqu’à l’aine, jouir de la santé et de la gaieté de ceux qui se portent le mieux.
Quand on voit survenir ainsi de temps en temps des maladies nouvelles, il semble que les peuples, occupés au mouvement et au progrès de leur vie, soulèvent, sans le savoir, des agents hostiles et funestes qui leur apportent la mort et la désolation. Les peuples, dans leur sourd et aveugle travail de développement, sont comme les mineurs qui, poursuivant le filon qu’ils sont chargés d’exploiter, tantôt déchaînent les eaux souterraines qui les noient, tantôt ouvrent un passage aux gaz méphitiques qui les asphyxient ou les brûlent, et tantôt enfin provoquent les éboulements de terrain qui les ensevelissent sous leurs décombres.
Une épidémie dont l’universalité et les caractères rappelèrent celle qui avait ravagé le monde sous Justinien, épouvanta le quatorzième siècle et laissa un long souvenir parmi les hommes. Cette maladie fut une véritable peste, dans le sens médical du mot, c’est-à-dire une affection signalée par des tumeurs gangréneuses dans les aisselles et dans les aines. On lui donna dans le temps le nom de peste noire, parce qu’elle couvrait le corps de taches livides ; en Italie, celui de mortalité grande (mortalega grande), à cause des ravages inouïs qu’elle exerça partout où elle se montra. L’historien impérial Cantacuzène, dont le fils Andronique succomba à cette maladie, décrit littéralement ces tumeurs propres à la peste ; il en signale de plus petites qui apparaissaient sur les bras, le visage et d’autres parties. Chez plusieurs, il se développait, sur tout le corps, des taches noires qui restaient isolées ou qui se réunissaient et devenaient confluentes. Ces accidents ne se trouvaient pas rassemblés sur tous ; chez quelques-uns, un seul suffisait pour produire la mort ; quelques-uns, atteints de tous ces symptômes, guérissaient contre tout espoir. Les accidents cérébraux étaient fréquents ; plusieurs malades tombaient dans la stupeur et un sommeil profond ; ils perdaient aussi la parole ; d’autres étaient en proie à l’insomnie et à une extrême anxiété. La langue et la gorge devenaient noires et comme teintes de sang ; aucune boisson n’étanchait la soif, et les souffrances duraient ainsi sans adoucissement jusqu’à la mort, que plusieurs hâtaient dans leur désespoir. La contagion était manifeste, car ceux qui soignaient leurs parents et leurs amis tombaient malades, et plusieurs maisons, dans la capitale de l’empire grec, perdirent tous leurs habitants jusqu’au dernier.
Jusque-là, nous ne voyons que les accidents de la peste ordinaire ; mais, dans cette peste du quatorzième siècle, il se joignit un symptôme particulier, ce fut l’inflammation gangréneuse des organes de la respiration : une violente douleur saisissait les malades dans la poitrine, ils crachaient du sang, et leur haleine répandait une odeur empestée.
Quelque inconnue que soit la cause qui produit dans les organisations humaines des désordres aussi multipliés et aussi profonds, ils ont quelque chose de matériel et de physique qui prouve que le corps est particulièrement attaqué par le mal. Mais il est aussi des affections moins grossières, si je puis m’exprimer ainsi, dont l’action se porte sur l’intelligence et engendre épidémiquement les altérations mentales les plus singulières. Le Moyen Âge a été remarquable par plusieurs affections de ce genre ; les unes propagées surtout par l’imitation, les autres développées sous l’influence des idées qui prédominaient parmi les hommes. J’emprunte à M. Hecker, que j’ai mis à contribution dans les pages précédentes, les détails sur la maladie qu’il a appelée la chorée ou danse de Saint-Guy épidémique, et qui était caractérisée par un besoin irrésistible de se livrer à des sauts et à des mouvements désordonnés.
Ces phénomènes laissent pénétrer profondément le regard dans le domaine moral de la société humaine ; ils appartiennent à l’histoire, et ne se reproduiront jamais tels qu’ils furent ; mais ils révèlent un endroit vulnérable de l’homme, le penchant à l’imitation, et tiennent par conséquent de très près à la vie sociale. De telles maladies se propagent avec la rapidité de la pensée, et elles sont placées entre les pestes qui, d’une origine plus grossière, attaquent plus le corps que l’âme, et les passions qui, flottant sur les limites de la maladie, sont toujours près de les franchir.
Voici ce qu’était la danse de Saint-Guy : des bandes d’hommes et de femmes, réunis par un égarement commun, se répandaient dans les rues et les églises, où ils donnaient un spectacle singulier. Ils formaient des cercles en se tenant par la main ; et, en apparence hors d’eux-mêmes, ils dansaient avec fureur, sans honte, devant les assistants, jusqu’à ce qu’ils tombassent épuisés. Alors ils se plaignaient d’une grande angoisse, et ne cessaient de gémir que lorsqu’on leur serrait fortement le ventre avec des linges ; ils revenaient à eux et restaient tranquilles jusqu’à un nouvel accès. Cette constriction de l’abdomen avait pour but de prévenir le gonflement qui se développait après ces terribles convulsions ; on obtenait aussi parfois le même résultat à l’aide de coups de pied et de coups de poing. Pendant la danse convulsive, ils ne voyaient pas, n’entendaient pas ; les uns avaient des apparitions de démons, les autres apercevaient des anges et l’empyrée. Quand la maladie était complètement développée, l’accès débutait souvent par des convulsions épileptiques ; les malades tombaient sans connaissance et écumants, puis ils se relevaient et commençaient leur danse forcenée. La couleur rouge avait la propriété de les irriter et d’augmenter la violence de leurs accès. Il en était de même des sons d’une musique bruyante, avec laquelle on les accompagnait dans plusieurs villes, et qui paraît avoir plusieurs fois provoqué l’explosion de la maladie chez des spectateurs. Un moyen qu’on employait souvent pour abréger leur accès, était de placer devant eux des bancs et des sièges, qui les obligeaient à faire des bonds prodigieux, et ils tombaient promptement épuisés de fatigue.
Cette maladie singulière a fait son apparition en Allemagne vers 1374, lorsqu’à peine avaient cessé les dernières atteintes de la peste noire ; et il ne faut pas croire qu’elle n’attaquât que quelques individus. Elle frappait du même vertige des masses considérables, et il se formait des bandes de plusieurs centaines, quelquefois de plusieurs milliers de convulsionnaires qui allaient de ville en ville, étalant le spectacle de leur danse désordonnée. Leur apparition répandait le mal, qui se propageait ainsi de proche en proche.
Le tarentisme est une maladie analogue qui a régné en Italie pendant plusieurs siècles, et qui, comme la danse épidémique de Saint-Guy, a disparu, au moins dans sa forme primitive. C’est dans la Pouille qu’elle a pris naissance, mais de là elle s’est propagée sur presque toute la péninsule. Dans ce pays, on l’attribua à la morsure d’une araignée appelée tarentule ; mais la morsure venimeuse d’une araignée, et surtout les terreurs qui s’ensuivaient, n’étaient que la cause occasionnelle d’une maladie nerveuse qui apparaissait aussi en Allemagne avec des symptômes peu différents, et qui avait une cause profonde dans la condition des peuples.
Les personnes qui avaient été ou qui se croyaient mordues par la tarentule tombaient dans la tristesse, et, saisies de stupeur, elles n’étaient plus en possession de leur intelligence ; la flûte ou la guitare pouvait seule les secourir. Alors elles s’éveillaient comme d’un enchantement, les yeux s’ouvraient, et leurs mouvements, qui suivaient lentement la musique, s’animaient bientôt et devenaient une danse passionnée. C’était une chose fâcheuse que d’interrompre la musique ; les malades retombaient dans leur stupeur ; il fallait la continuer jusqu’à ce qu’ils fussent complètement épuisés de fatigue. Un phénomène remarquable chez les malades, c’était leur désir de la mer ; ils demandaient qu’on les portât sur ses rivages, ou au moins qu’on les entourât de l’image de l’eau ; grande opposition avec cette autre redoutable maladie nerveuse : la rage.
On trouve dans plusieurs médecins grecs, et entre autres dans Marcellus de Sida, qui vivait sous Adrien et Antonin, la description d’une singulière maladie nerveuse. Voici le tableau qu’en trace Oribase, médecin de l’empereur Julien : « Ceux qui sont atteints de ce mal sortent de chez eux pendant les heures de nuit ; ils imitent les allures du loup en toute chose et errent jusqu’au lever du soleil autour des tombeaux. Il est facile de les reconnaître ; ils sont pâles, ils ont les yeux ternes, secs et enfoncés dans leurs orbites ; la langue est très sèche, ils n’ont point de salive dans la bouche et la soif les dévore ; leurs jambes, attendu qu’ils font de fréquentes chutes dans la nuit, sont couvertes d’ulcères incurables. » Les médecins grecs appelèrent ces malades lycanthropes, et le vulgaire, dans nos contrées, les désigna sous le nom de loups-garous. Ils pullulèrent, en effet, dans le Moyen Âge ; et ces individus qu’une étrange perversion des facultés intellectuelles portait à fuir dans les lieux déserts, à errer la nuit, souvent à marcher à quatre pattes, et même à se livrer à d’horribles appétits ; ces individus qu’une superstition non moins étrange plaçait sous l’influence des démons, ont été nombreux à certaines époques. Il est des temps où il s’établit une réaction entre les opinions régnantes et certaines altérations mentales, et où celles-ci se multiplient d’autant plus qu’on les croit plus communes. Les hommes qui étaient sous l’influence de mauvaises dispositions et d’un dérangement prochain, et qui n’entendaient parler autour d’eux que de ces transformations d’êtres humains en bêtes sauvages, tombaient soudainement atteints du mal qui régnait, et allaient grossir la foule de ces malheureux fous qui se croyaient réellement changés en loups. Ce Léger de Versailles, qui tout récemment s’est enfui dans les bois, y a vécu plusieurs mois solitaire et a fini par y assassiner une petite fille et la dévorer en partie, était atteint d’une aliénation toute semblable, et aurait passé jadis pour un loup-garou.
On rangera dans la même catégorie les sorciers qui ont tant occupé les hommes, il y a quelques siècles. La plupart n’étaient ni des scélérats en communication avec le diable, comme le pensaient les juges aveugles qui les condamnaient, ni des imposteurs qui essayaient de tromper le vulgaire, comme on est de nos jours porté à le croire ; c’étaient des fous que l’on nomme, en langage technique, hallucinés. Ils croyaient voir le diable, lui parler, être transportés au sabbat, danser sur la bruyère avec les démons et les sorcières. Toutes ces choses, ils les racontaient de la meilleure foi du monde, ils les soutenaient au milieu des tortures et des supplices ; ils assuraient, quoique chargés de fers et renfermés dans des prisons d’où ils ne pouvaient sortir, être allés chaque nuit à leurs rendez-vous nocturnes. Tout cela était faux ; ils l’affirmaient cependant et mouraient en l’affirmant. C’est qu’en effet ces visions avaient pour eux toute la réalité que les visions ont pour les fous. La sorcellerie fut une véritable et longue hallucination qui, pendant plusieurs siècles, affligea l’humanité ; et l’on peut dire qu’elle fut doublement une source de maux, d’abord en pervertissant les facultés intellectuelles d’un grand nombre d’hommes, et secondement en provoquant, de la part de la société contemporaine, les plus atroces persécutions contre des malheureux qui avaient besoin d’un traitement médical, et qu’on livrait partout aux tortures et aux bûchers.
Il faut encore faire mention d’une maladie singulière qui s’empara de quelques enfants en 1458. Elle appartient bien plus, par son caractère, à la grande époque des croisades qu’à la dernière moitié du quinzième siècle. En cette année les enfants, sur plusieurs points de l’Allemagne, furent saisis d’un tel désir d’aller en pèlerinage et en troupe au mont Saint-Michel de Normandie, que ceux à qui l’on refusait la permission d’accomplir le voyage mouraient infailliblement de dépit et de douleur. On n’empêcha pas en conséquence ces enfants de Saint-Michel, comme on les appelait, de suivre l’irrésistible penchant qui les entraînait vers un rocher lointain, et l’on s’occupa de leur procurer les moyens de faire la route. D’Ellwangen, de Schwabisch-Hall et d’autres lieux, il en partit plusieurs centaines. À Hall, on leur donna un pédagogue et un âne pour porter les malades. La bande alla jusqu’aux rivages de la mer, où elle attendit le temps du reflux pour arriver de pied sec au lieu désiré. Ces malheureux pèlerins ne trouvèrent pas, en France, des sentiments analogues à ceux qui les avaient conduits si loin, et ils essuyèrent toutes sortes de malheurs. Une vieille chronique allemande dit, dans son langage simple et naïf : « Plusieurs moururent de faim, plusieurs moururent de froid, quelques-uns furent pris en France et vendus ; aucun n’est jamais revenu. »
Il est difficile de ne pas reconnaître dans ces maladies nerveuses une influence des idées religieuses qui prédominaient à cette époque. Les esprits, entretenus dans des croyances mystiques, entourés de visions, de prodiges, de saints et de sorciers, s’ébranlaient facilement, et la moindre circonstance tournait vers la maladie des cerveaux déjà enclins aux émotions surnaturelles. Les hommes, à en juger par leur conduite depuis les croisades jusqu’aux pèlerinages des enfants, se livraient, dans la simplicité de leurs besoins, de leurs connaissances et de leurs ressources, à leurs impulsions tout autrement que nous, et ils essayaient leurs forces, encore mal réglées par la civilisation, d’une façon si différente de la nôtre, que ces manifestations paraissent étranges à l’âge actuel. Les convulsionnaires du siècle dernier étaient atteints d’une maladie nerveuse incontestable, et les camp-meetings des Américains, assemblées où l’on se livre à mille extravagances religieuses, sont sur cette étroite limite où la raison est bien voisine de la folie. Mais le siècle actuel favorise peu par ses opinions le développement d’affections qui restent bien plus isolées que dans des siècles plus crédules.
Entre les grandes maladies qui déciment de temps en temps les peuples, il est une importante distinction à faire. C’est celle qui sépare les maladies que l’on peut produire artificiellement de celles qui naissent par les seules forces de la nature, et que nulle combinaison des circonstances à notre disposition ne peut engendrer. Je m’explique : le scorbut, par exemple, est une maladie que l’on peut produire à volonté. Que l’on enferme un équipage nombreux dans un bâtiment malpropre, humide, où toutes les précautions d’hygiène sont négligées, avec des vivres insuffisants et malsains ; qu’on lance un tel vaisseau et un tel équipage dans une lointaine expédition, et le scorbut ne tardera pas à s’y développer. Cette maladie a été jadis l’effroi des navigateurs ; on ne pouvait entreprendre un long voyage, on ne pouvait réunir une flotte pour une grande expédition, sans que cette cruelle maladie vînt à se développer parmi les équipages. Aujourd’hui elle ne se montre plus que rarement et seulement dans les occasions où des circonstances fâcheuses ont soumis les marins à des privations et à des souffrances inaccoutumées.
Le typhus des camps est dans le même cas. Supposez un hôpital encombré de malades et de blessés, l’air stagnant dans des salles trop étroites, l’humidité répandue partout, le linge ne suffisant pas aux besoins, la malpropreté et les immondices dans les lits, sur les murs et sur les planchers, le découragement, la crainte, l’ennui maîtrisant les esprits de tous les malheureux renfermés dans un pareil asile, et bientôt vous verrez des fièvres du plus mauvais caractère naître dans cette enceinte ; et, si un semblable état de choses existe dans les innombrables hôpitaux qui appartiennent à des armées aussi nombreuses que le furent celles de Napoléon et de la coalition, en 1813, si ces armées occupent une vaste étendue de pays et se meuvent avec rapidité, alors le typhus, se développant sur une grande échelle, passera de ville en ville, comme la flamme d’un incendie, et ressemblera aux grandes épidémies spontanées ; cependant il sera né de toutes pièces au milieu de circonstances dont on peut provoquer la réunion quand on veut.
Il en est tout autrement des maladies que la nature seule développe. Celles-là, nulle combinaison humaine ne peut les enfanter : quoi qu’on fît, on ne déterminerait jamais une petite vérole sur un individu. La peste ni le choléra n’ont pas leur origine dans des circonstances que l’art des hommes puisse préparer. Là, jusqu’à présent du moins, tout est invisible, mystérieux ; là tout est produit par des puissances dont les effets seuls se révèlent.
Autre point à distinguer : parmi les maladies épidémiques, les unes occupent le monde et en désolent presque toutes les parties, les autres sont limitées à des espaces plus ou moins étendus. De ces dernières, l’origine peut être recherchée soit dans des circonstances locales d’humidité, de marécages, de matières animales ou végétales en décomposition, ou bien dans des changements que le genre de vie des hommes éprouve. L’antiquité usait de beaucoup de mets qui sont tombés en désuétude ; nous, de notre côté, nous avons des aliments que nos aïeux ne connaissaient pas. Il n’est pas indifférent d’avoir une bonne ou une mauvaise nourriture, de se vêtir bien ou de se vêtir mal, d’habiter des villes bien aérées et bien nettoyées, ou des rues étroites, humides et sales. Or, comme tout cela change de pays à pays, et, pour un même lieu, de siècle à siècle, il n’est pas étonnant qu’il survienne des changements dans la santé des hommes.
Un des exemples les plus remarquables de ces maladies locales, dues à des influences locales et néanmoins souvent ignorées, est la maladie des pieds et des mains, qui a régné à Paris en 1828, et qui a reçu en médecine le nom grec d’acrodynie. Ce fut une chose singulière de voir affluer dans les hôpitaux une foule de personnes saisies de douleurs plus ou moins vives aux mains et surtout aux pieds. Ces parties prenaient une coloration rougeâtre ; les malades n’en pouvaient faire aucun usage, et dans quelques cas la mort même a été la suite de cette affection. Plusieurs casernes, entre autres, comptèrent un grand nombre de malades. Ce mal, inconnu jusqu’alors, et qui ne ressemblait à rien de ce que les médecins voyaient journellement ou de ce que les auteurs avaient décrit, disparut subitement comme il était venu, et depuis il n’en a plus été question. Un médecin qui s’est occupé avec beaucoup de distinction des maladies de la peau, M. Rayer, l’a rapproché avec sagacité de la pellagre, autre affection singulière dont je ne puis me dispenser de dire un mot ici.
La pellagre est une maladie propre à l’Italie septentrionale. Elle attaque presque uniquement les gens de la campagne ; commençant par une maladie de peau, elle finit par porter atteinte aux organes les plus importants, particulièrement au cerveau et aux viscères qui servent à la digestion ; l’on conçoit que quand elle a atteint ce degré, elle devient une affection excessivement grave ; elle cause en effet souvent la mort des individus qui en sont atteints. Cette maladie ne voyage pas, et elle paraît essentiellement tenir à certaines conditions d’insalubrité qui se remarquent dans la haute Italie.
Il y a dans ces maladies des transformations, et pour ainsi dire des jeux, qui ne permettent aucune attribution précise. Quelques-unes, par exemple, après avoir eu un caractère très longtemps local, acquièrent soudainement une puissance bien plus grande et débordent à l’improviste sur les pays environnants. La suette anglaise est dans ce cas ; d’abord exclusivement bornée à l’Angleterre, elle fit lors de sa dernière apparition une invasion sur le continent et désola tout le nord de l’Europe. Cette maladie est si étonnante, qu’elle mérite une mention détaillée. Je l’emprunte à M. Hecker.
La suette anglaise était une affection excessivement aiguë, qui se jugeait en vingt-quatre heures. Dans cette marche si rapide, elle présentait des degrés et des formes différentes ; et les observateurs en ont signalé une où le signe caractéristique, la sueur, manquait, et où la vie, succombant sous un coup trop violent, s’éteignait en peu d’heures.
Le mal arrivait sans que rien l’annonçât. Chez la plupart, la suette, comme presque toutes les fièvres, commençait par un court frisson et un tremblement qui, dans les cas mauvais, se transformait en convulsions ; chez d’autres, le début était une chaleur modérée, mais toujours croissante, qui les surprenait, sans cause connue, au milieu du travail, souvent le matin au lever du soleil, même au milieu du sommeil, de sorte qu’ils se réveillaient tout en sueur.
Alors le cerveau devenait rapidement le siège de dangereux phénomènes. Plusieurs tombaient dans un délire furieux, et ceux-là mouraient pour la plupart. Tous se plaignaient d’un sourd mal de tête, et au bout de très peu de temps survenait le terrible sommeil, qui se terminait le plus souvent par la mort. Une angoisse horrible tourmentait les malades, tant qu’ils conservaient l’usage de leurs sens. Chez plusieurs, la face devenait bleue et se tuméfiait, ou du moins les lèvres et le cercle des yeux prenaient une teinte bleue. Les malades respiraient avec une extrême difficulté ; en outre, le cœur était saisi de tremblement et de battement continuels ; et cet accident était accompagné d’un sentiment incommode de chaleur interne, qui, dans les cas funestes, montait vers la tête et déterminait un délire mortel.
Après quelques délais, et chez beaucoup de prime abord, une sueur se manifestait sur tous les points du corps et coulait avec une grande abondance, apportant le salut ou la mort, suivant que la vie résistait à une aussi furieuse attaque.
La suette anglaise n’a pas été une maladie signalée par une seule invasion, et passant comme un ouragan sur les populations ; elle a eu cinq irruptions, séparées les unes des autres par d’assez longs intervalles, et variables par l’étendue des pays ravagés.
La suette, au moment où elle parut, était une maladie complètement nouvelle pour les hommes parmi lesquels elle sévissait. C’est aux premiers jours d’août de l’an 1485 que l’on fixe son apparition sur le sol de l’Angleterre. Le même mois, elle éclata à Oxford, et tel fut l’effroi qu’elle répandit dans cette université, que les maîtres et les élèves s’enfuirent, et que cette école célèbre resta déserte pendant six semaines. Londres fut envahi par la maladie dans le mois de septembre et perdit un grand nombre de ses habitants ; mais cette rapide et redoutable maladie ne devait pas avoir une longue durée : elle cessa subitement dans les premiers jours de janvier 1486, après s’être strictement renfermée dans les limites de l’Angleterre.
Après cette première attaque, la suette s’est montrée quatre autres fois en Angleterre, respectant toujours l’Écosse et l’Irlande, n’infectant de la France que Calais, alors occupé par les Anglais, et n’ayant pénétré qu’une fois en Allemagne et dans le nord de l’Europe.
Depuis lors, la suette n’a plus reparu en Angleterre ; elle y est aujourd’hui aussi inconnue qu’elle l’était avant le mois d’août 1485. On remarquera néanmoins qu’elle offre de grandes ressemblances avec la maladie cardiaque de l’antiquité, caractérisée aussi par un flux de sueur abondant.
Les sociétés, dans le cours du temps et par le progrès de la civilisation, éprouvent dans leurs mœurs, dans leurs habitudes, dans leur genre de vie, des changements considérables qui ne peuvent manquer d’exercer leur part d’influence dans l’hygiène publique.
Hippocrate fait la remarque que de son temps les femmes n’étaient pas sujettes à la goutte ; et Sénèque, que cette observation avait frappé, signale la fréquence de cette maladie chez les dames, accusant de cette différence les mœurs dissolues de Rome. Les voyageurs qui ont parcouru les premiers les divers archipels de l’océan Pacifique, assurent que les catarrhes n’existaient pas chez ces peuples avant l’arrivée des Européens. Platon dit la même chose des Grecs avant Solon.
C’est une question curieuse, mais difficile à examiner, que de savoir si, à mesure que la civilisation avance et se perfectionne, les maladies se multiplient et se compliquent. Bien des points sont à distinguer avant que l’on puisse répondre directement.
D’abord, quand on jette les regards sur l’origine des sociétés, les plus anciens monuments nous les montrent établies, avec une civilisation très avancée, dans l’Égypte, dans la Babylonie, dans l’Assyrie ; c’est de ces sources que sont sortis tous les ruisseaux qui, allant tantôt en se rétrécissant, tantôt en s’augmentant, présentent cependant de nos jours un flot de civilisation bien plus considérable qu’aux premiers temps où, pour nous, l’histoire commence. Il serait impossible de refaire l’histoire médicale de ces anciennes sociétés ; d’ailleurs une culture très perfectionnée les rendait, en beaucoup de points, fort semblables à nous. C’est autre part qu’il faut prendre nos termes de comparaison.
Il s’agit de considérer dans l’antiquité les Germains, les Gaulois, les peuplades scythes répandues en Europe et en Asie, et, de nos jours, les sauvages de l’Amérique, des archipels de l’océan Pacifique et de l’Australie. Ces peuples furent ou sont encore plus près que nous de ce qu’on appelle l’état de nature, puisqu’il est vrai que l’état de nature est cette condition chétive et errante de l’homme sans industrie, sans art et sans science.
Or, pour formuler en peu de mots l’état hygiénique de ces peuples par comparaison avec le nôtre, il faut reconnaître, en laissant de côté le calcul exact du nombre des malades, impossible à établir, qu’ils ont non seulement moins de ressources contre les maux qui assaillent l’espèce humaine, mais aussi moins de force de résistance en eux-mêmes contre les influences morbifiques, quand ils viennent à y être exposés.
Toute l’antiquité a reconnu que le Germain et le Gaulois, pleins d’impétuosité et d’ardeur, ne savaient résister ni à la fatigue, ni au travail, ni à la chaleur, tandis que le soldat romain l’emportait notablement, par ces qualités physiques, sur l’homme grand et blond de la Gaule et de la Germanie. De nos jours, la même chose a été constatée d’une manière différente ; c’est que la force musculaire des hommes civilisés, estimée par le dynamomètre, est notablement supérieure à celle des sauvages de l’Amérique. Volney avait été frappé de voir beaucoup de sauvages des États-Unis en proie au rhumatisme ; et Hippocrate, qui avait étendu ses voyages dans la Scythie, fait la même remarque touchant ces hordes qui, de son temps, vivaient à cheval et dans des chariots. Le père de la médecine a fondé à ce sujet la doctrine de l’influence des climats sur le naturel des hommes, doctrine qui paraît d’autant plus plausible qu’on se rapproche davantage de l’origine des nations. L’action du sol et de l’atmosphère est plus sensible et plus réelle sur des peuplades peu habillées, sans habitations fixes, toujours en contact avec l’air, les eaux et la terre, que sur les peuples modernes, où les sciences et l’industrie ont donné à l’homme tant de moyens de se défendre contre les agents extérieurs. Hippocrate eut certainement une vue grande et profonde des choses, et Montesquieu, qui l’a adoptée et reproduite, aurait dû y faire quelques restrictions, devenues nécessaires par le progrès des ans et de la puissance de l’humanité.
On ne peut se refuser à croire que les modifications que la vie des hommes reçoit de tout ce qui constitue la civilisation, prennent une part dans la production de certaines maladies et dans les altérations pathologiques que nous voyons amenées par le cours des siècles. Mais je crois qu’il est impossible d’attribuer à cette cause unique toutes les grandes épidémies que signale l’histoire, et qu’il faut chercher une influence différente, ou plutôt reporter l’influence morbifique à des sièges particuliers qui ont la funeste propriété de rayonner. Cela est vrai pour la peste, pour le choléra, pour la fièvre jaune. De la sorte, on est rejeté de nouveau sur les causes locales, ignorées du reste, qui créent le germe de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, en Égypte, en Inde, en Amérique.
L’influence des vastes épidémies est évidente sur les mœurs ; mais elle n’est pas favorable. La vie paraît alors si précaire, qu’on s’empresse de jouir de ces heures qui vont peut-être cesser bientôt. Les grandes calamités ont pour effet, en général, de laisser prédominer l’égoïsme et l’instinct de conservation à un point qui efface tout autre sentiment et change l’homme en une espèce de bête malfaisante. Rappelons-nous les naufrages, les famines, les désastres comme la retraite de Moscou ; alors une seule idée préoccupe, c’est celle du salut ; et, pour se conserver, on commet les actions les plus cruelles. Dans les épidémies, le même instinct se fait sentir, le même égoïsme se manifeste, et d’une part il conduit à l’abandon des attachements les plus chers et de l’autre à une jouissance précipitée de tous les plaisirs ; négligence de nos devoirs envers les autres et recherche désordonnée de nos plaisirs, tels sont en effet les caractères de l’égoïsme, en tout temps, mais qui deviennent plus frappants en temps de peste. Ce spectacle fut donné par Athènes, quatre siècles avant Jésus-Christ. Il le fut encore davantage dans la peste noire du quatorzième siècle ; à cette dernière époque, on vit d’une part un esprit de pénitence s’emparer des populations, et de l’autre, les plus effroyables cruautés être exercées à l’occasion d’absurdes soupçons. Ce mélange singulier vaut la peine d’être raconté ; j’en emprunte les principaux traits au livre de M. Hecker, sur la peste noire.





























