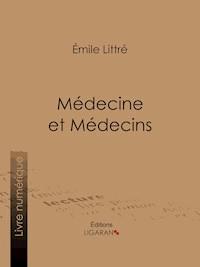Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Comme l'empire, fait par Jules César, constitue une longue période qui aboutit à une catastrophe inouïe, la domination des barbares, c'est à l'origine qu'il faut l'examiner, et dans le caractère que lui imprima son fondateur. Là se forme le nœud qui ne se dénouera pas, mais que tranchera le glaive des Goths, des Burgundes et des Francs. Évidemment les choses tournèrent aussi mal qu'il est possible".
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Souvent il m’arrive, soit pour accéder à une requête, soit pour complaire à un ami, soit pour me satisfaire moi-même, d’insérer, dans les recueils qui me sont ouverts, des articles (c’est le mot) sur des ouvrages divers. Ces études, nées ainsi des circonstances, n’ont pas du moins failli à leur nom : elles ont été pour moi occasion d’étudier ; d’autant plus qu’étant soumis à la salutaire discipline d’une philosophie dont l’un des mérites proéminents est de coordonner et de représenter les sciences positives, y compris l’histoire, je n’écris rien qui, par un lien certain, ne dépende de ce que je regarde comme les grandes généralités et les hautes pensées.
Dès lors il m’est possible, choisissant, parmi ces études, celles qui se rapportent à un même sujet, de faire ce que j’appellerais volontiers un demi-livre, c’est-à-dire une œuvre à laquelle manquent l’enchaînement, la déduction et la continuité, mais à laquelle ne manque pas une pensée unique.
Ici la pensée est historique, à savoir que le Moyen Âge n’est point une ère stérile et déshéritée dans laquelle se brise la tradition, mais qu’au contraire il a continué, à travers les difficultés léguées et acquises, le développement, dont il n’a changé ni la nature ni la direction.
Ceux qui ne connaissent pas la philosophie positive, s’étonneront sans doute quand je dirai qu’elle n’a pu exister et se produire qu’au moment où l’histoire est devenue une science, en d’autres termes alors qu’une loi fondamentale y a été trouvée. Et, pour le dire en passant, cette nécessité qui lui était imposée n’est pas la moindre différence qui la sépare de la philosophie théologique et de la philosophie métaphysique ; celles-là ont pu exister sans que l’histoire fût une science, et même l’histoire comme science n’est pas sans les gêner.
La loi fondamentale à laquelle je fais allusion et qui commence à pénétrer parmi les penseurs est que l’intelligence humaine, dans les périodes antiques, interprète les phénomènes en les attribuant à des volontés qu’elle fait analogues à la volonté des hommes ; que, plus tard, la raison, appliquant la critique à l’ordre des notions théologiques, rétrécit le domaine du surnaturel et substitue, partout où elle peut, aux volontés les essences et les qualités occultes ; et que, finalement, l’expérience, analysant les phénomènes, en tire des lois qui remplacent et les volontés primitives et les entités intermédiaires. On comprend que cette loi est non point une vue de l’esprit que la philosophie impose aux faits, mais un résultat expérimenta que les faits imposent à la philosophie. Je ne dis pas, non plus, que la civilisation n’a pu suivre que la voie indiquée ; là-dessus je ne sais rien ; je dis seulement que c’est celle-là qu’elle a suivie effectivement. Si, par la pensée, on forme le développement de cette loi fondamentale, l’on verra se dérouler sous sa direction toute la marche de l’histoire.
À celui qui fera cette revue se présentera le Moyen Âge, période suspecte à beaucoup d’esprits ; car c’est l’ère de la féodalité et du catholicisme. La féodalité, qui entra en décomposition d’elle-même et par le progrès des choses, n’en laissa pas moins, de siècle en siècle, des institutions ruinées, mais oppressives et choquantes pour des hommes qui s’éveillaient à une égalité et à une liberté nouvelles ; les bourgeois et le populaire furent également animés contre ces restes malencontreux d’un autre âge, et ils ne sont pas disposés à approuver dans le passé ce qu’ils ont condamné violemment et justement dans le présent. Contre le catholicisme s’élevèrent d’abord l’hérésie et la réforme, qui partagèrent l’Europe ; puis la science lutta contre lui, et, dans cette lutte, Galilée n’est qu’un épisode frappant et émouvant ; la libre-pensée suivit la science ; traitée rigoureusement tant qu’elle resta faible, elle n’est pas plus que le bourgeois et le populaire disposée à juger favorablement de l’âge et de la doctrine qui voulurent l’étouffer. C’est contre ces aversions naturelles mais fausses historiquement que furent écrits les articles composant le présent volume. La vérité scientifique doit toujours être dite impartialement, advienne que pourra. La justice que je rends au Moyen Âge est une justice historique qui ne réagit aucunement sur la lutte contemporaine. Bien plus, beaucoup de ceux qui s’acharnent contre la superstition et les ténèbres de cette période, désireux toutefois de sauver des lambeaux de théologie ou de métaphysique qui leur sont chers, reculent devant les conclusions radicales de la philosophie positive ; cette philosophie qui secoue loin d’elle jusqu’au dernier de ces lambeaux, mais qui, n’ayant ni pour l’ère du christianisme une haine révolutionnaire, ni pour l’ère du paganisme une haine chrétienne, professe admiration et reconnaissance pour la succession des grandes œuvres de l’humanité.
Le Moyen Âge n’a pas créé les conditions sous lesquelles il s’est formé ; il les a reçues. Aussi, ce qui seul doit être mis à sa responsabilité, c’est l’usage qu’il en a fait, soit pour les améliorer, s’il les a améliorées, soit pour les empirer, s’il les a empirées. Il succède à la domination des barbares en Occident. J’en fixe le commencement à la chute des Carlovingiens ; c’est alors qu’il n’y a plus un seul chef germain à la tête des nations romanes ; ces nations, redevenues indépendantes, sont gouvernées par des chefs indigènes ; c’est aussi l’époque de l’établissement définitif et régulier de la féodalité.
Je donne le nom d’empire barbare à toute la période où les Germains s’établirent en Gaule, en Italie et en Espagne, et où toutes les nations latines obéirent à des chefs barbares. Cet empire, qui commença à la chute d’Augustule, fut centralisé par Charlemagne et sous ses successeurs.
Mais comment ne pas jeter un regard sur l’empire romain qui laissa arriver les barbares ? La longue décadence qui préluda à cet immense désastre n’est pas moins une difficulté dans l’ordre de l’évolution, que n’est la confusion grandissant sous les royautés germaniques, ou la féodalité dressant ses donjons sur tous les points du territoire occidental.
C’est pourquoi j’ai voulu qu’une Introduction mît sous les yeux du lecteur quelques considérations générales sur l’empire romain, sur l’empire barbare et sur le Moyen Âge ; l’empire romain, où commence la décadence ; l’empire barbare, où elle arrive au dernier terme ; le Moyen Âge, où se marque le mouvement de restitution et qui aboutit sans interruption, sans solution de continuité, à l’ère moderne.
L’anarchie dans laquelle était tombée Rome, dominatrice des nations, rendait inévitable une crise politique ; et cette crise fonda l’empire. L’empire fut une dictature, avec une administration et des lois (l’administration et les lois romaines sont célèbres), mais sans institutions. J’entends par institutions tout mode régulier par lequel les gouvernés interviennent dans le gouvernement qui les régit.
Comme l’empire, fait par Jules César, constitue une longue période qui aboutit à une catastrophe inouïe, la domination des barbares, c’est à l’origine qu’il faut l’examiner, et dans le caractère que lui imprima son fondateur. Là se forme le nœud qui ne se dénouera pas, mais que tranchera le glaive des Goths, des Burgundes et des Francs. Évidemment les choses tournèrent aussi mal qu’il est possible. Mais, en même temps, il faut montrer, ce qui est véritable, comment dans cette période de décadence officielle s’élevèrent des forces restauratrices qui, ne se bornant pas à limiter le mal, produisirent un ordre intellectuel et moral, capable d’équivaloir, comme rôle intermédiaire, à l’ordre intellectuel et moral de l’antiquité.
L’empire ne s’établit point sans une lutte terrible. Le parti qui s’y opposa était puissant : Labiénus et l’Espagne, Pompée et Pharsale, Caton et l’Afrique en font foi. Mais, si la force des armées se balançait, la capacité des chefs ne se balançait pas ; et la supériorité du plus rapide vainqueur qui fut jamais, se manifesta partout. Le parti républicain, se sentant encore des ressources, le tua et recommença le combat contre un maître et le pouvoir absolu. Il est donc certain qu’à ce moment Rome était violemment partagée, et que beaucoup défendaient la république, tandis que beaucoup, ne s’en souciant plus, prêtaient leurs bras à qui voulait la renverser.
Devant cette crise qui, pourtant de siècles, décida du sort du monde civilisé (car dans l’empire romain était enclose l’œuvre de civilisation, œuvre suprême à laquelle les Parthes à l’Orient, les Germains au Nord, étaient étrangers) ; devant, dis-je, cette crise redoutable, l’histoire s’arrête un moment pour juger ce qui s’est fait ; puis, quand la solution est accomplie, elle ne considère plus que le phénomène, dont il faut étudier le développement et les conséquences.
Sous le règne de Tibère, Cremutius Cordus nomma, dans une histoire, Brutus et Cassius les derniers des Romains ; l’ombrageuse tyrannie du successeur d’Auguste punit de mort cette parole, et de destruction le livre où elle était consignée. Le fait est que, généralement, l’antiquité pencha, dans ses jugements, vers le parti républicain. Mais, de nos temps, regardant César comme le chef et le représentant du parti plébéien ou populaire, on a dit que son triomphe avait été le triomphe légitime et l’évènement heureux.
Cela est-il vrai ? César a-t-il en effet combattu pour la plèbe, assuré ses droits, accru son importance politique ? Est-elle après lui plus libre, plus puissante, plus grande ? D’ailleurs la plèbe antique est-elle l’analogue de la démocratie moderne ? Enfin, la plèbe qui suivit Clodius, Catilina et César lui-même, était-elle encore la plèbe de la vieille république et des Gracques ?
D’abord, écartons comme fausse l’assimilation de la plèbe antique avec notre démocratie moderne. La plèbe antique avait au-dessous d’elle les esclaves et tout ce qui n’était pas classé ; elle formait un corps essentiellement propriétaire, et, à vrai dire, une aristocratie intermédiaire entre les patriciens et la tourbe libre et non libre dont on ne tenait compte ni pour la paix ni pour la guerre. Au lieu que, depuis l’issue du Moyen Âge et du servage, la démocratie moderne a pour élément, à côté de la bourgeoisie, ces classes de travailleurs que l’antiquité ne connaissait que comme classes serviles ou n’admettait qu’à regret et avec défiance dans ses cadres politiques.
S’il importe de distinguer la plèbe antique de la démocratie moderne, il importe aussi de distinguer la plèbe en sa fleur de la plèbe en sa décadence. Rien ne fut plus sujet à décadence que la plèbe ; et cela se conçoit ; car c’était un corps fermé qui se recrutait insuffisamment, et un corps de petits propriétaires, à qui toutes sortes d’accidents ravissaient la propriété. C’est par la dissolution de la plèbe que toutes les républiques antiques ont manquée ; et Rome ne fit pas exception.
La plèbe romaine, depuis l’institution des tribuns, devint un corps vigoureux, discipliné, admirable, qui lutta à la fois pour des idées politiques et pour des idées qu’aujourd’hui nous nommerions socialistes. Dans l’ordre des idées politiques, elle réclama avec une indomptable ténacité l’égalité à l’égard des patriciens, et le droit de partager les hautes magistratures qui longtemps leur avaient été exclusivement dévolues. Dans l’ordre des idées socialistes, comme elle sentait à tout moment que la propriété, qui faisait sa force, lui échappait, elle demanda sans cesse à être protégée contre la misère et la dissolution par des partages de terres dont la conquête lui offrait de fréquentes occasions. Victorieuse politiquement, elle fut vaincue socialement. Les Gracques, suprêmes socialistes de la plèbe romaine, succombèrent ; le sénat noya leurs projets dans leur sang et dans celui de la plèbe, qui dès lors marcha rapidement vers une irrémédiable décomposition.
Le nom seul en demeura ; et c’était chose accomplie au temps de César. À la place d’une commune (qu’on me passe cette expression du Moyen Âge) ardente à conserver, à étendre certains droits qui lui étaient chers, il n’y eut plus qu’une tourbe chez qui tout sentiment politique avait disparu. Dépourvue des anciens mobiles, et ne s’en étant point donné de nouveaux, par ses penchants à la fois séditieux et mercenaires elle appartenait sans conteste à qui l’agitait ou à qui l’achetait, prêtant, pour la ruine de l’État, le grand pouvoir du forum et des comices aux ambitions par qui Rome était déchirée. Refaire une plèbe comme il s’en était produit une spontanément, six à sept siècles auparavant, à l’aurore des vieilles républiques, était impraticable, avec Rome conquérante et le monde conquis ; abolir l’esclavage et inaugurer la vraie démocratie était aussi loin des faits que des idées ; il ne restait donc que le débat sur lequel roula la guerre civile : ou l’empire dictatorial avec César et Auguste, ou la république aristocratique avec Pompée et Brutus.
Rien n’est donc plus faux que de se figurer César comme le représentant de la plèbe ; on ne représente pas ce qui n’existe plus. Cela se vit bien à l’épreuve : sous l’empire il n’y a plus que cette multitude réclamant à Rome du pain et des jeux, panem et circenses, et, dans les provinces, s’affaissant graduellement sous le poids de la fiscalité impériale.
Remarquez (ce qui est caractéristique de l’anéantissement politique de la plèbe) que César n’eut pas besoin d’un programme ; je me sers de cette expression moderne, qui rend bien la situation. La plèbe ne lui en imposa aucun, soit explicite, soit tacite. Si bien qu’il sembla d’abord que ce ne fût qu’une querelle entre César et Pompée. Quelques républicains s’y trompèrent et suivirent César ; mais, quand après Pharsale on se retrouva à Rome, ils virent bien que la république était finie et qu’ils avaient un maître. Ils se vengèrent de leur méprise par un coup de poignard.
César accomplit ce que Catilina venait de tenter. Je n’accepte pas contre ce sombre et audacieux conspirateur toutes les imputations qu’on lit dans les Catilinaires ; il fut vaincu et tué, ne laissant personne pour défendre sa mémoire si elle a pu être défendue. Mais ce qui est certain, c’est qu’il recruta à Rome et hors de Rome une bande hostile au gouvernement, et sans souci de plèbe, de république ou de liberté. Réussissant, il établissait quelques années plus tôt un empire peu différent de celui qui fut établi effectivement.
Écartons donc le fantôme du plébéianisme, et voyons ce qui fit vraiment la force de César et la durée de son établissement. L’empire fondé par lui représenta l’ordre sous la forme de la dictature ou pouvoir absolu beaucoup lui en surent gré ; et les premiers Césars, Auguste surtout, jouirent de la faveur que conciliait à l’empire la tranquillité générale, ou, pour me servir de l’expression de Pline, l’immense majesté de la paix romaine. Mais plus tard cette paix, cette majesté disparurent ; les guerres civiles éclatèrent, les guerres étrangères n’eurent que des trêves, et une menaçante destinée s’appesantit sur Rome.
Il n’est pas sans importance de considérer ce que devint la plèbe sous l’empire et par-delà l’empire. Par ce mot j’entends maintenant non pas la plèbe politique, celle-là est morte, mais l’ensemble des gens libres qui n’appartenaient ni à l’aristocratie nobiliaire et territoriale, ni à l’aristocratie administrative, en d’autres termes le corps des petits hommes libres. Sa destruction ne fut point arrêtée par le nouveau régime qu’on dit aujourd’hui avoir été fait pour elle. Déjà sous Vespasien, Pline l’ancien déplorait qu’elle eût disparu des campagnes italiques, s’écriant avec douleur que la grande propriété avait perdu l’Italie (latifundia perdidere Italiam). Dans les siècles suivants, la fiscalité impériale, de plus en plus écrasante, la rongea incessamment et réduisit ce qui en restait au désespoir. Les barbares arrivèrent ; dans la confusion, dans les partages, dans l’insécurité, la plèbe n’eut plus où reposer sa tête, si bien que, sous les Carlovingiens, elle avait disparu jusqu’au dernier homme ; il ne restait plus un seul individu libre, et chacun était devenu l’homme d’un supérieur. Si l’on revient par la pensée sur ce long changement social, on voit que la plèbe antique, souvent si grande et si belle, n’ayant, à cause de sa position entre l’aristocratie et les esclaves, qu’une base étroite, ne se maintient pas ; que, disparaissant graduellement, elle vient se perdre dans le vasselage de l’aristocratie féodale, et que de là elle renaît sous une forme plus liante, celle de la démocratie moderne. Donc, si, par un côté, il y a eu décadence et destruction, il y a eu, par l’autre, rajeunissement et reproduction. Certes je ne veux pas dire, car je ne le sais pas, que la destruction de la plèbe antique, l’absorption de tout plébéien dans le vasselage féodal, et l’issue, hors du sein de ce vasselage, de notre démocratie soient trois phases nécessairement coordonnées. Mais, cet incontestable fait d’évolution se réalisant, il a fallu que la situation totale renfermât des principes actifs qui ont fait prévaloir le progrès et le bien malgré de longues, de dures, de cruelles traverses.
Ayant noté que la plèbe, ou corps des petits hommes libres, déchut et décrut sous l’empire, il m’importe de noter ce que sous ce même empire devint l’aristocratie. Elle perdit tout ce que donne la politique, mais elle garda tout ce que donne la richesse. Le sénat fut maintenu, non dans son autorité mais dans son opulence ; soixante-quatre ans après la bataille de Philippes, Junie, femme de Cassius et sœur de Brutus, mourut laissant une immense fortune ; c’est à ses funérailles qu’on porta les images de vingt illustres familles, mais où manquèrent celles de Cassius et de Brutus, d’autant plus resplendissantes, dit l’historien, qu’on ne les y voyait pas. La grande propriété territoriale s’agrandit encore, et l’on peut juger de ce qu’elle était par ces quatre seigneurs qui, à eux seuls, possédaient toute la province d’Afrique, et que Néron mit à mort pour prendre leurs biens. Ainsi, tandis que les petits diminuaient, les grands se conservaient ; chose naturelle ; car, dans cette époque chaque jour plus inclémente, les petits n’eurent pas la constitution assez robuste pour résister. Si la vie de l’empire n’avait pas été coupée par les barbares, si, après le développement religieux et le christianisme, il y avait eu le temps pour que se fît un développement politique, on peut affirmer qu’il se fût fait par les riches, par les puissants, par les aristocrates qui auraient réclamé, arraché des droits politiques et l’intervention dans le gouvernement. Ainsi une solution féodale était dans la nature des choses bien plus qu’on n’est porté à le croire ; et, bien loin de s’étonner de l’institution de la féodalité, il faut y voir le produit de conditions sociales dès longtemps déterminées. Cela est si vrai que cette solution ne nuisit en rien à l’évolution totale ; car la féodalité enfanta la commune, et la commune enfanta à son tour la démocratie.
La plèbe des derniers temps républicains, très puissante puisqu’elle donnait les magistratures, très dangereuse puisqu’elle avait perdu toute conscience politique, devait être annulée dans les crises incessantes que sa propre décomposition suscitait. Elle le fut par César et Auguste ; elle l’aurait été par Pompée et Brutus. En quoi donc les deux partis différaient-ils ? En ceci, que d’un côté était un maître, de l’autre un patriciat. Il n’y avait de plébéianisme dans César et dans Auguste, qu’une lutte contre une aristocratie ; il n’y avait de républicanisme dans Pompée et dans Brutus qu’une lutte aristocratique contre un maître.
L’antiquité a généralement pensé que la cause républicaine valait mieux que la cause dictatoriale. C’est toujours chose grave que de réformer le jugement porté par une époque sur elle-même ; cela se peut sans doute. Mais il y faut des preuves décisives. Ici on les aurait si, la république écartée, l’ordre établi, l’empire fondé, les choses avaient pris un cours régulier de vie et de développement : tout le monde sait qu’il en fut autrement. Cet ordre de preuves étant mis de côté, il ne reste qu’à discuter le principe. Le pouvoir absolu n’est pas un principe : il l’est si peu que, malgré sa longue durée à Rome, il ne put jamais transformer l’empire en monarchie. La liberté, fût-elle aristocratique, en est un, assez beau pour honorer le drapeau et le linceul de ceux qui moururent en le défendant une dernière fois dans le monde romain.
Ceci dit, je ne prétends en aucune façon aller plus loin. Si les républicains l’avaient emporté, auraient-ils réussi à fonder un gouvernement ? Auraient-ils mieux fait, plus mal fait que l’empire ? Nul ne le sait. L’histoire effective ne leur appartient pas ; elle appartient à l’empire, qui seul en a été l’agent pendant une longue période et seul en est responsable.
De notre temps on a créé le mot césarisme, pour désigner par là une domination qui, comprimant la liberté, donne, par compensation, une certaine satisfaction aux intérêts de la démocratie. Acceptons ce rapprochement du césarisme ancien et du césarisme moderne, et suivons les deux termes qu’il renferme : plèbe et liberté. La plèbe romaine acheva de périr sous le césarisme ancien ; la plèbe française (je me sers ici forcément de ce mot antique) n’en a pas moins grandi socialement et politiquement sous le césarisme moderne, comme auparavant. La liberté romaine a été irrévocablement vaincue par le césarisme ancien ; la liberté française, frappée par le césarisme moderne, n’a point été vaincue. Quand Napoléon Ier, nouveau César, mais chétif César que les Labiénus et les Pompée de son temps ont mis deux fois en captivité, s’empara de la dictature, il lui fallut inscrire, dans ses constitutions, des principes et des libertés dont sans doute il fit une lettre morte ; mais ces libertés et ces principes, tout muets qu’ils furent, le troublaient tout absolu qu’il était, attendant sa chute inévitable, et recevant de lui dans sa dernière détresse un hommage qui montra la vanité et l’inconsistance de sa rétrograde et meurtrière politique.
Vraiment le césarisme moderne se fait tort en se mettant sous la recommandation du césarisme ancien ; et la situation le force à mieux valoir. En effet une science qui croît incessamment ; une raison publique qui se perfectionne par la science ; une politique sur laquelle cette raison gagne graduellement de l’ascendant ; une démocratie puissante ayant des idées et des intérêts qui sont sa vie ; une Angleterre, une France, une Italie, une Allemagne, une Espagne, en un mot une Europe où tout se supplée et se balance ; voilà ce qui manquait au monde romain, et voilà ce qui pousse le monde moderne dans une même voie et ce qui limite les oscillations.
César fut un militaire incomparable, singulièrement habile dans les affaires, éminent entre tous dans l’éloquence et dans les lettres. Mais, en politique, je veux dire en cette haute politique par laquelle un homme puissant, ayant une secrète conscience de l’avenir dans le présent, donne au présent une favorable impulsion vers l’avenir, la grande habileté lui manqua. Et s’il ne l’eût pas, on doit l’attribuer à l’incroyable dénuement de moralité où était cette âme si riche en dons intellectuels et si active en volonté. Dès lors, il ne vit plus d’autre issue et d’autre succès qu’une royauté à diadème et quasi asiatique, que le pouvoir absolu, cette perpétuelle tentation des esprits infirmes en politique.
Que le pouvoir absolu ait été donné tout d’abord comme caractère à l’empire par César, cela n’est pas douteux ; et Lucain s’écrie, avec autant de vérité que de tristesse, que la victoire de Pharsale a pour jamais exilé la liberté (redituraque nunquam libertas). « Sous ce nom de liberté, dit Bossuet (Hist. univ. III, 6), les Romains se figuraient avec les Grecs un état où personne ne fût sujet que de la loi, et où la loi fût plus puissante que les hommes. » C’est aussi ce que nous entendons par ce mot, et c’est ce que l’empire ne connut plus. Alors un centurion, un tribun (imaginez un capitaine, un colonel !) alla officiellement voir le condamné de l’empereur s’ouvrir les veines ou boire la coupe empoisonnée. Je ne connais rien dans l’histoire de l’obéissance militaire, qui soulève plus le cœur.
César ne fondit qu’une décadence terminée par une catastrophe. Lucain, dès Néron, s’aperçoit que la perte de la liberté a brisé l’action extérieure de Rome : « Oui, dit-il, la journée de Pharsale a autant abaissé Rome que tous les siècles passés l’avaient élevée (Sed retro tua fata tulit par omnibus annis Emathiæ funesta dies). » Quelques années après, la ruine est devenue plus visible : sous Trajan (Trajan, ce grand et victorieux empereur !), Tacite déclare que l’empire n’est plus de force à lutter contre les barbares, et qu’il ne doit désormais son salut précaire qu’au hasard de leurs dissensions. Laissons ce triste spectacle. César ne mérite pas de nom parmi les fondateurs, mais il en garde un parmi ces grands capitaines de la Grèce, de Rome et du Moyen Âge qui ont ou défendu ou étendu l’œuvre de la civilisation. Son service, à lui, c’est d’avoir conquis et romanisé la Gaule, comme celui de Charlemagne est d’avoir conquis et christianisé la Germanie. Qu’eût-ce été si, alors que la barbarie se précipita, elle avait eu pour avant-garde la Gaule ?
Chargé des destins du monde civilisé, l’empire les soutint mal. Sans doute, la difficulté d’être avait commencé avant lui pour le monde païen ; la cause profonde en était dans l’épuisement des idées sociales, religieuses et politiques qui avaient alimenté l’ancienne civilisation. Mais, cette difficulté, l’empire l’aggrava de la façon la plus funeste en la laissant se compliquer de l’invasion de la barbarie. Sous le poids de son régime, les lettres, les arts, les caractères, tout déchut ; les forces offensives et défensives s’énervèrent ; et les Germains mirent fin à l’œuvre de César et d’Auguste.
Le siècle, dit Tacite, et il parle du sien, qui fut si sombre, n’a pas été tellement stérile en vertus, qu’il n’ait aussi donné de nobles exemples. Cette parole du plus grave des historiens, je la détourne, et je dis : la décadence n’a pas été si irrémédiable qu’elle n’ait permis à une rénovation de naître et de grandir. C’est là, à vrai dire, le point important sans lequel l’histoire, cessant d’être une tradition, serait un hasard. La rénovation ne pouvait naître par la vie politique, que l’en avait rigoureusement étouffée ; elle ne pouvait naître par le mouvement des lettres et des arts, qui ne produisaient que des imitations de plus en plus chétives d’un passé glorieux, mais épuisé ; elle ne pouvait naître par le progrès des sciences positives : la mathématique et l’astronomie, seul domaine que l’antiquité possédât dans la positivité (la physique et la biologie n’étaient qu’ébauchées, et la chimie n’existait pas), la mathématique, dis-je, et l’astronomie constituaient une base trop étroite pour que l’influence sociale des sciences pût s’exercer.
Ce fut donc dans le domaine religieux et moral que s’ouvrit la rénovation, et que le monde ancien manifesta son foyer de vie et son expansion. Cette rénovation se nomme la religion chrétienne. Née peu d’années après l’établissement de l’empire, en trois siècles elle avait gagné le plus grand nombre et converti les empereurs. Il importe, pour mon but, de noter comment elle se lie au passé et à l’avenir. Les sages du paganisme avaient presque tous conçu comme le couronnement de leur science et de leur philosophie l’idée d’un Dieu suprême et unique, et repoussé comme une superstition les multiples adorations du vulgaire. Aussi, quand le monothéisme judaïque, tiré par Jésus-Christ et par saint Paul du particularisme qui jusqu’alors l’avait retenu, devint le christianisme et fut prêché aux gentils, une lutte de parole et d’écrits s’engagea à laquelle le paganisme ne put pas résister. Les discussions sur les hautes questions renaquirent ; les conciles furent de libres assemblées, et, comme l’a dit M. Albert de Broglie, les premières depuis la chute de la république ; on discuta, on régla le dogme et les devoirs. Victorieuse en sa qualité d’idée supérieure, la religion chrétienne, bien loin de craindre la science, comme elle fit plus tard, accueillit avec respect et sécurité tout ce que l’antiquité avait produit en ce domaine ; s’efforçant, en vertu de la morale commune qu’elle prêchait aux grands et aux petits, de restreindre l’esclavage, elle eut de la sorte une part dans le grand évènement social qui plus tard le changea en servage ; enfin, sous ses auspices, une reprise vers les lettres, les arts et tout ce qui avait misérablement déchu commençait à se faire sentir, quand l’inondation des barbares noya tout et soumit la civilisation à de nouveaux dangers, à de nouvelles épreuves. Mais dès lors avaient été jetés dans la masse sociale tous les éléments qui devaient s’incorporer à la barbarie et la transformer ; le désastre fut grand, la tradition fut amoindrie, mais elle ne fut pas brisée.
L’empire barbare est fait quand partout, dans l’Occident, c’est-à-dire en Bretagne, en Gaule, en Italie et en Espagne, une certaine masse de population germanique s’est mêlée aux populations indigènes, et quand partout les chefs romains ont été remplacés par des chefs germains. La catastrophe qui livra Rome aux barbares ne fut pas moins funeste à l’empire d’Orient : elle le sépara de sa force et de ses racines, le livra sans défense aux redoutables musulmans qui allaient apparaître sur la scène, et en fit une épave dont les flots se jouèrent et dont les derniers débris disparurent au quinzième siècle.
Cet empire barbare, fractionné entre plusieurs chefs, était en proie à de fréquents bouleversements ; et le même péril qui avait emporté l’empire romain le menaçait. Les Germains restés en Germanie se pressaient sur la frontière pour faire ce qu’avaient fait leurs devanciers ; les Lombards dépossédèrent les Ostrogoths, les Francs subjuguèrent les Burgundes, et, parmi les Francs, les Austrasiens enlevèrent la domination aux Mérovingiens. Ces funestes fluctuations durèrent jusqu’à ce que Charlemagne conquît la Germanie et par là mît définitivement terme aux grandes invasions barbares.
Dans l’intervalle un grand malheur arriva à cette latinité commandée par des Germains. Elle perdit l’Espagne, qui devint province musulmane. À ce moment, le domaine de la tradition latine fut singulièrement réduit ; et l’on ne sait ce qu’il en serait advenu si Charles Martel et ses guerriers n’avaient arrêté dans les plaines de Tours la conquête arabe. Pourtant l’Espagne ne fut jamais complètement aliénée ; et il suffit de quelques fugitifs retirés en des lieux de difficile accès, pour disputer d’abord un coin de terre, puis une province, puis le pays tout entier.
Durant ces ébranlements, tout ce qui avait pu faire espérer une rénovation dans l’empire romain disparut, et la décadence descendit beaucoup plus bas. De cette rénovation commencée et de cette décadence aggravée j’emprunte un exemple (car il faut en citer un) aux beaux-arts et à un homme qui en connaît bien l’histoire. M. Vitet, examinant à quelle époque on doit chercher le vrai caractère de l’art chrétien, est conduit à remonter au-delà du Moyen Âge : « Mais alors, dit-il, vous êtes en pleine barbarie. Et ce mot, notez bien, prend ici un sens tout littéral. Sans les barbares, en effet, que d’extravagantes rudesses ne seraient jamais entrées dans l’art du Bas Empire ! Ces renversements de toute règle, de toute loi du goût, ces monstrueuses altérations du corps et du visage humain, ces oublis enfantins non moins que grossiers de toute proportion, de toute perspective, jamais, par sa propre pente, la décadence pure et simple n’y serait descendue. Il fallait l’influence de ces hordes incultes pour l’y précipiter. Ce n’est donc pas cette période lamentable qui nous pourra fournir le type de l’art chrétien. Depuis le commencement du cinquième siècle jusqu’à la fin du dixième, que vous regardiez l’Orient, que vous parcouriez l’Occident, vous ne rencontrez plus ni art ni christianisme, à proprement parler. L’art est tombé si bas, qu’il ne peut pas plus exprimer le christianisme qu’autre chose ; il est impuissant à rien rendre, sauf une certaine sauvagerie, un certain aspect effrayant et farouche qu’affectent toutes ces figures soi-disant chrétiennes, au regard dur, à l’air sinistre, quelquefois drapées avec grandeur, toujours inanimées et symétriques, que le pinceau byzantin produit à profusion, et dont il inonde l’univers. Un seul intervalle lucide vaudrait la peine d’arrêter nos regards, s’il en restait de plus nombreux vestiges. Nous parlons du temps qui s’écoule entre l’émancipation de l’Église et les invasions des barbares, ce qui comprend un siècle tout au plus. Dans l’opinion commune, cette époque se distingue à peine des temps qui l’ont suivie ; personne ne lui fait sa part ; on lui impute maintes choses qui ne viennent pas d’elle ; on ne lui fait pas honneur de tout ce qui lui appartient ; de là des confusions, et, somme toute, une complète ignorance de ses vrais caractères. Pour que le quatrième siècle fût remis à sa place, pour qu’on prisât à sa juste valeur cette première floraison publique du christianisme émancipé, il faudrait que la dévastation ne se fût pas portée, en quelque sorte de préférence, sur les œuvres de ce temps-là. Plus elles étaient récentes, moins elles ont survécu. Des époques plus anciennes et réputées moins riches sont représentées encore pour quelques-unes de leurs œuvres, tandis que ce quatrième siècle, dont la fécondité est attestée par tant de témoignages, qu’a-t-il laissé de tous ces monuments qu’il a pourtant produits, et dont le dénombrement dans les écrits contemporains peut sembler presque fabuleux ? On a beau lui restituer et la mosaïque de Sainte-Pudentienne, et les figures de Sainte-Sabine, et Sainte-Constance, et le prétendu temple de la Paix, la basilique de Constantin : c’en est assez pour établir que les progrès de la décadence s’étaient comme arrêtés et suspendus durant cet élan public d’idées et de sentiments jusque-là comprimés ; mais des exemples si peu nombreux ne sont pas de suffisants témoins pour apprécier toute une époque. Nous serions donc réduits à ne trouver, en deçà du Moyen Âge, aucun ensemble d’œuvres d’art où nous puissions chercher un type de l’art chrétien, si nous n’avions encore trois siècles devant nous, les trois siècles des catacombes. » (Journal des Savants, février 1866, p. 83.)
On le voit, le quatrième siècle renaissait, quand les barbares détruisirent ces heureux commencements et rejetèrent les choses vers une inculte enfance. En effet ce qui advint des arts advint du reste : les lettres défaillirent ; l’administration romaine fut mutilée ; les lois romaines firent place aux coutumes barbares. Lorsque la civilisation reprendra sa marche ascendante, son point de départ sera placé plus bas qu’il n’eût été s’il n’avait pas fallu traverser la période barbare.
Mais c’est là tout ce qu’on peut dire : il y a temps perdu ; il n’y a pas solution de continuité et chute hors de la voie de la civilisation. Les rois germains reçoivent le christianisme, se soumettent à l’Église, parlent latin dans leurs lois et dans leur administration, et réunissent autour d’eux ce qui reste de lumières, de lettres et de savoir. Empire barbare, ou barbarie romanisée, on peut appeler comme on voudra cette période. Cependant l’Église étend partout son réseau de prédication et d’enseignement ; partout s’élèvent les monastères, asiles pour les hommes, pour les écoles, pour les livres ; et Rome, devenue la capitale d’un empire spirituel, modère tout ce grand corps de la religion. Ces fortes assises, qui reposaient elles-mêmes sur des assises plus anciennes, arrêtèrent la barbarie sur son penchant, en fixèrent la limite inférieure, et servirent à une renaissance qui ne pouvait pas manquer. Mais ce qui ne pouvait pas manquer non plus, c’est que cette renaissance eût certains caractères d’une nouvelle enfance. Le Moyen Âge n’a pas été impunément fils de la période barbare ; mais il n’en a pas moins su instituer solidement un régime social, et, sous ce régime, se faire une manière déterminée d’apprendre, de philosopher et d’avancer.
Charlemagne réunit sous sa domination toutes les principautés barbares. Mais cet ordre mixte où la tête était germanique et le corps était latin, approchait de son terme ; la fusion et la disparition de l’élément barbare dans la population romane s’accomplissaient ; et, quand le dernier des Carlovingiens eut été renfermé dans la tour d’Orléans par Hugues Capet, non seulement l’empire de Charlemagne fut fini, mais encore l’empire barbare. Dès lors il n’y a plus partout que des chefs indigènes, des Français en France, des Italiens en Italie, des Espagnols en Espagne, et des Allemands en Allemagne.
Là est le signe apparent du commencement du Moyen Âge. C’est aussi l’époque où naissent les langues romanes ; je dirais les langues modernes, si l’anglais n’était pas de formation postérieure, retardé qu’il fut par la conquête normande et la lente transaction qui s’opéra entre l’idiome anglo-saxon et le parler français. Formation des langues, établissement des chefs indigènes, commencement des nations modernes, assiette définitive des populations, régime catholico-féodal institué, servage remplaçant graduellement l’esclavage, tout cela se réunit pour arrêter définitivement le progrès de la décadence et pour marquer le point d’où vont partir les nouveaux efforts.
On avait beaucoup descendu ; il fallut beaucoup remonter. Si la grande antiquité avait vu les chétifs résumés qui formèrent les rudiments de l’instruction pour ces temps, elle aurait souri et se serait détournée. Pourtant, quelque rétréci que fût le cadre, il était toujours le même : grammaire, belles-lettres, science, philosophie.
De même que l’on suit un enfant qui, en grandissant, monte de classe en classe, de même on suit le Moyen Âge dans son progrès constant vers le savoir. C’est vraiment une société qui fait ses classes, qui sent la nécessité d’apprendre, qui travaille consciencieusement, rudement, et qui marque chaque siècle de son existence par d’importants développements, sans que jamais il y ait rétrogradation vers un passé plus ténébreux.
Cette éducation se partage en trois périodes distinctes : la période avant l’introduction des livres arabes en Occident ; la période qui suit cette introduction ; et celle où éclate la renaissance.
La première période comprend le dixième siècle et le onzième environ. Le dixième siècle n’a pas bon renom dans l’histoire ; on a dit que ce fut un âge de fer ; sans doute : pourtant ce fut, par rapport à l’âge précédent, une renaissance, petite, il est vrai, et humble, mais active et posant les bases de tout ce qui sera l’enseignement de l’université au treizième siècle. Cette période est purement latine, c’est-à-dire qu’on n’a que des livres latins, résumés ou traductions, pour s’instruire. De tous côtés s’élèvent de grandes écoles ; les professeurs sont ardents, les élèves studieux. La domination intellectuelle de l’Église est universelle ; tout ce qui est savoir lui appartient sans conteste, et elle le distribue d’une main libérale. De cette époque on cite Remi, qui fit un traité sur le trivium et le quadrivium, et qui commenta Donat, Priscien et Martianus Capella ; Gerbert, pape sous le nom de Sylvestre II, que l’on surnomma le nouveau Boèce ; l’archevêque Lanfranc qui attira à l’école de l’abbaye du Bec, en Normandie, une multitude prodigieuse d’étudiants et qui y fit fleurir la belle latinité ; enfin saint Anselme, célèbre dans l’histoire de la philosophie pour avoir, le premier, produit, en faveur de l’existence de Dieu, l’argument que dans l’école on nomme ontologique et auquel Descartes donna quelque développement.
La seconde période comprend les siècles subséquents. Si je la choisis comme point marquant, ce n’est pas à cause que l’Occident entre en communication avec une société qui alors jetait un grand éclat, mais qui, moins heureusement douée que la société occidentale, s’arrêta dans son essor pour retomber dans la demi-barbarie et dans l’insignifiance ; mais je la choisis parce qu’elle signale manifestement l’ascension du Moyen Âge qui, par sa force et son labeur, passe d’un degré inférieur à un degré supérieur. Qu’y a-t-il en effet d’important et de caractéristique dans cette introduction des livres et du savoir des Arabes ? c’est que ce savoir et ces livres n’étaient pas autre chose que le savoir et les livres des Grecs ; de sorte que le Moyen Âge renouait par cette voie indirecte ses relations avec les sources mêmes de la science ; la science seulement, car les Arabes avaient été inaptes à s’assimiler les belles-lettres et les beaux-arts des Hellènes. La mathématique, l’astronomie, la médecine grecques reparurent sous le vêtement arabe ; et le Moyen Âge eut pour longtemps la pâture intellectuelle qui lui convenait et qui le préparait à faire un pas de plus.
Il le fit en effet. Dès le quatorzième siècle on se mit en quête régulière des livres des anciens, et bientôt survint, avec la prise de Constantinople, la fuite, vers l’Occident, des lettrés grecs et de leurs livres. Il est bien inutile de parler ici de la renaissance ; tout ce que j’en veux noter, c’est qu’achevant le cycle, elle est le dernier terme du travail par lequel la société occidentale devint de plus en plus capable de comprendre son passé et d’y puiser ses forces. Cette fois, les lettres ne furent pas oubliées ; on se précipita dans l’étude et l’admiration des chefs-d’œuvre de l’antiquité. C’est ainsi que furent terminées les classes séculaires du Moyen Âge ; j’ai préparé mon lecteur à entendre cette expression.
Mais la société du Moyen Âge est, en sa qualité d’héritière de l’antiquité, une société complexe ; et, tandis qu’elle était enfant par certains côtés, elle était virile par certains autres et supérieure à sa devancière. J’indique la religion chrétienne supérieure à la religion païenne, le servage supérieur à l’esclavage, la distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel qui fut étrangère à l’antiquité, et les mœurs chevaleresques. Tout en ayant eu beaucoup à apprendre comme un enfant, le Moyen Âge avait eu, comme un homme, sa force propre, par laquelle il produisit d’importants éléments pour la sociabilité moderne.
Ainsi, dans l’ordre scientifique, il offre la grande création de l’alchimie et toutes les suites qu’elle comporte ; dans l’ordre scolastique, la longue et mémorable controverse entre le réalisme et le nominalisme ; dans l’ordre des lettres et des arts, une nouvelle poésie, une nouvelle architecture, une nouvelle musique ; dans l’ordre des inventions, l’application ou la découverte de choses très importantes, la boussole, le papier de chiffon, la numération décimale, l’eau-de-vie, de puissants acides, la poudre à canon, l’imprimerie ; dans l’ordre politique, l’affranchissement des serfs, les rudiments du gouvernement représentatif, les états généraux et la séparation croissante de l’élément laïque d’avec l’élément ecclésiastique ; dans l’ordre révolutionnaire, les schismes, les hérésies, la réforme.
Ce sont là des traits considérables ; mais le plus considérable de tous, c’est que, tout en préparant ainsi les voies du savoir, de l’affranchissement religieux et de l’affranchissement politique, il a fini, non pas comme l’empire romain, par une catastrophe, mais par une transformation naturelle et régulière qui conduit à l’ère moderne.
Ce qui s’est passé dans cette évolution peut être mis sous les yeux en une claire image du travail total de décomposition et de recomposition. Cette image est donnée par les langues romanes. Il n’est pas douteux que, par certains côtés, les langues néolatines ne soient une corruption du latin et la destruction d’un bel organisme grammatical ; mais, par d’autres côtés, elles sont un progrès sur la langue qui fut leur mère. Un caractère plus analytique, une conjugaison plus développée, la création d’un conditionnel et de plusieurs prétérits, l’introduction d’un article défini et d’un article indéfini ; voilà de notables perfectionnements. Il ne faut pas compter parmi les moindres œuvres du Moyen Âge les langues néolatines.
Ce qui fait que l’empire romain présente une longue décadence, commencée d’ailleurs avant lui, c’est que les doctrines et les établissements qui avaient fait la force, la grandeur et l’éclat de l’antiquité païenne étaient épuisés ; mais ce qui fait que cette décadence n’a rien d’irrémédiable et de mortel, c’est que, étant le produit et l’expression d’un avancement général des idées, elle ne tarde pas à devenir liée avec une reconstitution qui est le prolongement de cet avancement général.
Ce qui fait que l’empire barbare tomba au-dessous de l’empire romain, c’est que l’immixtion violente de populations demi-sauvages fit subitement baisser le niveau commun du savoir et des idées ; mais ce qui fait que cet abaissement trouve un terme et ne transforme pas l’Occident en une Germanie, c’est que les principales puissances morales qui s’étaient formées durant l’empire romain demeurent pleines de vie et d’autorité, et continuent à pousser la société dans les voies qui avaient été ouvertes.
Ce qui fait que le Moyen Âge, par comparaison avec l’antiquité, a une véritable période d’enfance, au moins partielle, c’est qu’il succède à l’empire barbare qui, à la lettre, était une enfance, puisque ces gens-là ne savaient pas même lire ; mais ce qui fait qu’il se développe en un sens déterminé vers un ordre supérieur, c’est que l’impulsion qu’il a reçue est bonne et puissante, émanant du fond antique fourni par la société païenne et revivifié par le christianisme.
Ainsi, dans ces trois grandes périodes inégalement douées, l’enchaînement traditionnel ne fut jamais rompu, la force impulsive ne fut jamais éteinte, et le monde façonné par les Grecs et les Romains ne fut jamais frappé de cette incapacité d’avancer au-delà d’un certain point qui paralyse le monde asiatique. D’où vient ce privilège ? De la race peut-être, mais non pas uniquement de la race. En effet les Perses et les Indiens sont de race aryenne comme les Grecs et les Latins, et n’en sont pas moins restés à mi-chemin dans la civilisation. Les Gaulois et les Germains sont aussi de race aryenne ; et, quand leurs peuplades s’agitaient confusément dans les vastes contrées où les migrations et les invasions les avaient portées, rien ne leur présageait qu’ils dussent être un jour parmi les lumières du genre humain. L’ancien monde asiatique (j’entends par là les Égyptiens et les Sémites de la Babylonie et de la Phénicie), auquel nous devons tant de reconnaissance pour avoir établi les fondements de la vie civilisée, arrivé là, ne put franchir le degré supérieur. Ce fut la Grèce qui le franchit, introduisant l’esprit humain dans la science abstraite et les hautes théories. À ce moment s’ouvrit la porte à une civilisation meilleure, plus intellectuelle, et, par une suite nécessaire, plus morale.
Par cet enchaînement, par ce développement, par cet accroissement de savoir, de puissance et de moralité, les voies de l’histoire sont justifiées. Qu’est-ce à dire ? Est-ce là l’expression d’un optimisme dont la sérénité n’est émue ni troublée par les souffrances des générations passées, présentes et futures, pourvu que soit atteint le but vers lequel tendent les choses ? Non, sans doute ; ce qui est justifié, c’est la vue de la science au sujet d’une marche déterminée de la civilisation ; ce qui n’est pas justifié, si du moins cette expression est permise à qui conçoit l’immanence des forces et des conditions naturelles, ce sont les désordres et les misères à travers lesquelles cette marche s’effectue. Ces désordres et ces misères sont dans la vie sociale ce que sont les maladies et les souffrances dans la vie individuelle. Plus un ordre naturel est complexe, plus il est sujet aux perturbations ; et, comme il n’y a rien de plus complexe que le corps des animaux et le corps des sociétés, il n’y a rien non plus qui soit plus affligé. L’homme moderne ne refuse pas d’acheter par un rude travail physique et intellectuel, et par d’inévitables épreuves, les bienfaits de la civilisation ; mais ce qu’il refuse c’est de les acheter au prix excessif qu’ils ont coûté jadis. Au milieu des guerres, des conquêtes, des invasions, des oppressions, des esclavages, des haines nationales et religieuses, des persécutions, des massacres, il semblait vraiment que tout cela fût le principal et que le progrès ne fût que l’accident. Aujourd’hui un ferme vouloir commence à s’élever parmi les sociétés d’élite, pour que les perturbations soient l’accident et que le progrès soit le principal. Bien loin que la loi de l’histoire n’inspire rien de desséchant, elle intéresse au sort de l’humanité, la met sur un piédestal et en vivifie l’amour. À cette lumière, poursuivre un idéal de vérité, de beauté, de justice devient la conscience de l’humanité ; et prendre part à cette tâche grandiose devient la conscience de l’individu humble et passager.
16 février 1867.
SOMMAIRE. – Le quatrième siècle de l’ère chrétienne est une des époques où l’on peut le mieux étudier les transformations sociales, et se convaincre qu’elles ne sont explicables que par une philosophie qui, en histoire, saisisse la filiation nécessaire des faits généraux, des doctrines et des époques. En effet, que voit-on alors ? la société païenne qui périt et l’empire romain qui succombe. Est-ce là tout ? Non ; à côté de cette destruction il se fait une reconstruction : la société chrétienne s’élève et l’empire spirituel se fonde. Ce qui serait advenu de cette destruction et de cette reconstruction laissées à elles-mêmes, nous ne le savons pas exactement ; car l’expérience, si je puis me servir de cette expression, fut troublée par l’intervention sinistre des barbares, qui portèrent partout le désordre et l’ignorance et qui causèrent un grand mal, réparable pourtant et réparé à la longue. Toute histoire qui raconte la décadence de l’empire doit donc simultanément raconter le développement ascendant du christianisme. Je sais que plus d’un dans le dix-huitième siècle et de nos jours regarde ce développement comme un malheur et une chute ; pourtant c’est de là qu’est sorti le Moyen Âge catholique et féodal qui organisa l’Europe entière en une sorte de fédération et de corps politique. Derechef je sais que ce Moyen Âge est aux yeux de plusieurs un temps de ténèbres et de barbarie, digne d’être effacé des annales de l’humanité ; pourtant c’est de lui qu’est sortie par une évolution naturelle l’ère moderne, avec ses sciences, ses arts, ses lettres et ses révolutions. À ce dernier mot, on comprend que l’établissement du christianisme au quatrième siècle et son règne pendant le Moyen Âge n’eurent rien de définitif, et que les épreuves l’attendaient au moment où la société moderne émanait de celle qui l’avait préparée. C’est en cela que mes considérations sur l’ouvrage de M. Albert de Broglie diffèrent de la pensée qui l’a inspiré. Ce qui se fit au quatrième siècle est pour lui quelque chose d’absolu, pour moi quelque chose de relatif ; mais, pour tous deux, il est certain que la société païenne tombait par sa propre décadence, et que la société chrétienne s’élevait par sa propre croissance. L’historien, sans mépris pour ce qui tombe, doit suivre ce qui s’élève, quand ce qui s’élève s’unit par un lien manifeste à tout le développement ultérieur.
« J’ai entrepris, dit M. Albert de Broglie, de raconter et de mettre en regard, dans leur suite parallèle, la dissolution de l’empire et la croissance de l’Église, le déchirement de d’unité matérielle du monde et la formation contemporaine de leur unité morale. » Dans cette phrase, M. Albert de Broglie, donnant le plan de son livre, a, en même temps, marqué d’une main sûre le nœud véritable de cette grande histoire et l’intérêt suprême qui s’y attache. Cet intérêt est tout entier en ce spectacle d’une vie qui se retire et d’une vie qui arrive, en cette trame qui se dénoue et renoue simultanément, en cette correspondance de destruction et de rénovation qui nulle part ne peut être mieux étudiée que dans la chute graduelle du monde romain et l’élévation successive du christianisme. Faire autrement, c’est gravement pécher contre la première des lois historiques, sans laquelle les évènements ne paraissent plus que flotter et se suivre au hasard. Voyez Gibbon : certes ni l’érudition, ni la force de la pensée, ni le labeur, ni le talent ne lui ont manqué ; mais, par des motifs qu’il n’importe pas ici d’examiner, il n’embrasse que la moitié de son sujet, la décadence de l’empire ; l’autre moitié, la croissance de l’Église chrétienne, il ne la traite que comme une espèce d’accident, qui vint augmenter la désorganisation et ouvrir plus largement la porte à l’invasion des barbares. Aussi, quand on a tourné le dernier feuillet et fermé le livre, quelle est l’impression qui reste ? Celle que ressent le voyageur qui, longeant un de ces grands fleuves de l’Australie destinés à ne pas atteindre la mer, le voit s’épancher en des sables stériles, s’y amoindrir à mesure qu’il avance, et se perdre en d’impraticables marais.
Il n’en est plus ainsi quand, ne scindant pas l’histoire et sachant en saisir l’ensemble, l’enchaînement et l’harmonie, on ne se laisse pas aller en aveugle sur la pente de ce qui tombe. Au lieu de cette vue désolée d’une décadence sans ressources, au lieu de cette fin misérable d’une grande chose, on aperçoit des commencements qui promettent un avenir fécond. Et ce n’est pas un optimisme trop confiant qui cherche à se consoler et à se faire illusion ; la réalité historique elle-même, on la mutile quand on n’embrasse pas à la fois le double courant descendant et ascendant. Il n’est pas une ruine à côté de laquelle ne s’élève un nouvel abri ; plus la destruction se hâte, plus la restauration devient active ; et quand, finalement, les destins de Rome impériale sont accomplis et que, comme pour la Troie du poète dont tous les débris fument à terre, la poudre soulevée par ce grand écroulement s’est dissipée, le christianisme a complété sa conquête du monde romain, et l’Église siège au faîte du pouvoir spirituel. M. Albert de Broglie a fait une juste et vraie comparaison de cette croissance avec celle de l’arbre gigantesque qui sort de son germe : « La plante, dit-il, aspire au ciel et s’étend dans l’espace par la seule vertu du principe organique qui réside en elle. Son unité, déjà tout entière dans la semence, s’épanouit, sans s’altérer ni se diviser, dans la plus riche végétation. L’ancienne colline que couvrait le palais des Césars n’est plus aujourd’hui qu’un amas de pierres informes et dispersées ; mais, sur ces ruines, quelque graine portée par le vent est venue un jour se déposer. Peu à peu la graine s’est fait arbre, et depuis le premier moment de sa croissance jusqu’à son complet développement, depuis la racine jusqu’à la cime, sur tous les points du cercle immense décrit par les rameaux, c’est le même suc vivifiant qui la parcourt et l’anime. » M. Albert de Broglie s’arrête là et veut voir dans Rome et son empire non un grand corps organique qui vieillit et succombe, mais une simple juxtaposition de parties qui se dissout. À tort selon moi ; Rome aussi naquit d’un germe ; quand la sève manqua à l’arbre, son feuillage se sécha, ses rameaux arides s’étendirent en vain dans l’espace, ses racines pourrirent dans le sol, et la tempête, accourant du fond du Nord, ne tarda pas à le renverser.
Ce fut Auguste qui effectua la transformation de la république en empire. Que cette transformation ait été faite avec adresse et accueillie avec faveur, c’est ce qui ne peut être l’objet d’aucune controverse. Je n’invoquerai pas les flatteries qui lui furent adressées ; car quel est le souverain absolu, ou, comme disait le rhéteur romain, quel est l’homme commandant à trente légions qui ait manqué de flatteurs ? Je me bornerai à citer la phrase concise de Pline qui juge les empereurs avec une très grande liberté d’esprit, et qui dit d’Auguste : « Il donna la couronne rostrale à Agrippa ; lui reçut du genre humain la couronne civique (Civicam a genere humano occepit ipse). » Ce fut certainement le sentiment général des contemporains, sauf de ceux qui regrettaient la liberté politique, désormais irrévocablement anéantie pour Rome et l’empire.
Ce sentiment, inspiré par la fatigue des convulsions civiles, était une erreur ; l’évènement le prouva. Pour le montrer, je n’ai aucun besoin d’invoquer les ébats sanguinaires des Césars, les armées se disputant l’empire, les insurrections des provinces, le fardeau croissant des taxes, le désespoir des classes imposables, la décadence des lettres et des arts. C’étaient là des symptômes graves d’une situation dangereuse ; mais cette situation pouvait avoir ses remèdes en elle-même. Déjà Pline l’Ancien, esprit dégagé de tous les préjugés entretenus parmi ceux qui regrettaient l’ancienne république, avait remarqué qu’après tout, ce qu’il appelait vita et ce que nous appellerions civilisation n’avait cessé de faire des progrès ; et le christianisme préparait dans le silence une religion, une morale, des lettres et des arts qui allaient bientôt resplendir. Une transformation laborieuse et profonde s’opérait sous le sceptre des Césars, sans qu’ils en eussent conscience ; et les maux qui éclataient de toutes parts au sein de cet immense empire étaient réparables. Aussi le véritable grief de l’histoire contre le régime impérial, c’est d’avoir laissé forcer les barrières par l’invasion barbare, d’avoir permis que les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs, les Suèves, les Lombards se soient établis en vainqueurs sur le sol romain, et que des chefs barbares soient devenus les rois et les seigneurs des populations romaines. S’il avait bravement et heureusement défendu le territoire et empêché le dieu Terme de la vieille Rome d’être renversé et foulé aux pieds, il aurait accompli son premier devoir ; et, aux plus sévères jugements de l’avenir, il eût toujours pu répondre qu’il n’avait pas failli à sa tâche et qu’en finissant il livrait aux destinées futures le monde romain tel qu’il l’avait reçu ; que c’était aux chrétiens, destructeurs du paganisme, aux nationalités nouvelles, héritières des anciennes, à saisir la direction des choses ; et que, quant à lui, il transmettait à ses successeurs tous les éléments de puissance et de civilisation. Mais cette grande et décisive apologie, il n’a pas à la donner. Tout absolu qu’il était à l’intérieur, il se trouva faible à l’extérieur. Aucun souvenir reconnaissant ne survécut à sa chute. Au lieu de recevoir son héritage dûment conservé par un pouvoir efficace, la société, passant des siècles à en recueillir les débris, reprit tardivement le cours de sa fortune ultérieure et de son développement.
L’empire, devant avoir une si misérable issue, a donc été, tel qu’il fut constitué, une mauvaise solution du terrible conflit qui mit fin à la république ; et, sans donner raison à ceux qui, dans les plaines de Pharsale et de Philippes, luttèrent contre lui, puisque nous ne savons ce qu’ils auraient fait de leur triomphe, l’histoire est pleinement autorisée à condamner ceux qui, vainqueurs, organisèrent leur succès définitif. On a souvent signalé et loué le procédé qu’Auguste employa pour transformer la république en empire ; tout bien considéré, on n’y peut louer que de l’adresse et un expédient, mais rien qui ressemble à une organisation véritable. L’apparence de la république demeura, peuple, sénat, consuls, magistratures ; seulement, derrière cette apparence, se trouvait un homme qui, revêtu de toutes les dignités républicaines et de leurs pouvoirs réunis, ne laissait au reste qu’un simulacre d’autorité. Évidemment, la république, toute morte qu’elle était, s’imposa à l’esprit d’Auguste, et, comme le Mézence de la Fable qui :
il joignit étroitement à ce qui ne vivait plus, ce qui, dans son espoir, devait vivre à jamais sous l’abri du Capitole. Les conditions de l’empire se trouvèrent liées à celles de la république ; il n’y eut plus moyen de passer à la monarchie ; et la domination des empereurs ne fut qu’une longue dictature à laquelle l’invasion des barbares mit un terme. Sans doute, en tout état de cause, il fallait bien que l’empire fût une certaine continuation de la république ; et, vu la subordination où le présent est à l’égard du passé, il ne pouvait pas en être autrement. Mais bien des voies différentes étaient ouvertes à cette nécessaire continuation ; et si, par exemple, les gens de Pompée et de Brutus avaient triomphé, les choses n’auraient pas suivi le même cours, un cours meilleur ou plus mauvais, nous ne savons, mais autre certainement. Les successeurs de la république, quels qu’ils fussent, devaient toujours avoir à compter avec deux forces qui allaient se faire sentir puissamment, le christianisme et les barbares d’outre-Rhin. L’empire, de païen qu’il était au début, se trouva chrétien au terme : c’était bien, et, de ce côté, on n’a rien de plus à lui demander ; mais, de romain qu’il était, il se trouva barbare, ce fut une honte et un malheur.