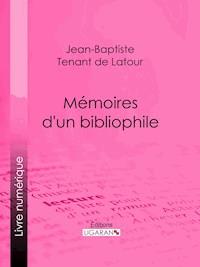
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Madame, Jean-Jacques Rousseau a dit quelque part que si jamais il était renfermé dans une prison d'Etat, il prendrait ce moment pour peindre le bonheur d'être libre. Tout le monde sait, en effet, que les biens dont on sent le plus vivement le pris, et par conséquent, dont on parle avec le plus de chaleur, sont ceux que l'on a perdus."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le C…, décembre 1838.
Madame,
Jean-Jacques Rousseau a dit quelque part que si jamais il était renfermé dans une prison d’État, il prendrait ce moment pour peindre le bonheur d’être libre. Tout le monde sait, en effet, que les biens dont on sent le plus vivement le prix, et, par conséquent, dont on parle avec le plus de chaleur, sont ceux que l’on a perdus. Certes, lorsque, à la suite de quelque station dans une de ces librairies plus particulièrement formées d’éditions rares, ou après une longue exploration de la plupart des étalages de nos quais, je regagnais mon abri des Ternes, muni d’un nouvel Elzévir, d’un nouveau Blaeu, de bien moins que cela, je n’aurais pas songé à écrire des lettres sur la bibliographie. Je songeais alors à jouir, non à raconter mes jouissances ; j’avais, en même temps, le bonheur et le calme de la possession, que rien, dans l’avenir, ne me semblait devoir jamais troubler. Aujourd’hui, à cent lieues de Paris, ne pouvant plus recommencer, chaque matin, la monotone, mais délicieuse journée de l’amateur de livres, mon esprit est presque exclusivement occupé des douceurs de mon ancienne et charmante vie. Mes nuits mêmes ne sont pas toujours exemptes de ces retours. J’en rêve, dit-on proverbialement et par figure : eh bien ! moi, j’en rêve à la lettre. Combien de fois ne me suis-je pas vu, en songe, allant, comme jadis, par une belle soirée d’automne, du voisinage de la Cité au Pont-des-Arts, et du Pont-des-Arts au bout de la grande rue provisoire du Carrousel ! Je vais fouillant dans toutes les échoppes, feuilletant, pour la cent et unième fois, les livres que j’ai déjà cent fois feuilletés. Je m’arrête plus longtemps qu’ailleurs devant tel étalage qui avait, à bon droit, mes plus grandes préférences. On m’indique du doigt un livre offert, sans doute pour la première fois, aux chalands. Je ne vois que bien imparfaitement à travers les vapeurs du songe, mais sûrement c’est un trésor. Je retrouve avec bonheur toutes les figures de ces braves gens que j’ai si longtemps pratiqués. Je vois parmi eux, amené là aussi par suite d’anciennes et douces impressions, tel de nos grands libraires qui serait probablement bien choqué que, même en rêve, que, même par l’effet du plus tendre souvenir, j’eusse pu le supposer en si modeste compagnie. Je marche toujours, j’achète toujours, enfin je me vois montant dans l’omnibus du Roule, je m’y place de manière à pouvoir examiner, tant bien que mal, tout ce que je viens de recueillir ; et… je m’éveille en sursaut, à la première chute d’un des nombreux volumes dont je me sentais si doucement chargé.
Cependant que sommes-nous, faibles humains, dans nos prévisions ? J’avais toujours envisagé comme l’époque du véritable et tranquille bonheur celle à laquelle je me trouve arrivé, à la vérité un peu trop tôt et malgré moi. J’ai transporté toutes mes richesses bibliographiques sous le feuillage de mes vieux châtaigniers, fort étonnés, me disait plaisamment mon si spirituel ami, M. de Feletz, d’abriter tant de belles choses. Je vis entouré de mes proches, de mes plus vieilles relations, et dans un pays où La Fontaine a reconnu que les hommes d’esprit ne manquent pas. Je jouis même de mes livres, à proprement parler, plus que je ne l’eusse fait jusqu’ici, puisque, en définitive, j’ai plus de temps à leur donner. Mais, hélas ! plus de bibliophiles, plus de libraires instruits, plus de gens qui parlent cette langue du petit nombre des élus ! Que je serais heureux d’avoir, au moins quelquefois, sous ma main, le plus ignorant de mes chers bouquinistes, le plus froid, je n’ose dire le plus raisonnable, de mes confrères ; de pouvoir leur montrer en détail, de pouvoir leur faire apprécier mes anciennes éditions, mes exemplaires de choix, mes Volumes couverts de notes marginales ! il me semble les voir s’extasiant sur ces marges de la plus belle grandeur, sur cette magnifique reliure en vieux maroquin du Levant, et je m’évertue à multiplier leurs surprises, car, ainsi que l’a très bien dit Charles Nodier, après le plaisir de posséder des livres, il n’y en a guère de plus doux que celui d’en parler.
J’ai donc besoin de parler livres, Madame, et, à défaut d’interlocuteur qui les aime à notre manière et qui les connaisse par où nous les connaissons, c’est vous que j’ai résolu de poursuivre de mes souvenirs ; de mes souvenirs du passé, de mes impressions du présent, car le goût des livres est un sentiment que rien ne vient altérer ou suspendre, et qui tient constamment celui qu’il anime dans un état de mouvement moral. Ce sentiment craint aussi, par sa nature, tout assujettissement à une froide régularité. En effet, comment mettre, dans les plaisirs de l’esprit, une suite méthodique, et quel amateur voudrait jouir de ses livres dans l’ordre rigoureux de son catalogue ? Je passerai donc très librement, et presque au hasard, d’un sujet à un autre, sans me préoccuper, en aucune façon, du livre dont je vous aurai parlé la veille, et sans prévoir le moins du monde celui dont je pourrai avoir à vous parler le lendemain. Boileau a dit que la plus grande difficulté d’un ouvrage est celle des transitions. Si jamais ma correspondance avec vous devient un ouvrage, l’on pensera peut-être que j’ai voulu me débarrasser d’avance de cette grande difficulté. Non, cela tient à la nature même des choses qui commande impérieusement la variété. C’est ici une véritable conversation : je viens causer livres comme nous pourrions le faire dans la rue Royale, au coin de votre feu, illusion à la fois triste et douce dans l’isolement littéraire où les évènements publics m’ont jeté. En un mot, je veux tout simplement faire avec vous le tour de ma bibliothèque, comme M. de Maistre a fait celui de sa chambre. Je sais bien qu’il y manquera toujours le talent aimable, l’inimitable talent qui a fait l’immense succès de l’autre voyage, mais votre indulgente amitié ne m’en demande pas tant. D’ailleurs, je n’ai pas besoin des mêmes ressources dans l’esprit pour donner un peu d’intérêt aux détails de mes explorations, j’ai à parcourir un pays bien autrement fécond en choses curieuses, et si mes observations restent, comme elles doivent le faire, bien loin au-dessous de celles de l’illustre voyageur, j’ai du moins la ferme confiance de faire dans ma course de meilleures rencontres que lui.
Agréez, etc.
Rien ne prouvé mieux, Madame, qu’il s’agit ici, non pas d’un livre plus ou moins didactique, mais d’une simple causerie, que l’abandon avec lequel j’ai laissé tomber dans ma première lettre, comme je l’eusse fait de mots universellement connus, ces noms à demi barbares d’Elzévir, de Blaeu, etc. C’est que je savais parfaitement que des lectures variées, des conversations d’hommes instruits vous avaient appris, depuis longtemps, ce que c’était que ces mots-là, et que vous ne les prendriez pas pour des termes de chimie. J’aurais pu faire également (et je ne m’en gênerai point par la suite) des citations anglaises, italiennes, et même… latines. Ce dernier mot, je le dis tout bas parce que c’est un secret que j’ai surpris, un secret que vous cachiez avec soin, surtout aux dames de votre société, quoique fort capables d’apprécier tous les genres de mérite. Ainsi, sans m’inquiéter, en aucune façon, des expressions plus ou moins techniques dont je suis parfois obligé de me servir, notamment dans quelques déductions élémentaires que je crois convenables ici à certains égards, je vais entrer piano pede en pleine voie bibliographique. Seulement, je prendrai garde de trop céder au penchant qu’à tout homme qui écrit sur un sujet qu’il affectionne particulièrement à s’étendre outre mesure, et je m’efforcerai de ne pas oublier ce que je désire aussi que personne n’oublie, savoir que je ne fais de la bibliographie ni pour les bibliographes de profession, ni même pour les bibliophiles d’une certaine force, mais pour quelqu’un qui en sait à peu près autant que moi, pour des lecteurs disposés à l’indulgence parce qu’ils en savent un peu moins, et surtout pour mon plaisir.
Commençant donc, ainsi que le veut un axiome vulgaire, par le commencement, mais sans remonter aux temps où l’on n’avait de livres qu’en formant des manuscrits, ce qui rentre dans la science bibliographique par un côté trop ardu ; commençant, dis-je, par le véritable commencement, je remarquerai que l’imprimerie, inventée vers le milieu du XVe siècle par Gutenberg, Fust et Schœffer, suivant les uns, ou seulement perfectionnée par ces trois grands artistes, suivant ceux qui veulent que l’invention première appartienne à Laurent Coster, a fait depuis, d’immenses progrès, tant en France qu’à l’étranger, sous les Aides, les Elzévirs, les Estiennes, les Barbou jusqu’à Ibarra, aux Bodoni et à nos Didot. Vous comprenez. Madame, que je ne rappelle ici que quelques noms formant jalons dans la marche progressive de l’imprimerie, ou plutôt, suivant mon objet particulier, une partie de ceux qui reviennent le plus souvent dans la langue des bibliophiles, ceux qui sont restés rattachés à un plus grand nombre d’éditions ou à des éditions plus renommées ; ce qui ne m’empêchera peut-être pas, dans le courant de ces lettres, de vous recommander, parfois, telle édition d’un imprimeur ou d’un libraire moins connu, comme supérieure à celles des imprimeurs-libraires dont je viens d’enregistrer les noms. En bibliographie, plus peut-être qu’en toute autre chose, les règles générales ont leurs exceptions.
Mais j’ai dû d’autant plus procéder comme je l’ai fait, Madame, et débuter par jeter ici ces vieux noms, ces noms si révérés parmi nous, que c’est surtout à l’ancienne librairie que s’applique plus généralement un des grands faible de l’amateur des livres, celui de faire des collections. Ici je suis obligé en conscience (et cela pourra bien, hélas ! m’arriver encore d’autres fois) d’abandonner aux attaques des profanes de bon sens certaines tendances un peu exagérées des membres de notre ordre. Par exemple, il est parfaitement bien vu, assurément, de faire des collections d’historiens, des collections de moralistes, de poètes tragiques, comiques, érotiques même. Outre que souvent les uns se complètent par les autres, outre qu’il est permis d’aimer à étendre, à varier ses possessions, toute comparaison appartient, de droit, à la littérature, et il convient que la bibliothèque d’un ami des lettres fournisse de nombreux moyens de comparaison. Mais faire une collection de tous les ouvrages disparates, et en différentes langues, connues ou non du collecteur, publiés par le même typographe, au hasard d’y rencontrer au premier rang, comme dans les publications des Elzévirs, Chapelain, Brébeuf, Cotin, et autres ejusdem farinæ, c’est ce que, par un esprit de confraternité, ou peut-être par un humble retour sur moi-même, j’ai appelé un faible, mais ce que vous avez sûrement bien envie vous, Madame, d’appeler autrement. Au reste, comme la même maladie n’a pas toujours le même, degré d’intensité, l’un se contente de rassembler les quatre-vingts volumes qui sont l’œuvre authentique des Elzévirs ; mais un autre vient y joindre tous les ouvrages qui, sans porter leur nom, sont sortis de leurs presses ; un troisième, un quatrième veulent aussi les livres imprimés avec les caractères elzéviriens, publiés par des parents, par des voisins de ces célèbres imprimeurs. Enfin, il en est qui ne seraient point complètement satisfaits s’ils ne possédaient pas jusqu’aux faux Elzévirs ; et c’est ainsi que, de proche en proche, la collection se monte aujourd’hui à plus de quinze cents volumes : sommes-nous assez fous !
Cette ardeur des collections, du moins en ce qui touche la forme, les caractères, la disposition générale et le nom, s’attache plus particulièrement aux Elzévirs. En effet, l’on ne croit pas valoir beaucoup mieux qu’un autre parce qu’on possède dans sa bibliothèque un grand nombre de Baskervilles, un grand nombre de Blacus, ou parce qu’on a la collection entière des Barbous, c’est-à-dire des ouvrages latins donnés par cet imprimeur dans le format in-12 avec une reliure uniforme, ou la collection entière des Variorum, c’est-à-dire des ouvrages publiés in-8°, cum notis variorum, avec les notes des différents commentateurs ; les Elzévirs, les Elzévirs ! voilà ce qui fait le fond et le grand prix des anciennes bibliothèques ; les Elzévirs ! c’est là le mot sacramentel, le véritable mot de passe des amateurs, et c’est aussi celui qui leur est habituellement jeté dans le monde, avec l’ironie si plaisamment caractéristique des ignorants, par ceux qui veulent faire semblant de rire des jouissances qu’ils ne sont pas en état de partager.
Dieu me garde, Madame, de vouloir vous exposer, en détail, les dates, les fleurons, les devises qui servent à distinguer les bons Elzévirs des Elzévirs moins parfaits : c’est une étude qui n’est pas médiocrement compliquée, une étude toute spéciale, et, si le cœur vous en dit, vous trouverez à la fin du Manuel du libraire et de l’amateur de M. Brunet, des notices faites comme tout ce que fait notre premier bibliographe sur les éditions des Elzévirs, d’Abraham Wolfgank, etc. M. Bérard, connu depuis dans le monde politique, et amateur fort distingué, a publié aussi d’excellentes recherches sur les Elzévirs ; enfin, on trouve en tête des Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, de Charles Nodier, une théorie des éditions. Elzéviriennes, morceau qui commence très heureusement un livre dont je vous parlerai peut-être encore plus d’une fois.
Je me bornerai donc à vous dire ici, Madame, qu’on reconnaît les bons Elzévirs, ainsi que beaucoup d’autres bonnes choses, au premier aspect. Ce n’est pas, en effet, une correction tout à fait hors ligne qui distingue ces éditions, c’est, avant tout, comme je l’ai déjà remarqué la beauté des caractères et du tirage ; pour peu qu’on ait d’usage à cet égard, dès qu’on est frappé à première vue de la belle exécution d’un Elzévir, l’on n’a qu’à recourir à son Brunet ; l’on reconnaît que l’on tient la bonne date. Les Barbous, ont aussi leur bonne date et leur date moins bonne, ainsi de tous les autres. Quand je dis, au surplus, que les éditions des Elzévirs ne se distinguent pas précisément par une plus grande correction, je n’entends pas les comparer aux éditions ordinaires. Celles des Elzévirs, celles des Barbou, les Variorum, etc., présentent généralement des textes corrects ; mais Robert Estienne, savant distingué en même temps qu’habile imprimeur, est, parmi les anciens, le seul de son état qui ait fait d’une correction rigoureuse le mérite fondamental de ses éditions. C’est aussi le premier qui, avant tout, désirant ne propager aucune erreur, et sans craindre de révéler celles qui avaient pu échapper à ses protes, a donné des errata, c’est-à-dire une liste des fautes d’impression contenues dans les livres qu’il publiait. Mais cet hommage rendu à la loyauté du savant Robert Estienne ne sera pour vous, Madame, d’aucun intérêt usuel. Les Estiennes, surtout celui-ci, n’ont guère travaillé que pour les grandes bibliothèques ; leurs publications sont, en général, d’énormes in-folio qu’il vous serait impossible de faire mouvoir, et que vous auriez, d’ailleurs, une trop grande crainte de voir surprendre dans votre cabinet de toilette par quelqu’une des belles dames à qui vous cachez que vous savez le latin.
Ainsi donc, Madame, des collections plus ou moins étendues, plus ou moins complètes, des éditions plus ou moins belles, plus ou moins recherchées ; un grand choix d’ouvrages en un seul volume, ce qu’en termes du métier on appelle des unités ; quelques volumes dits particulièrement uniques au moyen d’adjonctions spéciales ou d’autres singularités ; des manuscrits en petit nombre, mais se recommandant par les grandes qualités du genre ; surtout autant de raretés, qu’on le peut, n’ayant souvent, hélas ! que ce seul mérite ; voilà ce qui fait principalement l’objet de nos soucis, de nos recherches, de nos affections. Si tous ajoutez à tout cela des gravures soignées, qui, dans quelques circonstances, et lorsqu’elles ont été prises au sérieux, fournissent des renseignements remplis d’intérêt sur les costumes, sur le goût, presque sur les mœurs du temps ; de belles marges ! autre mot de passe dont on tient grand compte, spécialement quand il s’agit de vieux livres ; enfin, tant comme complément nécessaire que comme moyen de conservation, de belles et bonnes reliures, des reliures avouées par le bon goût ; vous aurez presque tout l’ensemble d’une bibliothèque d’amateur.
Seulement, je ne saurais assez vous le répéter, Madame, je parle, je cause livres, je jouis des joies de toute ma vie, mais ce n’est point ici la science proprement dite, c’est ailleurs qu’il faut la chercher. Si, donc mon bavardage bibliographique ne vous suffit pas, ou plutôt s’il vous fait venir le goût de la chose, placez au premier rang de vos livres, pour les feuilleter sans cesse et les refeuilleter en toute occasion : la Bibliographie instructive de Debure, le Dictionnaire des Anonymes du savant Barbier, les différentes publications sur la matière de notre excellent ami, l’excellent maître de mes fils, feu Gabriel Peignot, celles de MM. Beuchot, Guérard et autres ; enfin, comme le bréviaire obligé du bibliophile, l’ouvrage déjà cité ici et qui continuera de l’être à toutes les pages, le Manuel du libraire et de l’amateur de livres de M. Brunet. Je dirai plus : quand même vous ne voudriez pas faire une étude approfondie de la bibliographie, ou précisément parce que vous ne voudriez pas approfondir cette étude, ce livre doit être le vôtre de tous les moments. Il est en forme de dictionnaire, et, sans aucun effort, sans aucune peine, l’on peut se fixer, en quelques minutes, sur l’édition la plus parfaite, sur toutes les circonstances d’exécution et sur les prix variés d’un livre, plus ou moins avantageusement connu. Il n’est pas besoin de n’être qu’une femme aimable et spirituelle pour se contenter de ces résultats.
Il me reste encore, malgré tout, Madame, et même en voulant me renfermer dans les limites d’une conversation bibliographico-littéraire, il me reste encore à effleurer quelques sujets qui se rattachent de très près aux principaux éléments d’une bibliothèque d’élite. Je reviendrai aussi avec un peu plus de détail sur certains points purement matériels ; car, tout en repoussant de ma plus vive conviction le culte excessif de la forme extérieure des livres, je suis obligé de reconnaître que la bibliographie, à quelques égards, la tient en très grande et très juste considération.
Agréez, etc.
Le C…, 25 septembre 1839.
Je n’y saurais tenir plus longtemps. Madame ; il faut que je suspende un peu le cours de nos développements préliminaires pour vous parler de l’admirable résultat d’un rapprochement de dates que je viens de faire tout récemment. Il y a d’autant plus d’urgence que c’est, en quelque sorte, le dénouement d’une petite anecdote en fait de bouquins, que déjà vous connaissez. Mais, comme le public ne la connaît pas, lui, et comme il est convenu que nous devons, un peu plus tôt ou un peu plus tard, lui proposer de lire ces lettres, je vais, ainsi qu’il est d’usage sur notre scène, faire comme si vous ne saviez rien de tout cela, et vous raconter à vous-même mon ancienne découverte, pour arriver ensuite à celle qui date seulement de trois jours.
Vous vous souvenez donc, Madame, ou peut-être ne vous souvenez-vous plus que, vers 1827, me promenant sur un de mes quais d’affection, le quai du Louvre, je remarquai, au milieu des volumes d’une échoppe, le titre latin d’une Imitation de Jésus-Christ. Je n’ouvrais guère ce livre, en pareille rencontre, que lorsque le petit format carré long pouvait me faire espérer un Elzévir. Cependant, ce jour-là, soit que j’eusse un peu plus de temps à ma disposition, soit tendance naturelle à ne rien laisser derrière moi sans y avoir jeté un coup d’œil, je pris le petit volume, en apparence vrai meuble de séminariste, et je l’ouvris machinalement.
C’était, en effet, une édition assez commune de Paris, chez Lemercier, 1751 ; la croix ordinaire, avec quelques accessoires, figurait sur le frontispice ; mais immédiatement au-dessus on lisait ces mots autographes : À J.-J. Rousseau.
Je restai immobile d’étonnement, et aussi d’un plaisir que vous vous imaginez, vous qui connaissez (par moi du moins) tous les enfantillages de notre état. Il m’était impossible de méconnaître l’écriture de Rousseau, qui m’est si familière ; cependant, malgré ma certitude à cet égard, après avoir payé ma découverte soixante-quinze centimes, je pris par le Pont-des-Arts, dont je me trouvais alors peu éloigné, et je me dirigeai vers la rue des Marais-Saint-Germain, qu’habitait mon excellent relieur, l’honnête Messier, chez qui j’avais, dans ce moment, un exemplaire des Œuvres de Jean-Jacques Rousseau où se trouvait le fac-similé d’une de ses lettres : j’étais pressé de comparer.
J’avais fait à peine vingt pas sur le pont, tout en feuilletant le précieux volume, que déjà je lisais à la marge d’une page ces deux lignes traduites d’un demi-paragraphe du livre Ier, chapitre X : « Puisqu’il nous est si rare de nous taire avant d’avoir blessé notre conscience. » Le doute n’était plus possible ; l’écriture de Rousseau était là dans toute sa caractéristique netteté. J’allais, je feuilletais toujours, remarquant que la plus grande partie du volume était soulignée, mais ne trouvant plus rien d’écrit à la main. Enfin, au bas d’une page, livre II chap. IX, je vois les quatre derniers mots de cette phrase « Nec caro adhuc mortua est, » effacés au crayon, et, au-dessous, la phrase écrite par Rousseau de la manière suivante : « Nec homines mali mortui sunt. » Là se révélait le misanthrope tout entier : c’était, assurément, une grande preuve morale de plus, c’était un nouveau sujet d’enchantement.
J’arrive chez Messier, où je reçois par le fac-similé une confirmation devenue inutile ; de là je retourne rue Coq-Héron, avec une espèce de vertige que cinq ou six hommes comprendront, seuls, à Paris ; je monte le grand escalier, toujours sous la même impression ; j’ouvre et referme les portes avec fracas, et je me précipite enfin dans le cabinet de notre adorable marquis de V… r, qui était assis au coin de son feu, devant ce petit bureau qu’il me semble voir d’ici, ce petit bureau dont le seul souvenir me cause encore, dans ce moment, pour son propre compte, de bien autres palpitations de cœur !
Mon excellent patron s’attendait sans doute à quelque rapport d’urgence : il laisse son travail pour m’écouter, tandis que moi, la figure radieuse, la parole entrecoupée, je m’écrie tout triomphant, et en mettant mon livre ouvert devant lui : « Qu’est-ce que cela ? »
M. de V… r, avec son calme habituel ce calme qu’il conserva même sous le poids de la plus inique persécution morale qui fut jamais, me répond : « C’est la signature de J.-J. Rousseau. » Il connaissait parfaitement son écriture, qu’il avait souvent eu occasion de voir dans les manuscrits autographes déposés à la bibliothèque du Corps législatif, et ailleurs. Je lui montrai ensuite les quelques lignes écrites en marge : c’était flagrant. Nous remarquâmes ensemble les mots et les phrases sans nombre qui étaient soulignés. « Voyons, dit M. de V… r, ce qu’un protestant aura pu souligner dans le quatrième livre, tout entier sur la présence réelle ? » Rien, en effet, ou presque rien ; le protestant n’avait souligné que quelques mots étrangers au dogme, et ce fut là naturellement une seconde preuve morale jointe aux preuves matérielles qui témoignaient déjà en faveur de l’authenticité de mon nouveau trésor.
– Voyez, voyez donc, m’écriais-je toujours, ce livre était pour lui un vade mecum de toutes les heures ; il le lisait la nuit, car voilà quelques gouttelettes de cire ; il le portait aux champs, car voilà une ou deux fleurs desséchées ; conçoit-on qu’il n’ait jamais rien dit d’un livre dont il ne se séparait pas un instant ? Autant qu’il m’en souvienne, le nom de l’Imitation n’est pas même prononcé une seule fois dans ses nombreux écrits. Dès demain je porterai mon petit, volume à l’historien de Rousseau, M. de Musset-Pathay, à son savant ami, M. Beuchot ; quel inépuisable sujet de réflexions en tous genres ! quelle heureuse matière pour quelques-uns de nos entretiens du soir ! Que je vais causer d’admiration ! que je vais faire de jaloux !
Et le meilleur, le plus vertueux des hommes, que rien n’agita jamais pour ce qui le touche personnellement, souriait à ma folle joie ; car il est toujours le plus heureux de ce qui, dans les petites comme dans les grandes choses, procure quelque plaisir à ceux qu’il croit mériter un peu de son amitié.
Ce premier effet produit, je courus porter ma conquête chez tout ce que j’avais d’amis particuliers sous le même toit. M. de Ranc…, Madame, cet admirable appréciateur de tout ce qui tient aux lettres, et qui les cultive, sans mot dire, avec tant de succès, reçut naturellement la seconde explosion de mon bonheur, de là j’allai chez son excellent frère, que nous avons tant pleuré depuis ! C’était là que m’attendait une troisième preuve morale, qui, assurément, était sans nécessité, mais qui, comme vous allez le voir, n’était pas sans poésie.
Auprès de ce pauvre Henri se trouvait, au moment où j’entrai, notre collègue Le F… Le livre vint, à son tour, dans ses mains ; il en tourna quelques feuillets, et, du ton de quelqu’un qui produit un dernier motif de conviction, il nous dit : « Et de la pervenche ! »
Je ne connaissais pas la pervenche, et je n’avais vu, jusque-là, dans la petite fleur qui était sous mes yeux, qu’une raison de penser que Rousseau portait ce livre avec lui lorsqu’il allait à la promenade ; mais, à ces derniers mots, ce fut de ma part, et aussi un peu, en vérité, de la part de ceux qui étaient présents, des cris répétés de surprise et de plaisir. Rousseau, à ce qu’il paraissait, avait continué son culte à la pervenche, puisqu’il la recueillait et la conservait ainsi en toute occasion. J’aurais volontiers embrassé Le F… ; cependant je lui en voulais un peu de ce qu’il n’avait pas dit précisément comme Rousseau lui-même : « Ah ! voilà de la pervenche ! » Enfin, je reprends mon volume, et j’achève d’en faire les honneurs dans la maison, particulièrement à M. R…r, jugé si compétent sous tous les rapports. Ce fut assurément un jour bien heureux dans ma vie, un jour rempli de surprises plus agréables les unes que les autres, mais dont, malgré moi, je prolongeai un peu trop le charme en ne fermant pas l’œil de toute la nuit.
Bientôt le bruit de ma découverte se répandit dans tout le petit cercle des bibliophiles. Chacun, selon l’usage, l’estimait plus ou moins, suivant ses goûts particuliers. M. de Musset-Pathay regrettait vivement de n’en avoir pas eu connaissance avant la publication de son Histoire de la vie et des ouvrages de Rousseau. « Combien tout cela donne à penser ! répétait-il comme moi ; voyez donc ! Rousseau n’a jamais dit un mot de ce livre ! » Et cependant la mémoire de M. de Musset le trompait alors, ainsi que les nôtres, comme vous le verrez dans la suite de cette narration.
Enfin la petite rumeur de surprise et d’admiration qui s’était élevée entre deux ou trois libraires et cinq ou six amateurs finit par se calmer entièrement, comme il arrive de tous les bruits de ce monde. Je me gardai bien de faire mettre une reliure nouvelle à mon cher petit volume ; je le conservai in puris, tel qu’il était sorti des mains de Rousseau ; seulement je lui fis confectionner un bel étui en cuir de Russie, et je le plaçai sur le rayon de ma bibliothèque le plus apparent, sur celui qui contenait le plus de choses précieuses dans le même format. Quelques années plus tard, il m’accompagna dans ma solitude, pour y figurer parmi mes plus douces consolations. Il ne tarda pas à remplir aussi la destination que lui avaient assignée d’avance, comme à toutes mes autres raretés, les amis dont je m’éloignais avec tant de regret. Il fut visité par le vieux pasteur du lieu, par un ou deux grands chasseurs du voisinage, par quelques autres encore. Il lui vint même, avec le temps, de plus chauds admirateurs : devant son orgueilleuse tablette s’arrêtèrent parfois d’aimables Parisiens, quelques jolies Parisiennes, des hommes de lettres distingués ; bref, je croyais que nous étions parvenus, lui à l’apogée de sa gloire, et moi au comble de ma satisfaction. De temps à autre, lorsque j’étais rendu à mon isolement, je le regardais avec amour je cherchais de nouveau les lignes autographes, je jetais un coup d’œil sur la pervenche, je flairais le volume, et tout était dit. Je ne supposais pas que dans ce bas monde il fût permis aux joies du bibliophile d’aller encore plus loin.
Mais nous voici enfin, Madame, à la dernière péripétie de cette histoire, que les profanes auront trouvée beaucoup trop longue, sans doute, tandis que, soutenue par des souvenirs qui nous sont communs, vous m’avez déjà pardonné tous mes détails. Cette péripétie est double, et c’est sa seconde moitié qui a eu le pouvoir de me faire faire un pas de plus dans les folles extases de l’amateur. Voici la première : Il y a deux ou trois jours seulement que, parcourant le premier volume des Œuvres inédites de Jean-Jacques, publiées dans le temps par M. de Musset-Pathay, je tombai sur une lettre adressée de Motiers-Travers au libraire Duchesne, le 20 janvier 1763, et vers la fin de laquelle Rousseau écrivait ce qui suit : « Voici des articles que je vous prie de joindre à votre premier envoi :
Pensées de Pascal, Œuvres de La Bruyère, Imitation de Jésus-Christ, latin. »
Ce fut d’abord là, pour moi, un trait de lumière. Il devenait évident que l’attention particulière donnée par Rousseau à l’Imitation de Jésus-Christ ne datait que de son exil, époque à laquelle il avait cherché sans doute, dans cette lecture, quelque consolation à ses malheurs. Mais la plupart de ses œuvres avaient alors été livrées au public, et c’est là ce qui expliquait, de la manière la plus concluante, le silence qui, dans le temps de ma découverte, nous avait tous si fort étonnés. Musset-Pathay avait, lui, complètement perdu de vue la pièce inédite qu’il venait pourtant de publier tout nouvellement.
Voilà pour ce qui concerne principalement la partie bibliographique de cette lettre ; mais voilà maintenant aussi, Madame, ce qui tient, plus particulièrement à cette vie, à cette animation morale que chacun qualifiera comme il voudra, mais que je fais entrer, moi, vous le savez, pour une si grande part dans les ineffables jouissances du bibliophile : c’est la seconde moitié de la péripétie.
Vous sentez bien que, d’après mes dispositions d’esprit et de cœur, j’avais toujours regardé comme un des plus heureux accessoires de mon volume cette petite fleur desséchée qui avait manqué me causer autant d’émotion qu’à Rousseau lui-même, lorsque mon collègue Le F… s’écria comme lui « et de la pervenche ! » Tout prouvait que cette fleur était toujours restée la fleur de prédilection de Jean-Jacques, puisqu’il avait placé cet échantillon entre les pages d’un livre ami, et c’était bien déjà, quelque chose ; mais j’eus à peine entrevu cette demande à son libraire, et cette date de 1763, qu’il me revint dans l’esprit, comme un éclair, que c’était précisément vers cette époque, qu’en se promenant avec M. Dupeyrou, il avait aperçu la fleur que son exclamation a rendue depuis si célèbre. Je cours vérifier la chose avec une espèce de tremblement nerveux, et je trouve en effet ; au tome Ier des Confessions, livre VIe, ces ravissantes lignes que tout le monde a lues, que personne n’a oubliées, mais que j’éprouve un véritable bonheur à reproduire ici :
« Je donnerai de ces souvenirs un seul exemple qui pourra faire juger de leur force et de leur vérité. Le premier jour que nous allâmes coucher aux Charmettes, maman était en chaise à porteurs et je la suivais à pied. Le chemin monte, elle était assez pesante, et craignant de fatiguer ses porteurs, elle voulut descendre à peu près à moitié chemin pour faire le reste à pied. En marchant ; elle vit quelque chose de bleu dans la haie, et me dit : Voilà de la pervenche encore en fleur. Je n’avais jamais vu de la pervenche, je ne me baissai pas pour l’examiner, et j’ai la vue trop courte pour distinguer à terre les plantes de ma hauteur ; je jetai seulement, en passant, un coup d’œil sur celle-là, et près de trente ans se sont passés sans que j’aie revu de la pervenche, ou que j’y aie fait attention. En 1764, étant à Cressier, avec mon ami M. Dupeyrou, nous montions une petite montagne au sommet de laquelle il y a un joli salon qu’il appelle avec raison Bellevue. Je commençais alors d’herboriser un peu. En montant et regardant parmi les buissons, je pousse un cri de joie : Ah ! voilà de la pervenche ! et c’en était en effet. Dupeyrou s’aperçut du transport, mais il en ignorait la cause ; il l’apprendra, je l’espère, lorsqu’un jour il lira ceci. Le lecteur peut juger, par l’impression d’un si petit objet de celle que m’ont faite tous ceux qui se rapportent à la même époque. »
Qu’on imagine toute ma joie ! C’est en 1763 que Rousseau a reçu à Motiers-Travers l’Imitation de Jésus-Christ dont il avait fait la demande à Duchesne ; c’est en 1764 que, pour la première fois depuis qu’il a, quitté les Charmettes, il retrouve la pervenche, et il la retrouve à Gressier, dans le voisinage de Motiers-Travers, qu’il habitait encore ; c’est là, certainement, la même fleur qui lui arracha ce cri d’enthousiasme et de sympathique souvenir, la même qu’il a recueillie, qu’il a insérée dans le livre, alors son livre favori ; et c’est moi qui possède aujourd’hui cette merveilleuse fleur, la véritable pervenche, trésor inappréciable pour tout ce qui a reçu du ciel une certaine manière de sentir. Ne trouvez-vous pas, en effet Madame, qu’il y a là de quoi faire sécher d’envie les Charles Nodier, les Aimé Martin, les Guilbert de Pixérécourt, je veux dire les hommes d’esprit du métier, ceux qui ne se renferment pas uniquement dans la partie matérielle du goût des livres, et qui, faiblesse pour faiblesse, accepteront plus volontiers celle qui s’attache aux restes d’une, vieille fleur, espèce d’évènement moral dans la vie d’un homme célèbre, que celle qui se préoccupe d’une ligne de plus ou de moins dans la grandeur des marges d’un Elzévir ?
Au reste, cette découverte fut assez singulièrement pressentie dans le temps même où je fis la rencontré de ma précieuse Imitation. Parmi ceux des miens qui : m’entouraient alors, il s’en trouvait un, encore presque enfant, mais qui déjà manifestait des instincts poétiques. Il soutint, en riant, que c’était, sans aucun doute, la fleur même qui avait tant ému Rousseau. Les anciens attribuaient aux poètes le don de connaître l’avenir et les choses cachées. Cette fois-là, du moins, le jeune poète avait deviné.
Je crois avoir porté à un assez haut degré de certitude la petite démonstration dans laquelle je suis entré ici. Nous nous formons assurément quelquefois, nous autres amateurs, de bien étranges chimères. Que d’admirables créations, sorties de notre cerveau, se sont souvent évanouies devant un sérieux examen ! Je sais tout ce qu’on a dit, tout ce qu’on pourrait dire encore sur les paroxysmes de la fièvre bibliographique ; mais enfin nous ne nous trompons pas toujours ; et qu’on me présente, d’ailleurs, un seul de nos rêves entouré d’autant de probabilités que celui-là.
Je ne puis plus, malheureusement, transmettre tous ces détails à notre pauvre Musset-Pathay, mort du choléra lors de l’invasion du fléau ; mais il faut pourtant bien que je le dise à quelqu’un, il faut bien que je publie ma nouvelle découverte, pendant que ceux qui savent que j’ai cueilli ma pervenche sur le quai du Louvre, et non dans les champs au milieu desquels je vis aujourd’hui, sont encore là pour constater ce grand fait. Je devance donc, Madame, l’époque où je vous aurais entretenue de ma petite Imitation de Jésus-Christ, et je me hâte de vous écrire dans toute l’émotion du premier moment. Jamais je n’aurai porté assez tôt à la connaissance de ceux qui aiment les vieux livres et les grands écrivains ; la vive, l’indicible jouissance qu’il m’a été donné d’éprouver. Cela fait ; car j’envoie cet heureux épisode pour être inséré dans la Revue de Paris, je reprends avec plus de calme la suite si agréablement interrompue de nos paisibles entretiens.
Agréez, etc.
« L’on n’établit plus de livres aujourd’hui, disait un jour, en soupirant, un des libraires les plus instruits et les plus anciens de la capitale : voilà ce que j’appelle des livres ! continuait-il en promenant un œil de triomphe sur les majestueux in-folio qui trônaient dans ses galeries, mais cela ? » Et il laissait tomber, en même temps, un regard dédaigneux sur un rayon de superbes in-octavo magnifiquement reliés par les plus grands maîtres ; « mais cela… ? » Et il ne trouvait pas d’expression pour marquer son mépris. L’in-octavo, dans lequel les gens du monde voient un beau progrès de l’in-douze, semblait à notre bibliographe (car c’était un bibliographe de mérite) constituer une véritable dégradation, et je ne sais pas s’il ne craignait point, au fond, que les mœurs publiques n’en fussent sérieusement, menacées. Cet in-folio, si particulièrement révéré du savant libraire, se compose, ainsi que vous le savez, Madame, de la grande feuille d’impression, en son entier, formant, avec un seul pli, deux feuillets (quatre pages) ; de même que l’in-quarto est cette grande feuille formant, au moyen d’un second pli, quatre feuillets, comme l’in-octavo en a huit, formés de la même manière ; enfin, en modifiant dans quelques dispositions les plis de la feuille, viennent l’in-douze, l’in-dix-huit, et jusqu’à l’in-trente-deux. C’est l’in-octaxo qui, aujourd’hui, a la vogue, et en vérité, je ne sais pas trop pourquoi, car lorsqu’on fait tant que de renoncer à la parfaite commodité de l’in-douze je serais bien tenté, moi aussi, d’accorder toutes mes préférences aux formes si imposantes de l’in-folio et de l’in-quarto : le grand est grand.
Ces goûts divers peuvent, du reste, très bien se justifier les uns comme les autres, ou plutôt se combiner parfaitement bien ensemble. Une bibliothèque n’offre jamais un aspect plus agréable que lorsqu’elle se compose de formats variés. Les in-folio, les in-quarto, sur les rayons inférieurs ; plus haut les in-octavo, puis les in-douze, ainsi de suite : il n’est pas jusqu’au joli in-dix-huit qui ne puisse figurer avantageusement dans une grande réunion de livres. L’in-trente-deux seul, je l’avoue, me semble un peu mesquin, sans compter que l’œil n’est que très médiocrement flatté par cette-petite-forme carrée qui n’avait jamais été celle d’un livre jusqu’à ces derniers temps. Mais la mode, vous le savez, Madame, exerce son influence sur toute chose. La librairie moderne a repoussé presque entièrement des bibliothèques privées les in-folio et les in-quarto. C’est, comme je l’ai déjà dit, l’inoctavo qui domine ; l’in-douze, auquel j’ai grand regret, semble rester cantonné dans les vieux livres, de sorte qu’une bibliothèque, formée uniquement de livres nouveaux, ou de réimpressions, courrait risque de présenter exclusivement un grand nombre d’in-octavo, quelques in-dix-huit et beaucoup d’in-trente-deux. L’agréable transition de l’in-douze y manquerait tout à fait si M. Charpentier, qui a rendu tant d’autres services à la librairie, ne nous avait ramené à peu près les dimensions de l’in-douze dans le format anglais qu’il a si heureusement popularisé.
Quoi qu’il en soit, ce qui manque en formes plus ou moins solennelles, en dispositions plus ou moins artistiques aux livres qu’on imprime aujourd’hui, est, à quelques égards, un peu compensé non pas malheureusement par la qualité supérieure des papiers, mais par leur éclatante blancheur, par le bon goût de quelques dispositions intérieures, enfin par l’effet général résultant du point de perfection atteint par l’imprimerie. Si la plupart des imprimeurs, qu’on presse quelquefois très mal à propos, étaient, libres, au contraire, d’apporter à leur-travail la sage lenteur de quelques-uns des plus habiles, si les libraires-éditeurs joignaient plus généralement à tous les avantages qu’ils ont sur le plus grand nombre de ceux qui les ont précédés, cette patience à toute épreuve, cette recherche de soins qui distinguaient particulièrement les éditeurs du temps passé, assurément les réimpressions ordinaires seraient de beaucoup supérieures aux éditions les plus recherchées d’autrefois.
Il en est ainsi, Madame, d’un point qui a bien aussi son importance : je veux dire la reliure. Nous avons aujourd’hui un bien plus grand nombre de bons relieurs qu’on n’en comptait avant nous, et l’art lui-même est porté beaucoup plus loin ; mais l’extension immense qu’a prise le goût des livres, en produisant une foule de mauvais ou de médiocres relieurs, et une grande quantité de fâcheux systèmes de reliure qu’on ne connaissait pas jadis, oblige parfois les bons artistes eux-mêmes de faire trop vite, et, soit par suite de cette grande hâte, soit par tout autre motif, l’on trouve trop souvent dans les œuvres d’un talent remarquable des imperfections de détail qui ne devraient appartenir qu’à la médiocrité.
Songez, Madame, à toutes les conditions indispensables pour constituer une reliure parfaite, car il ne s’agit pas seulement ici de la satisfaction des yeux ; c’est là un piège grossier qui ne prend que celui qui est tout à fait étranger à la véritable connaissance des livres : il faut d’abord que les feuilles soient pliées de manière à ce que les justifications (l’on appelle ainsi la partie imprimée de la page) se répondent aussi exactement que possible ; il faut que le travail du pliage, surtout la couture qui le suit, soient confiés à des ouvriers attentifs qui évitent avec soin les transpositions, ainsi que tout autre accident ; et, faut-il le dire ? ces ouvriers sont de jeunes ouvrières dont il est souvent bien difficile de commander l’attention ; enfin, après d’autres détails également essentiels, arrivent le choix et l’habile emploi des peaux, des maroquins, des cuirs de Russie, des veaux de toute couleur ; puis les dorures sur tranches et ailleurs, puis les dentelles, les ornements à froid, etc., etc. Quand nos bons relieurs donnent à ces divers points le soin particulier qu’ils exigent, les clients n’ont nullement à se plaindre de leur lenteur, la perfection de l’ouvrage qui sort de leurs mains devient une explication suffisante du temps qu’ils y ont employé.
Mais si toutes les réimpressions, en même temps qu’elles ont plus d’éclat, étaient aussi parfaites d’ailleurs que les vieilles éditions ; si les reliures modernes, en même temps qu’elles sont plus élégantes que les anciennes, offraient autant de perfection à d’autres égards, quel prétexte auraient les amateurs pour justifier la préférence qu’ils donnent, en général, aux vieux livres ? Ils n’oseraient jamais dire qu’ils les préfèrent uniquement parce qu’ils sont vieux, et le goût de ceux qui les recherchent se renfermerait dans un cercle beaucoup plus rétréci. L’on peut, au contraire, confesser hardiment qu’on aime à la fois, et par différents motifs, les vieux livres et les nouvelles éditions. Je remarquerai même, ainsi que je l’ai fait pour la variété des formats, que l’aspect d’une bibliothèque saisit beaucoup plus agréablement la vue par le mélange des vieux livres et des livres nouveaux (pourvu, toutefois, que les premiers soient d’une irréprochable conservation) que ne le ferait une réunion de livres entièrement neufs, trop semblable à un magasin de librairie. Certes, une reliure de Derome ou de Padeloup et de plus anciens qu’eux forme en même temps un agréable accord et un agréable contraste avec une reliure de Simier ou de Thouvenin. Je ne cite que des morts. Ces beaux vélins blancs (fussent-ils quelque peu fumés) des vieilles reliures de Hollande font merveilleusement à côté des maroquins ou des cuirs de Russie les mieux traités. Enfin, quelque austère que puisse être, en elle-même, la composition d’une bibliothèque d’amateur il est indispensable que l’élément extérieur réunisse les différentes conditions exigées dans tout ce qui est plus ou moins destiné à frapper les yeux ; et, sans contredit, la première de toutes est une heureuse variété.
Je terminerai, Madame, par un article qui n’eût pas ôté le dernier de ces divers préliminaires s’il eût été plus applicable aux bibliothèques d’un ordre privé ; mais bien qu’il ne doive pas rester étranger, tant s’en faut, à celle d’un vrai bibliophile, vous reconnaîtrez bientôt qu’il n’appartient véritablement qu’à des réunions de livres dont il est tout à fait impossible et dont il serait, d’ailleurs, tout à fait sans objet sérieux de traiter ici.
« Comment avez-vous classé vos livres, monsieur le marquis ? » demandais-je un jour à feu M. d’Herbouville, possesseur d’une magnifique bibliothèque, et l’un des hommes de France le plus en état de la bien classer. « Ma foi, mon cher enfant, me répondit-il avec son sourire légèrement narquois, les plus beaux devant, les plus laids derrière. » Vous, comprenez bien, Madame, que M. d’Herbouville ne me faisait pas cette réponse beaucoup plus sérieusement que je ne vous la rapporte ici ; mais c’est qu’en effet les divers classements (car il s’en faut peu que chaque bibliographe n’ait le sien), les classements par ordre de matières, tels, à peu près, qu’on les trouve dans les bons catalogues : la théologie d’abord, ensuite la jurisprudence, puis les sciences et les arts, les belles-lettres, l’histoire et enfin les innombrables subdivisions plus arbitraires encore que les points principaux ; cet ordre de classement, dis-je, ne peut être rigoureusement employé que dans les grands établissements publics, où la confusion, d’ailleurs, se mettrait trop aisément sans cela. Mais dans une bibliothèque de quelques milliers de volumes, où l’on n’est pas obligé, où il ne serait pas possible d’admettre tous les ouvrages qui se rattachent à chaque division, où l’on n’admet assez généralement que des livres plus ou moins utiles ou plus ou moins aimés, là où toute une matière peut être représentée par cent volumes de formats divers ; le moyen de placer tout cela les uns à côté des autres sans qu’une disparate choquante soit le moindre des inconvénients ? Et cependant je suis loin d’entendre par là qu’il faille sacrifier toute espèce de classement à une froide régularité, à des rayons d’un alignement architectural. Je pourrais cependant, si je le voulais, Madame, vous citer, touchant ce genre de régularité ; une autorité bien imposante : M. de Talleyrand, m’a-t-on assuré, ne voulait souffrir dans sa bibliothèque particulière que des lignes immenses d’in-octavo, tous rangés en bataille comme des grenadiers prussiens. Ce n’était certes pas là un reflet de l’esprit à la fois le plus étendu et le plus varié qui ait brillé de notre temps. Mais qui sait s’il n’y avait pas dans cette prédilection marquée quelque chose de l’impression qu’avait pu recevoir dans sa jeunesse, en faveur du naissant ou plutôt du progressant in-octavo





























