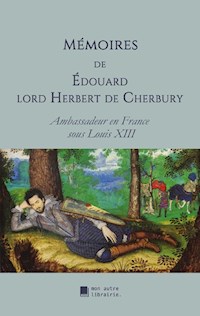
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Récit par lui-même de la vie bien remplie d'un philosophe, poète, soldat, historien et ambassadeur, fort engagé dans la politique de son temps entre l'Angleterre d'Élisabeth et la France de Louis XIII. Tenu par le secret il nous en dit hélas peu sur les arcanes des cabinets, mais ses descriptions des cours royales sont captivantes par leur réalisme. Il nous en apprend aussi beaucoup sur la vie militaire lors des campagnes, alors saisonnières, que se livraient les souverains d'une Europe troublée. Ce gentilhomme philosophe, diplomate bravache, nous offre un aperçu surprenant de l'esprit d'une époque aujourd'hui bien curieuse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mémoires
de
Édouard lord Herbert de Cherbury
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition J. Techener, Paris, 1863.
Couverture : portrait de lord Herbert
de Cherbury par Isaac Oliver.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-79-9
Table des matières
Dédicace
Avertissement pour la première édition
Chapitre I
But et utilité de ces mémoires. – Histoire de ma famille ; ma naissance et ma première éducation. – Réflexions sur les facultés que Dieu a mises en nous. – Après la mort de mon père j’entre à l’Université. – Mon horreur pour le mensonge. – Je me marie à quinze ans. – Malgré mon mariage je poursuis le cours de mes études.
Chapitre II
Préceptes pour l’instruction complète d’un jeune gentilhomme. – Il doit passer en revue toutes les sciences et tous les arts : la médecine, la botanique, la morale, la logique, l’art oratoire, les auteurs grecs, la théologie, la philosophie, la civilité, la danse, l’escrime, la natation et l’équitation en usage pour la guerre. – Un gentilhomme ne doit s’adonner ni au jeu ni à la chasse à courre, ni aux courses de chevaux ; motifs qui doivent l’en détourner.
Chapitre III
Je m’établis à Londres avec ma mère. – Ma présentation à la reine Élisabeth. – Le roi Jacques Ier me fait chevalier du Bain. – Cérémonies de la réception dans cet ordre. – Je pars pour la France. – Mon séjour à Merlo chez le connétable de Montmorency. – Chasses au loup et au sanglier. – Curieuse réponse de M. d’Isancourt. – Description de Chantilly. – Je vais à la cour du roi Henri IV et à celle de la reine Marguerite. – M. de Balagny.
Chapitre IV
Retour en Angleterre. – Grand danger que je cours dans la traversée. – Le genet que m’avait donné le connétable. – Après quelque temps passé dans ma famille, je pars avec lord Chandos pour les Pays-Bas. – Siège de Juliers. L’armée française, commandée par M. de la Châtre. – Bravade de M. de Balagny. – Ma querelle avec lord de Walden. – Je provoque M. de Balagny. – Sir John Ayres tente de m’assassiner.
Chapitre V
Je retourne à l’armée du prince d’Orange. – Défi d’un Espagnol. – Ma visite au marquis de Spinola. – Je pars pour Venise et Florence. – Mon séjour à Rome. – Je reviens par Florence à Turin. – Je suis envoyé en France par le duc de Savoie. – Mon arrestation à Lyon par ordre du gouverneur. – Le duc de Montmorency m’accorde avec lui. – Je reviens aux Pays-Bas par Genève. – Gracieuse réception du prince d’Orange.
Chapitre VI
Affreuse traversée de Calais à Douvres. – Je tombe malade de la fièvre quarte. –Je suis nommé ambassadeur en France. – Mon arrivée à Paris. – Audiences du roi et de la reine. – Leur portrait. – Le duc de Luynes. – Second séjour à Merlou. – Mon aventure avec l’ambassadeur d’Espagne. – Le connétable de Lesdiguières.
Chapitre VII
Examen de conscience. – La société française. – Anne d’Autriche et le duc de Bellegarde. – La réforme en France. – Vive altercation avec M. de Luynes. – Mon rappel en Angleterre. – Je reviens à Paris. – Voyage du prince de Galles en Espagne. – M. de Puisieux. – Le P. Séguirand. – Intervention miraculeuse du ciel. – On négocie le mariage du prince de Galles avec Madame Henriette de France. – Je suis remplacé comme ambassadeur.
Chapitre VIII
Suite de la vie de lord Herbert. – Ses dépêches pendant son ambassade en France. – Il prend le parti du Parlement contre le roi Charles Ier. – Sa santé s’affaiblit. – Lettre à son frère. – Sa mort et son épitaphe. – Ses opinions religieuses. – Prière qu’il a composée. – Liste de ses ouvrages. – Ses poésies. –Jugement sur son caractère et ses talents. – Son sang-froid au moment de la mort.
Mémoires
de
Édouard lord Herbert de Cherbury
Ambassadeur de France sous Louis XIII
Traduits pour la première fois en français
Par le comte de Baillon
Première traduction française de ces mémoires publiée sous les auspices de M. le baron
A. Seillière par les soins de J. Techener, libraire à Paris, 1862.
Dédicace
au très noble
Henry Arthur Herbert
Comte de Powis
Vicomte Ludlow, lord Herbert de Cherbury
Baron Powis et Ludlow
Et trésorier de la maison de Sa Majesté
Mylord,
Permettez-moi d’offrir à Votre Seigneurie, sous cette forme plus durable, le présent si précieux que j’ai reçu de ses mains. C’est à vous que votre grand-aïeul doit sa résurrection : laissez-moi, Mylord, annoncer au monde que vous nous avez autorisés, lui et moi, à dire la vérité, autorisation qui vous fait tant d’honneur, et que malheureusement bien peu de descendants des héros ont eu la noble pensée d’accorder.
Jusqu’à présent lord Herbert n’était guère connu que par ses écrits : je me trompe fort si désormais il n’est pas regardé comme un des caractères les plus extraordinaires que ce pays ait produits. Les descendants des plus fières lignées ne rougiront pas de se distinguer dans les lettres aussi bien que dans les armes, en apprenant à quelle hauteur s’est élevé lord Herbert dans ces deux carrières. Les héritiers de Votre Seigneurie auront devant les yeux un modèle digne d’exciter leur émulation, et en admirant le respect avec lequel vous avez rendu justice à votre commun ancêtre, ils ne pourront oublier la reconnaissance due à la mémoire de Votre Seigneurie, pour leur avoir transmis les souvenirs de sa gloire.
J’ai l’honneur d’être, Mylord,
de Votre Seigneurie,
le plus obéissant et le plus obligé serviteur,
Horace Walpole
Strawberry Hill, 1764
Avertissement pour la première édition
Il y a quelques années, les pages que voici auraient été considérées comme le plus riche présent qui pût être offert au monde des lettres. Les Mémoires du fameux lord Herbert de Cherbury, écrits par lui-même, auraient éveillé la curiosité au suprême degré. Peut-être un moindre intérêt s’attachera-t-il à cette tardive apparition, non que les talents du noble écrivain aient baissé dans l’estime publique, car son Règne de Henri VIII est toujours considéré comme un chef-d’œuvre de biographie historique ; mais c’étaient ses ouvrages philosophiques qui, en excitant vivement l’admiration ou la censure par leur finesse et leur singularité, avaient placé très haut le nom de lord Herbert. Les grands hommes qui ont illustré, en nombre considérable, la période suivante, ont détourné à leur profit une part de l’attention publique ; c’est seulement pour un génie de premier ordre que la renommée va grandissant avec les années, et peut surnager au-dessus de l’indifférence qui pèse sur un auteur, à mesure que le silence se fait autour de ses ouvrages. Les écrivains spéculatifs, quelles que soient leur pénétration et la sublimité de leur talent, obtiennent rarement le sceau de l’approbation générale, parce que, parmi les différentes aptitudes que la Providence a accordées à l’homme, le raisonnement n’est pas une puissance qui soit arrivée à sa dernière perfection. La poésie et l’éloquence ont été poussées si loin, que les grands maîtres en ce genre n’ont pu être égalés jusqu’à ce jour ; mais quel est le livre d’argumentation humaine, quel est le système d’opinions humaines qui n’ait été en partie réfuté ou rejeté ? La nouveauté elle-même, dans les recherches métaphysiques, devient souvent en réalité la réfutation de ce qui était précédemment nouveau. La contradiction fait la célébrité des doctrines qu’elle attaque ; les doctrines plus nouvelles étouffent cette célébrité. C’est là une vérité que les bigots du temps de lord Herbert n’auraient pas aimé à entendre ; mais ce qui est arrivé à tant de grands hommes est devenu aussi son partage. Ceux qui croyaient faire taire sa renommée lui avaient donné plus d’essor ; puis, quand le cri de l’enthousiasme a salué une nouvelle idole, elle a commencé à déchoir. Son rôle moral a recouvré son éclat, mais il a trouvé moins de spectateurs pour l’applaudir.
Cette introduction à ses Mémoires ne sera pas déplacée, quoique au premier abord elle puisse égarer le jugement du lecteur, en lui faisant peut-être espérer qu’il y trouvera écrit de sa propre main le compte-rendu des croyances d’un homme que des dévots imbéciles ont autrefois accusé de n’en avoir aucune. La foi de lord Herbert et sa profonde vénération pour la Divinité apparaissent clairement dans ces pages ; mais ni l’incrédule ni le moine n’y trouveront une complète satisfaction. La vie d’un philosophe n’est pas toujours une déduction de ses principes, ni un traité de philosophie en action ; je vais donc anticiper sur la surprise du lecteur, et ce sera par un seul mot : à son grand étonnement, il trouvera que la vie de Platon n’est que l’histoire de don Quichotte.
La noble famille qui offre ces pages au monde est au-dessus de ces préjugés mesquins, qui font que tant d’autres privent le public de ce qui lui était destiné par ceux qui seuls avaient le droit de donner ou de retenir. Il n’y a donc pas lieu de supprimer ce que lord Herbert a osé dire. Faiblesses, passions, peut-être quelque vanité, et certainement une mauvaise tête : voilà ce qu’il a dédaigné de dissimuler, parce qu’il cherchait la vérité, écrivait sur la vérité, et était lui-même la vérité en personne. Il avouait franchement ses fautes ou ses erreurs. Ses descendants, tout en les reconnaissant, ont voulu, à travers ces faiblesses, conduire le lecteur jusqu’à ses vertus, et désirent que le monde fasse avec eux la juste observation que voici : « Il a dû y avoir en lui un prodigieux fond de vertu, d’énergique résolution et de mâle philosophie pour que, dans ces temps de bravoure aussi barbare que mal comprise, de mœurs absurdes et de fausse gloire, lord Herbert ait pu rechercher une renommée mieux fondée et découvrir qu’il devait y avoir une gloire plus désirable que celle d’un duelliste de roman. » Personne n’est plus obstinément aveugle sur le ridicule que celui qui y est passé maître ; mais tel ne fut pas le cas pour lord Herbert. Son courage a fait de lui un héros, quel que fût alors l’héroïsme à la mode ; mais ses talents profonds en ont fait un philosophe. Peu d’hommes ont réellement brillé sous tant de jours différents, et ses héritiers, tout en ne l’approuvant pas dans tous ses moyens d’arriver à la gloire, feraient tort peut-être à sa mémoire s’ils laissaient ignorer au monde qu’il était fait pour briller dans toutes les sphères, que son tempérament impétueux ou sa raison supérieure lui ont fait aborder tour à tour.
Comme soldat, il gagna l’estime du prince d’Orange et du connétable de Montmorency, ces deux grands capitaines ; comme chevalier, ses actes furent calqués sur les plus purs modèles de la Reine des fées.1 Avec de l’ambition, sa beauté et sa grâce l’auraient mené à tout ce que peuvent souhaiter les plus aimables chevaliers. Comme ministre public, il maintint dignement l’honneur de son pays, même quand son roi l’exposait à un échec. L’histoire dont j’ai parlé prouve qu’il était fait pour en écrire les annales aussi bien que pour les ennoblir par ses actions, et nous laisse le vif regret qu’il n’ait pas complété, ou que nous ayons perdu le compte-rendu de son ambassade, qu’il nous avait promis. Ces négociations si laborieuses étaient toujours mêlées ou suivies de méditations et de recherches philosophiques. Dépouillez chaque époque de ses excès et de ses erreurs, et vous pourrez difficilement assigner à la vie d’un homme une série d’emplois et d’occupations qui lui aient mieux convenu. Valeur et activité militaire dans la jeunesse, affaires d’État dans l’âge mûr, contemplations et travaux pour l’instruction de la postérité dans le calme de la vieillesse : telle fut la vie de lord Herbert ; c’est lui-même qui va nous en faire le récit.
Le manuscrit a couru grand risque d’être perdu pour le monde. Henry lord Herbert, petit-fils de l’auteur, mort sans enfants en 1691, avait laissé par testament ses biens à François Herbert de Oakly-Park, fils de sa sœur, et père du présent comte de Powis. Le manuscrit original était conservé à Lymore, comté de Montgommery, résidence principale de la famille depuis que Cromwell eut fait démolir le château de Montgommery. Henry lord Herbert épousa une fille de François, comte de Bradford, et Lymore, avec une grande partie de ses dépendances, lui fut assigné comme douaire. Devenue veuve, lady Herbert y vécut presque toujours, et mourut en 1714. On ne put alors retrouver le manuscrit, quoique pendant sa vie on l’eût vu souvent entre ses mains. Quelques années après il fut découvert à Lymore, parmi de vieux papiers, en très mauvais état, avec des feuilles déchirées et d’autres tellement tachées qu’elles étaient à peine lisibles. Dans cette circonstance, on fit appel aux Herbert de Ribbisford, descendants de sir Henry Herbert, le plus jeune frère de l’auteur, qui passaient pour avoir reçu en garde un duplicata de ces Mémoires. Ils reconnurent que cette copie avait existé, mais il leur fut impossible de se rappeler ce qu’elle était devenue. Enfin, vers l’année 1737, ce livre fut envoyé au comte de Powis par un gentilhomme dont le père avait acheté une propriété de Henry Herbert de Ribbisford, fils de sir Henry Herbert dont nous avons parlé, pour lequel on avait fait revivre en 1694 le titre de Cherbury, qui s’était éteint en 1691. À la vente de cette propriété, il avait laissé dans l’habitation un petit nombre de livres, de tableaux et d’autres objets qui y restèrent jusqu’en 1737. Parmi eux se trouvait ce manuscrit, qui, non seulement par son contenu qu’on a pu collationner avec l’original, mais aussi par la ressemblance de l’écriture, paraissait être ce duplicata, l’objet de tant de recherches.
Écrit par lord Herbert, à l’âge de plus de soixante ans, cet ouvrage n’a probablement jamais été complet. On a en général conservé l’orthographe du manuscrit, à l’exception de quelques erreurs qu’il a été nécessaire de corriger, et on y a ajouté quelques notes au sujet des personnages importants dont il est question dans le texte. Le style en est remarquablement bon pour cette époque, qui, placée entre le langage mâle et expressif du siècle précédent, et la pureté extrême de notre temps, n’avait rien pris de l’un ni de l’autre. Les observations de Sa Seigneurie sont neuves et fines ; quelques-unes sont pleines de justesse, comme celles qui regardent le duc de Guise. Son jugement sur la Réforme est un modèle de sagesse ; sa réponse au confesseur du roi de France est pleine de vivacité ; ses rapports avec le duc de Luynes, et toute sa conduite, sont une preuve évidente de son ardeur naturelle ; mais ce qui est le plus remarquable, c’est l’air de conviction et de véracité qui circule dans toute sa narration. Si l’auteur nous étonne, et que l’étonnement nous fasse douter, le charme de son ingénieuse honnêteté dissipe toute hésitation. Son histoire répand une lumière curieuse sur les mœurs de cette époque, quoique les rayons en soient rapides et passagers ; mais parmi ces mœurs, rien n’est plus frappant que le manque absolu de police dans ce pays-ci. Je ne citerai pas d’autres exemples, car j’ai peut-être déjà trop divulgué les secrets de ce livre, pour lequel, si les autres lecteurs y trouvent la moitié du plaisir que j’ai éprouvé moi-même, ils devront une extrême reconnaissance au noble personnage dont la faveur m’a permis de leur communiquer une curiosité si pleine d’intérêt.
Chapitre I
But et utilité de ces mémoires. – Histoire de ma famille ; ma naissance et ma première éducation. – Réflexions sur les facultés que Dieu a mises en nous. – Après la mort de mon père j’entre à l’Université. – Mon horreur pour le mensonge. – Je me marie à quinze ans. – Malgré mon mariage je poursuis le cours de mes études.
Je crois que si tous mes ancêtres avaient pris la peine d’écrire leur histoire et de la léguer à la postérité, ceux qui doivent probablement fournir à peu près la même carrière auraient pu y puiser d’utiles enseignements, et il y aurait eu pour eux un avantage certain à se laisser diriger par les observations de leurs père, grand-père et bisaïeul, plutôt que par ces maximes et ces exemples vulgaires qui ne peuvent leur convenir aussi bien sous tous les rapports. Ainsi, soit que l’existence de ces ancêtres ait été simple et retirée, et ne puisse leur fournir que des préceptes sur la manière de se conduire envers leurs enfants, leurs serviteurs, leurs tenanciers, leurs parents et leurs voisins, soit que leur vie se soit passée au loin, au milieu des travaux de l’Université, du barreau, de la cour ou des camps, leurs héritiers ne pourraient manquer d’en tirer plus de profit que de toute autre histoire : voilà pourquoi j’ai résolu de transmettre à ma postérité les circonstances de ma vie, que je considère comme devant me faire le mieux connaître et leur être le plus utile. Dans ce récit, j’affirme n’écrire qu’en toute vérité et sincérité, car j’ai toujours dédaigné de mentir ou de tromper personne, et à plus forte raison lorsque je m’adresse à ceux qui me sont si proches. Si je me suis décidé à prendre la plume, maintenant que j’ai plus de soixante ans, c’est pour passer sévèrement en revue les actions de ma vie, en reconnaître le bien et le mal, blâmer ce qui mérite de l’être, et faire ainsi ma paix avec Dieu. Je veux aussi pouvoir me féliciter de ce qui, grâce à la bonté et à la faveur du ciel, a pu être fait d’après les principes de la conscience, de la vertu et de l’honneur. Avant d’arriver à cet examen personnel, il faut que je dise quelques mots sur ma famille, en tant que les faits qui la regardent me sont arrivés par une voie digne de confiance ; je ne pourrai pas, du reste, en parler longuement, car je n’avais que huit ans à la mort de mon grand-père, et j’ai perdu mon père quatre ans après. Comme depuis j’ai passé presque tout mon temps à l’étranger, il m’a été impossible d’arriver à une connaissance approfondie de toutes leurs actions ; je me contenterai donc de raconter ce qu’il y a dans leur histoire de plus connu et de plus certain.2
J’ai eu pour père Richard Herbert, esq., fils d’Édouard Herbert, esq., et petit-fils de sir Richard Herbert, chevalier, lequel était le plus jeune fils de sir Richard Herbert de Colebrook, dans le comté de Monmouth. Parlons d’abord de mon père : je me rappelle qu’il avait la barbe et les cheveux noirs comme tous nos aïeux de son côté, dit-on ; il avait l’air mâle et un peu sévère, en tout il était beau et bien fait ; son courage était grand, et il en donna la preuve quand il fut traîtreusement assailli par plusieurs malfaiteurs dans le cimetière de Lanervil, au moment où il voulait en saisir un qui refusait de paraître en justice. Mon père se défendit contre eux tous. Aidé seulement d’un certain John Howell Corbet, il avait repoussé ses adversaires, lorsqu’un de ces misérables, passant derrière lui, lui fit par-dessus les épaules des autres assaillants une blessure à la tête avec un foret ; il tomba, mais en revenant à lui, quoiqu’il eût le crâne ouvert jusqu’au cerveau, il vit fuir ses adversaires et ensuite rentra à pied chez lui à Llyssyn, où il fut soigné et guéri. Il offrit alors un combat singulier au chef de la famille par l’ordre duquel il croyait que le crime avait été commis, mais celui-ci, repoussant toute participation à cet acte, offrit de faire serment de son innocence ; l’assassin s’étant alors réfugié en Irlande, d’où il ne revint jamais, mon père se désista de toute poursuite à cet égard. Sa blessure ne l’empêcha pas de reprendre toute sa force et sa santé, de sorte qu’il put se livrer de nouveau à tous les exercices de la vie de campagne et devint le père d’une nombreuse lignée. Quant à son intégrité dans les places de député-lieutenant du comté, de juge de paix et de custos Rotulorum, que mon grand-père avait occupées avant lui, on sait encore que ses ennemis eux-mêmes en appelaient à sa justice, qui ne leur a fait défaut en aucune occasion. Il avait une instruction plus qu’ordinaire, comprenait bien le latin et était très versé dans l’histoire.
Mon grand-père avait mené une existence très variée : commençant par la cour, où il avait dissipé presque tout son patrimoine, il embrassa la carrière des armes et fit sa fortune avec son épée à la bataille de Saint-Quentin en France, dans les guerres du Nord et dans les rébellions qui survinrent pendant les règnes d’Édouard VI et de la reine Marie. La fortune lui fut si favorable que non seulement il quitta le service plus riche qu’il n’y était entré, mais qu’il y amassa assez d’argent pour pouvoir acquérir la plus grande partie des propriétés qui sont arrivées jusqu’à moi, quoique j’aie aussi des terres achetées par sa mère lady Ann Herbert, comme le prouvent des actes faits en son nom que je pourrais montrer.
J’aurais dû avoir d’autres biens que mon grand-père avait vendus presque pour rien, et dans lesquels mon père aurait pu rentrer, si mon grand-père y avait consenti. Ce dernier était connu pour un grand ennemi des voleurs et des brigands, qui infestaient alors en grand nombre les montagnes du comté de Montgommery ; il se mettait souvent à leur poursuite de jour et de nuit, et à ce sujet, quoiqu’on m’ait raconté bien des histoires, je me contenterai d’en rapporter une seule.
Quelques bandits s’étaient logés dans un cabaret sur les hauteurs de Llandinam : mon grand-père, suivi de quelques domestiques, étant venu pour les prendre, le chef de ces brigands lui décocha une flèche qui porta dans le pommeau de sa selle ; mon grand-père alors le chargea l’épée à la main, et quand il l’eut pris il lui montra la flèche, en lui reprochant ce qu’il avait fait ; le bandit, peu touché de cela, lui dit que son seul regret était d’avoir laissé chez lui son meilleur arc, qui, assurément, lui aurait fait passer la flèche au travers du corps. Cet homme, traduit en justice, fut exécuté pour ce fait.
Mon grand-père avait un tel pouvoir dans la contrée, que plusieurs ancêtres des meilleures familles actuellement existantes dans le comté de Montgommery étaient ses serviteurs et lui doivent leur élévation. Il prenait aussi grand plaisir à exercer l’hospitalité ; à chaque repas, sa table, qui était fort grande, avait deux services composés des meilleurs mets qu’on pût trouver ; il avait aussi une nombreuse famille et beaucoup de domestiques. C’était alors l’usage dans le pays de dire quand on voyait se lever un oiseau : « Vole où tu voudras, il faudra que tu rôtisses à Black-Hall » ; c’était un bâtiment peu élevé, mais très spacieux, que mon grand-père avait fait bâtir ; son père et lui avaient d’abord demeuré au château de Montgommery. Malgré son existence dispendieuse, il éleva bien ses enfants, maria ses filles dans les meilleures familles du voisinage et envoya ses plus jeunes fils à l’Université. C’est de là que son fils Mathieu partit pour les guerres des Pays-Bas, où il resta quelque temps, puis il revint dans son pays et s’établit à Dolegeog, dans une belle propriété que mon grand-père lui donna. Son fils Charles, après avoir aussi passé quelques années dans les Pays-Bas, revint également en Angleterre et se maria depuis à une héritière, dont le fils aîné, sir Édouard Herbert, chevalier, est procureur général du roi. Son fils Georges, qui, au nouveau collège à Oxford, s’était fait remarquer par une grande instruction et une piété exemplaire, mourut d’hydropisie, dans un âge peu avancé.
Malgré toutes ses dépenses, mon grand-père augmenta considérablement ses domaines, mais sans injustices ni violences ; et la preuve en est qu’aucune réclamation ne me fut adressée, lorsqu’à plusieurs reprises je fis offrir par mon intendant, soit des indemnités, soit même la restitution aux anciens propriétaires.
Mon aïeul mourut à l’âge de quatre-vingts ans, ou à peu près, et il fut enterré dans l’église de Montgommery, sans aucun monument, tandis que j’en ai fait élever un fort convenable à la mémoire de mon père.
Mon bisaïeul, sir Richard Herbert, était, du temps de Henri VIII, steward des seigneuries et marches du Nord et de l’Est du pays de Galles et du comté de Cardigan, et il y avait le droit de haute justice ; mais en usant de ce privilège, il montra toujours tant d’équité, qu’il en acquit une remarquable réputation, comme on le voit dans les rapports du temps conservés aux archives de White-Hall ; j’en ai touché quelques mots dans mon Histoire de Henri VIII. Je n’en dirai guère plus sur son compte, sinon que c’était également un grand ennemi des rebelles, des voleurs et des brigands, et qu’il était fort bon justicier. Si un homme cruel et perfide s’était trouvé investi d’une pareille puissance, il y aurait amassé une grande fortune ; mais il n’en laissa qu’une fort médiocre, sauf ce qu’il avait hérité de son père. Il est aussi enterré à Montgommery : sa tombe est la plus élevée des deux qui ont été placées dans le chœur de l’église.
Mon trisaïeul sir Richard Herbert de Colebrook fut ce héros incomparable qui (ainsi qu’il est dit dans l’histoire de Hall et de Grafton) traversa seul deux fois, sa hache d’armes à la main, une nombreuse armée d’hommes du Nord et revint sans une blessure mortelle, ce qui est plus remarquable encore que tous les hauts faits d’Amadis de Gaule et du chevalier du Soleil. Outre ce récit des prouesses de sir Richard Herbert à la bataille de Banbury ou d’Edgecot-Hill, puisque c’est là qu’elle fut livrée, je rapporterai quelques traditions qui le concernent et que je tiens de bonne source. L’une dit que sir Richard Herbert, occupé avec son frère William comte de Pembroke à réduire un corps de rebelles3 au nord du pays de Galles, assiégea un de leurs chefs dans le château d’Harlech, comté de Merioneth. Le capitaine de cette forteresse, vieux soldat des guerres de France, où, disait-il, il avait défendu un château si longtemps, qu’il avait exercé la langue des vieilles femmes du pays de Galles, prétendait garder celui-là assez longtemps pour exercer la langue des vieilles femmes de France. En effet, la place n’était guère prenable que par la famine, et sir Richard Herbert se vit contraint de recevoir ce capitaine à composition : ce dernier ne se rendit même qu’à la condition expresse que sir Richard Herbert emploierait tout son pouvoir pour lui obtenir la vie sauve. Sir Richard l’amena donc au roi Édouard, en priant Son Altesse d’accorder une grâce, dont l’espérance avait seule décidé cet homme à rendre une place importante où il aurait pu tenir longtemps encore ; mais le roi répondit à sir Richard Herbert qu’il ne lui reconnaissait aucun pouvoir pour pardonner, et qu’après son audience il n’aurait plus qu’à livrer ce capitaine à la justice. Sir Richard Herbert répliqua qu’il n’avait pas encore fait tout ce qu’il pouvait en faveur de son protégé, et conjura humblement Son Altesse, soit de prendre sa propre vie en échange de celle de ce malheureux, soit de le remettre dans le château et de charger un autre que lui de l’en déloger, puisque c’était là la dernière preuve qu’il pût donner à ce capitaine d’avoir fait tout au monde pour le sauver.
Le roi, se voyant poussé dans ses derniers retranchements, accorda à sir Richard la vie dudit capitaine, mais ce fut la seule récompense qu’il obtint pour ses services.
Voici l’autre histoire. Sir Richard Herbert était avec son frère le comte de Pembroke dans l’île d’Anglesea à la poursuite de sept frères coupables d’une foule de crimes et de meurtres ; les ayant pris, le comte de Pembroke fut d’avis que pour purger la terre d’une si mauvaise engeance, il fallait les faire pendre tous. Leur mère alors vint trouver ce lord et le conjura à genoux d’épargner deux ou au moins l’un de ses fils, assurant que la mort des autres suffirait pour faire un exemple et satisfaire la justice. Sir Richard Herbert appuya cette demande, mais le comte, les trouvant tous également coupables, répondit qu’il ne voulait pas faire de distinction entre eux, et ordonna en conséquence qu’ils fussent tous exécutés ensemble. Le désespoir de la mère fut tel que, se mettant à genoux avec un chapelet sur chaque bras (ainsi le dit la légende), elle le maudit, en priant Dieu de faire tomber sa colère sur lui au premier combat qu’il livrerait. À la suite de cela le comte se rendant sur le champ de bataille d’Edgecot, comme nous l’avons dit plus haut, après avoir rangé ses hommes, trouva son frère sir Richard Herbert à la tête de ses troupes, appuyé sur sa hache d’armes, dans une attitude triste et pensive. « Que peut donc craindre ton grand corps, lui dit-il (car il dépassait de la tête toute l’armée), pour que tu aies l’air si triste ? Ou bien es-tu si fatigué de la marche, que tu sois obligé de te reposer ainsi sur ta hache d’armes ?
– Ce n’est ni l’un ni l’autre, répondit sir Richard, au moins pour le moment ; mais je ne puis m’empêcher de redouter pour vous les effets de la malédiction de cette femme qui avait des chapelets sur les bras. »
Sir Richard Herbert fut enterré à Abergaveny dans un monument fort somptueux pour l’époque, qui existe encore, tandis que le comte de Pembroke fut enseveli dans l’abbaye de Tintirne et sa tombe a disparu dans la ruine de la chapelle. Le plus jeune fils de ce comte de Pembroke a eu une fille mariée au fils aîné du comte de Worcester, qui enleva ainsi le beau château de Ragland avec de grands revenus à l’héritier mâle de cette maison, second fils dudit comte de Pembroke et aïeul de la famille de Saint-Gillian, dont j’épousai depuis l’héritière, comme je le dirai en son lieu.
Ce qu’il y a de curieux, c’est que la postérité du comte de Pembroke et celle de sir Richard Herbert se trouvent réunies de nouveau en la personne de ma femme et la mienne, et ce qui est plus remarquable encore, c’est que, quand les deux frères furent faits prisonniers à la bataille dont je viens de parler, en défendant la juste cause d’Édouard IV, le comte ne demanda jamais que sa vie fût épargnée, mais bien celle de son frère, ainsi que le dit la chronique.
Aussi cette union des deux maisons dans ma postérité devrait produire une perpétuelle obligation d’amitié et d’amour réciproque entre tous ses membres, puisque ces deux frères ont laissé à leur famille un si digne exemple, en paraissant ne vivre et ne mourir que l’un pour l’autre.
Ma mère était Madeleine Newport, fille de sir Richard Newport et de sa femme Marguerite, fille et héritière de sir Thomas Bromley, membre du conseil privé et exécuteur testamentaire de Henri VIII, laquelle, après la mort de son mari, donna des preuves extraordinaires de piété et d’amour pour ses enfants. Elle joignait, à une exactitude extrême aux prières de chaque jour, en public et en particulier, une sollicitude excessive pour sa postérité ; bien qu’elle fût libre de donner ses vastes propriétés à celui qu’elle voudrait, elle commença par établir ses filles avec des dots suffisantes dans les meilleures familles du voisinage ; puis elle remit sa fortune et le soin de sa maison à son fils aîné François. Elle avait pendant de longues années exercé l’hospitalité avec une abondance et un ordre inconnus jusqu’alors dans son pays, car outre la bonne chère qu’elle faisait à ses hôtes et qu’imita son fils sir François Newport, elle avait l’habitude après le dîner de distribuer de ses propres mains aux nombreux pauvres de ses domaines des aumônes en argent, plus ou moins fortes, d’après les besoins de chacun.
Par cette famille je descends des Talbot, des Devereux, des Gray, des Corbet et de beaucoup d’autres nobles maisons, comme on peut le voir par leurs quartiers, qui ornent les beaux écussons des Newport. Je pourrais en dire bien plus long sur mes ancêtres de ce côté, mais ce serait dépasser mon but ; je ne parlerai donc que de ma mère, de mes frères et de mes sœurs. Ma mère, après de longues années de vertu et d’amour passées avec mon père, lui éleva, après sa mort, un beau monument dans l’église de Montgommery ; puis elle donna à ses enfants une excellente éducation et les mit en bonne passe de faire leur fortune ; en un mot, elle se montra la femme qu’a décrite le Dr Donne dans son oraison funèbre, qui est imprimée. Ses fils se nommaient Édouard, Richard, William, Charles, Georges, Henry, Thomas ; ses filles, Élisabeth, Marguerite, Françoise. Pour suivre mon plan, je dirai un mot de chacun d’eux, avant de passer à ma propre histoire. Mon frère Richard, après avoir fait de fortes études, alla aux Pays-Bas, où il passa plusieurs années et s’acquit une grande réputation à la guerre, et par ses duels nombreux ; si bien que, grâce à ces deux moyens, il mourut couvert des cicatrices de vingt-quatre blessures, et fut enterré à Berg-op-Zoom. Mon frère William, qui avait aussi reçu une brillante éducation, partit pour les guerres du Danemark, où dans un duel, son épée s’étant brisée, non seulement il se défendit avec le tronçon qui lui restait, mais joignant son adversaire, il le renversa et le maintint sous lui jusqu’à ce qu’on vînt les séparer. Il passa ensuite dans les Pays-Bas et mourut bientôt après. Mon frère Charles, membre du nouveau collège d’Oxford, y mourut jeune, non sans avoir donné de grandes espérances à tous égards. Mon frère Georges se montra si bon écolier, qu’il fut fait orateur public de l’Université de Cambridge.4 On a conservé de lui quelques ouvrages anglais, qui, quoique remarquables dans leur genre, sont loin de montrer la connaissance approfondie qu’il avait du grec et du latin, et des littératures sacrées et profanes. Sa vie fut sainte et exemplaire ; de telle sorte qu’aux environs de Salisbury, où il vécut dans son bénéfice pendant de longues années, il fut presque regardé comme un saint. Il n’était pourtant pas exempt d’emportements et de colère : c’est une infirmité commune à ceux de notre race ; mais à cette exception près, sa vie fut irréprochable. Henri, après avoir fait de très bonnes études comme ses autres frères, passa en France par le conseil de ses amis, et là il apprit la langue de ce pays dans une grande perfection ; puis il revint à la cour, et fut nommé gentilhomme de la chambre du roi et maître d’hôtel ; par ces places, et par un bon mariage, il arriva à une grande fortune, dont il jouit lui et ses héritiers. Il se montra aussi fort brave dans plusieurs duels et autres aventures, et très habile dans sa conduite à la cour, où il réussit à merveille. Mon frère Thomas était posthume, puisqu’il naquit quelques semaines après la mort de son père : ayant passé un certain temps à l’école, il devint page de sir Édouard Cecil,5 général de l’armée auxiliaire de Sa Majesté près des princes d’Allemagne, et se distingua particulièrement au siège de Juliers, en 1610, où il se conduisit si bien, que dans cette nombreuse armée son courage sut se faire remarquer en toute occasion. À son retour, il alla aux Grandes Indes sous les ordres du capitaine Joseph, qui en s’y rendant rencontra un grand vaisseau espagnol, et fut tué malheureusement dans la lutte. Le découragement s’empara alors de ses hommes ; mais mon frère Thomas, pour venger sa mort, les ramena au combat avec tant de vigueur (comme me l’a raconté bien des fois sir John Smyth, gouverneur de la Compagnie des Indes) qu’ils parvinrent à forcer le vaisseau espagnol à s’échouer. Là les Anglais le percèrent de tant de coups de canon, qu’il dut être abandonné comme tout à fait hors de service. Mon frère se rendit ensuite avec le reste de la flotte à Surate, et de là il accompagna les marchands de la Compagnie chez le grand Mogol, d’où après un séjour d’un an il revint avec la même flotte en Angleterre. Il passa ensuite sur l’escadre que le roi Jacques envoyait à Alger sous le commandement de sir Robert Mansell, où nos hommes manquant d’argent et de vivres, et plusieurs vaisseaux s’étant écartés pour tâcher de faire une prise qui pût ravitailler le reste de l’escadre, il eut la chance de rencontrer un navire et de le prendre. Il y trouva dix-huit cent livres sterling, ce qui sauva la flotte entière d’une perte certaine.





























