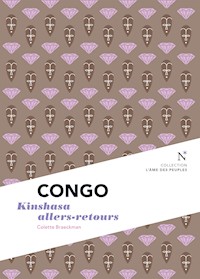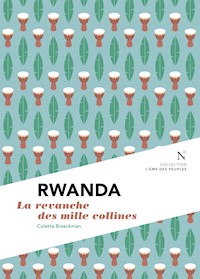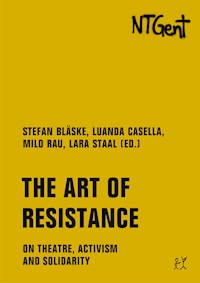Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Grand reporter pour
Le Soir, Colette Braeckman arpente la planète dès les premières années de sa carrière de journaliste. Les reportages se succèdent, Amérique latine, Asie du Sud-Est, Portugal, Corne de l’Afrique… Puis dans les années 80, elle se concentre sur le pays dont elle rêvait depuis l’enfance : le Congo devenu Zaïre, l’ancienne colonie des Belges.
Elle y couvre les dernières années du régime Mobutu, l’arrivée au pouvoir des Kabila père puis fils, les guerres successives et les drames humanitaires. Au Rwanda, elle suit toutes les étapes du génocide, depuis les signes avant-coureurs de la tragédie jusqu’à son accomplissement.
Les guerres et les drames de l’Afrique centrale lui inspirent une dizaine de livres et de nombreux articles dans la presse internationale.
Dans cet ouvrage passionnant,
Colette Braeckman raconte ses années au galop, assemble le grand puzzle de sa vie d’aventurière, raconte les coulisses de ses enquêtes et ses tête-à-tête avec les chefs d’État africains et leurs modestes sujets. Avec elle, on bondit dans l’avion, on mange la poussière sur les pistes congolaises, on risque sa vie pour un bon papier.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Originaire d’Uccle,
Colette Braeckman, après avoir entamé des études d’interprète, entre au quotidien La Cité où elle apprend « sur le tas » le métier de journaliste. En 1971, engagée au quotidien Le Soir, elle publie son premier livre,
Les étrangers en Belgique (éditions Vie Ouvrière) puis est transférée au service international. Les reportages se succèdent, Amérique latine, Asie du Sud-Est, Portugal, Corne de l’Afrique puis dans les années 80, après avoir passé une année sabbatique aux États Unis grâce à une bourse Fullbright, elle se concentre sur le pays dont elle rêvait depuis l’enfance : le Congo devenu Zaïre, l’ancienne colonie des Belges. Elle y couvrira les dernières années du régime Mobutu, l’arrivée au pouvoir des Kabila père puis fils, les guerres successives et les drames humanitaires. Au Rwanda, elle suivra toutes les étapes du génocide, depuis les signes avant-coureurs de la tragédie jusqu’à son accomplissement. Les guerres et les drames de l’Afrique centrale lui inspireront une dizaine de livres et de nombreux articles dans la presse internationale, dont Le Monde Diplomatique, qui lui vaudront d’être par deux fois, à l’Université de Liège et à l’Université catholique de Bukavu, nommée Docteur honoris causa. La publication du livre L’homme qui répare les femmes (éditions GRIP) consacré au Docteur Denis Mukwege et la collaboration au film éponyme réalisé aux côtés de Thierry Michel contribueront à la notoriété du médecin-chef de Panzi qui recevra le Prix Nobel de la paix en 1998. Dans les colonnes du Soir, elle continue à suivre l’actualité africaine et plus particulièrement l’évolution de la République démocratique du Congo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
préface
Entre ici, Colette Braeckman!
« Envoyée spéciale Colette Braeckman ». Nous allons enfin découvrir ce qu’elle a de si spécial ! Avouez que vous aussi, vous imaginez Colette sanglée dans une veste multipoches couleur sable, sautant en parachute au-dessus de Kinshasa, un carnet de notes à la main. Oubliez cette vision patriarcale du reportage : on a affaire à une queen du journalisme, une femme qui a tracé sa route dans un univers masculin qu’elle a secoué en y apportant sa singularité. Dans mon panthéon, elle a mis la pâtée à Albert Londres.
Une vie à raconter celle des autres, et elle se décide enfin à nous conter la sienne. On assiste à l’éveil de sa curiosité : dans une enfance contrainte, son imaginaire la rend capable de voyager à partir d’un objet, le goût du récit grandit avec l’appétit d’évasion que le déterminisme social cantonne au rang de fantasme. Elle se rendra compte bien plus tard que la rêverie de l’enfant solitaire était la clé pour déverrouiller la porte d’un monde qu’elle croyait hors de sa portée. Dès lors, plus rien ne lui résistera. Ce livre raconte comment la détermination envoie le déterminisme au tapis.
Il nous invite aussi dans les coulisses de ses grands reportages, les grands événements qui ont secoué l’Afrique et les grands personnages qu’elle a croisés. Oui, ici tout est grand comme le Congo, ou comme l’Asie où il lui est arrivé de couvrir l’actualité, et ici c’est parfois la petite Colette qui pose un regard amusé sur son parcours. « Amusé », car on y décèle comme une part d’incrédulité quand elle se retourne sur sa carrière, « amusé » car elle révèle aussi qu’elle a beaucoup d’humour, un levier nécessaire pour garder du recul sur le chaos du monde et parfois ses propres difficultés. Il en faut une sacrée dose pour ne pas se laisser submerger par la violence qui règne sur son principal terrain d’étude : les Grands Lacs. Il en faut aussi lorsque certaines élections s’apparentent à un sketch, notamment dans la République pas toujours très démocratique du Congo.
Aujourd’hui, Colette est culte. Son travail marque les lecteurs de Belgique, d’Europe et d’Afrique par sa qualité et sa quantité. Elle le dit elle-même, « J’ai pissé de la copie ! » Elle a même pissé un nombre si incalculable de copies qu’il y aurait de quoi arroser deux cents hectares de forêt en plein désert, dont les arbres auraient fourni la pâte de ses papiers. Car c’est aussi l’histoire de la presse écrite contemporaine qui est racontée à travers son récit. De la machine à écrire aux premiers PC et des articles dictés par téléphone à ceux envoyés par la grâce d’une connexion internet erratique débusquée avec obstination comme on rechercherait une info. Colette a donc connu l’époque où l’on pouvait dire des meilleurs journalistes que leurs papiers étaient téléphonés.
Colette Braeckman, c’est Le Soir. Quasi toute une carrière dans le même journal, une fidélité sans faille, observez-la bien, car on a cassé le moule. Bien qu’ayant travaillé quelques années pour Le Soir, j’ai rarement croisé l’Africa queen, et pour cause, elle est toujours en vadrouille. La dernière fois que je l’ai vue, c’est d’ailleurs dans un train, où j’avais d’abord reconnu sa voix au timbre mi-posé, mi-enjoué, un timbre qui lui ressemble : l’œil qui frise derrière de grandes lunettes, et cette mise impeccable, boucles d’oreilles, carré délimité par son sourire et robes colorées. Oubliez la veste couleur sable vous ai-je dit.
Dans la rédaction ou sur le terrain, Colette prend plaisir au travail, elle s’y raccroche parfois, et ses efforts ont sculpté une œuvre journalistique et une stature de reporter. Je propose donc de remplacer toutes les statues de Léopold II par des statues de Colette. Une gageure, tant elle a la bougeotte. D’ailleurs, ses mémoires ne figent en rien l’histoire du personnage, qui a encore bien des pages à écrire et des histoires à nous transmettre. Lorsque vous aurez refermé le récit que vous tenez entre vos mains, vous vous poserez sans doute cette question : à quand le biopic ?
Charline Vanhoenacker
Introduction
Mes carnets noirs
Des pages blanches, étroites, idéales pour une écriture précise et mesurée. Des pages serrées dans une couverture de cuir jamais griffée. Des carnets noirs, cadeau immuable et obstiné.
Ils sont là, entassés, toujours au même endroit, dans le fond d’ une armoire. À chaque fin d’ année – ou était-ce à chaque anniversaire ?–, je répondais « merci, c’ est gentil ».
Les carnets sont restés vierges. Intacts. Peut-être d’ autres les utiliseront-ils, lorsque je les aurai distribués ou déposés sur une brocante.
Pourquoi ce cadeau, tendre mais insistant ? L’ intention était limpide : pour que je raconte, que j’ encombre ces pages au grain délicat avec le fatras de mes histoires. Ou que je note, au jour le jour, les pensées, les émotions, les réminiscences qui me traversaient l’ esprit. Que je collationne les à-côtés, que je les épingle comme des papillons, avec ou sans estampille.
La réponse, jamais explicitement formulée, c’ était non. Non, il était trop tôt pour soulever la chape de l’ enfance. Toujours trop tôt pour provoquer la collision entre le lointain passé et le présent.
C’ est au jour le jour qu’ il me fallait vivre, courir, aimer, oublier pour mieux retenir l’ instant. Il était trop tôt aussi, ou déjà trop tard, pour fouiller les poubelles, exhumer les reproches moisis, m’ attarder sur les occasions manquées et le temps que je croyais avoir galvaudé.
Quant au présent, n’ avais-je pas déjà tout dit ? Le plus visible, le plus évident avait été écrit. J’ avais passé ma vie à me trimballer d’ un endroit à l’ autre, à ouvrir les yeux au-delà du cercle de mes lunettes, à tendre l’ oreille pour ne rien manquer, à transformer mon cerveau en enregistreur portable. Durant des décennies, j’ avais « pissé de la copie », rempli des colonnes avec la vie, les drames, les complots ou les bonheurs des autres. Traqué le réel, ou en tout cas ses apparences. J’ avais été soumise à la dictature de l’ instant, sans m’ autoriser trop de recul car je savais bien que derrière moi le gouffre s’ ouvrait, celui du doute et des incertitudes.
Pourquoi m’ offrir ces carnets ? N’ avais-je pas beaucoup écrit, n’ avais-je pas déjà beaucoup raconté ? Aussi loin que je remonte, si j’ aime écrire, j’ aime aussi parler. Cela me ramène peut-être à mon enfance de fille unique : lorsque je revenais de l’ école, en milieu d’ après-midi, j’ étais attendue par une mère attentive, qui me disait « dis-moi tout, raconte-moi ta journée… ». Lorsqu’ elle était certaine que je n’ avais rien omis, elle commentait, recadrait, multipliait les injonctions « tiens-toi droite », « si tu dis la vérité, tu ne dois avoir peur de personne ».
Par la suite, lors des camps de vacances, j’ étais nulle en tout : je haïssais les jeux de société, multipliant les fautes pour perdre au plus vite et me faire éjecter, je manquais les ballons que je ne voyais pas arriver, expédiais les balles de tennis bien au-delà des terrains, démolissais les plinths et autres engins de torture. Lors des corvées vaisselle, on m’ adjurait d’ essuyer avec prudence et de ne pas faire de zèle. Ce n’ est qu’ au moment de la veillée que je me rattrapais : là, enfin, je pouvais faire la chronique de la journée. Raconter les hauts faits des uns et des autres, enfiler les anecdotes, essayer, dans la mesure où c’ était possible, d’ arracher quelques rires et un peu de considération.
Bien plus tard, mes amoureux ont toujours été capables d’ écouter. Capables ? Sans aucun doute. Obligés ? Sûrement… À chaque retour de voyage, il leur fallait découvrir l’ envers du décor. Ils étaient priés de mesurer l’ étendue de mes bêtises, de compatir avec les occasions manquées, les malentendus. De déposer des compresses sur les blessures d’ amour propre, de partager les indignations et les enthousiasmes.
À leur manière, ils soignaient aussi le corps et le cœur. Comme cette fois où, débarquant du Rwanda en mai 1994, je me découvris couverte de pustules, envahie par les démangeaisons. J’ avais le sentiment que, jusqu’ aux mouchoirs de poche, mes vêtements étaient envahis par la vermine et imprégnés de mort. Appelant à l’ aide, je reçus un conseil surprenant : « Va au fond du jardin, déshabille-toi entièrement malgré le froid et reste ainsi. J’ arrive. »
C’ est peut-être alors que je reçus le premier carnet. Au cas où…
Si, ce soir-là, je n’ ai rien dit, essayant seulement de me réchauffer, les jours suivants, j’ ai tenté de vider la mer avec un gobelet, rédigé la seule version possible sinon acceptable, en sachant bien que je ne livrais que le surplus de l’ indicible. Que je nettoyais la surface du couvercle.
Aujourd’ hui, les carnets sont toujours là. Avec leurs pages blanches dépourvues de texte, mais imprégnées de souvenirs.
À contrecœur, à reculons, j’ ai cependant entrepris de feuilleter quelques chapitres, en songeant à celui qui m’ offrit les carnets noirs et en m’ excusant auprès de ceux qui connaissent déjà toutes mes histoires.
Chapitre 1.
Les rêveurs paradisde l’enfance
L’oncle venu d’ailleurs
À cette époque, la petite rue du Silence, aux confins d’ Uccle, à la limite sud de Bruxelles, n’ était pas encore à sens unique. Alourdis de fleurs dans la montée ou légers comme des bulles lorsqu’ ils cahotaient sur les pavés, les corbillards se croisaient sur le chemin du cimetière. Durant des heures je les regardais passer, je comptais les voitures qui roulaient au pas et soupesais du regard les groupes silencieux, vêtus de sombre, qui montaient vers le portail de pierre bleue.
Parfois, lorsque le vent soufflait d’ est en ouest, quelques particules noirâtres s’ échappaient du crématorium en direction de la rangée de maisons en contrebas mais nul n’ y prêtait attention. En cette moitié des années 1950, le cimetière représentait alors la seule vie du quartier, son unique attraction et le bistrot installé en face de l’ entrée principale portait bien mal son nom, « Au Silence ». À l’ issue de chaque enterrement, le même scénario se répétait : pâles, la mine défaite, les gens endeuillés se réfugiaient dans l’ établissement et s’ écroulaient sur les chaises comme des coureurs arrivés en bout de piste.
Ceux qui revenaient de la cérémonie de crémation donnaient l’ impression de flotter dans le vide, ils prenaient du temps pour se remettre. Les catholiques paraissaient plus sereins, lestés de paroles de réconfort. J’ aimais les voir s’ attabler devant des tables couvertes de plateaux présentant des « pistolets », ces petits pains fourrés de fromage ou de jambon, et engloutir des bières. Après les premières minutes d’ affliction, les endeuillés se lançaient dans de grands discours de retrouvailles. Ils passaient en revue le sort des vivants et s’ informaient de leurs santés respectives.
Je me demandais si la mort de l’ un de mes parents rassemblerait jamais tant de monde. J’ avais l’ impression que nous, on ne connaissait personne et j’ étais certaine que si, vivants et discrets, nous réussissions à laisser tout le monde indifférent, morts nous ferions moins de bruit encore. Je regrettais que mes parents aient été des gens si effacés, il me semblait que s’ ils réussissaient à rassembler du monde derrière leur cercueil, ce serait la preuve qu’ au moins ils avaient existé.
Un jour où, fidèle à mes habitudes, je tuais le temps en observant les groupes qui se relayaient au « Silence », je vis une incroyable voiture se faufiler derrière un corbillard et briser la file des affligés. Le véhicule aurait pu se contenter de remonter notre rue sans passer par le cimetière et, s’ il avait grimpé tout droit, il aurait freiné net devant la porte de notre maison. Au lieu de cela, on aurait dit que le conducteur prenait plaisir à glisser entre les voitures bien astiquées, comme pour exhiber l’ épaisse couche de poussière rouge qui maquillait les sièges, le volant, les pare-chocs, tandis que de l’ argile fraîche semblait avoir été plaquée sur les phares. Rouge aussi était le petit homme au visage poupin qui s’ accrochait au volant et s’ arrêta pile. Avant même que s’ entrouvre la portière, mes parents avaient bondi. Je vis mon père, un homme si réservé d’ ordinaire, étreindre l’ inconnu, tandis que ma mère se contentait de piquer un baiser sur la joue rose du visiteur. Poussant mon vélo devant moi comme un bouclier, je m’ approchai lentement et demeurai inerte lorsque l’ inconnu m’ embrassa avec un mélange d’ effusion et de timidité.
Cependant, l’ air de famille était incontestable : front haut, regard myope, petites lunettes rondes, cet inconnu ne pouvait être que le frère de mon père, un homme dont l’ existence n’ était jamais évoquée qu’ à travers des soupirs, des silences qui rythmaient les phrases comme des points de suspension. Cette fois pourtant, il s’ agissait de réelles retrouvailles : alors que mon père poussait son cadet dans l’ escalier, ma mère se précipitait pour sortir son plus beau service à café et me bousculer au passage. J’ étais priée de céder ma chambre à l’ inconnu et de l’ appeler « mon oncle ».
Un an plus tôt, l’ affaire aurait été réglée plus facilement : je me serais précipitée sous la table ronde du salon. De là, cachée sous la nappe, j’ aurais pu deviner le rythme de la conversation en observant le battement de pied des convives. Mais cette fois je n’ osais plus. Je savais qu’ en cas de fuite ma mère allait me rappeler à l’ ordre, évoquer « l’ âge de raison », répéter que « le ridicule ne tue pas » et asséner sur un ton définitif « il y a un temps pour tout ». Coincée entre la cuisine où je craignais d’ être réquisitionnée pour servir le café et le salon débarrassé en toute hâte de ses housses, je décidai de m’ installer dans une sorte de no man’ s land près de la porte, à mi-chemin du monde des adultes. Un terrain neutre d’ où je tentais de comprendre pourquoi, après tant d’ années de silence, ce petit homme rond comme une balle de tennis avait soudain rebondi dans notre direction.
Au fil des bribes de conversation, je finis par comprendre que l’ oncle Ernest arrivait tout droit d’ Algérie. Sa famille – celle de mon père – l’ avait, semblait-il, considéré comme un rêveur, sinon un raté. N’ avait-il pas refusé de reprendre le commerce de mon grand-père, écarté l’ idée de jouer en Bourse comme mon oncle, l’ autre frère de mon père ? Cadet de famille, il avait cependant accepté de devenir prêtre et, se faisant appeler Pierre, il avait aussitôt pris le large, avec dans sa valise de cuir une soutane soigneusement pliée qui ne pouvait qu’ inspirer confiance. Qu’ était-il allé faire dans cette Algérie alors en proie à la guerre ? Prêcher la bonne parole, ouvrir un établissement pour jeunes filles de bonne famille, se mêler de politique ?
Alors que ma mère tentait de m’ éjecter du salon au moment où la conversation devenait intéressante, je compris que l’ oncle avait séjourné dans des villages au bord du désert, dormi à la dure, sympathisé avec de grands garçons bruns qui, disait-il, lui avaient appris à faire la guerre et à aimer autrement. De ce voyage, il avait ramené des tableaux aux couleurs violentes qu’ il refusait de sortir du coffre de sa voiture et lorsqu’ il évoquait les paysages de dunes et les rouges couchers de soleil, ma mère faisait tinter sa vaisselle. Les couverts cliquetaient comme pour exprimer une sorte de désapprobation ménagère.
Mon père, qui ne comprenait rien aux aventures de son cadet, mais se réjouissait de le retrouver, se contentait d’ ouvrir de nouvelles bouteilles de bière et de nettoyer avec minutie ses lunettes rondes, comme s’ il voulait traquer la moindre trace de poussière rouge. N’ osant pas m’ approcher de la table familiale, j’ écoutais de loin les histoires de panne de voiture, de pièces de rechange trop chères, d’ un petit pactole familial qui avait fondu au soleil. Je ne retenais que les évocations des gens de là-bas, ces hommes aux longues robes, ces femmes si belles qu’ il fallait les cacher, tandis que leurs pieds soigneusement peints apparaissaient plus désirables encore que leurs visages invisibles. Plus tard dans la soirée, l’ oncle parla aussi des montagnards, des gens qu’ il décrivait comme libres, audacieux, qui refusaient les voiles et les contraintes et dont les femmes couraient au puits sans dissimuler leur visage.
Tout à la fin de la soirée, mon père avait les yeux rétrécis, les joues rougies.
La fumée de sa pipe avait créé dans la pièce un nuage bleu dans lequel s’ enroulaient les volutes de la cigarette de l’ oncle. Tout doucement, l’ invité commença à parler de la guerre. Car ce pays-là, si beau qu’ il aurait souhaité le peindre jour et nuit, était déchiré par la guerre. L’ armée française, disait-il, ratissait les villes ; les combattants locaux, qu’ il appelait d’ un nom bizarre, les fellaghas, se cachaient dans les villages puis fuyaient dans les montagnes et n’ hésitaient pas à tuer ceux qui refusaient de les héberger.
Sitôt qu’ il fut question de blessés, de morts, dès que l’ oncle entreprit de raconter les mutilations et les fusillades, ma mère s’ emporta et me renvoya dans ma chambre. Il fallut que je colle l’ oreille à la porte pour deviner des fragments de récits, interrompus par ma mère qui répétait : « On a entendu assez d’ horreurs pendant notre guerre à nous… » Mon père, d’ une voix basse et grave que je ne lui connaissais pas, disait qu’ il fallait laisser parler son frère, qu’ il était important de respecter les combats et les épreuves des autres, que le voyageur avait sans doute besoin de confier son histoire à quelqu’ un…
Même si, bien longtemps après, des témoins de l’ époque m’ ont parlé de mon oncle comme d’ un homme sympathique, plus aventurier que curé, qui franchissait volontiers la frontière algérienne chargé de liasses de billets dissimulés dans sa soutane, je n’ ai jamais compris ce qui l’ avait poussé vers ce pays en guerre. Je savais seulement que c’ est là qu’ il avait voulu se lancer dans la peinture, que cet homme du Nord avait été attiré par des garçons trop beaux, que ce curé aux allures de père tranquille avait été fasciné par la guerre, la violence, l’ aventure. Jeune encore, rond et comme usé par les années d’ exil, il me faisait l’ effet d’ un galet poli par des vents contraires. Un galet ignorant pourquoi il avait été poussé sur cette plage-là et non sur une autre.
Alors que les adultes bavardaient jusqu’ au plus profond de la nuit, mes rêves pour la première fois me transportèrent vers des paysages nouveaux, où se dressaient des dunes immenses, où des gens furtifs, se déplaçant à dos de mulet sur des sentes escarpées, étaient dépassés par mon oncle au volant de sa voiture rouge…
Le lendemain, alors que nous étions au milieu de la semaine, était un jour férié. Mais lequel ? Je ne m’ en souviens plus. S’ agissait-il de célébrer la dynastie, la fin de la guerre ou la résurrection des morts ? Je sais seulement qu’ au matin l’ oncle était toujours là. Il avait dormi dans ma chambre, il semblait frais et dispos. Ses joues luisaient, il se frottait les mains comme pour étendre une invisible pommade. Pour quelqu’ un qui revenait du désert, qui avait dû se débrouiller avec les pannes de voiture et puiser dans les plats avec ses doigts, il présentait des mains étrangement nettes, avec des ongles soigneusement limés, des paumes douces et blanches et ses gestes mesurés étaient tendres et lents. Des mains de peintre peut-être, mais surtout des mains qui avaient gardé l’ onction du sacerdoce…
Ce matin-là, en tout cas, les confidences de la veille appartenaient au passé. L’ invité de la nuit ne songeait qu’ à repartir, comme si une seule soirée en compagnie de mes parents lui avait amplement suffi. Il parlait vite, de l’ état de sa voiture, de l’ usure des pneus et du moteur. Il expliquait qu’ il était attendu ailleurs et qu’ il lui faudrait faire bonne impression. Mes parents, toute réserve disparue, s’ employèrent à l’ aider. Ma mère repassa le linge qu’ elle avait lessivé durant la nuit, mon père, d’ autorité, se mit à laver la voiture poussiéreuse. À cette époque, les car-wash n’ existaient pas encore et les privilégiés qui possédaient une voiture passaient volontiers des heures à nettoyer le véhicule à grandes eaux, à le ripoliner, puis laissaient le gros bijou étinceler devant leur porte, ravis d’ épater les voisins. Mon père trouvait peut-être du plaisir à laver lui aussi une voiture devant un garage vide, qui d’ ordinaire ne servait qu’ à stocker les sacs de charbon et les réserves de bois. Sans doute voulait-il aussi témoigner son affection à ce frère si peu connu. Réquisitionnée pour l’ occasion, je fus priée de faire la navette avec des seaux d’ eau propre, des brosses, des torchons.
Je n’ avais jamais vu mon père s’ agiter autant. Se démenant autour de cette longue voiture rouge, il récurait les portières, d’ où la poussière s’ écoulait en longues traînées, il s’ attaquait à la rouille des jantes, jetait des seaux d’ eau sur le toit, passait une peau de chamois sur les vitres. De loin, ma mère criait « cela suffit ainsi, demain elle sera à nouveau sale », mais mon père n’ entendait rien. Comme si l’ honneur de la famille en dépendait, il lavait, frottait, grattait, et son cadet, un sourire moqueur derrière ses lunettes rondes, le regardait s’ agiter sans lui prêter main-forte.
Même les plus nobles entreprises ont une fin et, avant midi, la voiture était prête. Briquée, polie, elle sentait le frais, le propre tandis qu’ un filet d’ eau rougeâtre glissait vers le caniveau.
Durant plusieurs jours, des traces de poussière allaient s’ accrocher dans les interstices du trottoir et mon oncle avait depuis longtemps disparu que mon père éternuait encore.
L’ oncle lui-même semblait remis à neuf. Son visage poupin était éclairé par une chemise immaculée, la houppe grise de ses cheveux le faisait ressembler à un Tintin fripé et je me souviendrai toujours de ses petites mains huileuses et douces.
Pour le déjeuner, ma mère s’ était surpassée. Elle avait dressé la table ronde, celle des jours de fête, sorti les couverts argentés, le service reçu en cadeau de mariage, plié les serviettes, fait chambrer une vieille bouteille de vin qui reposait dans la cave à charbon et qui datait peut-être de sa journée de noces. Faussement confuse, ma mère expliquait « je l’ ai gardée pour le jour où nous aurions la visite de “quelqu’ un” »…
L’ oncle ne s’ est pas fait prier. Il s’ est répandu en compliments bien tournés, s’ est révélé un convive agréable. J’ observais ses gestes précis, sa manière de s’ essuyer les lèvres après chaque bouchée ; il ressemblait à un chat repu et, alors qu’ il attendait le cognac que mon père lui proposait, je m’ attendais à le voir ronronner au coin du feu.
Quelques minutes plus tard cependant, l’ urgence se faisait à nouveau sentir. L’ après-midi était à peine entamée qu’ il devait partir. Finie l’ évocation de l’ Algérie, terminés les récits de pannes dans le désert, oubliée la guerre qui l’ avait sans doute attiré là-bas et puis repoussé vers son pays d’ origine.
Il lui fallait prendre congé. Se confondre en remerciements, m’ embrasser en me promettant un cadeau qui ne viendrait jamais. Il s’ inclinait devant ma mère qui, baissant enfin la garde, répétait en vain une autre de ses phrases fétiches : « Attends jusqu’ à ce que tu partes… »
L’ assaut de bonnes paroles ne dura guère. Dès le premier tour de clé, la voiture sembla hennir, frémir. Au démarrage, le carburateur mal réglé lâcha un pet accompagné d’ une fumée noire qui nous fit tousser.
Le lendemain, mon père toussait encore. Il éternuait, frissonnait malgré le beau temps que son frère avait peut-être ramené d’ Algérie. Il avait froid, comme s’ il aspirait à retrouver le soleil vertical dont l’ autre lui avait tant parlé. Rien ne pouvait le réchauffer et après trois jours de frissons, ma mère commença à s’ inquiéter. Le vieux médecin de famille prescrivit des remèdes homéopathiques et après cinq jours, il se décida à faire appel à un confrère car le malade semblait s’ affaiblir.
Dans le couloir, il y avait des conciliabules, les médecins chuchotaient, comparaient leurs diagnostics. Quant à moi, reléguée dans ma chambre, je me sentais très loin de cette agitation. J’ étais comme un nuage flottant au-dessus du désert, j’ avais la tête ailleurs.
Car ma mère, pour m’ occuper, m’ empêcher de poser des questions, avait fait une razzia sur la bibliothèque paroissiale et m’ avait ordonné de lire un livre par jour, cinq par semaine, au minimum. Délibérément, elle avait choisi des récits de voyage, ce qui me permit de découvrir Frison-Roche, Henry de Monfreid, Antoine de Saint-Exupéry… M’ usant les yeux la nuit, ne comprenant pas tout ce que je lisais, je réussis à dévorer quatre livres par semaine, atteignant presque le quota requis et je notai soigneusement les titres afin de pouvoir les citer à mon père.
Je n’ allais pas en avoir l’ occasion. De loin, c’ est-à-dire depuis le couloir, je voyais l’ homme s’ enfoncer dans le lit. Comme si les draps étaient une dune de sable blanc, dans laquelle il allait peu à peu s’ engloutir.
Mon père, un grand homme costaud, transpirait abondamment. Son corps semblait fondre à vue d’ œil, il rapetissait. Ses lunettes n’ étaient plus qu’ un paraphe de métal sur la page blanche de son visage. La maison bruissait de mots étranges, staphylocoque doré, pénicilline…
Je ne lâchais mes livres que pour pédaler comme une forcenée. Je filais vers l’ entrée du cimetière et dans la montée, j’ arrivais même à dépasser les corbillards. Je ne comprenais pas que mon père agonisait et qu’ interdite d’ accès à sa chambre je jouais les estafettes pour les enterrements des autres.
J’ ai traversé la mort de mon père comme un épisode incongru, inséré entre deux livres, comme une chute de vélo au milieu d’ une course. J’ étais pressée de remonter en selle, de dévorer le chapitre suivant. Interdite de visite et chassée de l’ enterrement, j’ en ai oublié de pleurer et personne ne m’ a dit de le faire.
Lorsque j’ ai entendu chuchoter que le malheureux avait sans doute été victime d’ une maladie tropicale alors qu’ il n’ avait jamais voyagé et que, peut-être, la voiture venue d’ Algérie avait amené quelque microbe contre lequel le sédentaire n’ avait pu opposer aucune défense, j’ ai eu envie d’ aller là-bas à mon tour. De suivre les traces de cet oncle disparu, qui ne donna plus jamais de ses nouvelles. Je voulais découvrir les montagnes, les dunes, les déserts. Descendre plus loin encore, vers les forêts tropicales. Je savais que je ne risquais rien. Qu’ en mourant à la sauvette, sans avoir eu le temps de me dire au revoir, mon père m’ avait peut-être immunisée.
L’ année suivante, je reçus un nouveau vélo et je l’ appelai Ulysse. Chaque jour, je fixai un autre livre sur mon porte-bagages. Mais je ne suis plus passée devant l’ entrée du cimetière, car la rue avait été mise à sens unique…
En attendant Bamboula
Dès que ma mère s’ est retrouvée seule, les visites se sont raréfiées, le temps des condoléances n’ avait pas duré longtemps. Je n’ avais pas assisté à l’ enterrement de mon père et je n’ avais pas été conviée au salon lorsque les visiteurs évoquaient la mémoire du défunt. Il s’ agissait de m’ épargner, de me faire passer à côté du chagrin immense qui ravageait ma mère. Confinée dans ma chambre, je lisais sous les couvertures, me fatiguant les yeux à la lueur d’ une lampe de poche. Certes, dans la chambre d’ à côté, j’ entendais des sanglots qui s’ étouffaient dans les draps, mais la porte était fermée et je ne songeais pas à entrer. Je ne pleurais donc pas, et surtout pas en public, ce que je considérais comme une déchéance.
Depuis la carapace dans laquelle je m’ étais verrouillée, le chagrin de ma mère me semblait indécent. À tout moment, ses larmes ruisselaient, elle reniflait, se mouchait. C’ est en vain que je lui disais de se tenir droite, de ne pas pleurer devant les gens, d’ attendre d’ être rentrée à la maison.
À vrai dire, j’ étais gênée par son allure. Alors qu’ auparavant ma mère était une jolie femme, mince, portant des robes fleuries qu’ elle cousait elle-même et que ses cheveux frisés bouffaient autour d’ un visage criblé de taches de rousseur, elle s’ était brusquement transformée, décidant de porter ce que l’ on appelait à l’ époque « le grand deuil ». La totale. Le noir absolu, sans concessions. Un chapeau noir, avec une voilette qui descendait jusqu’ au menton. Des bas, noirs eux aussi. Durant trois ans, le temps de passer de l’ enfance à l’ adolescence, j’ ai suivi une femme voilée, une ombre qui se faufilait dans les rares réunions de famille, se glissait dans les églises, fuyait les contacts et n’ aimait guère que j’ invite des amies à la maison. De toute façon, je n’ en avais pas envie. Car moi aussi, j’ étais en noir. Les bonnes raisons ne manquaient pas car, dans la famille, les enterrements se succédaient. Pourquoi aurais-je dû changer de garde-robe ? Même lors des goûters d’ enfants, auxquels j’ étais rarement conviée, je détonnais avec ma robe noire, très élégante, que maman avait cousue avec soin et j’ avais honte de mes cheveux bouclés que je tentais en vain de domestiquer. Des lunettes épaisses, dont les lourdes montures étaient remboursées par la sécurité sociale, me mangeaient le visage.
La famille n’ avait plus quitté sa province pour venir nous voir, les quelques amis du couple avaient discrètement pris leurs distances. Tout au plus des cousins fermiers avaient-ils accepté de m’ accueillir le temps des vacances. Partageant leur vie et leur travail, je me levais à l’ aube comme eux et menais les vaches au champ ; en vraie citadine, je protestais lorsque le cousin forçait l’ allure avec des coups de bâton. Durant longtemps, parler de ces années-là, c’ était comme descendre dans la cave à charbon. Desceller des dalles de béton et ramener des seaux de coke, sinon de suie. Parfois, cette suie remontée du passé me pique encore les yeux.
La silhouette de ma mère s’ entoure de brouillard et je la revois à nouveau, qui appose sous ses lettres et sur les enveloppes une signature rapide et sans appel « Madame Veuve ». Car jusqu’ à la fin de sa vie, elle arbora ce statut de veuve comme une décoration, sinon un signe d’ ascension sociale. Quant à moi, j’ étais devenue une « enfant de veuve ». Rien de plus et rien de moins. Une fille unique, à demi orpheline, qui préférais me taire lorsqu’ on me demandait où était mon père, pourquoi je n’ avais pas de frère ou de sœur.
Ce que je préférais, c’ était lire au soleil, tapie au fond du jardin derrière une muraille de haricots grimpants. Car ma mère, se souvenant de ses origines paysannes et obligée de surveiller son budget, avait soigneusement mis en culture la moitié du jardin. Elle ne me proposait jamais de l’ aider et je tuais le temps en pédalant furieusement, comme si je voulais disperser dans le vent la mémoire de ces années de bruine.
Au lendemain du décès de mon père, mon grand-père maternel s’ était installé chez nous afin de partager le montant de sa modeste retraite d’ ouvrier tailleur de pierres. En échange, il ne souhaitait que le couvert et un peu de tendresse, et ne cessait de répéter que la mort de mon père était une injustice. De loin, je l’ aimais bien, il était doux et bienveillant, ses genoux étaient solides. Mais avec le temps, sa présence s’était faite plus lourde. Il n’ arrivait plus à gagner la salle de bains sans être aidé, il risquait de chuter dans les escaliers. Pour lui faire de la place, ma chambre avait été coupée par une mince cloison et, chaque nuit, j’ étais réveillée par sa toux de vieillard, ses ronflements, ses promenades nocturnes. Lorsque ses rêves se transformaient en cauchemars, il frappait sur la feuille de carton qui nous séparait et j’ avais l’ impression qu’ il me hélait depuis le fond d’ un puits. La tendresse qu’ il m’ inspirait commença à vaciller ; j’ avais l’ impression que sa présence dissuadait mes copines de classe de venir me retrouver et je sentais que je perdais peu à peu le contact avec mes rares amies.
Le comportement du vieil homme devenait imprévisible. Non content de fumer la pipe dans son fauteuil, à tout moment il fuguait, se promenait dans le quartier en gilet et bras de chemise, même sous la pluie et la neige. Je surprenais de grosses larmes qui se perdaient dans sa moustache blanche lorsqu’ il murmurait qu’ il aurait préféré mourir à la place de mon père. J’ aurais dû l’ embrasser comme autrefois, m’ adosser à sa canne et en caresser le pommeau, mais je n’ en faisais rien. Du matin au soir, j’ étais ravagée par une colère froide, silencieuse. Une rage injuste, dirigée contre ma mère qui m’ empêchait de sortir, contre ce vieil homme qui, dans le salon, prenait toute la place et mobilisait le quartier lors de ses tentatives de fuite.
Faute de partenaires, mes poupées restaient sans emploi et je préférais me contenter de la compagnie des garçons. À cette époque, les enfants pouvaient encore jouer dehors et nous dévalions les pentes dans des caisses d’ emballage plantées sur des roues. Même si nous les appelions des caisses à savon, elles nous donnaient le sentiment de concourir en Formule 1.
Un jour, alors que, tête en avant, je m’ étais jetée dans la descente et me préparais à heurter la bordure du trottoir, je fus arrêtée net dans mon élan.
Un inconnu avait calé la roue, bloqué la planche à laquelle je m’ accrochais comme une noyée. Je me retrouvai le nez fixé sur une sandale noire, dont les lanières serraient un pied de géant couvert d’ une chaussette de coton. Un rire tonitruant déferlait sur moi comme une cascade et semblait jeter sur mes épaules un mélange de cailloux et d’ écume. Avec prudence, je relevai les yeux, pour découvrir une longue robe noire et l’ extrémité d’ une cordelette qui servait de ceinture. À la même hauteur, des mains ressemblaient à ce que ma mère, dans son patois wallon, appelait des « pelles à brins », c’ est-à-dire ces énormes pelles carrées que les familles pauvres utilisaient autrefois pour récolter le crottin des chevaux. Des crottins qui, une fois séchés, étaient jetés dans les poêles à charbon.
À ma grande surprise, je vis alors ces battoirs couturés de cicatrices, qui se terminaient par des ongles carrés, se pencher vers moi pour me saisir par le cou tandis que ma planche à roulettes était projetée vers le fond de la rue d’ un magistral coup de pied. J’ entendis une voix profonde me promettre une solide fessée.
À toutes fins utiles, peu habituée à un tel traitement, je me mis à hurler et à trépigner sous le regard moqueur des garçons. J’ enrageais : depuis des semaines, désireuse de me faire accepter par la bande, je m’ efforçais de courir aussi vite que les gamins, j’ avais renoncé à utiliser les freins de ma planche à roulettes et appris à placer quelques gros mots. Tous ces efforts risquaient d’ être réduits à néant par cet énergumène qui jurait en flamand et promettait, godverdomme – crénom de Dieu…–, de me dresser comme il avait dressé les Nègres.
Traînée par une poigne de fer, je fus jetée aux pieds de mon grand-père qui me caressa avec sa canne, tandis que la voix de stentor de l’ inconnu ordonnait à ma mère de mieux surveiller sa fille.
Pour la première et dernière fois de ma vie, je fus vraiment punie et enfermée dans la cave à charbon, d’ où ne filtrait qu’ une faible clarté délivrée par un soupirail. La fissure dans la porte n’ a jamais été réparée. Ayant découvert un marteau qui datait du temps où mon grand-père taillait les pierres, j’ avais entrepris de casser ma prison à coups de maillet et il fallut que les voisins interviennent pour que ma mère consente à venir me délivrer et à me mettre au lit, lestée d’ une gifle magistrale.
Le lendemain, ma fureur s’ était évaporée car le visiteur, désireux de dédommager ma mère pour les quelques sous qu’ elle lui avait donnés en dépit de notre gêne financière, nous avait laissé quelques souvenirs.
Je compris alors que l’ inconnu était un missionnaire, ami de longue date de notre famille. Tous les trois ans, il revenait en Europe pour passer des examens médicaux et il profitait de son séjour pour récolter des fonds pour ses œuvres.
C’ est ainsi que je découvris celui que j’ appelai aussitôt le « Bamboula » : une statue d’ ébène d’ une cinquantaine de centimètres, avec un beau visage lisse, un nez droit, des yeux taillés en amande et des jambes étrangement courbées, trop courtes par rapport à l’ ensemble de la silhouette.
Jamais je n’ avais touché un bois aussi lisse, aussi doux. Je ne me lassai pas de caresser le ventre rond et luisant de la statuette ; lorsque j’ y collais mon nez, il me semblait humer des odeurs de forêt et, si je fermais les yeux, j’ entendais des chants d’ oiseaux.
Bien des années plus tard, un spécialiste devait m’ expliquer que la statuette représentait un exemple typique de ce que l’ on appelait l’ art missionnaire. Elle avait été fabriquée à l’ intention des prêtres qui rentraient en Europe à l’ occasion de leurs congés. En échange d’ une obole pour leurs œuvres d’ Afrique, ils offraient à leurs proches un souvenir exotique. C’ est plus tard aussi que je compris pourquoi j’ avais tant aimé caresser le ventre de la statue : il était curieusement asexué et, à l’ endroit du pénis, on avait l’ impression que le bois avait été poncé avec soin. J’ apprendrai plus tard que les artistes indigènes, dont les principaux clients étaient les missionnaires, avaient veillé à ce que les statuettes soient dépourvues de sexe, afin de ne pas choquer les « Mompé » – « mon père », nom donné aux religieux dans l’ ancien Congo belge.
En plus de la statue, le prêtre nous avait laissé deux autres objets extraordinaires : une sorte de sabre dentelé de plus d’ un mètre, sans doute arraché à un poisson scie, et une pique en corne, plus longue que celle d’ un hérisson, que ma mère considérait avec méfiance, comme si elle avait été empoisonnée.
J’ aimais me frotter contre le bois de la statuette et j’ avais l’ impression que, malgré son sexe mutilé, elle dégageait une sorte d’ énergie virile. Ne partageant pas cette tendresse, ma mère, dès le départ du missionnaire, relégua le petit bonhomme dans le couloir et il prit place entre le téléphone et la garde-robe. Durant des années, le triste destin de cet otage venu du Congo fut d’ accueillir, sur son chef finement sculpté, des chapeaux et des bonnets de laine tandis que son cou se ceignait d’ écharpes incongrues. Son principal mérite, disait son hôtesse, c’ était d’ empêcher les couvre-chefs de se déformer.
Quant à moi, il me suffisait de regarder le petit bonhomme et de lui murmurer « Salut, Bamboula », un surnom que j’ étais seule à lui avoir donné, pour que se mette à tourner l’ usine à rêves.
Tous les trois ans, fidèle et ponctuel, le missionnaire revenait et ses récits s’ allongeaient. Il avait cessé de me tirer par les oreilles et se contentait de décrire un fleuve immense qu’ il devait remonter à bord d’ un bateau à aubes.
Il nous racontait qu’ après quatre à cinq jours de navigation, l’ embarcation accostait dans la paroisse de brousse où le père était accueilli par des chants et des tambours. À peine revenu de congé, le religieux se mettait en devoir de baptiser les nouveau-nés, de ranger les médicaments ramenés d’ Europe, distribués avec parcimonie.
Le prêtre nous décrivait ces gens qui semblaient assoupis durant des jours entiers, frappés d’ un mal qui me faisait rêver, la maladie du sommeil. Le lendemain, me décrochant la mâchoire, je racontais à l’ institutrice que j’ étais atteinte de la maladie du sommeil, mais elle me réveillait d’ un coup de baguette.
À cette époque, il ne se passait rien dans ma vie. L’ avenir n’ apparaissait que comme un long couloir gris, dans lequel je cheminais interminablement. Lorsque je me promenais à vélo, je regardais les maisons des autres et, derrière les rideaux, je voyais des familles qui semblaient jouer aux cartes ou regarder la télévision qui venait d’ être installée dans les foyers, des couples qui se serraient, des convives qui semblaient toujours attablés devant des repas de fête.
Je collectionnais soigneusement les images du Congo dissimulées dans les emballages de mon chocolat favori, je froissais en boule les papiers argentés et le dimanche, je les déposais dans le grand tronc que le curé avait laissé à l’ entrée de l’ église, devant la statue d’ un Noir joufflu qui semblait dire merci jusqu’ à la fin des temps.
Je me promettais d’ un jour découvrir la patrie d’ origine du Bamboula et de m’ endormir moi aussi au son des tambours.
Le confessionnal
Le bon missionnaire qui nous rendait visite tous les trois ans ne s’ était pas contenté d’ amener sa part de rêve. Il avait aussi rassemblé un lot d’ indulgences au bénéfice de ses fidèles.
C’ est à cause des rêves que le père scheutiste1, d’ origine française, avait semés en moi qu’ après son départ j’ ai accepté de fréquenter l’ église de notre paroisse bruxelloise.
Le temps pressait, disait ma mère, il devenait urgent pour moi de descendre de vélo, d’ étudier par cœur quelques prières, d’ apprendre à baisser les yeux. Je me suis empressée d’ oublier les autres recommandations, plus ambitieuses pour le salut de mon âme, mais j’ ai retenu de cette époque que, dans notre capitale bilingue, les Flamands et les francophones n’ étaient pas encore séparés. Nous fréquentions tous la même église et nous écoutions les sermons du même curé, qui semblaient toujours plus éloquents dans la langue de l’ autre.
Comme la paroisse était petite et que le nombre de fidèles diminuait d’ année en année, tous les enfants candidats à la communion solennelle avaient été regroupés dans une seule classe préparatoire. Flamands et francophones étaient alors mélangés, ce qui allait devenir illégal par la suite. Nous récitions les mêmes prières ; déjà incompréhensibles dans notre langue maternelle, le français, elles évoquaient des incantations barbares lorsqu’ elles étaient ânonnées dans celle du voisin.
Ainsi apprenions-nous à faire rouler les R, à placer ailleurs les accents toniques, à peser sur la dernière syllabe des mots. Comme les autres, je m’ appliquais à faire longuement siffler entre mes lèvres la finale de « bied voor ons ». Ce « Priez pour nous » murmuré dans la langue étrangère, se terminait comme un filet d’ eau et nous faisions durer le plaisir en faisant siffler le S, imitant ainsi le bruit des toilettes.
À chaque séance de catéchisme, le groupe avait déjà deux prières d’ avance alors que, pissant de rire, nous nous tenions encore la vessie avec ce « ons » qui se faufilait dans l’ église comme un serpent.
Cet âge était cruel, intolérant. L’ autre, quel qu’ il soit, était volontiers moqué, avec d’ autant plus de hargne qu’ il était proche de nous et nous ressemblait. Pour nous démarquer, il ne fallait pas grand-chose : une pointe d’ accent, un vêtement original, une situation familiale particulière. À cette époque, les familles décomposées ou recomposées formaient l’ exception et il me suffisait de ne pas avoir de père ou de frère, pour déjà me différencier dangereusement du groupe.
C’ est pour cela que, désireuse de faire oublier ma propre singularité et de prévenir d’ éventuelles moqueries, je participais joyeusement à la chasse à l’ « autre » et prenais part, au premier rang, aux batailles homériques qui nous opposaient aux catéchistes flamands.
Nos séances d’ éducation religieuse ayant lieu le soir, nous profitions du vide de l’ école paroissiale, lors des après-midi de congé, pour nous cacher dans les classes désertes. Nous y ramassions des craies que nous jetions sur nos condisciples et, dans la cour, nous tirions les nattes de ces filles trop blondes. Il nous est même arrivé d’ enfermer quelques Flamandes dans les toilettes, au fond de la cour. Nous leur expliquions qu’ elles étaient les sauvages et que, chargées de les convertir, nous finirions par les baptiser.
D’ autres fois, transformées en cow-boys poursuivant les Indiens, nous poussions les Flamandes dans des réserves imaginaires, vers les confins de la cour de récréation et il nous arrivait de les considérer comme les premiers Nègres qu’ il nous faudrait civiliser. Pour leur bien, c’ était évident.
Des décennies plus tard, j’ allais me rappeler cette cruauté juvénile, songeant que ces belles filles un peu lourdes, qui fuyaient les harpies que nous étions et qui lorgnaient déjà du côté des garçons, auraient pu se comparer aux Hutus tandis que nous, les francophones, avec nos stupides complexes de supériorité, notre brusquerie et notre langue plus acérée, nous aurions pu nous faire passer pour les Tutsis de la périphérie bruxelloise.
À onze ans, il était temps de quitter le quartier. Je renâclais car, à l’ école, j’ avais fini par m’ amuser, par apprendre moi aussi à me moquer des autres et à me défendre s’ il le fallait.
Avec soin, ma mère passa en revue les établissements de la commune. Le plus proche était un athénée, institution laïque, mais il n’ était pas question de me laisser fréquenter une « école sans Dieu ». D’ autres établissements religieux existaient mais ils étaient jugés trop snobs pour une fille qui « montait » des quartiers populaires d’ Uccle et peut-être étaient-ils jugés trop cher.
Je fus inscrite dans un établissement un peu plus éloigné, mais de bonne réputation, accueillant surtout des élèves issus de la classe moyenne, filles de commerçants, de travailleurs indépendants. Les débuts avaient commencé par une humiliation. Puisque je dévorais les livres, que je connaissais par cœur les répons des messes en latin et que j’ abhorrais les travaux manuels, ma mère avait voulu m’ inscrire en section latin-grec. Dès le premier cours, mon sort fut scellé. Le professeur, une blonde élégante, interrogea les élèves et haussa les sourcils dès les premiers mots que je prononçai. D’ emblée, elle avait demandé qui d’ entre nous connaissait quelques mots de latin et, avec enthousiasme, j’ avais crié « ite missa est ».
Au bout d’ une journée, elle avait compris et pria ma mère de passer la voir. Sans ambages, l’ enseignante signifia que « je n’ avais pas le niveau social requis pour me permettre de suivre avec succès des humanités gréco-latines et qu’ il me fallait donc chercher une autre orientation ». À l’ idée de me retrouver en section « coupe-couture » dans un établissement dit « professionnel », je menaçai d’ employer les ciseaux pour m’ ouvrir les veines et un compromis fut rapidement trouvé. J’ allais m’ inscrire dans la section dite « humanités modernes » ou « économiques », privilégiant sans doute l’ économie mais avant tout l’ apprentissage des langues, ce qui me convenait parfaitement car, pour moi, langues étrangères était synonyme de voyages.
La première année, même si j’ étais bien décidée à m’ accrocher, je me révélai la plus gauche des élèves, régulièrement qualifiée d’ « empotée ». En fait, à part lire, écrire et exercer ma mémoire, je ne savais pas grand-chose. Ici aussi, les cours de gymnastique se révélaient être un supplice, je confondais la gauche et la droite (à l’ époque, la dyslexie était encore peu connue), j’ étais incapable de marcher en respectant l’ alignement, de sauter sur le plinth en écartant les deux jambes en même temps (deux réflexes à la fois, c’ était trop pour moi…). Je détestais toutes les balles, qu’ elles sautent, roulent, rebondissent et, par-dessus tout, qu’ elles me soient envoyées. La fille unique haïssait tout autant les jeux de société, les pièces à déplacer, les cartes à battre, les devinettes, les charades. Lorsque je me trouvais, bien malgré moi, insérée dans un jeu, je m’ empressais de commettre les erreurs qui allaient précipiter mon éviction et c’ est avec délice que je retrouvais le dernier livre en date, qui m’ attendait fidèlement.
De temps en temps, je regagnais l’ école de mon enfance, pour m’ y préparer à ce qui était présenté comme « le plus beau jour de ma vie », la date fatidique de ma communion solennelle, appelée aussi « profession de foi » où j’ allais promettre à Dieu de lui être fidèle à jamais.
Alors que la date se rapprochait, je songeai qu’ il était temps d’ aller confesser mes péchés, afin de me montrer digne de porter la robe blanche que ma mère cousait jour et nuit et qui allait me donner l’ allure d’ un moine trébuchant. Je voulais être propre, faire tremper mon âme dans l’ eau de la contrition, me récurer de fond en comble et chasser enfin toutes les scories de l’ enfance. L’ étude du catéchisme s’ était révélée moins douloureuse que prévu : apprendre par cœur les Évangiles avait été un jeu d’ enfant et je récitais d’ une seule traite les textes proposés. Ma conviction était d’ autant plus ferme que, lorgnant sur les enfants de chœur, je ne manquais aucune des messes du matin et, bien avant l’ heure de l’ office, je savourais les parfums de l’ encens et des fleurs fraîches. Mon zèle avait engendré des réactions contradictoires : une religieuse, impressionnée, s’ était demandé si « je n’ avais pas la vocation ». Mais lorsqu’ elle me posa la question, je lui répondis sans ambages qu’ à la compagnie du Christ je préférais celle des garçons.
Le curé de la paroisse, lui, voyait les choses autrement. Lunettes sombres, soutane serrée, il me convoqua dans son bureau pour me sommer de « laisser tranquille » sa troupe d’ enfants de chœur, qu’ il emmenait régulièrement camper pour renforcer leur spiritualité. Menacée d’ être expulsée du catéchisme, sanctionnée par d’ éternels châtiments, je répondis avec un calme qui me surprit : « Vous n’ avez pas le droit de m’ empêcher de voir mes amis. En maternelle déjà, nous jouions ensemble… » Lorsque le curé, interloqué, convoqua ma mère pour se plaindre de mon comportement, cette dernière, à ma grande surprise, me soutint fermement et lui répéta qu’ elle me faisait une totale confiance.
Elle me livra alors une clé qui allait m’ accompagner ma vie durant : « Si tu restes polie, que tu es sûre de ton droit, tu peux aller partout, garder la tête haute. Même si tu vas chez le Roi, tu ne dois rien craindre… »
Quelques semaines plus tard, soupçonné de pédophilie, le curé fut retiré de la paroisse mais les plus séduisants de ses enfants de chœur ne furent plus jamais tentés de regarder les femmes.
À la veille de cette première communion, comme une peau morte après un coup de soleil, des éléments de ma foi allaient commencer à se détacher l’ un après l’ autre.
Durant des semaines, je m’ étais préparée à l’ exercice de la confession.
J’ avais le sentiment de n’ avoir rien oublié. Ni les avanies infligées aux Flamandes ni les fous rires qui suivaient le détournement des oraisons ou les impatiences qui me faisaient jaillir de la maison comme poussée par un ressort. J’ avais même décidé d’ avouer que j’ aurais dû mieux aimer mon grand-père et en tout cas le lui montrer davantage. J’ admettais qu’ au moment de la mort de mon père, je n’ aurais pas dû dire tout haut que, de mes parents, c’ était lui le préféré.
Malgré tous mes efforts de mémoire, la récapitulation de mes fautes me paraissait cependant trop brève, peu sérieuse en ces temps de grand nettoyage. À toutes fins utiles, je décidai d’ y ajouter la simonie et le nicolaïsme, des mots étranges quelquefois prononcés par mon grand-père. J’ étais sûre que ces termes pédants feraient de l’ effet. (Je n’ allais réaliser que bien plus tard que le trafic des indulgences ne serait jamais mon fort.)
Bref, tout était prêt, j’ avais appris par cœur la liste de mes turpitudes. La chapelle était située au rez-de-chaussée du couvent où nous avions mémorisé, trois jours durant, le vade-mecum du parfait aspirant à la sainteté. Le lieu était petit et sombre, seule brillait dans le chœur la lueur du Saint-Sacrement. Arrivée en dernière minute, je trouvai l’ oratoire pratiquement vide, avec seulement quelques silhouettes penchées sur leur prie-Dieu, expiant sans doute de mystérieux péchés que j’ avais omis de faire figurer sur ma liste.
Sûre de ma mémoire, désireuse d’ en finir au plus vite, je me jetai presque dans le confessionnal plongé dans l’ obscurité, en distinguant à peine une sorte de guichet derrière lequel je m’ imaginais que le prêtre, comme une sorte de postier de l’ âme, me délivrerait quelques timbres de rédemption valables pour l’ éternité. Dans un premier temps, je balbutiai, mais bien vite, ma mémoire se libéra. Ma courte vie fut passée en revue, dans tous ses détails et sans la moindre complaisance. Lorsque la litanie s’ acheva, je courbai les épaules dans l’ attente de la sentence. J’ étais impatiente d’ écouter le verdict qui devait à la fois me laver, me purifier et m’ infliger une pénitence rédemptrice.
Les secondes s’ écoulèrent, puis les minutes. Le silence avait fini par devenir oppressant. Méritais-je vraiment cette torpeur accablée, ce reproche muet ? Le cœur du prêtre aurait-il cédé à la fatigue, au poids de mes aveux, ou bien le brave homme se serait-il endormi ?
Il me fallut de longues minutes pour oser bouger, sortir avec précaution de la cabine de bois où je me sentais coincée.
C’ est alors que le drame survint : en soulevant délicatement le rideau mauve qui était censé dissimuler le médecin de l’ âme, je m’ aperçus que le bocal était vide. Que j’ avais débité toute ma vie, pour la première et la dernière fois, devant une cloison de bois percée de trous, derrière laquelle il n’ y avait rien. Personne. Il n’ y avait donc pas eu d’ écoute, pas de blâme, pas de pénitence, pas de pardon. La lessive n’ avait pas eu lieu.
La déception aurait dû me faire pleurer mais j’ éclatai d’ un fou rire nerveux. Regagnant le dortoir des filles, je ne dis rien à personne. Je ne pensai même pas « mission accomplie », et dormis d’ une traite.
Bien longtemps après, je devais conclure que ce soir-là j’ avais perdu la foi, comme plus tard j’ allais perdre ma virginité. Par inadvertance, en déposant le poids léger de ma vie sur une balance dépourvue de fléau.
L’Expo 58, apothéose d’une certaine Belgique
Cette année-là, en 1958, Bruxelles quitta ses airs de province. La ville craquait sous toutes ses coutures, éventrée, percée, nivelée. Ma mère qui, ses achats terminés, aimait prendre un café dans le centre-ville, ne s’ y retrouvait plus. Lorsque, pour la première fois, elle s’ avança dans l’ escalator d’ un grand magasin de la rue Neuve – l’ Innovation, qui allait flamber quelques années plus tard –, elle trébucha sur la dernière marche en mouvement et termina les bras en avant. Vexée et furieuse, elle décida derechef de rentrer à la maison pendant que je pouffais de rire.
À vrai dire, on ne s’ y retrouvait plus depuis qu’ une exposition universelle avait été annoncée dans notre capitale. La Belgique, encore sûre d’ elle et de ses atouts, entendait faire bonne figure et des travaux avaient été entrepris d’ est en ouest : ici, on creusait pour faire place à des parkings en abattant au passage des maisons qui avaient résisté depuis le Moyen Âge, là on amenait un viaduc préfabriqué, qui allait déverser des flots de voitures dans des tunnels qui ressemblaient à des montagnes russes.
Les places du haut de la ville étaient éclairées par des bandeaux lumineux qui faisaient défiler les dernières nouvelles et quelques adultes, amis de ma mère, en profitaient pour tenter de me faire passer ma nouvelle lubie : être journaliste. Ils m’ assuraient que le temps des journaux imprimés allait bientôt se terminer, que ce métier dont je rêvais était voué à disparaître.
Je nourrissais moi-même de sérieux doutes, depuis que ma mère avait été convoquée par la directrice de l’ école. Depuis des semaines, installée au premier rang, j’ avais soigneusement dissimulé un handicap qui allait en s’ aggravant : je voyais de moins en moins bien. Le professeur de gymnastique n’ avait pas trouvé normal que je fonce comme un bélier fou en direction de ses plinths pour les manquer avec fracas, et que je sois totalement incapable de rattraper un ballon ou tout autre objet volant. La titulaire de notre classe, un professeur de français que je vénérais, n’ avait rien remarqué. Et pour cause : j’ apprenais tous les textes par cœur et, pour ne pas être prise au dépourvu, j’ essayais de devancer les programmes. Mais comment aurais-je pu prévoir la trajectoire d’ une balle de volley ?
Lorsqu’ elle se rendit compte que je ne voyais plus à deux mètres, ma mère me traîna vers un autre oculiste, plus jeune et mieux outillé. Après avoir examiné avec attention mes yeux, puis mes lunettes, il me fit sortir de la pièce avec une colère contenue. Sitôt l’ entretien terminé, nous nous dirigeâmes vers un autre opticien. Il était apparu que le précédent, chaudement recommandé par la Sécurité sociale, avait interverti les verres, corrigeant sévèrement le plus sain de mes yeux et abandonnant l’ œil malade. La myopie s’ était donc aggravée au rythme de ma croissance, c’ est-à-dire de manière spectaculaire. Sitôt l’ erreur corrigée, c’ est d’ un pas léger que nous nous sommes dirigées vers l’ Expo.
C’ était mon seul désir, sinon mon obsession : y passer le plus de temps possible. J’ aurais voulu courir sur les chantiers, passer des jours entiers sur cette chape de béton qui remplaçait désormais les prairies d’ autrefois.
J’ aurais voulu tout découvrir, le prestige du pavillon des États-Unis, la puissance du pavillon soviétique, la flèche du génie civil qui ne tenait en équilibre que par miracle et je rêvais évidemment de prendre place dans l’ une des boules de l’ Atomium. J’ aurais voulu disposer d’ un droit d’ entrée permanent, vivre des surprises quotidiennes, recevoir, comme une prime fabuleuse, six mois de rêve et d’ émerveillement. Amèrement, je reprochais à ma mère de n’ avoir acheté que douze tickets d’ entrée, d’ avoir mesuré nos plaisirs avec parcimonie.
Plus que les différents pavillons, où les États du monde entier s’ affichaient sous leur meilleur jour, ce qui me fascinait, c’ était la diversité des visiteurs. Ici des hommes portaient de longues robes, là des femmes laissaient entrevoir leur nombril. Craignant me perdre dans la foule, ma mère me tenait fermement par la main, elle nattait encore mes cheveux alors que je piaffais d’ impatience comme un poney qui tire sur son licou.
Alors que le monde était venu à nous, que la terre entière était à portée de main, ma mère voulait passer une bonne partie de notre temps dans le pavillon de « La Belgique joyeuse ». Des gens qui semblaient sortis tout droit des bistrots de notre quartier mangeaient des frites, buvaient de la bière dans des verres qui avaient la dimension de hanaps moyenâgeux ; certes, il y avait de la musique, de la couleur, de l’ ambiance, mais je regardais de haut ces bedaines, ces visages alourdis par la graisse. À vrai dire, si j’ avais eu l’ âge requis, j’ aurais aimé être engagée parmi les hôtesses de l’ Expo, ces jeunes filles triées sur le volet qui s’ occupaient des visiteurs de marque. Multilingues, elles préfiguraient déjà l’ avenir international de Bruxelles.
Les heures passées dans ce périmètre magique filaient trop vite et, lors de notre troisième visite, je serrais les dents. Une douleur aiguë me tenaillait le ventre, chaque pas équivalait à un lancer de couteaux, mais muette, stoïque, craignant d’ être ramenée à la maison, je ne desserrais pas les lèvres. C’ est pliée en deux que je traversai le pavillon du Congo belge.
J’ étais fascinée par les photos en noir et blanc qui montraient des cases aux toits de paille, devant lesquelles des gens à demi nus cuisinaient en plein air. J’ aimais particulièrement les images de guerriers coiffés de plumes d’ autruche, qui faisaient des sauts prodigieux et passaient au-dessus de la tête de missionnaires ébahis. Mais davantage que les photos, que les objets venus d’ Afrique, je ne me lassais pas d’ observer les visiteurs venus tout droit de « notre » Congo.
Eux, ils ne portaient pas de coiffe de paille, ils n’ avaient pas de grosses lèvres et leurs cheveux crépus étaient divisés par une longue raie, dessinée avec soin. J’ apprendrai plus tard que c’ est Baudouin, « Bwana Kitoko » (joli garçon en lingala), qui lors de sa visite en 1955 avait lancé la mode. Depuis son départ, tous les jeunes Congolais arboraient des lunettes rondes et des cheveux soigneusement séparés par une raie.
Serrés dans des costumes stricts, le visage éclairé par des chemises d’ un blanc éclatant, tirés à quatre épingles, les visiteurs congolais marchaient lentement. Eux aussi étaient désireux de tout voir, de tout enregistrer. Comme s’ ils étaient conscients de la chance qui leur avait été donnée, ils ne voulaient rien perdre de l’ Expo et visitaient systématiquement tous les pavillons, se préparant ensuite à découvrir Bruxelles elle-même.
À l’ époque, je ne comprenais pas que, pour ces invités venant du Congo, notre colonie, ainsi que des deux protectorats de la Belgique, le Rwanda et l’ Urundi (qui allait devenir le Burundi), la découverte de l’ Expo et plus encore les premiers pas à Bruxelles avaient représenté un choc dont ceux que l’ on appelait alors les « évolués » ne se remettraient jamais. Car à côté de « nos » Congolais, intimidés, endimanchés, triés sur le volet avant d’ être autorisés à faire le voyage, d’ autres Africains parcouraient joyeusement les allées de l’ Expo. Issus des anciennes colonies françaises ou britanniques, certains d’ entre eux vivaient déjà dans des États indépendants. D’ autres s’ enorgueillissaient d’ avoir envoyé des députés les représenter à l’ Assemblée nationale française et, sur leur poitrine, les plus âgés arboraient des décorations récoltées durant la Deuxième Guerre mondiale. Des écrivains, des professeurs étaient invités à des colloques où ils s’ exprimaient dans un français élégant. À côté de ces hommes bien vêtus, sûrs d’ eux, qui ressemblaient à des notables prospères ou des universitaires, les ressortissants du Congo belge, intimidés, avaient une allure de provinciaux replets.
Si les coloniaux répétaient d’ un air suffisant l’ un de leurs adages, « ventre plein, nègre content », la presse, surtout étrangère, répercutait volontiers les doléances de nos invités : ces jeunes adultes acceptaient assez mal de devoir loger dans des institutions religieuses ou des auberges de jeunesse, et ils considéraient comme une brimade l’ obligation de rentrer avant minuit…