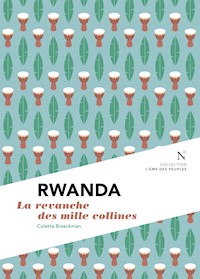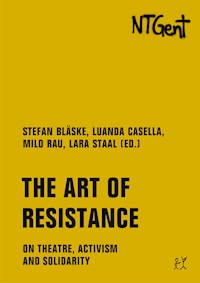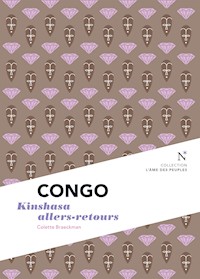
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Un pays ? Pas tout à fait, tant ses frontières sont convoitées et disputées. Un continent ? Pas complètement. Alors, une fresque ? Évidemment ! Le Congo est un tableau peint au rythme de l’Afrique, sur une toile immense où l’ardeur de survivre et l’ingéniosité forment les ressorts d’une naïveté apparente et si séduisante. Le Congo est musical, il danse, il chante, il vibre quand il rit et quand il pleure, sur les rives du grand fleuve, cette artère profonde de l’Afrique remontée par des aventuriers tout droits sortis du cœur des ténèbres. Ce petit livre n’est pas un guide. C’est un décodeur. La rumba congolaise y rythme l’amour et les folies de la vie. Le courage des femmes outragées par les guerres interminables y révèle la détermination de surmonter les décennies d’horreur. Un récit à l’image des Congolaises, rempli de leur folle énergie et ode à l’éternelle maternité de l’Afrique. Un grand récit suivi d’entretiens avec Isidore Ndaywel (historien), Maddy Tiembe (sociologue) et Freddy Tsimba (artiste plasticien).
À PROPOS DE L'AUTEURE
Ancienne journaliste au Soir, auteure de nombreux ouvrages sur l’Afrique des Grands Lacs,
Colette Braeckman sillonne le Congo et le Rwanda depuis des décennies.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Carte
AVANT-PROPOSPourquoi le Congo ?
Promis, juré : lorsque le Congo aura retrouvé le calme, sera remis sur les rails, sur la voie du développement, de la paix aux frontières, du partage équitable des ressources, je m’en irai voir ailleurs. Je reviendrai en vacances sur les rives du fleuve, sur les plages de Moanda ou, plus sûrement encore, dans les verts alpages du Nord Kivu. Partout, je retrouverai des amis de longue date et, à la fraîche, autour d’une Primus ou d’une Tembo, nous ranimerons nos souvenirs. Il sera question de Lumumba que je n’ai pas connu, de Mobutu dont je me souviens comme si c’était hier, de Laurent Désiré Kabila dont j’étais à peu près la seule Européenne à pleurer la disparition, de son fils l’hermétique Joseph et de son successeur depuis 2018, l’autre « héritier » Félix Tshisekedi.
Au moment de l’indépendance, en 1960, la Belgique a cru qu’elle quittait le Congo. Les sociétés coloniales avaient rapatrié leurs avoirs en métropole, les fonctionnaires de l’administration avaient été remplacés par des coopérants eux-mêmes suivis par des humanitaires, le président Mobutu avait bien tenté de rallumer épisodiquement les feux de la querelle permanente et de l’amour-haine, la Belgique politique ne cessait de se répéter que pour elle, le Congo appartenait au passé et qu’il fallait chercher d’autres horizons. C’était plus vite dit que fait.
Vociféré, scandé, martelé, épelé, décliné avec tous les accents de la haine et du mépris, un nom émergeait des conversations, se détachait de tous les bulletins d’information : Lumumba, Patrice Lumumba. Rentrant de l’école, je le retrouvai à la « une » de notre quotidien dont un correspondant réclamait qu’un « geste viril » règle enfin le problème. Puisqu’il n’était question que de cet inconnu qui attirait tant de passion, je commençai à m’intéresser à lui. Dans mon journal, je retrouvai les fragments du discours qu’il avait prononcé le 30 juin 1960 et qui avait été qualifié d’insultant. Pour ma part, je trouvai ce texte plutôt bien écrit : « Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des Nègres. Qui oubliera qu’à un Noir on disait « tu », non certes comme à un ami, mais parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls Blancs ? »
Cet homme m’intriguait et je suivis de loin, sans tout comprendre, sa destitution, son emprisonnement, sa fuite, son arrestation. Je n’ai jamais oublié cette photo qui le montre enchaîné, blessé, jeté à l’arrière d’un camion. Son regard m’a longtemps poursuivie. Lorsque quelques jours plus tard, en janvier 1961, sa mort fut confirmée, annoncée à la radio comme un bulletin de victoire, je me suis retirée dans ma petite chambre et j’ai passé des vêtements noirs.
Même si j’étais trop jeune pour comprendre, il me semblait qu’il me fallait porter le deuil. Mais surtout, alors que je lisais et relisais les manchettes des journaux, j’avais le sentiment aigu d’un mensonge. Je sentais qu’on ne me disait pas toute la vérité, qu’il y avait autre chose. Autrefois, désireuse d’en savoir plus, j’avais décidé qu’un jour, j’irais voir là-bas. De mes propres yeux. Que j’irais au Congo. Pour regarder. Pour comprendre. Pour raconter. Des décennies plus tard, je raconte toujours, ou en tout cas j’essaie, mais je ne suis pas encore sûre d’avoir compris.
Ce pays est trop vaste. Il m’échappe, il me surprend, me déconcerte. Quatre-vingts fois la Belgique ! Quatre fois la France ! Combien de fois ces chiffres n’ont-ils pas été répétés ? Quand il s’agissait du Congo, tout était toujours conjugué au superlatif : un « scandale géologique », « le plus long fleuve du monde après l’Amazone ». Une terre riche, qui « pourrait nourrir toute l’Afrique ».
Trop d’emphase, trop de démesure. Pour les « petits Belges » que nous étions, le Congo a longtemps été notre seule fenêtre ouverte sur le monde. Notre « ailleurs » à nous, à la fois lointain, différent et familier. Jusqu’aujourd’hui, le Congo me fascine, m’éblouit ou me consterne. Il est trop, et parfois trop peu. Lorsque je débarque, ce pays me prend à la gorge, avec cette odeur d’herbe, de forêt qui se glisse jusque dans la poussière de Kinshasa. Sauf en saison sèche, lorsque le ciel est plombé, hermétique, les pluies ne sont jamais loin. Elles creusent des ornières, des flaques immenses que les hommes traversent en remontant leurs pantalons et que les femmes abordent en posant leurs souliers en équilibre sur leur tête. De plus en plus souvent, l’eau déborde, ronge les immeubles orgueilleux qui s’écroulent sans prévenir et les nouveaux quartiers.
Au premier abord, à Kinshasa, le fleuve est invisible. On sait pourtant que sans lui, cette ville de huit millions d’habitants (ou peut-être dix, sinon douze ? l’une des plus peuplées d’Afrique…) n’aurait jamais existé. C’est à partir du pool, qui porte le nom de Stanley, que les bateaux peuvent remonter jusque Kisangani. C’est ici, via cette autoroute liquide, que le reste du pays apporte ses offrandes, le riz de l’Équateur, le poisson, les grumes… Sur la carte, ce fleuve immense se déploie comme une chevelure de femme, avec ses boucles et ses affluents innombrables, ces voies d’eau qui enserrent la forêt et définissent le pays. Mais Kinshasa, elle, tourne le dos à son fleuve ; les berges sont réservées aux baleinières qui pourrissent, aux pirogues motorisées qui fuient vers Brazzaville, la capitale d’en face.
Ce pays me fascine, oui, par son immensité, sa diversité, ses infinis possibles. Mais aussi, surtout, par ce sourire irréductible qui m’accueille toujours. « Ça va ? Ça va un peu… un peu seulement… » et parfois, rarement, « un peu bien ». Ce qui veut dire que ça va mieux, ou en tout cas que l’on espère que cela ira. Demain, peut-être, ou après. Toujours l’incertitude, la précarité. Le bonheur, c’est au jour le jour qu’il se tisse, addition de petits moments, de chances modestes, avec un peu d’espoir toujours, qui glisse entre les interstices du malheur.
C’est pour cela aussi que je ne me lasse pas du Congo. Au Congo, il y a toujours de quoi serrer les poings. De quoi raconter. Ce pays, c’est notre passé, mais son libéralisme débridé, sa mise en coupe sauvage, son désordre, c’est notre avenir aussi. Parler du Congo, inscrit depuis cinq siècles au cœur de la mondialisation, c’est parler de nous.
Kinshasa allers-retours
Arriver au Congo, quelle que soit la frontière franchie, cela ne s’oublie jamais. C’est au départ du Rwanda que l’impression est la plus forte. D’un côté du poste frontière de la Grande Barrière, qui sépare Gisenyi de Goma, la capitale du Nord-Kivu, on quitte un pays soigné, fleuri comme un jardin anglais. Les voitures roulent lentement, les sourires sont retenus, les agents de l’immigration vous dévisagent attentivement, les gardes-frontières vous font reculer derrière la ligne, au centimètre près.
Sitôt que l’on franchit le no man’s land entre les deux pays, alors qu’imperceptiblement on se détend, c’est l’impression de désordre qui s’impose. Partout, on crie, on se bouscule, on rigole. On passe en fraude. Avec un clin d’œil complice, Papa Pitsou facilite les démarches et coupe la file. Sur le côté, des camions attendent, lourdement bâchés, des chauffeurs de taxi transportent les bagages d’un pays à l’autre.
À Bukavu, c’est autre chose encore : les femmes qui reviennent du marché de Cyangugu au Rwanda traversent le pont sur la rivière Ruzizi et remontent vers la ville à petits pas, chargées de hottes plus lourdes qu’elles, qui tirent leur front vers le sol. Pommes de terre, haricots, bananes, c’est le petit Rwanda qui nourrit son grand voisin.
À Kinshasa, les handicapés, exemptés de taxes, attrapent au vol des ballots qui sont jetés vers eux depuis le bateau qui accoste au « beach » et fait la liaison avec Brazzaville.
Sur les lignes aériennes intérieures, les grands sacs taillés dans du plastique blanc et bleu ramènent du poisson séché, des fruits et d’autres marchandises. Ces bagages sont pesés certes, mais en cas de surpoids, on s’arrange, on glisse l’équivalent d’un « sucré », d’un « café » (un dollar) ou bien plus si nécessaire. Rien d’étonnant à ce que les bateaux coulent, régulièrement, emportant vers le fond du fleuve ou des lacs des passagers qui n’ont jamais appris à nager, que les avions surchargés s’écrasent au décollage, à tel point que les sociétés d’assurance interdisent aux expatriés d’emprunter les compagnies nationales : le Congo, où l’on néglige les lois de la pesanteur et où les kilos supplémentaires se vendent au plus offrant, connaît la plus grande densité au monde d’accidents aériens ou maritimes. Ce tumulte est cependant joyeux, bon enfant. Une maman pesant plus de cent kilos ne s’offusque même pas lorsque le steward du vol vers Lubumbashi lui demande poliment d’aller s’installer à l’arrière de l’appareil, en expliquant qu’avec son poids, elle pourrait déséquilibrer l’avion.
« Ambiance à gogo »
Ce chaos apparent s’étend au secteur minier : depuis la libéralisation de l’exploitation minière en 1982, le secteur artisanal est devenu le plus grand employeur du pays. Six millions de Congolais y trouvent leur subsistance, au jour le jour. Dans des circonstances souvent dangereuses, épuisantes, voire proches de l’esclavage. À juste titre, les ONG internationales plaident pour la régularisation du secteur. Elles souhaiteraient que l’exploitation des mines soit confiée à des sociétés ayant pignon sur rue, que la traçabilité des minerais soit établie et que les mines « sauvages » ou clandestines soient fermées, car elles occupent des femmes et des mineurs d’âge et sont souvent contrôlées par des groupes armés.
Cependant, dans une mine d’or proche de Lemera au Sud-Kivu, un jeune garçon, les pieds plantés dans la boue, la pioche sur l’épaule, me salue de loin en m’invitant à rejoindre son groupe, des jeunes gens rassemblés autour d’un bac de bière, et il annonce joyeusement : « Ambiance à gogo ».
D’en haut, depuis la route en surplomb, où passent les camions qui descendent vers la ville d’Uvira et la frontière du Burundi, on ne distingue que des silhouettes affairées comme des fourmis. Cependant, lorsque nous arrivons au bout d’un sentier aussi glissant qu’une piste de ski, les attributions des uns et des autres se précisent. Pas question d’avancer sans avoir été saluer les « P.D.G. » responsables des carrés miniers : ils attribuent les emplacements, partagent le fruit des efforts communs, s’occupent des malades ou des blessés à évacuer. Chaque mineur autorisé à travailler ici doit s’acquitter d’une cotisation de 10 $ par mois. Les chefs de cellule, de secteur, les A.D.G. (administrateur directeur général) et autres vice-P.D.G. sont assis à l’écart et surveillent le chantier. Plus près de la rivière, d’autres hommes, des contrôleurs, pointent chaque jour les creuseurs présents sur le site, qui, les pieds dans l’eau, remuent et tamisent les boues. Un homme, chaussé de bottes rouges, arpente les lieux, carnet de notes à la main. Un creuseur nous explique pourquoi il attire les regards désapprobateurs : « C’est le représentant du gouvernement, envoyé par l’organisme Saescam, imposé par la communauté internationale ; c’est lui qui garantit la traçabilité des minerais ». « Il coûte cher et ne sert à rien » conclut un étudiant qui ne travaille ici que durant les congés scolaires afin de gagner de quoi payer ses études.
D’un fourré proche de la rivière, des rires s’échappent : les mamans y ont installé une cuisine d’où s’élève la fumée des brochettes. Attachées aux arbres, des chèvres attendent en bêlant le moment du sacrifice. Des « femmes libres » arborent dès l’aube des perruques blondes ou rousses, un maquillage outrageux. Leurs talons hauts s’enfoncent dans la terre et elles offrent aux regards leur généreuse poitrine. Leur allure effrontée contraste avec la modestie des « mamans twangeuses », des femmes plus âgées qui, accroupies, pilent les pierres dans des mortiers afin de faciliter le tamis. Tout autour, des enfants s’affairent : ils vont chercher de l’eau ou du bois pour le feu, poussent des vélos chargés de sacs remplis de pierres, nettoient canaux et rigoles. Le travail est dur, les galeries creusées à même le flanc de la montagne et mal étançonnées s’effondrent trop souvent, le « syndicat » des creuseurs affecte aux cérémonies de deuil l’argent des cotisations. Mais du matin au soir les transistors crachent une musique tonitruante, d’un groupe à l’autre on se salue, chacun sait exactement ce qu’il doit faire et espère toujours « la chance », tomber sur une belle pépite, sur une pierre à forte densité de minerai.