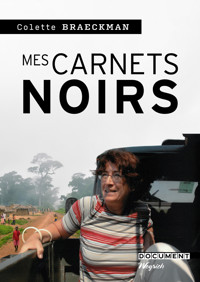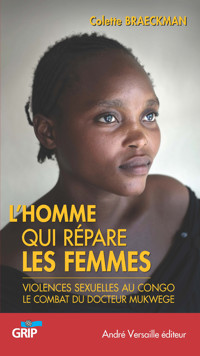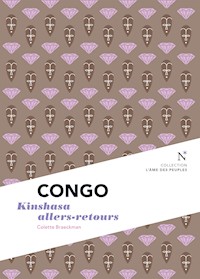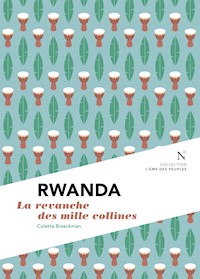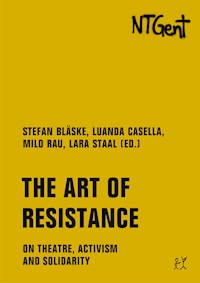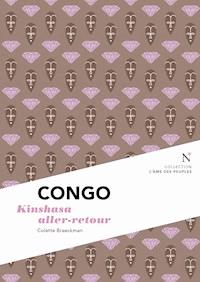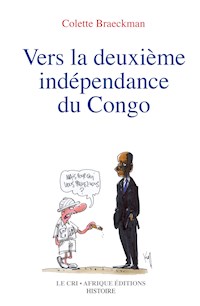
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Présente et active depuis un siècle aux côtés du Congo, la Belgique a cependant manqué bien des rendez-vous, sous-estimé les revendications de ses interlocuteurs et, en particulier, leur aspiration à la dignité, au respect mutuel. Récemment encore, elle a mal perçu la ténacité de
Joseph Kabila et risqué une rupture que nul ne souhaitait vraiment.
Si la guerre se termine, le Congo, après avoir connu des élections démocratiques, récupérera enfin toute sa souveraineté. Il pourra alors, peut-être, proclamer véritablement son indépendance. La deuxième… Avec ou sans la Belgique ?
Ce livre décrit le pari qu’a représenté la transition vers la démocratie, finalement réussi grâce à l’appui international, à la détermination des acteurs politiques congolais mais, surtout, grâce à la volonté d’une population désireuse de décider de son destin, de reconstruire son État, de confirmer son sentiment national.
Ce livre retrace aussi le parcours de
Joseph Kabila, depuis son arrivée au pouvoir dans des circonstances dramatiques jusqu’à sa victoire électorale. Il relate les tentatives d’émancipation économique et les obstacles qui se sont multipliés, parmi lesquels la relance de la guerre au Kivu par le général rebelle
Laurent Nkunda.
Lorsqu’il s’agit du Congo, le pessimisme coïncide souvent avec le bon sens, en apparence en tous cas. Ce livre-ci tranche par rapport à ce conformisme de la raison, il se conclut sur une note prudemment optimiste, à l’heure où le Rwanda et le Congo ont décidé d’unir leurs efforts pour régler la question des combattants hutus rwandais réfugiés au Congo, prétexte à quinze années de guerre, de pillages, de martyre aussi pour les femmes du Kivu…
Les perspectives qui se dessinent en Afrique centrale ne laissent personne indifférent. Après avoir sillonné le Congo dans tous les sens depuis des années,
Colette Braeckman nous dresse son bilan de manière passionnante et magistrale.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Colette Braeckman est journaliste, chargée de l’actualité africaine au journal
Le Soir où elle s’intéresse tout particulièrement à l’Afrique centrale. Outre ses articles quotidiens, elle publie aussi dans
Le Monde diplomatique et de nombreuses revues, elle est l’auteur de livres incontournables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VERS LA DEUXIÈME INDÉPENDANCE DU CONGO
DU MÊME AUTEUR
Le Dinosaure, le Zaïre de Mobutu,Fayard 1992
Rwanda, histoire d’un génocide,Fayard 1994
Terreur africaine, Burundi, Rwanda,
Zaïre, les racines de la violence,Fayard 1996
L’Enjeu congolais,Fayard,1999
Les Nouveaux prédateurs,Fayard 2002
Lumumba, un crime d’État,Aden, 2002
Colette Braeckman
Vers la deuxième
indépendance
du Congo
Essai
Catalogue sur simple demande.
www.lecri.be [email protected]
(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
ISBN 978-2-8710-6758-0
© Le Cri édition,
Av Leopold Wiener, 18
B-1170 Bruxelles
En couverture : dessin original (© Pierre Kroll)
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
En souvenir de Bénédicte Vaes
Avec tous mes remerciements à Elisabeth Burdot, Bob Kabamba et Robert Verdussen pour leur vigilante relecture.
Sigles & abréviations
AFDL : Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo
AIC : Association internationale du Congo
ALIR : Armée pour la libération du Rwanda
AMP : Alliance pour une majorité présidentielle
BDK : Bundu Dia Kongo
CEI : Commission électorale indépendante
CEPGL : Communauté économique des pays des Grands Lacs
CIA : Central Intelligence Agency
CIAT : Comité international d’accompagnement de la transition
Conader : Commission nationale pour le désarmement
CPI : Cour pénale internationale
CREC : China Raylway engineering Corporation
EIC : État indépendant du Congo
EITI : Initiative pour la transparence dans l’industrie minière
FDLR : Forces démocratiques pour la libération du Rwanda
FMI : Fonds monétaire international
HRW : Human Rights Watch
ICHEC : Institut des Hautes études commerciales
IRC : International Rescue Committee
MLC : Mouvement pour la libération du Congo
Monuc : Mission des Nations unies au Congo
MPLA : Mouvement populaire pour la libération de l’Angola
MSR : Mouvement social pour le renouveau
NEPAD : Nouveau partenariat pour l’Afrique
PALIR : Parti pour la libération du Rwanda
Palu : Parti lumumbiste unifié
PPRD : Parti populaire pour la reconstruction et le développement
PPTE : Pays pauvres et très endettés
PRP : Parti de la révolution populaire
PTB : Parti du travail de Belgique
RCA : République centrafricaine
RCD : Rassemblement congolais pour la démocratie
RCD ML : Rassemblement congolais pour la démocratie, mouvement de libération
RCD N : Rassemblement congolais pour la démocratie-national
RDR : Rassemblement pour le retour des réfugiés
RUD : Rassemblement pour l’unité et la démocratie
SADC : Conférence pour le développement de l’Afrique australe
UDPS : Union pour la démocratie et le progrès social
UN : Union pour la nation
Introduction
Un livre qui ne dit pas tout
Ce livre ne dit pas tout. Au départ, il s’agissait seulement de tenter de raconter comment, un siècle exactement après la reprise de l’État indépendant du Congo par une Belgique plus réticente qu’enthousiaste, l’ancienne métropole avait dilapidé le capital d’influence et de sympathie dont elle était créditée en Afrique centrale.
Anecdotes donc, récit des attentes déçues, des maladresses, des offenses infligées à des dirigeants démocratiquement élus… Histoire des rendez-vous manqués, hier et aujourd’hui…Évocation de quelques personnages clés, au premier rang desquels Joseph Kabila, dont les origines et la personnalité suscitèrent plus de questions et d’hypothèses que de certitudes…
Description d’une méthode, celle d’un homme qu’un tragique caprice du destin porta au pouvoir et qui tenta, avec humilité et obstination, de répondre à l’impossible défi et réussit, contre toute attente à réunifier son pays et à le conduire aux élections.…
Cependant, au fil de la rédaction, à mesure que les évènements se précipitaient, le propos du livre s’est élargi, les questions se sont aiguisées : le Congo, à la veille du cinquantième anniversaire de son indépendance, qui sera célébré en 2010, n’aurait-il pas le droit, au lendemain des élections démocratiques, de s’émanciper des anciennes tutelles, de trouver de nouveaux partenaires, en Chine notamment ? Et les critiques dont ses dirigeants faisaient l’objet, auxquelles s’ajoutait la reprise de la guerre à l’Est, n’étaient-elles pas une nouvelle tentative de déstabilisation ?
Ce livre est focalisé sur la manière dont Kabila réussit à asseoir son pouvoir et à écarter ses rivaux, avec une habileté que Mobutu lui-même n’aurait pas reniée. Il relate comment la guerre s’est réveillée au Kivu et en présente les acteurs, les commanditaires et les victimes, parmi lesquelles les femmes, soumises au martyre des violences sexuelles, il décrit les jeux de dupes de l’économie mondialisée, le Katanga et ses mines convoitées, les Chinois dont la présence suscite espoirs et polémiques….
Il néglige le formidable réveil des provinces qui entendent tirer parti de la décentralisation, les initiatives populaires qui se multiplient, le travail législatif mené par l’Assemblée nationale, le lent labeur de la reconstruction institutionnelle, pour se focaliser sur quelques points chauds ou controversés. Une autre histoire reste à écrire, celle de ce géant qui se réveille et qui étire ses muscles au cœur de l’Afrique. Celle de la population congolaise elle-même, son courage face aux crises qui se succèdent, son patriotisme, son inépuisable capacité de résistance et d’espérance… L’histoire des héros quotidiens, qui sont légion. Rendez-vous est déjà pris…
I Un siècle de rendez-vous manqués
Les réalisations du colonisateur belge ont souvent été mises en évidence, ainsi que les efforts déployés dans le cadre de la coopération au développement. Au cours de ce siècle d’histoire commune, sous Mobutu, sous Kabila père et fils, il y eut aussi nombre d’incompréhensions, de maladresses. Des crimes aussi…
La coïncidence peut paraître anecdotique : alors que c’est en 2008 qu’une crise majeure a éclaté entre la Belgique et le Congo – à tel point que l’on eut le sentiment de voir la République démocratique du Congo s’affranchir définitivement du « droit de tutelle » politique sinon moral que continuait à s’octroyer l’ancienne métropole –, c’est exactement un siècle plus tôt, le 15 novembre 1908, que l’immense territoire que représentait alors l’État indépendant du Congo était arrimé à la Belgique, un pays qui n’était alors lui-même indépendant que depuis 85 ans !
Même si, par testament, il avait déjà légué le Congo à la Belgique en 1889, ce n’est ni sans peine ni sans débats que Léopold II avait accepté de céder à l’État belge une colonie qui avait incarné ses rêves les plus audacieux, ses plus grandes ambitions et son immense appât du gain.
Les réticences du souverain qui, après avoir sollicité et obtenu de la part de la Belgique plusieurs emprunts, constatait que son empire générait enfin ses premiers bénéfices, s’accompagnaient d’âpres débats au Parlement belge. Les arguments utilisés à l’époque rappellent des thèmes qui seront encore d’actualité un siècle plus tard.
Au cœur du problème figurait déjà la « rentabilité » du Congo, une obsession masquée par la philanthropie.
Qu’on en juge. Le deuxième roi des Belges, qui a déjà soutenu des prospections du côté de Madagascar, du Surinam, du Guatemala, estime qu’à la Belgique aussi, « il faut une colonie » et, de manière plus triviale, il recherche une « bonne affaire » qui lui permettra d’accroître sa fortune personnelle – déjà considérable.
Lorsqu’il convoque en son palais de Laeken le journaliste explorateur Henry Morton Stanley et s’attache ses services, le souverain dissimule prudemment le caractère économique de ses ambitions. La science sera sa première couverture : Stanley, qui a déjà mené deux expéditions en Afrique centrale, est envoyé dans la région située à l’embouchure du Congo pour y fonder des postes commerciaux pour le compte du Comité d’études du Haut Congo, qui sera bientôt remplacé par l’Association internationale du Congo (AIC). Alors que Savorgnan de Brazza, le rival de Stanley, passe des accords avec les chefs de tribus riveraines du fleuve, par lesquels ils reconnaissent la souveraineté française, le roi commence à s’inquiéter : il redoute que les activités de Stanley soient bientôt contrées par les ambitions des puissances de l’époque, la France, mais surtout la Grande-Bretagne ainsi que le Portugal, présent depuis longtemps sur les rives atlantiques de l’Afrique.
Au prétexte scientifique se superpose assez vite un premier subterfuge : le roi, à l’intention des Britanniques et des Américains, propose de faire de tous les territoires, présents et futurs, de l’AIC, une zone de libre-échange. Quant à la France, Léopold II désarme son éventuelle hostilité en lui proposant, en 1884, un « droit de préemption » sur le territoire, au cas où il abandonnerait son projet. La manœuvre est habile : les puissances de l’époque se surveillent et se neutralisent, et la Grande-Bretagne et le Portugal hésitent désormais à bousculer le roi des Belges, dans la crainte qu’il ne cède alors « son » territoire aux Français, lesquels se contentent d’attendre et de voir venir…
Lorsque l’État indépendant du Congo est créé en 1885, il est reconnu comme la propriété personnelle de Léopold II, mais surtout le bassin dit « conventionnel » du Congo devient une zone dite de libre-échange et de libre navigation. Autrement dit, ce territoire devient en principe ouvert à tous et, dans un premier temps en tout cas, l’implantation belge y est même minoritaire. La justification morale de l’entreprise, rapidement trouvée, nourrira longtemps la propagande coloniale : il s’agit de mettre fin à l’esclavage qui dépeuple le centre de l’Afrique, essentiellement au départ des côtes de l’océan Indien.
Est-il encore nécessaire de rappeler que, sur le terrain, la réalité est bien différente ?
Dans les faits, les campagnes antiesclavagistes permettent aux mandataires de Léopold II de briser les courants commerciaux traditionnels (les exportations d’ivoire et d’or entre autres) et d’étendre leur mainmise jusqu’au cœur du continent. Contrairement à ce que l’on affectait de croire à l’époque, le centre du bassin du Congo n’était pas une « tache blanche » sur la carte, mais un vaste territoire sillonné de routes commerciales, de pistes sur lesquelles Stanley s’engagea et trouva en chemin porteurs et approvisionnement…
En outre, si l’esclavage proprement dit est aboli, il est promptement remplacé par d’autres servitudes, aussi meurtrières : le travail forcé, l’obligation faite aux villages de fournir vivres et porteurs, la répression et la mise au pas souvent violente des autorités traditionnelles.
Quant à la liberté de commerce, confirmée par la Conférence de Berlin, elle ne se traduira jamais réellement dans les faits : Léopold II instaure le système « domanial » par lequel toutes les terres non cultivées (dont beaucoup étaient tout simplement laissées en jachère) sont considérées comme « vacantes » et deviennent par conséquent propriété de l’État, c’est-à-dire du souverain, qui seul a donc le droit d’y mener des opérations commerciales1.
À lire les premiers récits de Stanley (notammentCinq années au Congo), on peut d’ailleurs se demander si la nature du commerce a réellement changé : les premiers explorateurs, qui ont besoin de produits de cueillette et de porteurs, introduisent une monnaie nouvelle, les « mitakos », des fils de laiton qui arrivaient au Congo par rouleaux de 35 kilos et qui étaient découpés en fines baguettes. Cette monnaie, dont le cours était arbitrairement fixé à cinq centimes, rétribuait les produits achetés aux paysans et permettait à ces derniers d’acquérir les marchandises proposées par les nouveaux venus.
Stanley s’émerveille du marché des vêtements usagés : « l’expérience a entièrement confirmé mes prévisions : j’ai rencontré par milliers des enfants noirs qui ne croient pas déroger en utilisant de vieux habits de pâles enfants d’Europe qui, au contraire, se donnent beaucoup de mal pour amasser de quoi acheter ces vêtements passés et en devenir les fiers et légitimes propriétaires. » Le commerce de la friperie venue d’Europe avait de beaux jours devant lui…
En réalité, les résolutions de l’acte de Berlin auront une double traduction : les puissances coloniales de l’époque ne se lanceront pas dans une colonisation directe du bassin du Congo, mais en cèderont l’apanage à des groupes financiers internationaux. Ces derniers mettront efforts et moyens en commun pour financer la construction de voies de chemin de fer et autres infrastructures, afin d’ouvrir au commerce le cœur du continent et réaliseront d’abord l’impressionnant chemin de fer des cataractes.
En fait, l’État indépendant du Congo (EIC) sera toujours confronté à la tension opposant d’un côté Léopold II et les capitalistes belges qui soutiennent son entreprise, et de l’autre, les milieux financiers européens. Ces derniers, à chaque atteinte à la liberté de commerce, dénoncent avec éclat les abus du système léopoldien et, en particulier, l’exploitation de l’ivoire et du caoutchouc. La pratique qui consiste à exhiber une main coupée pour justifier l’usage des munitions fera particulièrement scandale et deviendra emblématique.
Par ailleurs, s’il est obligé de recourir aux services de mercenaires internationaux, recrutant des volontaires jusqu’en Scandinavie, Léopold II tient cependant à ce que l’EIC garde un caractère aussi « belge » que possible : il demande que des officiers belges soient détachés à l’Institut cartographique militaire, encourage les missions catholiques à s’implanter sur son territoire autant qu’il tente de décourager les missions protestantes (soupçonnées d’alimenter les campagnes de dénigrement), il veille à ce que les flux du commerce se dirigent en priorité vers le port d’Anvers, et c’est auprès du gouvernement belge, aussi réticent soit-il, qu’il sollicite ses premiers emprunts.
L’entreprise commerciale de Léopold II et ses abus, qui découlent moins de la cruauté des individus que de ce que Jean Stengers appelle une « logique capitaliste poussée à l’extrême » suscitent des vagues de critiques aux États-Unis et surtout en Grande-Bretagne, des critiques qui ne sont d’ailleurs pas toujours désintéressées. Les dénonciations du Congo léopoldien, formulées par la « Congo Reform Association », fondée par Morel et Casement, ne secouent pas seulement le monde anglo-saxon : elles ont de profondes répercussions en Belgique où la question congolaise devient un problème de politique intérieure.
Curieusement, les clivages qui se manifesteront sur ce sujet ressemblent parfois à ceux que l’on retrouvera un siècle plus tard : alors que le roi, à la recherche de capitaux, a tissé des liens de plus en plus étroits avec les groupes financiers, son entreprise rencontre l’indifférence des milieux libéraux et l’hostilité du Parti ouvrier belge (POB), prédécesseur du parti socialiste. En 1898, Walthère Frère Orban, qui dirige un gouvernement libéral homogène, est franchement hostile aux entreprises africaines du roi et le cabinet Malou, qui lui succédera, partage ces réticences. Par contre, lorsque le parti catholique arrive au pouvoir avec Auguste Beernaert, il soutient les ambitions royales et défendra l’EIC sur la scène politique belge2.
En 1908, le débat fait rage : les radicaux (libéraux progressistes) sont opposés au colonialisme et, rejetant l’idée d’annexer le Congo, ils se retrouvent aux côtés des socialistes. Émile Vandervelde, le chef de file du POB, s’oppose à l’aventure militaire et capitaliste et il dénonce avec éloquence les abus commis dans l’EIC, assurant que l’opprobre qu’ils suscitent rejaillit sur la Belgique elle-même. Il n’ira cependant jamais jusqu’à mettre en cause le principe même de la colonisation.
Quant à la population du royaume, elle n’est tout simplement pas concernée : les aventures du roi se déroulent en terre lointaine et inconnue, la colonisation est le fait des grands groupes financiers et de certains individus, civils ou militaires, qui s’attachent au service du souverain, le Congo n’est pas une colonie de peuplement. En 1908, il n’accueille pas plus de 1 500 Belges, dont l’espérance de vie se trouve fortement raccourcie par l’insalubrité du climat… En fait, la plupart des Belges, dont le pays est à la pointe du développement industriel européen, n’ont aucun goût pour l’aventure tropicale, à l’exception de quelques personnages hors du commun.
Mais, lorsque le Parlement belge vote finalement la reprise du Congo, un sentiment l’emporte : il faut mettre fin aux abus de l’ère léopoldienne, empêcher qu’ils dégradent l’image d’une jeune métropole très soucieuse de respectabilité internationale. Mettre en valeur la colonie, la développer, mais sans avoir ni à combattre pour elle ni, moins encore, à débourser quoi que ce soit…
La Charte coloniale adoptée en 1908 est très précise sur ce point : le Congo et la Belgique auront des finances séparées, une « cloison étanche » doit empêcher la métropole d’être jamais entraînée dans le « gouffre financier » que pourrait représenter le Congo.
Le Congo a grandi la Belgique
En réalité, des historiens comme Stengers ou Van Temsche établissent, chiffres et exemples à l’appui, que les flux financiers ont toujours eu tendance à remonter dans l’autre sens : c’est le Congo, exportateur de matières premières, dont les finances étaient mieux équilibrées et le franc plus fort (Bruxelles tenait absolument à préserver sa parité avec le franc belge), qui soutenait l’économie de la métropole. Toutes les données indiquent que la « mère patrie » a toujours eu une balance commerciale déficitaire envers sa colonie, les importations venues du Congo ont toujours été supérieures aux exportations de la métropole.
Après la seconde Guerre mondiale, c’est grâce au Congo, qui a produit du cuivre, de l’uranium et d’autres matières stratégiques mises à la disposition des alliés à un « prix d’ami », que la Belgique émerge du conflit sans être endettée. Ce pays, dont l’armée n’a pas combattu, a cependant, grâce au Congo, apporté une contribution inestimable à l’effort de guerre, ce qui lui permet de prendre place sans rougir à la table des Grands, celle des vainqueurs. La Belgique devient ainsi l’un des pays fondateurs des grandes institutions internationales de l’après-guerre, les Nations unies et ses différentes agences, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international…
Aujourd’hui encore, si la Belgique siège au conseil d’administration du Fonds monétaire international, à la tête d’un groupe d’une trentaine de pays, c’est parce qu’au moment de la création du Fonds, en 1945, Bruxelles a pu déposer une participation significative en or, alors que les autres pays européens étaient lourdement endettés. Et il est évident que c’est d’Afrique centrale que venait cet or…
Si l’on commence à savoir que la Belgique, durant toute la période coloniale, n’a pas avancé d’argent pour le Congo et a « mis en valeur » sa colonie en utilisant les ressources propres de cette dernière, en revanche le degré d’enrichissement de la métropole elle-même et celui de certains citoyens belges demeure un secret bien gardé. Certes, chacun sait que c’est grâce au Congo que les grands groupes financiers belges ont pu prendre leur essor et trouver leurs assisses financières, qu’il s’agisse du holding de la Société générale ou du groupe Bruxelles Lambert.
On sait aussi que c’est grâce au Congo que la place d’Anvers s’est développée, d’abord avec le commerce de l’ivoire et du caoutchouc, ensuite avec le transbordement des minerais dirigés vers les usines de raffinage de Hoboken et d’Olen. Et il est de notoriété publique que c’est grâce aux liens avec l’Afrique que la Compagnie maritime belge et la jeune Sabena ont pu accumuler leurs premiers bénéfices, d’autant plus facilement que la colonie étant une cliente captive : les prix des services de l’Agence maritime internationale étaient supérieurs à ceux des autres compagnies — dans les années ’70 encore, après la zaïrianisation, le montant des sommes dues par le Zaïre à la Sabena, et qui figure toujours dans la dette extérieure du pays, a été facturé au taux de 80 FB de l’époque pour un franc congolais alors que la valeur des biens des citoyens belges « zaïrianisés » était, elle, calculée au taux dérisoire de 45,25 FB pour un zaïre…3
Durant toute la période coloniale, le Congo avait l’obligation d’acheter du matériel belge, même si le prix de ce dernier n’était pas compétitif par rapport à la concurrence.
Il est généralement admis que la « trilogie coloniale » se composait de l’administration qui gérait, de l’Église qui éduquait et évangélisait et des trusts qui développaient l’économie et « mettaient en valeur » les ressources de la colonie. Dans cette conception, le citoyen belge « lambda » n’était guère concerné par le Congo, le produit de ses impôts ne se dirigeait pas vers la colonie, et ses revenus propres n’étaient en rien affectés par l’engagement africain. Il ne faudrait cependant pas en conclure que le Belge moyen ne tirait pas lui aussi profit, à sa modeste manière, de la relation privilégiée avec le Congo. Tous les Belges qui écoutaient les émissions de l’INR avant 1960 se souviennent de la litanie qui précédait quotidiennement les informations de la mi-journée. Quelques minutes avant treize heures, celui que l’on appelait alors le « speaker » énumérait les cours en Bourse des sociétés présentes au Congo, Kilo Moto, Cofinindus, et, bien sûr, l’action préférée du bon père de famille : l’Union Minière du Haut Katanga…
Malgré cet intérêt financier de nombreux citoyens moyens qui encaissaient leurs coupons sans états d’âme et suivaient la hausse de leurs actions, le rendez-vous colonial ne sera honoré que par quelques groupes relativement restreints : les missionnaires (parmi lesquels une majorité de prêtres, souvent d’origine modeste, recrutés dans le nord du pays), les fonctionnaires (pour la plupart des francophones car seul le français était obligatoire dans la colonie) et les agents des grandes sociétés, embauchés pour des durées déterminées. Le Congo n’étant pas une colonie de peuplement, seuls les missionnaires et les religieuses y passeront leur vie entière et, lorsqu’ils rentreront au pays, en congé ou pour y terminer leur vie, ils intéresseront famille et cercles de relations à l’œuvre missionnaire et aux questions sociales. Quant aux laïques, la plupart ne séjourneront dans la colonie que le temps de leur vie active ou la période prévue par leur contrat, la plupart d’entre eux choisissant de passer leur retraite en Belgique. Ce n’est qu’après 1945, et dans certaines régions comme le Kivu, que des colons belges s’établiront de manière durable.
Ce manque d’enracinement humain de la population belge au Congo explique pourquoi il y eut tant de rendez-vous manqués et permet peut-être de comprendre la différence de perception de part et d’autre.
En effet, durant les huit décennies que dura la colonisation, les citoyens belges furent, certes, tenus informés du Congo, considéré comme un sujet de « politique intérieure » dans les grands quotidiens, mais la grande majorité d’entre eux n’avaient aucun engagement direct en Afrique. Par contre, les Congolais ne connurent pratiquement que les Belges !
Une mentalité d’« enfant unique »
Aujourd’hui encore, il est courant d’entendre les Congolais proclamer d’un ton sans réplique : « vous êtes nosnokos, nos oncles, vous nous avez colonisés. » La plupart des Congolais, y compris au sein des jeunes générations, estiment que les Belges ont des devoirs particuliers à l’égard de leur pays, des devoirs qui découlent de l’engagement colonial, ce lien étant d’autant plus fort qu’il était exclusif. En effet, non seulement le pouvoir colonial a limité l’accès au Congo des ressortissants d’autres nationalités, mais il a veillé à tenir sa population à l’écart des influences extérieures.
Soucieuse de préserver l’« image du Blanc » afin que les indigènes demeurent convaincus de la supériorité de leur maître, l’administration coloniale exigeait que les candidats à l’émigration présentent des garanties de moralité et de solvabilité (certificat de bonne vie et mœurs, dépôt bancaire) et elle interdisait l’accès du Congo aux chômeurs ou aux aventuriers.
Cette sélection sociale était bien différente de la politique pratiquée par les autres puissances coloniales : le Portugal ouvrit largement ses colonies à de « petits blancs » qui se mêlèrent aux populations locales et les Français se montrèrent également moins sélectifs. Quant aux Britanniques, s’ils expédiaient des prisonniers en Nouvelle-Zélande pour qu’ils y rachètent leur peine, ils veillèrent aussi à ce que les candidats à l’émigration vers la Rhodésie aient un bon « pedigree » social et en particulier ils réservèrent certaines des meilleures terres de la Rhodésie du Nord (le Zimbabwe d’aujourd’hui) aux anciens pilotes de la Royal Air Force. Les héros de la seconde Guerre mondiale se transformèrent ainsi en prospères fermiers blancs, ce qui explique peut-être la pugnacité dont ils firent preuve par la suite…
L’autorité coloniale empêchait aussi les Congolais de circulerlibrement à travers leur immense pays – des permis étaient exigés– et surtout elle veillait à ce que ses « pupilles » n’aient guère de contacts avec le reste du monde.
La Force publique avait participé à plusieurs combats décisifs sur le sol africain dont les batailles d’Adoua et de Saïo en Ethiopie, où les forces allemandes furent vaincues et leur progression arrêtée. Elle ne fut cependant pas autorisée à envoyer un détachement participer en Europe aux grands défilés de la victoire alliée : « il ne faudrait pas que cela leur donne des idées », assurait-on en Belgique… Ce n’était pas mal vu : dans le cas des colonies françaises, ce sont les anciens « tirailleurs sénégalais » qui, après leur retour de métropole, furent les premiers à porter la revendication de l’indépendance.
Il faudra attendre 1958 pour que les premiers groupes de Congolais soient autorisés à venir à Bruxelles. Ils y découvriront avec émerveillement l’Expo 58 et seront présents au « Pavillon congolais » qui recueille un gros succès de foule. Les Africains constatent aussi, non sans stupeur, qu’en Belgique il y a aussi des Blancs pauvres, des chômeurs, des ouvriers qui se consacrent à des travaux manuels ou peu qualifiés. Mais, avant tout, ces Congolais, visiteurs occasionnels ou employés dans le pavillon de leur pays, auront l’occasion de s’entretenir avec des compatriotes issus de différentes provinces et c’est là qu’ils forgeront un embryon de conscience nationale.
Le malentendu des « évolués »
>Puisqu’il ne s’agit pas ici de retracer une histoire déjà amplement parcourue, mais de relever quelques-unes des occasions manquées, rappelons seulement qu’au départ, les « évolués », avec à leur tête un certain Patrice Lumumba, demandaient simplement un meilleur statut social, plus d’égalité avec les Blancs. Bref, davantage de considération. De l’avis des observateurs de l’époque en effet, si la discrimination raciale n’existait pas officiellement au Congo, c’est dans la colonie belge que la « colour bar » ressemblait le plus à la situation prévalant en Afrique du Sud et en Rhodésie. On l’a souvent dit : les contacts entre les Belges et les Congolais étaient corrects, mais empreints d’un profond paternalisme, qui dissimulait dans le chef des premiers un indéniable sentiment de supériorité. Sentiment qui, se confondant avec l’ignorance pure et simple, explique pourquoi, alors que d’autres pays africains accédaient déjà à l’indépendance, les Belges, en toute bonne foi « ne virent rien venir »… Ils estimaient que les progrès très réels qui avaient été accomplis surtout dans les années d’après guerre, en matière de santé, d’éducation, d’organisation de la société devaient les prémunir contre d’éventuels soulèvements, des émeutes de la faim ou de la misère. Leur satisfaction, renforcée par un efficace appareil de propagande, les amena à sous-estimer totalement les aspirations « non matérielles » des Congolais, dont celle de retrouver la maîtrise de leurs propres affaires et d’être pleinement respectés, non pas comme des pupilles, mais tout simplement comme des êtres humains…
Si, en 1958, la Belgique avait compris le sens profond de la demande formulée par les « évolués » congolais, la revendication de l’indépendance pure et simple aurait peut-être pu être différée. Le fameux « plan Van Bilsen », formulé en 1955 par le professeur gantois et soutenu par les milieux catholiques progressistes, qui prévoyait l’accession à l’indépendance dans un délai de trente ans, aurait alors eu plus de chances d’être appliqué…
Aux aspirations légitimes formulées par les premiers évolués congolais, la Belgique répondit, comme souvent, par un effort financier : un plan décennal fut rédigé, un emprunt souscrit (dont la charge allait ensuite être portée au débit du nouvel État congolais), les efforts allaient s’intensifier en matière d’investissements, de santé, d’éducation. Plus que jamais les Belges voulaient transformer le Congo en « colonie modèle » afin d’étouffer dans le bien-être matériel d’éventuelles revendications. Ne chuchotait-on pas dans les salons ce dicton de circonstance « ventre plein, nègre content ».
Pari congolais ou lâchage ?
Le malaise s’approfondit cependant, jusqu’à ce que Bruxelles accepte finalement de tenir le désormais fameux « pari congolais » unanimement décrit comme un lâchage pur et simple. En quelques mois, le passage à l’indépendance fut décidé.
Pourquoi tant de précipitation ? C’est qu’en Belgique l’opinion n’était pas disposée à voir le pays s’engager dans une guerre coloniale, au contraire de la France, embourbée dans la guerre d’Algérie. Les « coloniaux », dont le nombre était inférieur à 100.000 personnes (89 000 officiellement recensées) étaient souvent mal vus par l’opinion métropolitaine qui les considérait comme des privilégiés et elle n’était guère plus encline à financer un conflit ni à soutenir un effort de développement plus coûteux dans une colonie qui, pour la première fois de son histoire, menaçait de devenir déficitaire. À la veille de l’indépendance, une commission chargée d’étudier les problèmes du Congo établit qu’en 1960 les recettes du Congo devraient s’élever à 12 ou 13 milliards et les dépenses à 20 ou 21 milliards)4. Cependant, la métropole interdit à la colonie d’emprunter sur le marché financier américain.
Lorsque fut prise la décision d’accorder au Congo l’indépendance demandée par ses porte-parole, il ne s’agissait pas seulement d’un abandon précipité ; la décision comprenait aussi une part de machiavélisme, car si les commandes politiques étaient confiées à des Congolais, les Belges avaient bien l’intention de garder en mains les leviers de l’économie, et la table ronde consacrée à l’économie fut le lien d’âpres débats.
À la veille de l’indépendance, les grandes compagnies transférèrent leurs avoirs en Belgique tandis que la dette contractée par l’autorité coloniale fut mise au passif du jeune État et cela en dépit des conventions internationales en la matière.
Maints ouvrages ont évoqué l’intervention militaire de la Belgique, qui n’avait pas été sollicitée par le Premier ministre Lumumba, le départ précipité de tous les fonctionnaires belges, qui entraîna la ruine de toute l’administration sur laquelle le jeune État aurait dû pouvoir compter, le soutien à peine déguisé apporté à la sécession du Katanga, etin finela décision d’écarter « définitivement » Lumumba de la scène politique.
Le mot « définitif » prit par la suite le sens que l’on sait et conduisit Louis Michel, quarante ans plus tard, à reconnaître la responsabilité morale de la Belgique dans l’élimination du Premier ministre.
Avec le recul, même si nul n’aurait pu prévoir l’évolution personnelle d’un Lumumba volontiers exalté et excessif, son assassinat n’apparaît pas seulement comme un crime politique, mais comme une faute due à l’absence de compréhension de son message fondateur du 30 juin. Il était normal qu’en réponse au discours du roi Baudouin marqué par le paternalisme et la bonne conscience, le Premier ministre veuille, à l’intention de ses partisans et de toute une population suspendue à ses lèvres, marquer une rupture par rapport à l’ordre ancien, quitte à atténuer ses propos par la suite. Mais les Belges présents à Léopoldville n’entendirent pas le discours dit de « réparation » que Lumumba prononça l’après-midi même et dans lequel il préconisait une heureuse collaboration entre les deux pays. Furieux, à la suite du roi Baudouin, ils avaient déjà quitté les lieux et criaient au scandale, à l’offense. Ce n’est donc pas le texte dit de « réparation » qui fut retransmis en Belgique et passa à la postérité.
Sans revenir sur la période troublée des années 1960-65 (nous y reviendrons lorsqu’il sera question de Laurent-Désiré Kabila et d’Antoine Gizenga), passons à l’interminable règne de Mobutu, qui prit le pouvoir en novembre 1965 pour en être chassé le 17 mai 1997.
Durant ces trois décennies, les relations avec la Belgique furent toujours très personnalisées, marquées par le charisme et les capacités de manipulation d’un homme habile, qui maîtrisait parfaitement le mode de fonctionnement des Belges, cet inextricable mélange de sentimentalité et d’intérêts matériels.
Bien sûr, ses interlocuteurs n’étaient pas dupes : malgré les discours officiels, les dirigeants belges ne tinrent jamais Mobutu en grande estime. Mieux que quiconque, ils savaient dans quelles circonstances et avec quels appuis le jeune militaire avait pris le pouvoir, ils savaient à quel point leurs ressortissants avaient été spoliés lors de la « zaïrianisation » intervenue en 1973 et qui avait déchiré le tissu économique du pays. Ils savaient aussi que la rétrocession finalement décidée en 1976 n’avait rien réparé, car l’essentiel de l’appareil productif du pays, redistribué aux proches du chef de l’État, avait été détruit.
Durant les trois décennies que dura le règne du maréchal, les Belges se comportèrent avec un réalisme cynique : quoique sans illusions, ils flattaient le maître de Kinshasa et, après chaque foucade, tentaient de se réconcilier avec lui pour des motifs à la fois économiques et géopolitiques.
Ce soutien belge, qui se traduisait par l’effort de coopération, par l’appui accordé au Zaïre dans les instances internationales, par les nombreux échanges de visiteurs, demeura cependant ambigu jusqu’au bout — c’est la Belgique aussi qui accueillait les opposants et demeurait la caisse de résonance de leurs griefs et de leurs dénonciations.
Parmi les opposants, les Belges avaient cependant fait leur choix : dès les années 80, les partisans de l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) qui entendaient créer un deuxième parti pour faire concurrence au Mouvement populaire de la révolution, le parti unique, furent écoutés sinon soutenus à Bruxelles. L’ancien Premier ministre de Mobutu, Nguza Karl i Bond, passé à l’opposition, reçut également le meilleur accueil dans l’ancienne métropole. Dès les années ’90, ce sont les porte-parole de la société civile et des milieux religieux qui devinrent les interlocuteurs favoris des Belges. Par contre, les opposants plus radicaux, issus des milieux lumumbistes évincés au début des années 60, devenus d’anciens « rebelles » en dépit de leur victoire électorale initiale, n’étaient guère en cour. S’ils disposaient de quelques soutiens dans les milieux progressistes, ils n’avaient pas l’oreille des cercles officiels. Cette ignorance explique pourquoi, à plusieurs reprises, les Belges furent pris au dépourvu par des développements inattendus : en 1978, lorsque les « Tigres » katangais, que l’on croyait être d’anciens gendarmes de Tshombé, attaquèrent par deux fois le Katanga devenu Shaba, les milieux diplomatiques n’avaient aucun contact avec les agresseurs, à l’exception d’Anne-Marie Lizin. À l’époque, la bourgmestre de Huy faisait ses premières armes au cabinet socialiste d’Henri Simonet et elle entra en contact avec les rebelles par l’intermédiaire de Gaëtan Kakudji, un cousin de Kabila qui travaillait au CNCD (Centre national de coopération au développement) de Liège. Par la suite, Bruxelles, à l’exception, notoire du PTB (Parti du travail de Belgique), la Belgique continua à ignorer à peu près tout du maquis que Laurent-Désiré Kabila avait maintenu en activité sur les rives du lac Tanganyika jusqu’au milieu des années 80. Après l’échec des rébellions des années 60 en effet, Laurent-Désiré Kabila, un Balubakat du Katanga, qui avait soutenu Patrice Lumumba, se replia sur sa région d’origine (Nord-Katanga) où il créa une zone révolutionnaire échappant à l’autorité du pouvoir de Kinshasa.
Cependant, le leader du PRP (Parti de la révolution populaire) venait quelquefois en Europe : en 1979, il assista à un congrès du PTB, à Bruxelles et, en 1982, il fut invité au Tribunal Russel pour le Zaïre organisé aux Pays-Bas. Ces déplacements ne lui donnèrent pas l’occasion de contacts politiques significatifs, même si Kabila profitait de chaque voyage pour rencontrer des militants de son parti et des sympathisants du Comité Zaïre et de l’ONG Oxfam qui lui envoyaient de temps en temps des secours et des ballots de vêtements.
En 1996, lorsqu’il apparut que Kabila se trouvait à la tête de l’AFDL (Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo) qui avait lancé les premières opérations militaires au Kivu, les Belges plongèrent dans leurs livres d’histoire et dans les mémoires de Che Guevara pour rafraîchir leurs connaissances. Ils ne se doutaient pas que les principaux cadres du parti de Kabila, qui n’allaient d’ailleurs pas tarder à rejoindre ce dernier à Goma, se trouvaient depuis longtemps en Belgique.
Ignorant des pans entiers de l’opposition congolaise, les Belges offrirent à Mobutu un soutien ambigu, toujours tempéré par la lucidité et les réticences. Ainsi en 1978, lorsque les rebelles venus d’Angola s’étaient emparés de Kolwezi, l’attitude de Bruxelles fut typique : désireux d’intervenir, à la fois pour sauver leurs ressortissants et pour préserver la prééminence de leurs intérêts, mais craignant de donner l’impression qu’ils se portaient au secours du président Mobutu, les Belges se firent « dribbler » par les Français qui furent les premiers à sauter sur la ville. Les avions belges, eux, avaient été obligés de faire un détour par l’Afrique du Sud, le survol de tous les États d’Afrique francophone leur ayant été interdit sur ordre de Paris !
En fait, de 1958 à 1992, la politique étrangère de la Belgique fut pratiquement monopolisée par les sociaux-chrétiens qui entendaient à la fois maintenir leur présence dans la colonie, se montrer solidaires de sa population en soutenant les projets de coopération, mais aussi exprimer au régime un soutien critique.
Le cobaye de l’ajustement structurel
Pour ce faire, tout en multipliant les gestes personnels à l’intention de Mobutu, les Belges se retranchaient volontiers derrière les institutions de Bretton Woods dès lors qu’il s’agissait de prôner plus de rigueur.
Le Zaïre de Mobutu fut ainsi l’un des premiers pays d’Afrique à mettre en œuvre les mesures d’ajustement structurel. Alors que dans les années 70 des progrès remarquables avaient été enregistrés dans l’enseignement et que des milliers de diplômés arrivaient sur le marché, dès le milieu des années 1980, le FMI (Fonds monétaire international) et la Banque mondiale, désireux de réduire les dépenses publiques, introduisirent une politique de « recouvrement des coûts » : les patients allaient être obligés de payer pour leurs soins de santé et les parents allaient devoir participer aux frais de l’éducation de leurs enfants. À l’époque, 40.000 enseignants furent mis à pied par le Premier ministre Kengo wa Dondo, qui y gagna une durable impopularité dans son pays et une réputation d’inflexible rigueur dans les milieux financiers internationaux.
S’alignant sur les institutions internationales, la Belgique, qui aurait du être informée des conséquences sociales de ces mesures d’austérité imposées au Zaïre, ne fit rien pour s’y opposer. En réalité, la dette extérieure fut le moyen de pression par lequel la Belgique, de concert avec les milieux internationaux, tentait de garder un certain contrôle sur le régime, dont elle connaissait les excès et la corruption.
Mobutu, lui, jouait sur plusieurs registres : il maîtrisait parfaitement les données géopolitiques et excellait à se présenter comme l’allié indispensable des Occidentaux, en particulier les États-Unis engagés dans la guerre froide et hostiles au régime angolais considéré comme procommuniste et soutenu par les Cubains. Et, lors du sommet de la francophonie qui se tint à Québec en 1988, il se félicita publiquement du fait que le Zaïre ait été colonisé en français…
Avec les Belges, Mobutu adorait jouer au chat et à la souris, mélangeant habilement l’émotion, la sentimentalité et les considérations strictement économiques. Jusqu’en 2009, les Belges, se trompant d’époque, crurent que de telles équations avaient encore cours : lors du dernier incident opposant De Gucht à Kabila, les officiels des Affaires étrangères laissaient entendre que tout se règlerait lors de la prochaine commission mixte, autrement dit lorsqu’ils augmenteraient l’enveloppe de la coopération, refusant de comprendre que les exigences de Kinshasa n’étaient pas d’ordre matériel mais psychologique…
Dans le cocktail subtil qui leur était servi par Mobutu, les Belges eurent toujours de la peine à repérer de réels accents de sincérité, masqués trop souvent par la mise en scène théâtralisée de l’émotion.
Car les blessures, bien réelles, ne manquèrent pas. En 1989, la presse flamande mit en doute les origines de Mobutu, le traita de bâtard. L’émotion du président, qui s’en prit vivement à la presse belge, était loin d’être feinte.
Quelques années plus tard, en 1993, lorsque le gouvernement belge s’opposa à ce que Mobutu soit invité aux funérailles du roi Baudouin alors que le président rwandais Habyarimana menait le deuil, le président fut très affecté par cette décision, qui ne tenait compte ni des relations très personnelles qui s’étaient nouées entre les deux hommes ni de la mentalité congolaise, où les deuils sont sacrés et permettent de transcender les conflits…Pour être certain d’être convié à la cérémonie, Habyarimana, la veille, avait consenti à signer à Arusha les accords de partage de pouvoir qu’il allait par la suite traiter de « chiffons de papier »…
« J’attendais des amis, j’ai trouvé des comptables »
En 1989, masquée par des considérations sentimentales, c’est la dette qui fut la véritable cause de la crise entre la Belgique et le Zaïre.
Mobutu espérait qu’une fois encore Bruxelles allait plaider la cause du Zaïre auprès des institutions financières internationales et montrer l’exemple en allégeant les mesures de remboursement.
Cette scène-là, qui fut suivie de beaucoup d’autres, je m’en souviens comme si c’était hier. C’était un dimanche soir à Gbadolite. Lorsque l’avion militaire belge se posa sur la petite piste qui traversait des champs de pamplemousses cultivés par des coopérants chinois, une brume légère montait encore de la rivière Oubangui, qui marquait la frontière avec la Centrafrique. Il faisait torride, nous étions fourbus. En effet, pour être certain d’arriver vers 18 heures dans la ville où le Président nous attendait dans son palais de marbre — en ces années-là, c’était encore l’hôte présidentiel qui fixait l’heure du rendez-vous… — l’avion gouvernemental avait quitté Melsbroek à 3 heures du matin. Haves, épuisés, le Premier ministre Wilfried Martens et son collègue des Affaires étrangères Léo Tindemans, qui s’étaient rendus directement à l’aéroport à l’issue d’une énième crise gouvernementale, ne payaient pas de mine, avec leur barbe qui avait poussé et leurs vêtements fripés. Ils furent reçus par un Mobutu en pleine forme, qui visiblement sortait d’une sieste réparatrice et avait peaufiné son numéro.
Comme souvent, il avait invité au banquet, sur la grande terrasse de Gbadolite où un buffet était tenu au chaud, les religieuses et les enseignants de l’école locale, en plus de quelques familles belges. À l’intention de ses hôtes, il avait prévu, en plus du saka saka et des brochettes locales… du boudin compote. Les ministres belges y virent une délicate attention, et rares furent les membres de la délégation qui soupçonnèrent l’ironie du geste.
Cependant, avant de passer au dîner officiel, le Président avait convoqué la presse belge et invité la télévision nationale à filmer l’entretien. Les journalistes avaient piètre allure, ils étaient aussi fatigués que les ministres, et les caméras ne se privaient pas de filmer les vêtements chiffonnés, les cheveux hirsutes.
Mobutu, lui, passa à l’offensive sans attendre les questions. L’émotionnel d’abord : il reprocha à la presse belge de lui avoir manqué de respect, et même de l’avoir traité de « bâtard »… Mais très vite, il embraya sur le chapitre économique et accusa : « J’attendais des amis, j’ai trouvé des comptables. » Il espérait en effet que les Belges réussissent à convaincre les autres créanciers d’alléger une partie substantielle de la dette qui hypothéquait l’économie du pays.
La longue crise qui devait se développer après ce spectaculaire coup d’envoi devait habilement mêler les arguments d’ordre émotionnel et les revendications économiques.
À cette occasion, les intellectuels de la place, et non des moindres, furent sollicités par la présidence pour construire un argumentaire bâti sur l’équation naguère posée, un peu imprudemment, par Henri Simonet lorsqu’il était en charge des Affaires étrangères : « pour un franc qu’elle investit au Zaïre, la Belgique en retire trois. »
Il fut question du contentieux économique, des avantages concédés sans barguigner aux entreprises belges… Vu de Kinshasa, il ne s’agissait pas seulement d’un exercice rhétorique ou d’un duel sur commande : les arguments nationalistes firent mouche au sein de la population, sans pour autant redorer le blason d’un Mobutu dont tous connaissaient les excès et qui, désormais, était publiquement mis en cause par les Belges, dont les avis faisaient toujours référence.
L’opinion congolaise se souvient toujours du débat dit de clarification qui eut lieu à Bruxelles, sous les cameras de la RTBF, où trois ténors du régime (Me Nimy, Kamanda wa Kamanda et Mpinga Kasenda) furent invités à croiser le fer non pas avec des politiciens belges (qui s’étaient courageusement récusés) mais, à défaut, avec une maigre brochette de journalistes, dont moi-même et Paul Goossens, duMorgen. Ce dernier, avec une brutalité très nordique, parodia les propos tenus auparavant par Wilfried Martens « J’aime ce pays, j’aime ses dirigeants… » et il asséna « Nous aimons ce pays, cette population, mais vos dirigeants, nous les détestons… »
S’exprimant avec un incontestable talent oratoire, préparés comme pour un match de boxe, les émissaires congolais dominèrent le débat et, avec emphase, ils annoncèrent « la fin des relations privilégiées entre le Congo et la Belgique ». En Belgique, les nombreux téléspectateurs furent impressionnés par leur brio. Mais au Zaïre, où le débat fut diffusé en boucle et célébré avec force champagne rosé dans les milieux officiels, les spectateurs furent saisis de stupeur: dans ce pays dominé par le parti unique et où la presse ne pouvait que célébrer la grandeur du maréchal, c’était la première fois qu’ils entendaient des Belges déjuger avec autant d’éclat leurs dirigeants et dénoncer publiquement la corruption du régime !
À la suite de la crise belgo-zaïroise, qui se termina à Rabat par un replâtrage précaire, les relations entre Bruxelles et Kinshasa se détériorèrent d’autant plus que le contexte international avait changé : la guerre froide était terminée et les considérations géopolitiques qui imposaient de ménager Mobutu avaient disparu.
Une rupture provoquée en 1990
C’est pour ces raisons qu’en 1990 les Belges se permirent d’aller jusqu’au bout de leur logique et de consommer la rupture.
Là aussi, s’il ne s’agit pas à proprement parler d’une occasion manquée, on peut se demander si Bruxelles n’est pas allé trop loin, sans mesurer les conséquences qu’allait entraîner sa décision.
En effet, à la suite du massacre des étudiants sur le campus de l’université de Lubumbashi, une expédition punitive, les Belges prirent Mobutu au mot.
Auparavant déjà, il avait décrété la fin des « relations privilégiées ». Lorsqu’il s’emporta à nouveau et réclama la fin de la coopération, Bruxelles s’exécuta sur-le-champ. Refusant d’écouter les émissaires qui assuraient que les paroles du chef de l’État avaient dépassé sa pensée, déclinant les offres de négociation venues d’un pouvoir dont ils escomptaient la chute à brève échéance, les Belges retirèrent effectivement tous leurs coopérants, abandonnant le terrain aux ONG et aux organisations humanitaires.
C’est de cette époque que date l’essor de la coopération indirecte, menée par le biais d’innombrables ONG belges œuvrant de concert avec des partenaires locaux. Si cette politique permit le développement de la société civile, elle consacra aussi le dépérissement de l’État, la fin du cadre politique et macro-économique sans lequel aucun développement réel n’est envisageable.
À l’époque, la décision de retrait de la coopération, destinée à précipiter la fin du régime et en tout cas à l’obliger à partager le pouvoir, fut saluée par l’opposition intérieure et par la société civile. Les conséquences désastreuses de cette rupture ne tardèrent pas à apparaître : par pans entiers, les secteurs de l’éducation et de la santé s’effondrèrent, des dizaines de projets qui ne se maintenaient que grâce à la présence et au financement de coopérants belges furent abandonnés. Et surtout, la coopération militaire belge fut retirée, alors que, jusque-là, elle avait épaulé l’armée de Mobutu et s’était efforcée, malgré la corruption ambiante et le tribalisme croissant, de maintenir opérationnelles certaines unités. Le délitement de cette armée qui n’était plus qu’une façade s’accentua, laissant le pays sans défense face aux forces des pays voisins.
Le retrait des Belges déclencha une réaction en chaîne : les deux autres pays de ce que l’on appelait alors la troïka (Belgique, France, États-Unis) abandonnèrent le Zaïre, l’Union européenne suspendit ses programmes et les institutions internationales firent de même. Bref, le pays se retrouva en roue libre, sur une pente raide. Abandonné à lui-même.
Quelques années plus tard, on allait mesurer les conséquences dramatiques de ce lâchage : non seulement le régime était affaibli et Mobutu lui-même était malade, miné par un cancer qu’il refusait de faire examiner dans une Europe qui lui avait fermé ses portes, mais cet immense pays au cœur de l’Afrique n’avait plus ni infrastructures, ni système social, ni monnaie. Et de surcroît, il était dépourvu de forces armées capables de défendre son territoire et de protéger sa population.
Participant au pouvoir tout au long des années 90, les socialistes flamands, intervenant désormais aux côtés des sociaux-chrétiens, portent une grande responsabilité dans l’évolution de l’Afrique centrale : le ministre Erik Derycke, en charge d’abord de la Coopération puis des Affaires étrangères, résumait sa politique en une phrase : « l’Afrique aux Africains ! ». Il assurait qu’il ne tenait pas à se rendre sur le terrain, car il voulait ainsi « rester objectif » — en réalité, il ne tenait pas à succomber au « charme » du Congo-Zaïre et au sentimentalisme qui marque presque inévitablement les voyages officiels, des émotions auxquelles un De Gucht allait par la suite remarquablement résister.
« L’Afrique aux Africains » : cette expression, en réalité, ne masquait qu’une profonde volonté de désengagement. En réalité, les socialistes flamands, outre qu’ils n’avaient jamais eu de véritables racines au Congo, avaient été profondément impliqués, à l’instar des pays d’Europe du Nord et des Pays-Bas dans le soutien à la lutte anti-apartheid menée par les pays d’Afrique australe. Ils se tournaient vers les pays d’Asie pour les matières économiques et avaient pratiquement abandonné aux catholiques le Zaïre et surtout le Rwanda. Cette démission explique la méconnaissance dont feront preuve les responsables politiques, et les conduira à des erreurs de jugement qui auront des conséquences dramatiques.
Dans ces années-là, il était de bon ton de critiquer l’engagement constant des milieux sociaux-chrétiens, qui depuis l’indépendance avaient pratiquement dominé les Affaires étrangères et la Coopération.
Certes, ils avaient pratiqué à l’égard de Mobutu un dangereux mélange d’émotion et d’affairisme, ils avaient joué tous les tempos de la valse hésitation, du « je t’aime moi non plus »… Et au Rwanda, c’est sans la moindre hésitation qu’ils avaient soutenu le régime Habyarimana, sans s’inquiéter du point aveugle du régime hutu, l’ostracisme qui frappait les Tutsis, et surtout le danger que représentait le refus de réintégrer une diaspora tutsie de plus en plus déterminée et organisée.
Cependant, les milieux dits « laïcs », socialistes et libéraux, sont loin d’être exempts de reproches : les libéraux se caractérisèrent toujours par la défense des milieux d’affaires et beaucoup de tolérance à l’égard de leurs « amis », tandis que les socialistes francophones défendirent eux aussi, beaucoup trop souvent, des intérêts particuliers, tandis qu’en matière de coopération ils préféraient d’autres cieux, asiatiques ou latino-américains, abandonnant pratiquement le Zaïre et encore plus le Rwanda et le Burundi aux ONG d’obédience catholique.
Ce désintérêt des « progressistes » laïques entraîna leur méconnaissance des réalités du terrain : le libéral Jean Gol fut bien l’un des seuls à discerner la faille du régime rwandais du temps d’Habyarimana, à dénoncer sa tendance génocidaire. Dans le cas du Zaïre, les milieux socialistes et chrétiens soutenaient à fond le combat pour la démocratisation que menait l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) et son chef Tshisekedi qui avait rompu avec Mobutu au début des années 80 et ils pensèrent jusqu’au bout que la conférence nationale souveraine allait réussir à détrôner pacifiquement le dictateur et amener au pouvoir des dirigeants « modérés ». Focalisés sur les évènements qui se déroulaient à Kinshasa, les milieux de gauche ne mesurèrent ni le degré d’affaiblissement du pays ni l’envergure des ambitions régionales qui allaient croissant. Et ils sous-estimèrent gravement, comme ils l’avaient fait depuis la fin des années 60, l’existence de l’opposition extérieure, incarnée par Laurent-Désiré Kabila, Antoine Gizenga et leurs partisans de la diaspora…
Rendez-vous manqué avec Laurent-Désiré Kabila
En 1996, les Belges n’avaient rien vu venir. C’est avec surprise qu’ils assistèrent au début de la guerre d’octobre menée depuis la frontière rwandaise, qu’ils découvrirent un Laurent-Désiré Kabila qui semblait émerger du passé et qui prenait la tête de l’AFDL (Alliance des forces démocratiques de libération), marchait sur Kinshasa avec le soutien des armées du Rwanda et de l’Ouganda. Une chance historique fut alors manquée.
À l’époque, le secrétaire d’État à la Coopération Reginald Moreels était, comme tous les responsables issus des milieux catholiques, obnubilé par le sort des deux millions de réfugiés hutus présents dans les pays limitrophes du Rwanda et surtout au Kivu. Lorsque les combats provoquèrent le démantèlement de ces camps qui représentaient une menace pour le nouveau régime de Kigali, Moreels se soucia d’abord du sort des réfugiés hutus. Il n’hésita pas à qualifier de « deuxième génocide » les massacres de civils qui accompagnèrent la destruction des camps et la poursuite des « génocidaires » vers l’intérieur du Zaïre. Traumatisés qu’ils étaient par le génocide de 1994 au Rwanda et par ses conséquences, influencés par la diplomatie française efficacement relayée par les vociférations d’Emma Bonino, la commissaire européenne au développement qui traitait Kabila de « boucher », les Belges ne prirent pas le temps d’analyser finement les rapports de forces au sein du nouveau pouvoir qui s’installait à Kinshasa après le départ de Mobutu. Ils négligèrent de prêter attention aux rapports transmis à Léo Tindemans par Christian Tavernier — un ancien mercenaire ami de Bob Denard, familier de la région, qui avait gardé le contact avec quelques anciens « collègues » américains.
Tavernier assurait à cette époque que la guerre entamée au Kivu n’était que la partie visible d’un vaste projet géopolitique, qui visait à chasser du pouvoir un Mobutu malade et à confier le contrôle de l’Afrique centrale à un personnalité montante, soutenue à fond par les Américains et peut-être Israël : un certain Paul Kagame, qui n’était encore à l’époque que le très puissant ministre de la Défense du Rwanda.
Si les Belges avaient davantage tenu compte des mises en garde de Tavernier, s’ils avaient pris la peine de mieux connaître les nouveaux acteurs, ils auraient constaté dès le début le manque d’homogénéité de la nouvelle équipe en place à Kinshasa. Remarqué que dès l’arrivée des rebelles à Lubumbashi, où Kabila, s’emparant du micro, s’était « autoproclamé » président, ses alliés avaient commencé à se méfier d’un homme qui se dégageait de leur tutelle avant même d’atteindre la capitale…Si les ministres belges de l’époque avaient fait de plus fréquents voyages à Kinshasa, ils auraient observé les tiraillements entre Kabila et les conseillers rwandais et ougandais qui l’encadraient étroitement ainsi que les efforts déployés par le nouveau président pour tenter d’alléger la tutelle de ses alliés de circonstance.
Une analyse plus fine aurait alors permis à la Belgique de prêter une oreille plus attentive aux demandes pressantes qui venaient de Kinshasa où Kabila suppliait l’ancienne métropole de reprendre au plus tôt sa coopération militaire, de renvoyer des coopérants civils et d’encadrer autant que possible les nouvelles autorités. Dans l’esprit de Kabila, il ne s’agissait pas là de construire une nouvelle dépendance, mais bien au contraire de se donner une alternative face aux alliés africains qui voulaient le maintenir sous tutelle et, on le découvrira par la suite, l’utiliser comme un simple homme de paille.
La « Conférence des Amis du Congo », qui se tint à Bruxelles en décembre 1997 ne fut guère suivie de résultats, pas plus que la conférence sur la sécurité régionale organisée en mai 1998 à Kinshasa avec pour objet de rassurer les pays de la région. On y entendit Kabila déclarer qu’à l’avenir il mettrait les ressources du Congo à la disposition du développement de l’Afrique. Ce discours tomba dans le vide : les alliés rwandais et ougandais, qui à l’instar des Occidentaux l’avaient déjà abandonné et condamné, avaient même négligé de faire le déplacement…
On peut être certain que si les Belges, dès la chute de Mobutu en 1997, avaient eu l’audace de se lancer dans la formation d’une nouvelle armée congolaise, les tuteurs rwandais n’auraient pas osé s’y opposer et, en août 1998, il leur aurait été beaucoup plus difficile, sinon impossible, de relancer la guerre.
Pas de tapis rouge pour le président
Lorsqu’en août 1998, le Rwanda entreprit de renverser Kabila, il fut approuvé, sinon encouragé par les Occidentaux qui jugeaient que le successeur de Mobutu était décidément trop peu malléable. Ils lui reprochaient d’avoir suspendu les partis politiques et empêché le Chilien Roberto Garreton d’enquêter sur le massacre présumé des réfugiés hutus. (En réalité, Kabila, qui n’avait eu aucune influence sur le champ de bataille, essayait, à son propre détriment, de « couvrir » ses alliés…)
Depuis Bruxelles, Eric Derycke exprima carrément sa « compréhension » pour les rebelles, s’abstenant de blâmer les pays voisins qui envahissaient à nouveau le Congo. En novembre 1998, alors que le nord et l’est de son pays étaient envahis par les armées du Rwanda et de l’Ouganda, c’est tout naturellement en Belgique que Kabila vint expliquer sa position. Mais les Belges ne voulaient discerner dans la rébellion que les conséquences d’un coup d’État manqué que, peut-être, ils approuvaient secrètement. Même s’ils n’avaient guère d’affinités avec le nouveau président, une meilleure analyse de la situation leur aurait permis de distinguer les véritables enjeux économiques et politiques et les risques de conflagration régionale.