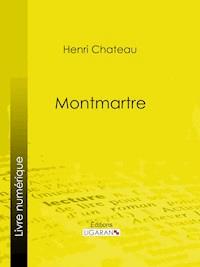
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il faut bien l'avouer : Si l'histoire de Paris est assez peu connue des Parisiens, celle de Montmartre est totalement ignorée des Montmartrois."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À NOTRE TRÈS SYMPATHIQUE CONFRÈRE ET AMI PAUL GAVAULT
Il faut bien l’avouer : Si l’histoire de Paris est assez peu connue des Parisiens, celle de Montmartre est totalement ignorée des Montmartrois.
Quel sujet pourtant plus digne d’une étude historique, quelle terre plus riche en souvenirs, quelles pages plus sombres dans l’histoire des destinées humaines, quels rires plus sonores au milieu du concert des joies nous pourraient être offerts en quelque coin de la planète, si ce n’est à Montmartre, la butte sacrée ?
Montmartre ! n’est-ce pas un peu du cerveau de Paris, – tout au moins la partie des lobes frontaux où se localise la folie, – et Paris a-t-il cessé d’être le phare du monde ?
Il nous a donc paru intéressant de reconstituer cette histoire de Montmartre au point de vue archéologique, social, artistique et, faut-il le dire, religieux. Nous n’avons pas oublié que la Butte a tiré son nom de l’une de ces sources : Mont des Martyrs ou Mont de Mars. Mais, Christianisme ou Paganisme, il y a toujours une religion à l’origine, comme il y a des croyances religieuses, – d’aucuns les eussent appelées superstitions, – au berceau de tous les peuples.
Nous avons dû, pour cet important essai de reconstitution, consulter nombre de documents, puiser nos matériaux en de considérables ouvrages d’historiographes anciens ou modernes. Nous avons fait en sorte de ne rien omettre de ce qui était susceptible d’intéresser le public au cours de cette revue minutieuse, aussi de ce qui pouvait contribuera faire aimer Montmartre, terre sacrée où se manifestèrent de grands héroïsmes et des passions ; toute la beauté et la laideur humaines ; où s’est éveillé un art exquis, où fusent des rires et sanglotent des larmes : toute la gamme qu’ont chantée les hommes !
Rendons ici un juste tribut de reconnaissance à tous ceux qui, par leurs travaux, nous furent de si précieux auxiliaires en la tâche que nous avons assumée, aux fondateurs et collaborateurs du Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie du XVIIIe arrondissement : le Vieux Montmartre, à MM. Wiggishoff, maire actuel du XVIIIe arrondissement et président de ladite Société ; Lamquet, adjoint ; J. Mauzin, J. Nora, Félix Jahyer, Am. Burion, L. Lucipia, docteur Fourès, Alexis Martin, L. Lazard, L.-A. Bertrand, H. Compan, Pierre Delcourt, Charles Sellier, Léon d’Agenais, Michel de l’Hay, Blondel, Frémont, etc.
C’est à eux que reviendra l’honneur d’avoir, les premiers, par leurs recherches patientes et leur érudition, donné le jour à la monographie de Montmartre.
À l’œuvre, maintenant, dans notre essai d’historiographie. Mais voici que des murmures s’élèvent, bougons et fâchés. « Montmartre, dit-on, terre d’immoralité !… »
Non, monsieur, terre d’IMMORTALITÉ ! Quelle chose néfaste vraiment que le bérengérisme à tendances ultra-vertueuses et qui prétend conduire les hommes, une férule à la main ! Laissez donc s’amuser la jeunesse, vieillard à l’œil jaloux. La morale ! La morale !… Elle diffère suivant les latitudes et les époques. Laissez donc s’amuser la jeunesse, laissez Montmartre fol, libertin et rieur, bercer en son giron l’humanité grave et sérieuse de demain.
Les historiographes, qui n’ont pu se mettre d’accord sur l’origine de Paris, devaient présenter, sur celle de Montmartre, des divergences d’opinions. Qu’il nous soit permis, avant d’aborder l’histoire de l’enfant, de dire en quelques mots, à grands traits, ce que fut Paris, cette nourrice bienfaisante dont Montmartre a tiré à la fois sa vie physique, sa vie intellectuelle et morale.
Quels furent ses fondateurs et d’où vient son nom ? D’après quelques auteurs, Paris serait plus ancien que Rome ; l’absence de documents probants ne permettra sans doute jamais d’établir la vérité sur ce point. Jules César, dans ses Commentaires, parle de Paris, et l’apostat Julien s’y arrêta longtemps, semble-t-il, pendant son séjour dans les Gaules. Les Grecs et les Latins l’ont appelé diversement : Lutetia, Læutetia, Lucotetia Parisii et Lutetia Parisiorum. Du culte d’Isis, du mot celte Var signifiant « ce qui s’élève au bord de l’eau, ce qui flotte », on a déduit également Var-Isis, Barisis (vaisseau d’Isis) d’où Parisis. La nef figurant dans les armes de la Ville peut s’expliquer ainsi. Nous trouvons en égyptiaque Ber-Isis, barque d’Isis.
D’autres savants rapportent l’origine du nom Lutèce aux marais croupissant alentour et qui la rendaient extrêmement boueuse. Était-ce déjà un présage, et ce mot lutum, boue, plus tard Lutetia, devra-t-il nous faire tirer de la sagacité ancestrale des conclusions faciles, mais fâcheuses, relatives à notre temps ?
À son origine, Lutèce se trouvait renfermée dans une île de la Seine, aujourd’hui la Cité, entourée de bois, de marais (rive droite) et de vignes (rive gauche). Les Romains conquirent Paris environ 52 ans avant Jésus-Christ ; pour éviter cette domination, les habitants avaient brûlé leur ville, mais subjugués par Labiénus, ils aidèrent les Romains à sa réédification.
Sous ces maîtres du monde, qui la possédèrent jusqu’en 486, Lutèce s’agrandit considérablement. Conquise alors par les Francs, elle devint, en 508, capitale des États de Clovis, premier roi chrétien (481-511). Clovis continua l’œuvre de ses prédécesseurs, il fit de Paris son séjour ordinaire, y construisit maisons et châteaux, donnant en somme le premier grand essor dans la voie d’accroissement de notre merveilleuse cité actuelle.
Des hameaux, des petits bourgs, des contres d’habitats se formèrent aux environs qui furent réunis et encadrés 600 ans plus tard sous le règne de Philippe Auguste (1180-1233) par la construction, qui dura vingt ans, de murailles à jamais fameuses, car elles sont en effet les premières fortifications de Paris. Or, cette ceinture, qu’avait rêvée le vainqueur de Bouvines et qu’aujourd’hui les Parisiens aspirent à délier – ô tempora – cette ligne fortifiée passait précisément au pied de la Butte, donnant accès dans la cité par la porte Montmartre. Voici quelles étaient en 1628 les vingt portes de Paris, énumérées dans l’ordre périphérique : Les portes Saint-Antoine, Saint-Louis. Saint-Martin. Sainte-Anne, de Richelieu, Saint-Honoré, de Nesle, de Bucy, Saint-Michel, Saint-Marceau, du Temple, Saint-Denis, Montmartre, Saint-Roch, de la Conférence, Dauphine, Saint-Germain, Saint-Jacques, Saint-Victor et Saint-Bernard.
Passons à l’histoire de Montmartre. Il est à peu près certain, si nous remontons jusqu’aux temps géologiques, que la vieille butte gisait alors au fond d’un océan quelconque, qu’elle émergea par suite des lents et considérables bouleversements du sol et parut enfin avec d’autres monticules plus ou moins élevés, les mers allant au loin se creuser un autre lit. Elle se recouvrit alors d’une luxuriante végétation. C’est l’époque des fougères arborescentes. Transformée, elle offrit plus tard des bois, des fontaines, des sources. Les chansons de gestes du cycle carlovingien, pour faire de suite un grand pas, nous parlent du grand bois de Montmartre qu’arrosaient les Fontaines de Saint-Denys, du But ou du Buc, de l’Eau-Bonne et de la Fontenelle.
La légende attribuait aux eaux de la fontaine Saint-Denis. – située à peu près à l’emplacement actuel de l’impasse Girardon, – une vertu merveilleuse. « Jeune fille qui a bu de l’eau de Saint-Denis sera fidèle à son mari ». Tel était le dicton populaire. C’est que, toujours d’après la légende, saint Denis décapité, aurait lavé sa tête dans cette fontaine ! On raconte aussi que, dès son arrivée à Paris, Ignace de Loyola s’y baigna.
La fontaine du But ou du Buc, ainsi nommée de ce que les Anglais, lors de la guerre de Cent ans y venaient tirer à l’arc, était située sur le versant nord de la Butte où passe aujourd’hui la rue Caulaincourt. On l’appelait également Fontaine de Mercure.
Mais la fontaine de l’Eau-Bonne était celle dont on faisait le plus grand usage. Elle a disparu en 1800, laissant son nom à une rue encore existante : la rue de la Bonne. Quant à la quatrième, elle avait aussi donné son nom à une rue, la rue Fontenelle, devenue depuis quelques années rue de la Barre.
Ces fontaines, causes fréquentes d’éboulements par suite d’infiltrations dans le sol, entretenaient sur la Butte une riche végétation. En 1834, elles ne suffisaient plus à alimenter Montmartre dont la population était alors de 24 000 habitants. On construisit donc, rue Ravignan, un réservoir de faible distribution. En 1860, les eaux de la Dhuys vinrent l’alimenter plus abondamment. Devenu insuffisant en 1888, on a dû songer à en établir un autre. Collé presque au flanc du Sacré-Cœur, ce réservoir, aujourd’hui complètement terminé, est alimenté par les eaux de la Seine et de la Dhuys.
Montmartre est un témoin des âges disparus ; le mont Valérien est dans ce cas. La montagne est debout, avec ses strates apparentes et horizontales pour attester que les terrains parallèles ont été enlevés par les eaux de la mer ou par d’immenses courants, probablement au début de l’époque quaternaire. Les géologues constatent la parfaite horizontalité des couches, de Meudon à Montmartre. Des sables de Fontainebleau, des bancs de marne, tantôt argileuse, tantôt calcaire ; des assises puissantes de gypse constituent ces couches sédimentaires. Le sable de la crête s’étend jusqu’à 10 mètres de profondeur.
Sans être très riche en fossiles, Montmartre a cependant fait taire d’immenses progrès à la géologie et fourni de précieux documents aux naturalistes, notamment à Olivier. Des découvertes qu’il a pu faire dans la première masse de gypse de la butte découle peut-être le fameux principe de la corrélation des formes qui lui a permis la reconstitution de types disparus : l’Anoplotherium, le Paleotherium magnum, etc.
À diverses reprises, dans les bancs de marne, on a rencontré, pétrifiés en silex, des troncs de palmier d’un très gros volume. On a également trouvé, sur la Butte, le mica en grande quantité, ainsi qu’une variété de gypse calcarifère, appelée montmartrite.
D’ailleurs, l’assise des gypses, qui atteint à Montmartre 50 mètres environ d’épaisseur, a fourni longtemps un plâtre très estimé. De là encore une nouvelle dénomination de la cité : Ville Blanche, en raison de l’aspect coquet et neigeux qu’offrit le vieux Paris construit presque en entier avec le plâtre de Montmartre, ce plâtre que chantèrent des poètes du XVIe siècle.
L’exploitation des carrières – arrêtée depuis l’hiver 1859-60, bien qu’elle puisse encore donner un plâtre abondant – eut pour effet d’enlever à la Butte son côté pittoresque, ses fontaines, ses arbres, mais favorisa la viticulture montmartroise. Si l’on en croit l’adage populaire :
le vin recueilli sur les couches de plâtre d’un terrain gypseux formé de bancs de marne et d’argile devait être de qualité inférieure, mais tiendrait peut-être à notre époque un rang honorable, mis en parallèle avec les produits chimiques de nos débitants parisiens.
Le point culminant de la Butte est à 127 mètres au-dessus du niveau de la mer ; 65 mètres au-dessus des places Blanche, Pigalle et des Martyrs, 104 mètres au-dessus de la Seine.
Les savants ne sont pas d’accord sur l’étymologie du nom de Montmartre ; fondant leur opinion sur l’existence des temples élevés en l’honneur de Mars et de Mercure, les uns le font dériver de Mons Mercurii, de Mons Cori, de Mercomire, de Mons Mercorii ou de Mons Martis ; d’autres, dom Duplessis, par exemple, l’appellent Mons Corus, du nom des vents du Nord-Ouest ; d’autres enfin, l’abbé Hilduin, Frodoard, disent Mons Martyrum, et ces dénominations sont devenues Mont-Marte et, par corruption, Montmartre.
Ce nom : Mons Martyrum, a été donné à la Butte après le supplice de saint Denis et de ses compagnons. Marte et Martre indiquent, en effet, des lieux d’exécution. L’ancienne rue du Martroi ou Martrai, à Paris, conduisait place de Grève. Des places de village portent encore les noms de Marte, Martrais, Martrois, Marthuret ; enfin des pierres druidiques sur lesquelles se consommèrent des sacrifices portent les noms de Marte, Martel ou Martine.
Mars et Mercure ont en leur temple sur la Butte ; des auteurs estimés, Guillebert de Metz, Raoul de Presles, Hilduin, Hurtaut et Magny, Gilles Corrozet, Sauval, etc., sont d’accord sur ce point. Le temple de Mars devait être situé entre la place du Tertre et l’endroit où fut élevée plus tard la chapelle du martyre. À la fin du XVIIe siècle on voyait encore vers le midi de la place du Tertre un vaste terrain ayant appartenu à cet édifice. Plus considérable, le temple de Mercure occupait le milieu d’un bois à l’extrémité occidentale de la colline, à peu près sur l’éminence où se trouve encore aujourd’hui le moulin de la Galette.
De toute sa végétation riche, de ses temples où furent adorés les dieux, Montmartre n’a gardé que ce faible souvenir. Le temps a fait son œuvre ; la pioche des carriers a fouillé la colline, le flot montant d’une humanité industrieuse a vécu sur ses flancs : ce furent des moulins, des fontaines, une abbaye. Le flot a grandi ; il ne reste rien du pittoresque d’autrefois. Les bois ont disparu. Montmartre n’est plus qu’un amas de maisons hautes, d’habitations banales, parmi lesquelles des places, des rues, des marchés et sur la crête, à la place où furent adorés les dieux, une construction disgracieuse et lourde : le Sacré-Cœur.
Saint Denis, évêque d’Athènes, surnommé l’Aréopagite, avait un goût particulier pour les voyages. Après avoir parcouru l’Égypte, il se trouvait à Hiéropolis quand mourut Jésus-Christ. Denis avait alors vingt-cinq ans. Le Conseil de l’aréopage le reçut dans son sein ; plus tard, entraîné et converti par Paul, il eut pour mission de fonder l’Église d’Athènes. Vingt ans après, il installe Publius sur son siège épiscopal, quitte son église et se rend à Rome. Saint Clément, successeur de saint Pierre, envoie alors Denis vers l’Occident. Malgré son grand âge, nous disent les livres saints, il obéit et se met en route, escorté de nombreux compagnons. Plus on est de fous, plus on rit. La caravane chrétienne pénètre et se disperse dans les Gaules ; Arles, Beauvais, Rouen, Évreux, Chartres, Toul, Reims, le Mans, etc., reçoivent respectueusement un saint. Quant à Denis, il prend naturellement la plus grosse part : Lutèce. Charité bien ordonnée… Montmartre fut alors un de ses endroits favoris. Le saint homme y fit, dit la légende, de nombreux discours, il y opéra aussi des miracles. Des auteurs anciens nient absolument cette version, laquelle possède aussi ses partisans : l’abbé Doublet, en tête. Que Denis ait opéré des miracles – il y a des gens qui voient du merveilleux partout – qu’il ait converti les foules à sa croyance ou qu’il ait vécu en misanthrope sur les hauteurs de la Butte pour n’être plus qu’à deux pas du Paradis, le certain ou le probable, d’après les écrits du temps, est que Fercennius Sisinnius, préfet des Gaules, fit martyriser notre pauvre Denis, ainsi que ses deux compagnons, le prêtre Rustique et le diacre Éleuthère ; voulut les obliger à sacrifier aux dieux Mars et Mercure ; puis, devant leur refus formel, les fit flageller et conduire au pied du temple de Mars où comme dernière… mésaventure, il leur arriva de perdre la tête par le moyen violent de la décollation. Ce supplice achevé, le préfet des Gaules eut lieu d’être surpris, si nous en croyons le P. Binet qui écrivait en 1625 : « Recueillant sa teste qui estait tombée à ses pieds, saint Denys la met entre ses mains comme s’il eut porté la couronne et le trophée de ses victoires. Si on vit gens estonnez au monde, ce furent les Chrestiens et même les payens et surtout les satellistes et bourreaux qui sachant bien asseurément d’avoir tranché la teste, estaient quasi hors d’eux-mêmes voyant ce mort qui s’en allait ainsi. » Il y avait de quoi, Père Binet, il y avait de quoi !
Maintenant que nous avons sacrifié à la légende, voyons ce qu’il faut penser, non plus de saint Denis portant sa tête dans ses mains, position assez anormale et plutôt gênante en voyage, mais du fonds même de vérité sur lequel toute légende prétend s’appuyer. Saint Denis a-t-il été martyrisé à Montmartre ?
Des quelques découvertes faites en 1611 et de traditions très anciennes, il semble résulter que la chose est probable, toutefois, de nos jours, se sont renouvelées des prétentions contraires qu’il serait injuste de ne pas mentionner.
Vers 1869, à propos de travaux d’embellissement projetés à Montmartre, un habitant de cette commune demandait à l’autorité compétente « s’il n’y avait pas lieu d’ériger à cette occasion un monument destiné à perpétuer la mémoire de cet évènement, se fondant sur ce que le projet, qui n’avait jamais été exécuté, consacrerait une place glorieuse et sainte au haut d’un escalier projeté à l’endroit où, pour la première fois, saint Denis et ses compagnons prêchèrent le Christianisme dans les Gaules et reçurent la couronne du martyre, projet digne du sujet et que devait apprécier l’administration municipale. »
Mais saint Denis ne prêchait pas pour la première fois dans les Gaules, ayant déjà converti avant son arrivée sur la Butte une partie du Parisis, du Meldois et des pays dont Rouen et Chartres étaient les métropoles. Et puis, saint Denis a-t-il été mis à mort par les ordres d’Aurélien, par ceux de Fercennius ou antérieurement par ceux de Valérien ? On manque de documents originaux. On n’est d’accord que sur le genre de supplice : la décapitation. Quant au lieu, mêmes ténèbres ; quelques auteurs l’ont placé dans la cité, à Saint-Denis-du-Pas, oubliant que les Romains suppliciaient hors des villes ; d’autres, entre Paris et Montmartre, sur une colline ; or, où est la colline ? d’autres, enfin, et ceux-là sont le plus grand nombre, ont choisi Montmartre, on ne sait pourquoi, et cette tradition a prévalu. Pourtant, Grégoire de Tours, historien d’une grande valeur et témoin presque contemporain, écrit que « le bienheureux Denis termine enfin sa vie sous le glaive » et… c’est tout. Dans son ignorance probable de tout détail relatif au supplice, il ne dit mot du lieu même où il fut accompli.
On doit donc mettre au rang des interpolations et, par conséquent, des choses douteuses, que saint Denis aurait été martyrisé sur la colline de Montmartre. Hilduin, abbé de Saint-Denis sous Louis le Débonnaire, est également perplexe. Il se contente de dire, dans sa Vie de saint Denis, « que les élus du Seigneur furent livrés au bourreau et conduits au lieu du supplice, ad pœnalia loca. »
Comme les hagiographes, les chroniqueurs s’étant plus ou moins répétés, nous dit l’abbé Valentin Dufour, sans mentionner Guilbert de Metz qui a copié Raoul de Presles, nous nous bornerons à indiquer des critiques plus sérieux.
« En ce temps, dit le Journal de Paris sous Charles VI, 1429, s’en alla le Père Richart et le dimanche devant dit qu’il devait aller prêcher au lieu du beau pré ou le glorieux martyr, Monsieur saint Denys avait été décollé et maint autre martyr. » D. Félibien, dans son histoire de saint Denis, consent à placer le lien de l’exécution hors la ville, sur une éminence, abattue depuis, dépendant de Montmartre, ne voulant pas contredire les partisans de la Butte, ni ceux du Catalogus qui le placent à la Chapelle, ou à l’Étrée, près Saint-Denis, ou même dans la ville actuelle de Saint-Denis. Le Père Longueval, dans son Histoire de l’Église gallicane, est d’avis que c’est sur la butte Montmartre. Il s’appuie pour cela sur d’anciens monuments qu’il oublie toutefois de mentionner. L’abbé Lebœuf, qui avait cru trouver le lien du supplice de saint Denis dans certaine Vie de sainte Geneviève écrite au milieu du VIe siècle, a dû revenir au sentiment commun.
Dans son Histoire de la Ville et du diocèse de Paris, l’abbé Lebeuf constate l’existence, au temps de Louis le Chauve, d’une église vouée à saint Denis et sise sur la montagne appelée depuis Mons Martyrum, bien qu’on ne puisse inférer de l’autel consacré dans l’église de l’abbaye par Eugène 111 en 1137, que ce fut le lien du martyre.
« La rue des Martyrs, dit Jaillot, Recherches sur Paris, est la continuation de la rue du Faubourg-Montmartre depuis la barrière jusqu’à Montmartre même. Une chapelle, appelée "du saint martyre", et l’opinion où l’on croit que saint Denis et ses compagnons y ont été décapités, lui ont fait donner ce nom qui ne se trouve que sur un plan moderne de Paris. »
Un érudit et un antiquaire contemporain, M. Albert Lenoir, dans la Statistique monumentale de Paris n’est pas plus précis. Même opinion irrésolue chez M. Edmond Leblant, autre archéologue de mérite.
Dans ses Études historiques sur Montmartre, M. de Trétaigne rapporte la version la plus accréditée relative à la mort de saint Denis en se basant sur les assertions suivantes d’Hilduin : « Ils furent ramenés sur le penchant méridional de Montmartre près de l’endroit où l’on croit que se trouvait le temple de Mars, et là, ils furent tous les trois décapités. »
E regnare idoli Mercurii ad locum constitutum educti ad decollationem, sunt genua flectere jussi (Aréop. v° 116).
Les mêmes hésitations se retrouvent chez les Bollandistes qui font toujours mourir saint Denis à Montmartre.
Personne donc n’est d’accord, et toutes recherches dans ce sens ne feront qu’accroître les incertitudes.
Citons pourtant une quatrième et traditionnelle version d’après laquelle saint Denis aurait été surpris au fond d’une cave où il avait accoutumé de dire clandestinement sa messe, puis décollé ainsi que l’un de ses amis. De là, sa tête entre ses mains, le décapité serait parti pour le lieu de sa sépulture, parcourant ainsi un demi-myriamètre environ avec trois haltes de repos le long du chemin ! Jolie performance en pareil accoutrement ! diraient les incrédules s’ils ne se rappelaient que dans ces questions de record, la parole célèbre de Polignac conserve toute sa force : il n’y a que le premier pas qui coûte.
En résumé, avec l’abbé Valentin Dufour, concluons que l’endroit précis où fut décapité saint Denis, – si toutefois saint Denis a été décapité. – si même il a existé – ne pourra jamais être déterminé rigoureusement.
Laissons maintenant parler Albert Lenoir qui nous donne les six stations de saint Denis :
« Saint Denis, apôtre et premier évêque de Paris, arriva de Home par la voie antique située au midi de la ville, s’arrêtant à trois endroits différents sur cette route, au lieu où s’élevèrent plus tard les églises de Notre-Dame-des-Champs, Saint-Étienne-des-Grés et Saint-Benoit. Ces lieux furent considérés comme ses premières stations. Dans l’île de la Cité, deux chapelles lui furent consacrées, comme ses quatrième et cinquième stations ; on les nommait Saint-Denis-du-Pas et Saint-Denis de la Chartre. À la gauche du monastère de Montmartre et plus bas, la chapelle du Martyre, depuis des siècles, était un lieu de pèlerinage que l’on considérait comme la sixième, et devenu station de Saint-Denis ; cette croyance s’accrut par la découverte que l’on fit, le 13 juillet 1611, d’une crypte profonde, située à l’orient de cette chapelle et qui contenait un autel grossièrement exécuté, et au-dessus une croix cassée gravée dans le mur, selon le procès-verbal publié par les historiens du temps ; croix de forme grecque comme on les faisait dans les premiers siècles chrétiens. D’autres croix et des fragments d’inscriptions étaient gravés sur les parois de cette crypte. »
Enfin, d’après Catulle, il paraît que saint Denis eut une septième station au lieu où il fut enterré et qui porte aujourd’hui son nom. Hilduin, le premier, a désigné Montmartre comme le lieu du supplice de Saint Denis quorum memoranda et gloriosissima passio e regione urbis Parisiorum, antea mons Mercurii… : nunc vero mons martyrum colatur (apud Surium, t. Ier, p. 40). Une charte du roi Robert confirme cette tradition (Dom Bouquet, Historiens de la France, t. X.p. 503). Deux églises sous le vocable de saint Denis y existaient déjà au temps de Louis le Gros.
S’appuyant sur des documents divers, M. L. Lazard prétend que « c’est au bon roi Dagobert, – création que ne lui ont attribuée ni la légende ni la chanson populaire qui lui ont cependant fait gloire de tant de choses, – qu’est due l’institution de la célèbre procession du chef de saint Denis ». Il serait assez malaisé de fournir les preuves de cette affirmation ; mais elle est présentée, sans l’ombre d’un doute, par le premier historiographe de Montmartre, le R. Père Léon. Son livre paru en 1661, chez Florentin Lambert, à Paris, la France convertie, octave de sermons en l’honneur de saint Denis, « avec un recueil des plus belles antiquitez de la Royale abbaye de Montmartre », est dédié à la reine Marie-Thérèse d’Autriche, colombe de la paix comme la nomme galamment l’ex-provincial des carmes réformés de la province de Touraine, devenu prédicateur de Leurs Majestés Royales.
L’introduction en soixante-dix pages, consacrée à l’histoire du martyre de saint Denis qui est, sans contestation possible, aux yeux du Père Léon, saint Denis l’Aréopagite, comprend également l’histoire du culte rendu au saint et des détails, qui tous ne sont pas intéressants, sur l’histoire de l’abbaye.
À la page 46 se trouve le passage auquel nous faisions allusion :
« Dagobert… obligea les Religieux de Saint-Denys d’aller-en procession de sept ans en sept ans et de porter le chef du glorieux martyr et de célébrer une messe solennelle en ce lieu de son martyre : ce qui se continue et ordinairement avec quelques miracles, ainsi que nous l’avons encore veu avec admiration la dernière fois que se fit cette belle procession en l’an MDCLVIII. »
Une procession rehaussée chaque fois d’un miracle ne pouvait manquer d’attirer un nombreux concours. Le Père Léon énumère les grands personnages qui se firent gloire d’y assister et notamment un nonce du pape.
« Il y a environ quarante ans qu’en cette qualité Monseigneur Bagni voulut assister à la procession du chef de saint Denys, qu’il accompagna à pié, depuis la ville de Saint-Denys jusqu’à Montmartre où il célébra la grand-messe pontificalement. »
On trouve dans les historiens de l’abbaye de Saint Denis des détails sur l’ordre et la marche de cette procession qui sont trop connus pour que nous ayons à les reproduire ici : on est peut-être moins bien informé sur la part que prenait à cette solennité le clergé de Montmartre : cette lacune est comblée par le petit manuscrit du XVIIe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale dans le fonds français, sous le numéro 19 248, et dont le titre est
« Directoire du clergé de Montmartre pour recevoir la procession du chef de saint Denis à Montmartre. »
L’auteur anonyme constate d’abord que la procession avait lieu jusqu’en 1639 aux environs de Pâques, et qu’en cette année elle fut transportée le jour de la Saint-Philippe et Saint-Jacques (1er mai).
Puis viennent les règles et prescriptions que doit suivre le clergé de Montmartre et la façon dont il doit accueillir les religieux et habitants de Saint-Denis.
Nous passons le texte du manuscrit.
La tradition, quant au lieu où fut enterré saint Denis, est incontestée. Pour ce qui est de la légende – plutôt amusante – qui fait porter à saint Denis sa propre tête en ses propres mains, peut-être convient-il d’en essayer l’explication. La statuaire moyenâgeuse plaçait entre les mains des saints un symbole qui caractérisait leur vie ; on plaçait dans celles des martyrs les instruments de leur supplice. Mais pour qu’il ne fût pas possible de confondre les décapités avec saint Paul armé du glaive symbolique de la parole, on mit leur tête entre leurs bras. Cette confusion évitée fit tomber dans une autre ; les âmes simples, inhabiles aux symboles, s’imaginèrent que ces martyrs avaient ainsi marché portant leur chef coupé dans leurs mains sanglantes. La légende populaire était dès lors créée.
Saint Denis a donné son nom à une ville, aujourd’hui chef-lieu d’arrondissement de la Seine. Il y fut enterré – dit la tradition – et cette église de l’antique abbaye où reposent les restes de nombreux rois de France demeure encore un but de pèlerinages en l’honneur de celui qui fut ou qu’on identifia avec l’Aréopagite.
Constatons, en terminant ce chapitre, que Montmartre fut un centre de foi dès l’invasion du christianisme dans les Gaules. Malgré son Sacré-Cœur, Montmartre aujourd’hui demeure un foyer, non plus chrétien, mais d’amusements, de débauches même, diront des critiques sévères et chagrins.
Ah ! monsieur saint Denis, grand saint Denis, qu’étiez-vous venu faire en cette galère ? Est-ce là votre œuvre, sont-ce là les fruits de votre évangélisation dans les Gaules ? Dans quelle terre avez-vous jeté la semence dont sortirent le Moulin-Rouge et les Quat’z Arts. Que n’êtes-vous resté, brave saint Denis, sur votre siège épiscopal d’Athènes qui vous assurait peut-être la vieillesse tranquille, la mort douce, c’est-à-dire la mort absolue, l’oubli !
Eh ! bien, non, monsieur saint Denis, vous avez bien fait. Il reste de vous une légende et c’est là peut-être la seule chose que les grands hommes de tous les temps auraient pu ambitionner. Amen.
Dès 628, Montmartre joue, dans les annales historiques de la France, un rôle important. Dagobert le déclare lieu d’asile, en mémoire de saint Denis. Plus tard, lors du siège de Paris (886) qui se défendit si vaillamment sous la conduite de son évêque Gozlin et de son gouverneur le comte Eudes, contre les trente mille Normands conduits par Godefried et Sigefried, Montmartre connut d’effroyables jours, précurseurs de ceux qui ensanglantèrent 1870, l’année terrible. Farouches, les guerriers normands, après avoir satisfait leurs instincts sauvages, accompli leur œuvre de dévastation, se rembarquaient, disparaissant. Ils saccagèrent ainsi Rouen, Pontoise, d’autres villes. La terreur était à son comble. Alors, raconte M. Amédée Burion (Bulletin du vieux Montmartre, fasc. 1), d’après le moine Abbon « portés sur les eaux de la Seine, ils (les Normands) arrivèrent droit du côté de l’abbaye du bienheureux Saint-Denis et établirent un camp retranché autour de l’église circulaire de Saint-Germain-des-Prés. Ils amenaient avec eux ou construisaient sur place d’énormes machines de guerre qui, s’abattant sur les remparts, vomissaient des flots de soldats ou lançaient des matières inflammables. Il fallait alors lutter corps à corps et broyer sous des blocs de rocher ces grappes de démons qui revenaient toujours à la charge et se faisaient un rempart de leurs compagnons tombés autour d’eux. » L’abbaye de Saint-Germain fut le témoin de luttes acharnées. Eudes, Gozlin et Ebble arrêtèrent du mieux qu’ils purent le flot montant des envahisseurs. Les malades et les blessés remplissaient Paris qui ne voulait pas se rendre. Époque terrible où du moins les assiégeants se battaient, ne réduisaient pas une ville, comme firent les Prussiens de 1870, par ce lâche moyen : la famine !
Ainsi que Grouchy à Waterloo, le duc Henriech, conseiller de Charles le Gros, ne put arriver au secours des Parisiens. Il venait de la Saxe ; il succomba en route. Gozlin et le duc d’Anjou moururent aussi. Alors, désespéré, le futur roi de France, Eudes (887-898) eut une idée héroïque. Confiant à Ebble, qui avait juré de mourir plutôt que de se rendre, le soin de veiller sur la capitale, il alla presser l’empereur de venir le secourir et de sauver Paris. En l’absence d’Eudes, et malgré des assauts chaque fois repoussés, tout alla pour le mieux. Hughes paraît enfin sur les hauteurs de Montmartre. À la tête de son armée, il brise les lignes des Normands et rentre dans Paris dont les portes lui ont été ouvertes par Ebble en poussant une vigoureuse sortie. Mais l’empereur tarde bien à venir. Sous le commandement des deux frères Thierry et d’Alderan, l’avant-garde de l’armée de secours, forte de six cents hommes, s’élance de Montmartre et triomphe des Normands qui comptent plus de trois mille morts. Les assiégés redoublent d’énergie, ils attendent l’empereur ils espèrent. Enfin sur la cime de Montmartre, c’est, un matin, le flamboiement des piques, des épées, des lances. Les Parisiens poussent des cris de joie. Voilà l’empereur ! Charles le Gros est là avec son armée composée de soldats de toutes nations. Déjà les Normands se préparent à regagner leurs barques, à fuir en toute hâte devant ce surcroît de forces qu’a dressées contre eux la venue de l’empereur… Il en fut autrement.
On sait par quelle paix honteuse se termina ce siège mémorable ; 700 écus d’or furent la rançon de ceux qui ne demandaient qu’à combattre et à vaincre. De plus, Charles le Gros livrait à la dévastation la vallée de la Seine jusqu’à Sens, accordant aux Normands un délai de quatre mois (on était alors en novembre) pour quitter le territoire parisien. L’empereur Charles le Gros – Bazaine ne fit pas autrement – a donc livré la France aux ennemis. La vengeance nationale l’atteignit bientôt : il fut déposé à la Diète de Tibur. On nomma Eudes duc de France en raison de sa conduite.
Montmartre a donc été, dans cette lutte, le pivot de la défense. C’est vers Montmartre qu’Eudes se dirige quand il va presser l’empereur de venir au secours des Parisiens ; c’est de Montmartre qu’il descend pour s’enfermer de nouveau dans Paris ; c’est de Montmartre que les 600 hommes composant l’avant-garde de l’armée de secours s’élancent sur Paris ; c’est enfin sur les hauteurs même de Montmartre qu’apparaît l’armée libératrice et que s’accuse la duplicité de Charles le Gros.
Mais, objectera-t-on, pourquoi les Normands ne s’étaient-ils pas emparés de Montmartre, étant donnée son excellente position stratégique ? La réponse est aisée. Bien que formidables, leurs forces ne pouvaient suffire à la réalisation d’un tel projet : les fortifications dont ils entouraient leurs camps en sont une preuve évidente ; de plus, pouvaient-ils s’écarter de leur flotte, l’âme, la raison même de leur force presque alors invincible ? N’étaient-ils pas, plutôt qu’une armée de terre, des navigateurs et des marins.
Si nous poursuivons nos recherches sur l’historique de Montmartre, nous voyons qu’en 977 dans sa guerre contre Lothaire, Othon II (955-983), fils d’Othon Ier, dit le Grand, empereur d’Allemagne, mort en 973, pénétra en France avec une armée de 60 000 hommes, saccageant tout sur son passage, incendiant le faubourg méridional et menaçant de brûler Paris. Il occupa Montmartre mais défendit que l’on détruisit les chapelles élevées en l’honneur des saints martyrs ; il se contenta d’accomplir une promesse qu’il avait faite à Hugues-Capet renfermé dans Paris « que l’alléluia qui serait dit pour remercier Dieu de ses victoires, serait chanté si haut et si fort qu’on n’en aurait jamais entendu de semblable. » C’est pourquoi, ayant réuni sur la butte un nombre considérable de clercs, il fit entonner l’Alléluia te Martyrum candidatus laudat exercitus par ce faisceau de voix stridentes à ce point que les habitants de Paris, surpris d’entendre ce chant solennel, se préparèrent à un siège aussi long que terrible. L’empereur allemand vint ensuite – accomplissant un vœu – frapper de sa lance à l’une des portes de la cité. Mais Hughes et Lothaire le contraignirent à battre en retraite.
La lutte qui, plus tard encore, aura pour foyer ce point stratégique si envié des assaillants – toutes les fois que les troupes ennemies ont investi la capitale, elles n’ont pas manqué de s’emparer de ses hauteurs – sera jusqu’en 1428 relativement assez calme. Notons pourtant les luttes des Armagnacs et des Bourguignons qui firent accorder à l’abbaye des lettres de sauvegarde royale par Charles VI en 1408. Mais vingt ans plus tard, lors du siège malheureux que Charles VII et Jeanne d’Arc viennent mettre devant Paris (septembre 1428) nous voyons son étoile glorieuse reparaître.
Au siècle suivant (8 mai 1590) Henri IV établit sur la Butte son quartier général ; il s’installe dans les appartements de l’abbesse du couvent et y mène joyeuse vie en compagnie des religieuses, si nous en croyons les chroniques du temps. Le saint aux Parisiens fut une décharge d’artillerie. Deux des pièces étaient placées sur la Butte-Montmartre. Et le siège en règle commença.
Un siècle encore après, le traité de Montmartre, relatif à l’annexion de la Lorraine à la France, devient un fait saillant du règne de Louis XIV.M. Mauzin nous donne à ce sujet des renseignements d’une grande valeur : « C’est par le traité de Montmartre, en date du 6 février 1662, que Charles IV, duc de Lorraine, fit le roi de France héritier de ses États, à condition que tous les princes de sa famille seraient déclarés princes du sang de France, et qu’on lui permettrait de lever un million sur l’État qu’il abandonnait. Le Parlement décida que ce traité n’aurait son effet que lorsqu’il aurait été signé par tous les intéressés : ce qui n’eut jamais lieu. – « Qui aurait dit à Charles IV, que le don qu’il faisait alors de la Lorraine sous des conditions illusoires, dit le président Hénault (Abrégé chronologique de l’histoire de France) se réaliserait sous Louis XV, qui en deviendrait un jour le souverain par le consentement de toute l’Europe. » – En effet, la Lorraine, au lieu d’être réunie à la France à la mort de Charles IV en 1675, ne le fut qu’en 1766 à la mort de Stanislas.
Si Montmartre a la bonne fortune d’être pour quelque chose dans l’annexion de la Lorraine à la France, à quelles circonstances, à quel hasard le doit-il ?
En consultant les mémoires des premières années du règne de Louis XIV, nous avons, dans le récit succinct qu’on va lire, exposé les principaux motifs qui provoquèrent la signature de ce traité.
Ambitions de ministres et vanités de princes, telles furent les seules causes du traité de Montmartre par lequel la Lorraine devait être réunie à la France.
À la mort de Mazarin, deux hommes, élevés à son école, prirent en main le pouvoir. C’étaient Colbert et Lyonne.
Ce dernier, jaloux de l’autorité et de l’influence que Colbert commençait à prendre sur le jeune roi, voulut, par un coup de maître, renverser son rival et s’assurer le crédit du monarque.
La réunion de la Lorraine à la France devint le but de ses efforts.
L’héritier du duché de Lorraine était le prince Charles, fils de François, frère du duc régnant Charles IV. Or, M. de Lyonne n’ignorait pas que Charles IV détestait autant son frère que son neveu. Il savait, en outre, que ce prince était conseillé ou plutôt gouverné par Henri II de Lorraine, duc de Guise, et par la sœur de celui-ci, Françoise-Renée de Lorraine, alors abbesse de Montmartre. Il connaissait surtout l’ambition des princes de la maison de Guise, leur espérance, tant de fois déçue, de se faire reconnaître, comme descendants de Charlemagne, princes de sang royal.
Sûr de l’appui de M. de Guise et de l’abbesse, son plan fut tracé et le mariage du prince Charles avec Mlle de Nemours, fille de Charles Amédée de Savoie, servit de base à ses desseins.
Cette union avait été projetée au printemps de 1661, sur les conseils de la reine-mère, Anne d’Autriche, et malgré la signature d’un contrat, on était arrivé aux premiers jours de l’année 1662 sans que Charles IV se fût décidé à donner un consentement formel à la célébration de cet hymen.
Louis XIV, instruit des projets de M. de Lyonne, écrivit au duc, envoya des courriers pour le sommer de prendre une décision au sujet du mariage de son neveu. Charles IV ; craignant d’irriter le roi et prévenu par le duc de Guise, vint à Paris.
Le duc de Lorraine à Paris, M. de Lyonne crut la partie gagnée.
Logé dans le palais des Guise, qui devint plus tard l’hôtel de Soubise, enivré des fêtes et des plaisirs que le prince lorrain lui offrait chaque jour, surveillé et conseillé d’un côté par M. de Lyonne, de l’autre par le duc de Guise et l’abbesse de Montmartre, Charles IV n’eut bientôt plus d’autre volonté, d’autre désir que se soumettre à leurs projets.
On lui persuada facilement que sa vie était menacée, que son neveu révolté contre lui, n’attendait qu’une occasion pour saisir la couronne et, que sa sûreté, aussi bien que le bonheur de son peuple, nécessitaient la protection du roi de France. Malgré les avis de quelques seigneurs dévoués à la maison de Lorraine, malgré les menaces de son frère, les supplications de son neveu. Charles IV n’écouta que M. de Lyonne.
Le 6 février 1662, au matin, Charles IV, accompagné du duc de Guise, se rendit secrètement à l’abbaye de Montmartre où, après avoir assisté à un office, il signa, en présence de l’abbesse, le traité qui donnait la Lorraine à la France.
L’article principal portait que le duc, n’ayant pas d’enfant légitime, déclarait le roi de France héritier des duchés de Lorrains et de Bar. En reconnaissance de cette donation, il était accordé aux princes de la maison de Lorraine le titre de princes de sang royal, titre qui leur donnait le droit de succession à la couronne de France, dans le cas où la branche des Bourbons viendrait à s’éteindre.
Comme garantie de ce traité, le duc de Lorraine s’engageait à remettre au roi la place de Marsal.
Un article spécial donnait à Charles IV la faculté de disposer d’une rente de 100 000 écus en faveur d’une personne qu’on ne voulait pas nommer. C’était le comte de Vaudemont, fils naturel du duc et Mme de Cantecroix.
Enfin, une somme de 1 000 000 de francs à percevoir sur les biens de Lorraine était assurée à Charles IV.
Le duc de Guise courut porter la nouvelle au roi qui était en partie galante, à la foire Saint-Germain. En voyant au bas du traité la signature du duc de Lorraine, Louis XIV ne put contenir sa joie et s’écria : Il n’y a rien dans la foire qui vaille les deux bijoux que je viens de gagner.
Toute l’habileté que déploya M. de Lyonne dans cette affaire devint inutile, car le traité ne fut jamais enregistré par le Parlement ; et, certes, après tant d’efforts et de luttes politiques, après avoir été presque sûr du résultat de l’entreprise, cet homme d’État ne pouvait prévoir qu’un jour le duc Charles répondrait au prince de Condé qui lui demandait ce qui avait pu le pousser à signer le traité de Montmartre : – À paraître plus habile homme que vous, Monsieur le Prince : en toute votre vie, vous n’avez fait qu’un prince du sang ; moi, d’un trait de plume, j’en ai fait plus de vingt.
Dans l’article fort bien rédigé, quoique peut-être un peu trop général, que M. Alexis Martin consacre au vieux Montmartre (Bulletin de la Soc. d’hist. et d’arch. du XVIIIe arrondissement), nous chercherions vainement des détails historiques sur la Butte pendant la Révolution. Les seuls faits intéressants à noter sur cette mémorable époque sont l’expulsion des Bénédictins, la démolition de tous les bâtiments existant alors, à l’exception de l’église Saint-Pierre, qui eut à subir, jusqu’en 1802, des destructions partielles diverses et les canons portés à Montmartre le 25 juillet 1789.
En tant que commune, Montmartre porta quelques mois, durant la Révolution, le nom de Montmarat.
Les cahiers présentés aux États généraux de 1789 par les paroisses de Montmartre et de la Chapelle sont excessivement intéressants ; malheureusement, la place nous manque pour les reproduire ici. On les trouvera dans les Archives parlementaires de 1789, Paris hors les murs, pages 631 et 733, chapitres intitulés : – « Montmartre, Cahiers des plaintes, doléances et remontrances, rédigés en l’assemblée du Tiers État de la paroisse de Montmartre qu’elle charge ses huit députés de présenter à l’assemblée qui doit se tenir au Châtelet de Paris. » – « La Chapelle-Saint-Denis, Des vœux, doléances et remontrances de la paroisse de la Chapelle-Saint-Denis. »
En 1814, le 29 mars, la Butte fut bravement défendue par une poignée de soldats que secondaient des élèves de l’École polytechnique.
Pendant les deux années suivantes – désastreuses s’il en fut – Montmartre devint le théâtre d’exploits remarquables qui, pour n’avoir pas été couronnés de succès, ne méritent pas moins d’être signalés à l’estimé publique. En 1814 les désastres éprouvés par Napoléon engagèrent les habitants de Paris à élever des fortifications contre les armées ennemies. On y travaillait avec beaucoup de zèle quand on vit nos soldats se replier sur les hauteurs qui entourent la capitale. Joseph Buonaparte occupait Montmartre avec son corps d’armée. Assailli par les bombes et les boulets des troupes coalisées, il se vit contraint de battre en retraite et confia à quatre cents dragons la défense du poste qu’il abandonnait. « Vingt mille hommes de l’armée de Silésie, rapporte le Dictionnaire topographique militaire





























