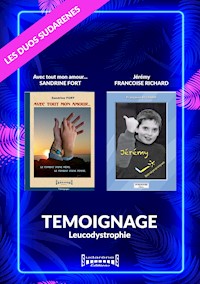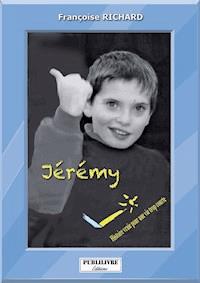Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Plusieurs générations de « voyageurs forains » se dévoilent dans cet ouvrage qui s’immerge au cœur de leurs vies. Fidèlement ressuscités, les souvenirs d’une enfance bercée par un quotidien bohème révèlent des codes, des traditions et des coutumes uniques. Chaque semaine, la famille se déplaçait de ville en ville pour exercer la profession de commerçants forains, incarnant un mode de vie singulier et pourtant d’une richesse précieuse et fascinante. Une existence atypique, où chaque étape devient une ode à la richesse des liens et au charme intemporel d’une vie hors des sentiers battus.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Françoise Richard, animée par des valeurs profondes de respect, de partage et d’écoute, s’implique avec dévouement dans le milieu associatif. En 2017, elle fait ses premiers pas en littérature avec "Jérémy", publié chez Sudarenes Éditions. Elle revient avec un témoignage empreint de délicatesse et d’émotion, une œuvre qui se veut à la fois un héritage pour ses proches et un voyage initiatique que la plupart des sédentaires ont envie de découvrir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Françoise Richard
Naître au sein d’une famille
de voyageurs
Foraine et fière de l’être !
© Lys Bleu Éditions – Françoise Richard
ISBN : 979-10-422-5431-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Je suis née le 1er décembre 1964 à Châteaubriant en Loire-Atlantique, j’ai donc 57 ans au moment où je tape ces premières lignes. Je suis née au sein d’une famille de voyageurs et fière de l’être, avec toutes ses valeurs, ses richesses, ses traditions, ses règles, ses us et coutumes.
La fratrie est composée de trois frères et une sœur : Maurice, né le 26 mai 1961 à Chaudron en Mauge (49), Armand, né le 7 décembre 1963, Yves, né le 31 mai 1974, et Yvonne, née le 28 novembre 1965 à la maternité de Châteaubriant.
Une histoire familiale originale !
Association de deux modes de vie complètement différents et partiellement opposés : itinérants et sédentaires.
Mon mari et moi avons eu deux enfants, Jessica et Jérémy qui font notre fierté ! Notre fille Jessica et son mari Maxime nous apportent le plus grand bonheur sur cette terre avec la naissance de leurs enfants : Thomas, âgé de 6 ans, et Camille de 3 ans, deux magnifiques petits-enfants. Mon mari Thierry et moi portons le titre de « grands-parents », papi, mamie, mémé, pépé, peu importe le choix du nom que nous utilisons. Devenir grand-père et grand-mère, c’est être un lien de filiation. Nos petits-enfants sont notre prolongement. Nous devenons, l’un et l’autre, les ancêtres avec un passé respectif, ceux qui racontent les événements d’un autre temps et qui révèlent l’histoire de la famille.
De mon point de vue, il me semble important de savoir d’où l’on vient afin que l’humain puisse se construire, comme l’exprime Otto von Bismarck au 19e siècle dans sa citation : « Si je ne sais pas d’où je viens, je ne sais pas où je vais, car je ne sais pas où je suis. »
Connaître le passé permet aux petits-enfants d’intégrer qu’ils viennent au monde avec une histoire qui remonte à loin dans le temps, qu’avant d’être membre d’une nation, ils font partie d’une famille. Nos petits-enfants sont surpris d’entendre grand-mère Françoise parler à papi Thierry dans une langue qu’ils ne comprennent pas encore. Ils posent des questions, curieux tout naturellement comme tous les enfants.
Mon rôle de grand-mère est de transmettre à notre descendance l’histoire de la famille, ses expériences, ses témoignages provenant également de nos anciens, dévoiler à cette génération le passé qui s’inscrira dans leur futur. Nos petits-enfants vont s’enrichir de cette transmission, la découvrir petit à petit et ainsi mieux se connaître, apprendre la façon dont nous avons été élevés mes frères, ma sœur et moi-même, au sein d’une famille unie et aimante, vivant toujours en famille élargie : grands-parents, père, mère, enfant, oncle, tante, cousin, tout un clan, se déplaçant de ville en ville chaque semaine, comprendre que par nos différences, nous possédons une richesse culturelle, des valeurs transmises par nos aînés et une richesse de cœur, que nous avons su nous adapter au monde qui nous entoure.
Nous avons également tissé des liens avec les « gadjés » (sédentaires) et de ce fait, nous avons été acceptés. Nous sommes citoyens français, comme nous l’avons toujours été depuis 1798, les actes de nos aïeux en témoignent. Notre lignée se modifie avec notre génération, nous avons toutes et tous fait des choix de vie qui ont transformé peu à peu notre manière d’être et de faire partie des gens du voyage.
Laisser une trace de notre histoire familiale et répondre aux nombreuses questions de mes neveux et petits cousins qui n’ont pas connu ce mode de vie : après ma génération, plus personne ne sera capable de transmettre ces informations avec autant de précision.
Je vais mener l’enquête, rechercher nos origines, remonter le temps… Faire renaître les souvenirs d’un mode de vie qui s’est transformé et adapté aux modalités et réglementations diverses, inscrites tout au long des générations passées. Je me lance dans une recherche généalogique afin de retrouver nos ancêtres pour « faire connaissance » avec ceux qui nous ont précédés. Je demande de l’aide à un ami, Gilles, qui apprécie ce genre de recherches. Je lui transmets les documents en ma possession et ceux que j’ai récupérés aux archives départementales. Il remonte jusqu’en 1798, période suffisante pour notre histoire. Au travers des différents actes de naissance, mariage, décès, je découvre la manière dont nos ancêtres ont vécu.
Je trouve aussi des indices et de vieux documents cachés dans une boîte à chaussures, jaunie par le temps, que nos grands-parents avaient précieusement protégée. Ces documents attestent de leur mode de vie, de leur fonctionnement et de leur place dans la société.
Partant à la rencontre des membres de ma famille, je téléphone, j’écoute, je prends des notes, je découvre et prends contact avec des sédentaires qui ont connu nos grands-parents. Je puise dans leur mémoire et leurs souvenirs pour faire remonter le passé. Grâce aux différentes rencontres et récits de ces personnes, je récolte des informations importantes. Certains m’accordent leur confiance et me fournissent de précieux documents en leur possession afin d’affiner mes recherches.
Pour trouver des informations concernant les grands-parents, je me rends chez ma marraine, la sœur de ma mère : madame Laclais Lucienne, dite « Lulu », née en 1945. Une brune aux cheveux mi-longs attachés par une barrette, avec des yeux vifs et pétillants, pas très grande, mais bien proportionnée. Cette femme courageuse, au caractère bien trempé, très dynamique, possède une joie de vivre communicative et un sourire permanent. D’une générosité incroyable, elle veille constamment sur les siens. Cette dernière vit à l’ancienne avec les codes des voyageurs. Que de bons souvenirs auprès d’elle, durant notre enfance et même encore aujourd’hui. Lulu me donne des documents ayant appartenu à ses parents ainsi que des informations sur son mode de vie après-guerre. Durant de longues années, elle vivra en maison avec son mari qui, lui, est sédentaire. Cette maison frappée d’alignement sera détruite par la municipalité afin d’en faire un espace vert. Lulu décide de repartir vivre en caravane et retrouve la famille élargie.
Pour en apprendre plus, ma cousine Sylvia et moi convenons d’un rendez-vous afin de remonter le passé, auprès de monsieur Maheux Gilbert, né en 1931, âgé de 93 ans, vivant au lieu-dit « Grand Rigné » près de Rougé. Ce dernier a vécu à proximité de nos grands-parents maternels et a fréquenté l’école avec certains de leurs enfants. Nous sommes surprises et ravies de la qualité de notre échange. Tout est frais et bien calé dans sa mémoire. Gilbert parle de nos grands-parents et de leurs enfants avec une facilité extraordinaire, comme si cette période datait seulement de la veille.
Le statut administratif des gens du voyage
Nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et trisaïeuls sont des commerçants forains ambulants dénommés « industriels forains ou fêtiers ». Ils sont classés dans la catégorie des « gens du voyage ». Le terme de voyageur ou voyageuse désigne le fait de ne pas appartenir au monde des sédentaires. Le voyageur est une personne comme une autre, sauf qu’il vit d’une manière qui lui est propre : il circule pour son métier en mode nomade, mais peut également choisir d’être semi-sédentaire (forain), voire devenir sédentaire. Toutefois, tous les forains ne sont pas issus de familles de gitans ou de « vrais » voyageurs. Parmi eux, il y a des « gadjés » qui ont choisi un métier ambulant. Ces derniers côtoient les voyageurs et s’imprègnent peu à peu des manières d’être des uns et des autres, en adoptant leurs comportements, gestuelle et langage. Ils copient les expressions, l’intonation, la prononciation ainsi que le débit de parole. Cependant, malgré tous leurs efforts, un petit quelque chose fait toute la différence : ils ont les paroles, mais sans la musique !
Nous savons nous reconnaître, sans même nous parler, juste au regard ou à la manière de nous mouvoir ou de nous poser.
L’expression « gens du voyage » désigne le statut administratif des Français ou des étrangers sans domicile fixe ou sans résidence fixe, circulant en France ou exerçant des activités ambulantes.
Loi No 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Cette dernière impose aux gens du voyage d’être en possession d’un titre de circulation et d’être rattachés à une commune. Une différence administrative importante existe entre les voyageurs concernant ces titres de circulation.
Livrets de circulation « A » « B »
Il est plus allégé que le carnet anthropométrique de 1912 de nos grands-parents (taille, cheveux, yeux, teint, corpulence, signes particuliers, empreintes) et il disparaîtra peu à peu du paysage.
Pour obtenir ce dernier, le forain doit prouver qu’il exerce pour son propre compte une activité professionnelle dans des conditions entraînant l’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Il doit être de nationalité française. Celui-ci est inscrit au registre des commerces, s’acquitte de l’URSSAF et paie des impôts. Il se voit délivrer un livret spécial de circulation « A », délivré par les autorités administratives, validité à proroger tous les deux ans par la préfecture. L’obtention de ce dernier nécessitera pour les gens du voyage de rejoindre une commune de rattachement. Dès l’âge de seize ans, le jeune forain doit obligatoirement être en possession de ce livret.
Pour les voyageurs exerçant une activité salariée, un autre modèle de livret de circulation « B » sera délivré. Ce dernier devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois.
Celui qui n’exerce aucune profession possède un carnet qui sera visé tous les mois.
Tous ces livrets doivent être validés, tamponnés et présentés à chaque demande des autorités, sous peine de prison allant de trois mois à un an, et même d’une amende.
Depuis 1968, les communes de plus de 5000 habitants ont le devoir d’assurer le stationnement des « campings » (caravanes) pour une durée de 48 heures minimum à 15 jours maximum sur des terrains officiellement désignés.
Nos trisaïeuls
À partir de 1836
Côté paternel : Famille Richard/Dufresne
Richard Auguste, né le 30 octobre 1843 à Villiers-Charlemagne (53). Marchand forain et tondeur de chevaux.
Son épouse Dufresne Virginie, née le 5 octobre 1836 à Laval (53). Marchande foraine de macarons et faïencière.
Côté maternel : Famille Lanouyé/Manceau
Lanouyé Victor, né en 1855, marchand forain.
Son épouse Manceau Léonie, née en 1855, marchande foraine.
Ces deux familles de voyageurs vivent en roulottes fabriquées en bois et bâche, avec les roues à rais en bois cerclées de métal. Elles sont tractées par des chevaux, des ânes ou des mulets selon les moyens de chacun.
La porte se trouve sur le côté ou à l’arrière et à l’avant, une ouverture assez large en guise de fenêtre permet, à l’aide de longues rênes, d’influer sur la direction et la vitesse du cheval. Une ouverture perce le toit en bois, de forme arrondie pour le passage du tuyau de poêle. Les autres roulottes, recouvertes d’une bâche épaisse, transportent le matériel.
Les voyageurs se posent au gré de leur envie, à proximité d’un point d’eau, dans un pré ou un endroit proche d’une bourgade, mais sans se fondre totalement dans la population environnante. Il faut déjà être en possession d’un formulaire papier afin de pouvoir se déplacer. Ils doivent le présenter lors d’un contrôle des représentants de l’ordre « la maréchaussée ».
Lors des transferts, ils emmènent avec eux : cheval, âne, chiens, furets, poules qui suivent le mouvement. Ils vivent en harmonie avec la nature et toujours en famille élargie, soit quatre roulottes minimum. Les hommes posent des collets, vont à la chasse et à la pêche, ce qui permet de nourrir la famille.
Ils gèrent au quotidien leurs besoins, les femmes connaissent les plantes et concoctent des remèdes ou onguents dans le but de soulager les maux et blessures de leurs proches. Ce savoir sera transmis au fil des générations.
Comme la roulotte sert essentiellement de chambre, la vie se passe en plein air. L’installation d’une bâche maintenue par des piquets et fixée à la roulotte permet de se protéger du soleil, du vent, de la pluie ou du froid. Le feu de bois est allumé en permanence, il est vital. Il permet de se réchauffer, mais surtout de cuisiner dans une marmite en fonte suspendue à un trépied ou posée à même le feu. Lorsque vient la nuit, le feu devient le lieu de ralliement où l’on se raconte les histoires du jour ou passées, où l’on évoque des légendes, mais aussi la mémoire des anciens, le moment où la musique, le chant et la danse se font entendre, où l’on transmet son savoir au plus jeune.
Ils choisissent un lieu offrant un point d’eau, une fontaine, une rivière ou un étang, ce qui permet de régler la question de l’hygiène. La lessive se fait à même la rivière la plus proche du stationnement et le linge est mis à sécher sur les haies ou sur un fil suspendu entre deux arbres.
Chaque jour, les voyageurs vont « chiner », c’est-à-dire faire du commerce avec les habitants, souvent dans les fermes où ils peuvent aussi faire du troc, voire se louer pour être journalier durant quelques jours ou semaines. Cela leur permet de se poser un peu plus longtemps si l’endroit leur convient. Les hommes sont rémouleurs, ramoneurs, vanniers et confectionnent des paniers qu’ils vendent en faisant du porte-à-porte ou sur les marchés. Ils s’improvisent saltimbanques, chanteurs, jongleurs, montreurs d’animaux, proposent des spectacles. Les femmes, quant à elles, munies d’un baluchon, vendent dentelles, napperons, porte-bonheur ou encore onguents dont elles ont le secret. Elles lisent les lignes de la main « Dorkave » et prédisent le futur à qui veut l’entendre. Une multitude de métiers pour gagner leur vie !
Ils sont catholiques et baptisés quelques jours après la naissance. Appréciés du « grand monde », ils peuvent être appelés à l’occasion d’une fête pour un spectacle ou faire découvrir la ménagerie aux enfants de la bourgeoisie.
Pourtant, ils sont très souvent montrés du doigt et calomniés en raison de leur mode de vie, on les nomme « romanichel, bohémien, jeteur de sort ». Certains sédentaires prétendent qu’ils sont « des voleurs de poules et d’enfants », ce qui ne manque pas d’effrayer la population.
Nos arrière-grands-parents
À partir de 1873
Côté paternel :
Famille Richard/Lanouyé
Richard Auguste, né le 20 novembre 1873 à Laval (53), marchand forain.
Son épouse Lanouyé Marie, née le 22 janvier 1883 à Coex (85), marchande foraine. Ils ont trois enfants : Joseph né le 4 novembre 1909, Renée et Marcelle.
Famille Peltier/Lanouyé
Peltier Victor, Jean Achille, né en 1880, marchand forain, au caractère bien trempé, autoritaire. Il possède un manège de chevaux de bois.
Son épouse, Lanouyé Rose Marie, née en 1885, marchande foraine. Elle vend des macarons. Ils ont trois enfants :
Louis, surnommé Rougeot à cause de ses cheveux roux.
Anna, née le 29 juin 1905, dite Nana.
Yvonne, née le 27 avril 1907, dite Boula.
Côté maternel :
Famille Menut/Landais
Menut Jean Narcisse, né le 26 novembre 1865 à Saint-Eloi (86), marchand forain et tailleur de pierre. Son épouse Landais Victorine, Aimée, née le 22 février 1869 à Gorron (53), marchande ambulante et journalière.
Famille Duchêne/Trémulot
Duchêne Frédéric Henri, né le 15 janvier 1885 à Champagne-Mouton (16), marchand forain.
Son épouse Trémulot Sidonie, née le 3 avril 1883 à Château-Gontier (53), marchande foraine et vannière.
Avec le temps, les roulottes, toutes bicolores, sont construites en dur, généralement bois et tôle, incluant parfois une armoire et un placard.
Les forains se déplacent toujours en famille élargie et se posent dans un bourg, très souvent pour une période de huit jours. Les gens disent d’eux : « C’est le village en bois qui arrive ! ». En effet, quand ils sont installés et que les baraques sont montées pour la foire, cela donne cette impression : un village à l’intérieur d’une ville, où la population circule juste le temps de la fête.
Dès leur arrivée, les forains, systématiquement contrôlés par les représentants de l’ordre, doivent présenter le « document-récépissé », qui révèle leur identité.