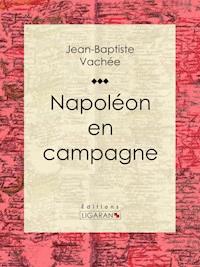
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"""Napoléon en campagne"" est un ouvrage captivant qui nous plonge au cœur des batailles et des stratégies militaires de l'empereur Napoléon Bonaparte. Écrit par Jean-Baptiste Vachée, historien renommé et spécialiste de cette période charnière de l'histoire, ce livre nous offre une vision détaillée et passionnante des campagnes militaires menées par Napoléon.
À travers une plume fluide et documentée, Vachée nous transporte dans l'univers complexe et fascinant de Napoléon. De la campagne d'Italie à celle d'Égypte, en passant par les célèbres batailles d'Austerlitz et de Waterloo, l'auteur décortique les stratégies militaires mises en place par l'empereur et analyse les enjeux politiques et géopolitiques de l'époque.
Mais ""Napoléon en campagne"" ne se limite pas à une simple description des batailles. Vachée nous offre également un portrait nuancé de Napoléon, mettant en lumière ses qualités de chef de guerre, mais aussi ses faiblesses et ses erreurs. Loin de l'image romantique et héroïque souvent associée à l'empereur, l'auteur nous invite à une réflexion plus profonde sur la personnalité complexe de Napoléon et sur les conséquences de ses actions.
En s'appuyant sur une solide recherche historique, Jean-Baptiste Vachée nous offre un ouvrage complet et accessible à tous, permettant de mieux comprendre les enjeux et les conséquences des campagnes militaires de Napoléon. Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement curieux de découvrir l'homme derrière le mythe, ""Napoléon en campagne"" saura vous captiver et vous éclairer sur cette période cruciale de notre histoire.
Extrait : ""Avoir toujours présente à l'esprit la situation matérielle et morale de son armée, démêler sur des renseignements souvent vagues et contradictoires la situation et les projets de l'ennemi, prendre un parti sur ces données incertaines, le poursuivre sans perte de temps, parer à l'imprévu, ménager et accumuler ses forces pour les dépenser sans compter à l'heure décisive : tel est, dans ses grandes lignes, le rôle du chef d'armée."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016673
©Ligaran 2015
Pendant l’été de 1807, le général Kosciuszko, le héros de l’indépendance de la Pologne, alors exilé à Fontainebleau, recevait la visite d’un de ses jeunes compatriotes, Chlapowski, qui était officier d’ordonnance de l’empereur Napoléon. Songeant à l’avenir de la Pologne, Kosciuszko parlait en ces termes au jeune officier :
« Tu fais bien de servir et d’étudier. Travaille bien et quand la guerre arrivera, fais attention à tout. Placé près de l’Empereur, tu peux acquérir beaucoup de connaissances et d’expérience. Augmente ton savoir le plus possible pour être utile plus tard à notre malheureux pays. Tu es à bonne école. Mais ne crois pas qu’il (l’Empereur) va reconstituer la Pologne ! Il ne pense qu’à lui-même… C’est un despote, son seul but, c’est sa satisfaction, son ambition personnelle. Il ne créera jamais rien de durable, j’en suis sûr. Mais que tout cela ne te décourage pas ! Tu peux apprendre beaucoup près de lui, l’expérience, la stratégie surtout. C’est un chef excellent. Mais, quoiqu’il ne veuille pas reconstituer notre patrie, il peut nous préparer beaucoup de bons officiers, sans lesquels nous ne pourrons rien faire de bon, si Dieu nous permet de nous trouver dans de meilleures circonstances. Je te répète encore une fois : Étudie, travaille, mais lui ne fera rien pour nous ! »
Prenons à notre compte les conseils de Kosciuszko. Pour nous instruire dans l’art de la guerre, allons – par la pensée – au quartier général de Napoléon.
Quel précieux enseignement pour un officier que de vivre dans l’entourage immédiat de Napoléon pendant ses campagnes, que de le voir travailler, faire ses plans, donner ses ordres, veiller à leur exécution, enflammer pour l’action généraux et soldats !
Les campagnes de Napoléon ont donné lieu à bien des études didactiques, ses plans de campagnes et de batailles ont été l’objet d’analyses savantes qui forment la base du haut enseignement militaire de toutes les armées. Il semble qu’il y ait bien peu à ajouter aux nombreux travaux de cet ordre. En tout cas, ce n’est pas de ce côté que se tourne notre ambition. C’est l’homme lui-même dans sa pensée et dans son action que nous voudrions saisir sur le vif, nous voudrions faire revivre en nous les impressions qu’aurait pu éprouver l’observateur attentif et avisé que Kosciuszko, dans l’intérêt de sa patrie, désirait voir près de l’Empereur.
Sans doute, ce qui aurait frappé, avant tout, ce témoin de la vie de Napoléon en campagne, aurait été la puissance de sa personnalité ; c’est un géant qui domine de cent coudées tout son entourage ; autour de lui, point de collaborateurs ; il n’y a que des agents d’exécution ; c’est Napoléon qui centralise tout, centralisation d’ailleurs absolument excessive, nullement à imiter, car c’est elle qui, éteignant tout esprit d’initiative, a contribué à provoquer la ruine du système. Mais, en dehors de ce pouvoir d’absorption exagéré, que de leçons à prendre dans le mode d’action et de commandement du maître de la guerre ! Ce mode d’action est caractérisé par un travail passionné, et par la volonté indomptable d’atteindre le but poursuivi. C’est la course à la solution simple, inattendue, décisive, par la voie la plus courte. Méditation incessante jusqu’à l’éclosion dans le cerveau de l’idée lumineuse, décision nette et rapide, exécution immédiate, sans aucune perte de temps : telles nous semblent être les sources du génie de Napoléon.
À côté de la partie psychologique du commandement il y a la partie métier. « Le cabinet de Napoléon était un laboratoire qui avait une partie toute mécanique. » « La vie de l’Empereur, ajoute Fain, se passait dans son cabinet… on pourrait dire que toutes les autres circonstances de sa vie n’étaient que des digressions. » Cela était vrai aussi bien en campagne qu’aux Tuileries, que ce cabinet fût installé dans les palais des rois, ou dans la plus misérable chaumière de Pologne. Quel intérêt pour un soldat de voir s’ouvrir devant soi la porte de ce sanctuaire ! Nous sommes au milieu de la nuit et voici que l’Empereur nous apparaît couché sur ses cartes éclairées par vingt bougies ; pendant que l’ennemi dort ou réunit des conseils, lui, solitaire, médite, décide, dicte ses ordres, utilise le temps à son maximum.
Nous le verrons ensuite poursuivre à l’extérieur l’œuvre éclose dans le silence du cabinet, surveiller l’exécution, animer son armée du souffle de sa foi et de son génie.
Notre but sera atteint – bien au-delà de notre espoir – si, à la fin de cette étude, nous commençons à voir, ainsi que Taine le demande à l’historien, Napoléon vivant, pensant et agissant dans son quartier impérial, avec ses passions et ses habitudes, sa voix et sa physionomie, ses gestes et ses habits, distinct et complet, un peu comme si, officier de son état-major, nous venions de faire une campagne sous ses ordres.
Du rôle du général en chef. – Puissance de l’individualité de Napoléon. – Conceptions essentiellement personnelles. – Méditation incessante. – Puissance de travail de Napoléon. – Travail de nuit. – Qualité du travail de Napoléon. – Force et constance de son attention. – Audace dans la décision. – Courage moral. – Quatre principes de guerre.
Avoir toujours présente à l’esprit la situation matérielle et morale de son armée, démêler sur des renseignements souvent vagues et contradictoires la situation et les projets de l’ennemi, prendre un parti sur ces données incertaines, le poursuivre sans perte de temps, parer à l’imprévu, ménager et accumuler ses forces pour les dépenser sans compter à l’heure décisive : tel est, dans ses grandes lignes, le rôle du chef d’armée. Personne dans l’histoire ne sut tenir ce rôle avec plus de maîtrise que celui qui fut successivement le général Bonaparte et l’empereur Napoléon Ier.
Il y eut sans doute dans la prodigieuse carrière de cet homme une part de bonheur, mais on ne saurait attribuer au seul bonheur la continuité et la grandeur de ses victoires, qui ne peuvent s’expliquer que par une étroite adaptation de ses facultés à l’art de la guerre. Quelles furent les facultés naturelles ou acquises qui du petit cadet corse firent un César triomphant en quatre-vingts batailles rangées, quelles furent ses méthodes de travail et de commandement ? Autant de questions que nous voudrions parvenir à élucider – plus ou moins complètement – en étudiant l’existence de Napoléon pendant ses campagnes et le milieu dans lequel il vécut.
Tout d’abord le haut commandement comporte de la part du chef qui l’exerce un travail de pensée, préliminaire à toute décision ; l’idée prend naissance, évolue, se précise et par un acte de la volonté se transforme en décision. Mais le rôle du chef ne se borne pas à prendre une décision ; il lui appartient aussi de participer à l’exécution de la décision, en surveillant, en dirigeant et contrôlant les agents d’exécution. Cette participation est indispensable à la liaison et à la convergence des efforts, au redressement des erreurs, à la vigueur de l’exécution. Enfin le devoir du chef est aussi de distribuer aux exécutants les sanctions qui correspondent à leur mérite ou à leur insuffisance.
Tout commandement, pour être exercé complètement, doit pourvoir à ces diverses obligations : travail de pensée, prise de décision, surveillance de l’exécution, distribution des sanctions ; la manière dont il y pourvoit lui donne sa physionomie caractéristique. Aucune de ces obligations ne peut être éludée sans qu’il en résulte un affaiblissement de l’action et de l’autorité du commandement.
Nous allons examiner successivement, sous ces différentes faces, en nous transportant dans son quartier général, la méthode de commandement de Napoléon, mais avant d’entrer dans cette analyse, un coup d’œil d’ensemble jeté sur ses campagnes et sur sa vie nous fait apercevoir de suite le caractère dominant de son action. Ce qui caractérise par-dessus tout Napoléon c’est la puissance de son individualité. Cette individualité animée par une âme ardente, passionnée, impatiente de mouvement, avide de succès, déborde sur tout son entourage, envahit toutes les fonctions. Son ambition égoïste l’incita à tout diriger pour tout régler à son profit. On a raconté que, lorsqu’il partit pour la première campagne d’Italie, il dit à un journaliste de ses amis : « Songez dans les récits de nos victoires à ne parler que de moi, toujours de moi, entendez-vous ? » Ce moi fut l’éternel cri de sa toute personnelle ambition. « Ne citez que moi, ne chantez, ne louez, ne peignez que moi, disait-il aux orateurs, aux musiciens, aux poètes, aux peintres. Je vous achèterai ce que vous voudrez, mais il faut que vous soyez tous vendus. »
Au service de ce formidable égoïsme, dont il faut exclure cependant toute idée mesquine, mettez l’esprit le plus puissant et le plus étendu, la volonté la plus forte et la plus tenace, une âme audacieuse, et vous comprendrez que, dans son commandement, Napoléon ait réduit au rôle d’aveugles instruments d’exécution tous les hommes qui, par la nature de leurs fonctions, auraient dû être les collaborateurs conscients de son œuvre.
Nous verrons plus loin comment il s’y prit pour animer l’exécution, pour donner à ses généraux et à ses troupes le principe de vie, ce qu’il appelle « le feu sacré » ; mais arrêtons-nous d’abord à l’éclosion de l’idée directrice qui est comme le fil conducteur d’une campagne ou d’une manœuvre. Cette idée est absolument sienne, elle lui appartient sans partage. Son opinion est sa seule règle et, comme il le dit lui-même, le bon instrument qu’était sa tête lui était plus utile que les conseils des hommes qui passaient pour avoir de l’instruction et de l’expérience. « À la guerre, écrit-il (30 août 1808), les hommes ne sont rien, c’est un homme qui est tout. » « Moi, au milieu de la nuit, quand une bonne idée me passe par la tête, dans un quart d’heure l’ordre est donné, dans une demi-heure il est mis à exécution par les avant-postes. » Ce n’est pas là un mot sans portée, les actes sont conformes aux paroles, nous avons sur ce point le témoignage d’un homme qui, de 1802 à 1813, a suivi l’Empereur dans toutes ses campagnes, vivant et dormant sous son toit. Malgré son habituelle admiration pour son maître, le secrétaire intime Meneval se permet à cet endroit une critique discrète, il nous dit que l’infatigable activité de corps et d’esprit de Napoléon le portait à pratiquer d’une manière trop absolue ce principe « qu’il ne faut pas laisser faire à d’autres ce que l’on peut faire soi-même » ; après avoir signalé une première fois cette tendance, Meneval y revient encore et s’exprime en ces termes significatifs et péremptoires :
« Berthier, Talleyrand et tant d’autres n’ont pas donné un ordre, n’ont pas écrit une dépêche qui n’aient été dictés par Napoléon. Celui-ci avait non seulement l’initiative des conceptions, mais encore se réservait le détail de toutes les affaires. Je ne prétends pas qu’il eût entièrement raison en voulant ainsi tout faire par lui-même, mais son génie d’une activité surhumaine l’emportait ; il se sentait les moyens et le temps de suffire à tout… en réalité c’était lui qui faisait tout. »
Au reste l’œuvre de Napoléon, par son originalité, exclut toute trace de collaboration. Ses ordres et ses instructions portent la griffe du maître. Des manœuvres comme celles d’Ulm, d’Austerlitz, d’Iéna, d’Eckmühl, pour ne citer que celles-là, chefs-d’œuvre d’une si grande et particulière allure, n’ont pu éclore que sous le souffle d’une inspiration unique, celle de l’Empereur. Par contraste, au même moment, chez ses adversaires, la controverse des conseils tuait l’originalité de la pensée, retardait la décision, conduisait aux solutions bâtardes et lentes qui laissent échapper l’occasion du succès.
Un exemple nous fera sentir plus vivement la manière de Napoléon dans l’élaboration et l’éclosion de l’idée. Nous l’empruntons à Ségur qui fut à la fois son historien et son aide de camp.
La scène se passe au quartier impérial de Pont-de-Brique, au mois de septembre 1805. L’Empereur vient d’apprendre qu’après le combat du cap Finistère, l’amiral Villeneuve, au lieu de suivre la flotte anglaise, est entré au Ferrol ; plus d’espoir de surprendre le passage de la Manche. Il mande Daru, intendant général de l’armée. Celui-ci se présente à 4 heures du matin, il trouve l’Empereur dans sa chambre, l’air farouche, son chapeau enfoncé sur les yeux, le regard foudroyant, éclatant en invectives et en reproches amers contre Villeneuve. Puis, brusquement, changeant de ton, Napoléon dit à Daru, en lui montrant un bureau chargé de papiers : « Mettez-vous là et écrivez ! » Aussitôt sans transition, sans méditation apparente, de son accent serré, bref, impérieux, il dicte sans hésiter le plan de la campagne de 1805, jusqu’à Vienne. Il dicte ainsi pendant quatre ou cinq heures. S’étant assuré que ses instructions étaient bien comprises, il congédie Daru : « Partez sur-le-champ pour Paris, en feignant de partir pour Ostende, arrivez-y seul pendant la nuit, que personne ne sache que vous y êtes ; descendez alors chez le général Dejean ; vous vous enfermerez chez lui, vous préparerez avec lui, mais avec lui seul tous les ordres d’exécution pour les marches, les vivres, etc., etc. Je ne veux pas qu’un seul commis soit dans la confidence ; vous coucherez dans le cabinet même du général Dejean et personne ne devra savoir que vous y êtes… » Peu importe l’exactitude absolue de ce récit donné dans une note remise aux archives (14 janvier 1836) par le fils de Daru ; il peut être discuté en certains points de détail, mais il dépeint l’homme qui semble faire jaillir de son cerveau, en un éclair de génie, ses plans et ses projets. Cependant il ne faut pas s’y tromper, l’improvisation n’est qu’apparente. Depuis un certain temps, Napoléon a ruminé son affaire, mais il ne s’en est ouvert à personne. « Si je parais toujours prêt à répondre à tout, disait-il à Rœderer, c’est qu’avant de rien entreprendre, j’ai longtemps médité, j’ai prévu ce qui pourrait arriver. Ce n’est pas un génie qui me révèle tout à coup ce que j’ai à dire ou à faire, dans une circonstance inattendue pour les autres, c’est ma réflexion, c’est la méditation. »
Ainsi pratiquée par un esprit aussi étendu et aussi puissant, esprit à la fois analytique et imaginatif, la méditation a donné naissance aux plans des quatorze campagnes du plus grand capitaine des temps modernes ; il médite constamment, sa tête travaille toujours, en dînant, au théâtre ; la nuit il se réveille pour travailler. Il enfante dans le travail et la peine comme la fille qui accouche : « Il n’y a pas un homme plus pusillanime que moi quand je fais un plan militaire, je me grossis tous les dangers et tous les maux possibles dans les circonstances ; je suis dans une agitation tout à fait pénible. Cela ne m’empêche pas de paraître fort serein devant les personnes qui m’entourent. Je suis comme une fille qui accouche. Et quand ma résolution est prise, tout est oublié, hors ce qui peut la faire réussir. »
Nous voyons apparaître ici en Napoléon une de ses qualités maîtresses, une de celles qui ont le plus contribué à l’élever, la puissance de travail. Les dix-neuf années de ce qu’on peut appeler sa vie publique ont été remplies par un labeur presque surhumain ; un de ses principes de guerre est que le temps est tout, et il sait que le temps perdu ne se regagne pas. Par disposition naturelle, par tempérament, sa résistance au travail est extraordinaire ; il dit lui-même à Las-Cases, que « le travail est son élément, qu’il est né et construit pour le travail, il a connu la limite de ses yeux, il a connu la limite de ses jambes, il n’a jamais pu connaître celle de son travail. » « Travaillant jusqu’à vingt heures par jour, on n’aperçut jamais ni son esprit fatigué, ni son corps abattu, ni aucune trace de lassitude, et je me suis souvent dit, écrit Chaptal, qu’un tel homme vis-à-vis de l’ennemi devait avoir par cela seul un avantage incalculable. » Sans être homme de guerre, Chaptal avait pressenti que, par sa méthode et sa puissance de travail, Napoléon, gagnant l’ennemi de vitesse, était toujours en situation de lui imposer sa volonté.
Napoléon avait, en outre, une précieuse et rare faculté, il travaillait aussi facilement la nuit que le jour. Il disait avoir travaillé plus la nuit que le jour. Ce n’est pas que les affaires lui causent des insomnies, mais il dort à heures ininterrompues et peu de sommeil lui suffît. En campagne, souvent réveillé subitement au milieu de la nuit et aussitôt levé, il donne ses décisions ou dicte ses réponses avec la même clarté, la même fraîcheur d’esprit qu’en plein jour. C’est ce qu’il appelait « la présence d’esprit d’après minuit » ; elle était complète et extraordinaire chez lui. « Telle était l’organisation privilégiée de cet homme extraordinaire en tout qu’il pouvait dormir une heure, être réveillé par un ordre à donner, se rendormir, être réveillé de nouveau sans que son repos ni sa santé en souffrissent. Six heures de sommeil lui suffisaient, soit qu’il les prît de suite, soit qu’il dormît à divers intervalles dans les vingt-quatre heures. » En campagne, à l’approche des batailles, la nuit était particulièrement consacrée à son travail de pensée. Généralement couché après son dîner, vers 8 heures, il se lève au moment où les rapports des reconnaissances arrivent au quartier impérial, vers 1 heure ou 2 du matin. Bacler d’Albe lui a installé, sur une grande table, au milieu de la pièce qui lui sert de cabinet, la meilleure carte du théâtre de la guerre ; sur cette carte, très exactement orientée et entourée de vingt ou trente chandelles, sont marquées avec des épingles à tête de couleur les positions des différents corps d’armée et ce qu’on connaît des positions de l’ennemi. C’est là-dessus qu’il travaille en promenant son compas ouvert à l’échelle de 6 ou 7 lieues – une étape. Avant la fin de la nuit, il a pris sa détermination, dicté et expédié ses ordres que les troupes exécutent dès les premières heures du jour. Dans un chapitre suivant nous le verrons opérer ainsi en un cas concret, mais dès maintenant on se rend compte de « l’avantage incalculable », comme a dit Chaptal, qu’une telle méthode de travail lui donnait sur un ennemi consacrant les heures de nuit au sommeil ou les gaspillant dans les délibérations sans fin des conseils.
Toutefois, il importe de remarquer que cette période de travail intensif n’eut qu’une durée limitée ; une pareille dépense de forces exige le feu sacré et la vigueur de la jeunesse. C’est l’opinion de Napoléon lui-même. Il l’exprimait ainsi en 1805 : « On n’a qu’un temps pour la guerre, j’y serai bon encore six ans (jusqu’à quarante ans) après quoi moi-même je devrai m’arrêter. » Comme il le prévoyait, à partir de 1809, il commence à décliner, sa pensée perd de sa netteté et de sa précision, sa volonté est moins forte, son caractère moins décidé. Ses maréchaux remarquent, déjà dès 1806, qu’il prend moins allègrement la vie de campagne, il commence à aimer ses aises, il a, pour ainsi dire, une « manière lâchée » de faire la guerre.
Si peu d’hommes ont, dans leur vie, travaillé par la pensée autant que Napoléon, moins encore ont tiré de leur travail un aussi grand rendement. Cela tenait autant à l’étendue de son intelligence, singulièrement remarquable, qu’à la force de sa volonté. À une imagination vive qui, d’une seule idée, en enfantait mille autres, il unissait « cette faculté de géométrie transcendante qu’il appliquait à la guerre avec la même aisance et la même ampleur que Monge l’appliquait à d’autres objets ».
« Les habitudes géométriques de son esprit l’ont toujours porté à analyser jusqu’à ses émotions. Napoléon est l’homme, nous pouvons le dire avec Mme de Rémusat, qui a le plus médité sur les pourquoi qui régissent les actions humaines. Incessamment tendu dans les moindres actions de sa vie, se découvrant toujours un secret motif pour chacun de ses mouvements, il n’a jamais expliqué ni conçu cette nonchalance naturelle qui fait qu’on agit parfois sans projet et sans but. « Aucun esprit n’est plus net ni plus positif ; personne n’est plus éloigné de ce défaut par lequel, suivant Frédéric II, les hommes pèchent le plus : « Ne point s’appliquer assez pour se faire des idées nettes des choses auxquelles on est employé. »
Une caractéristique du génie de Napoléon est la force et la constance de son attention. Son effort du moment se concentre en entier sur l’objet dont il s’occupe, sans permettre à son imagination de s’en écarter un seul instant, il prolonge cet effort jusqu’à l’éclosion d’une solution. Lui-même compare son cerveau à un casier où les différentes questions sont rangées avec ordre. Pendant le travail il ouvre un tiroir et n’envisage que l’affaire qui s’y trouve ; la question traitée, il passe de même à la suivante jusqu’au moment où, voulant se reposer, il ferme tous les tiroirs de son cerveau. Un travail de pensée aussi méthodique et aussi précis ne peut être obtenu que par l’effort d’une volonté persévérante et inflexible qui ramène avec obstination dans la voie tracée l’esprit naturellement vagabond. Toujours au fait, Napoléon « pense plus vite que les autres ». Il attribuait sa pensée plus rapide à une plus grande mobilité des fibres de son cerveau. Ne peut-on pas dire que cette économie de temps était due aussi en grande partie à la force de son attention ?
L’audace dans la décision, qui est une autre marque distinctive du génie militaire de Napoléon, se rattache, comme la rapidité de pensée, autant à la vigueur de la volonté qu’à la nature de l’esprit. C’est un joueur effréné, il ne cesse de jeter hardiment toute sa fortune sur le tapis en une partie décisive, mais, le plus habile des joueurs, il emploie à gagner cette partie toutes les ressources de son intelligence et de son expérience. « L’homme habile doit profiter de tout, ne rien négliger de ce qui peut lui donner une chance de plus. L’homme moins habile, quelquefois en en méprisant une seule, fait tout manquer. » Voilà ce qu’il écrivait à Talleyrand dont la diplomatie nonchalante et avisée augurait mal cependant de ce continuel défi à la fortune. « Je réussirai ! c’était le mot fondamental de ses calculs, et souvent son entêtement à le prononcer l’a servi pour y parvenir. » La confiance en son étoile fut sans aucun doute une des raisons de sa prodigieuse élévation, mais, par une naturelle conséquence, ce qu’il y avait d’excessif dans le génie de Napoléon fut aussi la cause de sa ruine.
Cette audace était soutenue par une ambition formidable de gloire, par le souci de vivre dans la postérité, par une résolution inébranlable de faire de grandes choses ou de périr avec honneur. Cette audace, qui semble téméraire à notre époque plus prudente, plus ambitieuse de bien-être que de gloire, se décèle dans les plans de campagne et de manœuvre de Napoléon, en ce qu’il y recherche sans cesse l’acte décisif, la bataille à grand rendement. Tout est calculé, il est vrai, pour limiter la part du hasard, mais cette « sacrée majesté » conserve toujours une influence, Napoléon le sait et le dit : « Tous les grands évènements ne tiennent jamais qu’à un cheveu. » Sans doute, comme il l’a proclamé, si ses guerres furent audacieuses, elles furent aussi méthodiques. « Il eut toujours en vue le rapport des moyens avec les conséquences et des efforts sur les obstacles. » Mais, malgré son esprit mathématique, il grossit souvent outre mesure, par orgueil ou diplomatie, sous le coup d’une illusion inconsciente ou préméditée, l’évaluation de ses ressources et de sa puissance d’action. Des expéditions comme celles d’Égypte et de Russie, loin de toute ligne d’appui et de ravitaillement, peuvent être considérées comme de téméraires aventures. Que serait-il advenu s’il eût été vaincu à Arcole, à Marengo, à Austerlitz, à Iéna… ? Surtout à Marengo, il a véritablement joué sur un coup de dé tout son avenir. Jeu d’audace qui peut réussir quelque temps, mais qui, indéfiniment répété, ruine son homme, en dépit de toute habileté.
Malgré la faillite de ce jeu à outrance, combien ne doit-on pas admirer le courage moral d’un homme qui, consciemment, engage toute sa fortune, avec l’avenir de son pays, dans des parties si redoutables ? Se reportant par la pensée aux heures de ses grandes décisions, Napoléon, à Sainte-Hélène, déclarait « qu’on se fait une idée peu juste de la force nécessaire pour livrer avec une pleine méditation de ses conséquences une de ces grandes batailles d’où va dépendre le sort d’une armée, d’un pays, la possession d’un trône ». Aussi, a-t-il proclamé plus d’une fois que la première qualité d’un homme de guerre était la fermeté de caractère. C’est une parole sur laquelle on ne saurait trop méditer en notre temps de démocratie et de paix prolongée, où souvent, par des circonstances qui ne permettent en rien d’apprécier la fermeté de caractère, un homme est porté au commandement suprême des armées !
Le courage moral de Napoléon ne se manifesta jamais avec plus de force qu’en 1796 avant Arcole. Son armée est alors accablée de fatigue, mécontente, inférieure de plus de moitié à l’ennemi, le Directoire refuse obstinément tout secours. « En ce moment critique (11-15 novembre 1796) Bonaparte lui-même s’alarme, il n’ose plus répondre de rien. Je tiens de Collot lui-même, écrit Ségur, qu’il le renvoya à Milan, en le prévenant de se tenir prêt à tout évènement. Bien plus, quelque pût être le fâcheux effet de cette précaution, il le chargea d’une lettre pour Joséphine, qu’il autorisait à se retirer de Milan à Gênes. Peu d’années après, à Saint-Cloud, elle-même m’a dit que dans cette lettre Bonaparte lui avouait « qu’il n’avait plus d’espoir, que tout était perdu, que partout l’ennemi montrait une force triple de la sienne, qu’il ne lui restait que son courage, que probablement il allait perdre l’Adige, qu’ensuite il disputerait le Mincio et que cette dernière position perdue, s’il existait encore, il irait la rejoindre à Gênes où il lui conseillait de se retirer ». Mais il restait à Bonaparte son courage moral, sa volonté de périr avec honneur en jouant une partie suprême, et aussi son audacieuse et méditative pensée. Ce fut suffisant pour retourner une situation désespérée. On connaît la manœuvre d’Arcole, les combats acharnés dans les marais de l’Alpon (15, 16, 17 novembre 1796), la rentrée triomphale à Vérone par la porte d’Orient. Que n’avons-nous connu, en 1870, à Metz, une pareille volonté de vaincre !
En résumé, conception essentiellement personnelle, méditation incessante, esprit actif et audacieux, remarquable par son étendue, mais essentiellement positif, volonté forte, obstinée, énergique : telles furent les ouvrières vigilantes et laborieuses qui tissèrent la trame des décisions et des plans de Napoléon. Quelques grands principes directeurs, très simples, furent les axes d’activité de cette pensée toujours en travail. Napoléon en donne l’essentiel dans une lettre à Lauriston, alors chargé de l’expédition des Antilles.
« Souvenez-vous toujours de ces trois choses :
Réunion des forces ;
Activité ;
Ferme résolution de périr avec gloire. »
Nous sommes tenté d’ajouter cette quatrième maxime, aussi toute napoléonienne :
« Surprendre l’adversaire par la ruse et le secret, par l’imprévu et la rapidité des opérations. »
Voilà la théorie, elle est simple, mais elle ne vaut que par l’exécution. Nous allons voir comment il la comprenait.
Impulsion que Napoléon donne à l’exécution. – Suppression de toute perte de temps entre la décision et l’exécution. – Prix du temps. – Intervention de Napoléon dans le travail d’état-major. – Établissement des ordres d’opérations. – Situation de Berthier vis-à-vis de Napoléon. – Napoléon est son propre directeur des étapes.
À la guerre, la plus belle conception est vaine si elle ne se matérialise en des actes, le meilleur plan ne vaut que par l’exécution. Cette opinion n’a jamais eu de plus zélé partisan que Napoléon ; par tempérament il était hostile aux rêveries purement spéculatives, à la tournure d’esprit de ceux qu’il appelait avec mépris « les idéologues ». Cet homme du Midi à l’imagination ardente était en même temps le plus pratique des réalistes. Chez lui, la vigueur et la rapidité de l’exécution ne le cédaient en rien à la force de la conception. Dans les belles manœuvres impériales, on se demande ce qu’on doit le plus admirer de l’idée ou du geste qui la réalise. Les belles combinaisons qui menaçaient l’existence des armées de Wurmser, Mélas, Mack, Brunswick, étaient en elles-mêmes des manœuvres savantes, elles auraient seules produit la défaite de l’ennemi, mais elles n’auraient fait que menacer le sort de ces armées, elles ne les auraient pas détruites sans cette brillante exécution, cette vigueur, cette rapidité qui ont étonné le monde.
Nous avons vu que, chez Napoléon, l’idée de la manœuvre était essentiellement personnelle ; il ne pouvait en être tout à fait de même de l’exécution qui, nécessairement, mettait en action, sous des formes diverses, un grand nombre d’hommes. Quel était le degré d’influence de Napoléon dans l’exécution ? En quelle mesure y intervenait-il ? Là, comme ailleurs, son individualité imprimait fortement sa marque en donnant à l’exécution une allure singulièrement ferme et rapide.
L’Empereur intervenait tout d’abord par la volonté ardente de supprimer toute perte de temps entre la conception de l’idée et l’acte qui en était la conséquence. La volonté et l’exécution étaient pour ainsi dire fondues ensemble… « L’art de Napoléon consistait surtout en ce que pour l’exécution d’un plan qu’il avait embrassé en grand et qu’il avait calculé, il choisissait avec une volonté ferme, inflexible, les moyens qui devaient le conduire au plus vite et le plus vigoureusement au but. Sa redoutable autorité dissipait comme une chimère toute objection, toute preuve d’impossibilité. »
Nul plus que lui n’a tenu compte de la valeur du temps. « La perte du temps est irréparable à la guerre, écrivait-il à son frère Joseph (20 mars 1806), les raisons que l’on allègue sont toujours mauvaises, car les opérations ne manquent que par des retards. » Aussi, que de recommandations dans ses ordres pour accélérer l’exécution. C’est à Murat qu’il écrit de l’abbaye d’Elchingen (17 octobre 1805) : « Je vous félicite des succès que vous avez obtenus. Mais point de repos, poursuivez l’ennemi l’épée dans les reins et coupez-lui toutes les communications. » D’Augsbourg (12 octobre 1805), à Soult : « Si l’ennemi n’est pas à Memmingen, descendez comme l’éclair jusqu’à notre hauteur. » En 1809, à Masséna, au moment de Landshut, il adresse cet entraînant appel : « Vous voyez d’un coup d’œil que jamais circonstance ne voulût qu’un mouvement soit plus actif et plus rapide que celui-ci… Activité, activité, vitesse, je me recommande à vous ! »
Après la bataille de Coutras (1587), Henri de Navarre perdit les fruits de la victoire en quittant son armée pour s’en aller en Béarn présenter de sa main à la comtesse de Guiche, qu’il aimait alors, les enseignes, cornettes et autres dépouilles des ennemis dont il avait fait un galant trophée. Voilà qui est bien différent de la manière de Napoléon, qui, sans être insensible aux charmes féminins, n’aurait jamais dérobé une minute à ses opérations pour une belle dame. Avant comme après la bataille, il avait pour principe d’imposer, à lui-même comme à toute l’armée, un effort presque surhumain. Alors, il n’y a pas d’obstacle, qu’on ne lui parle pas d’impossibilité, en aucun cas, il n’accepte ce genre d’excuses. C’est une sorte de bluff sublime auquel il a recours pour stimuler les énergies, pour entretenir ce qu’il appelait le « feu sacré » chez ceux qu’il poussait vers un but que l’audace était seule capable d’atteindre.
C’est dans cet état d’esprit qu’il écrit à Augereau vieilli et fatigué, cette lettre (26 février 1814) où les phrases se succèdent brèves, sonores, saccadées comme en une sonnerie d’assaut :
« Mon cousin, quoi ! six heures après avoir reçu les premières troupes venant d’Espagne, vous n’étiez pas déjà en campagne ! Six heures de repos leur suffisaient. J’ai remporté le combat de Nangis avec une brigade de dragons qui, de Bayonne, n’avait pas encore débridé… Je vous ordonne de partir douze heures après la réception de la présente lettre et de vous mettre en campagne. Si vous êtes toujours l’Augereau de Castiglione, gardez le commandement, si vos soixante ans pèsent sur vous, quittez-le et remettez-le au plus ancien de vos officiers généraux. La patrie est menacée et en danger, elle ne peut être sauvée que par l’audace et la bonne volonté et non par de vaines temporisations. Soyez le premier aux balles. Il n’est plus question d’agir comme dans les derniers temps. Il faut reprendre ses bottes et sa résolution de 93. »
C’est par cette rapidité dans l’exécution, jointe au secret des opérations, que Napoléon créait la surprise et déroutait son adversaire.
Rapidité et secret des opérations sont deux grands facteurs de la victoire qui, pour bien des raisons, tendent à échapper aux armées modernes ; mais tout est relatif dans les combinaisons humaines et celui des deux adversaires qui, dans la prochaine guerre, l’emportera sous ce rapport, mettra de son côté bien des chances de succès.
Napoléon intervenait encore dans l’exécution de bien d’autres manières, en particulier par le contrôle incessant et par l’action entraînante qu’il exerçait sur son armée ; j’y viendrai bientôt ; mais, pour le moment, je voudrais me borner à le regarder vivre et agir dans son quartier général, je désirerais le contempler par une fenêtre ouverte de son cabinet de travail, dans la solitude duquel germèrent tant d’idées fécondes. C’est là que nous l’avons déjà vu prendre sa décision et que nous allons le suivre encore.
La décision étant prise, l’exécution comporte tout d’abord pour le haut commandement un acte essentiel : donner les ordres. C’est là qu’on voit apparaître les auxiliaires immédiats du commandement, l’état-major.
Thiébault a défini l’état-major du chef d’armée « le point central des grandes opérations militaires et administratives d’une armée, celui où, d’après les ordres du général en chef, tout se règle et s’ordonne et d’où tout s’active et se surveille ». Il est au-dessus des forces humaines, ajoutait-il, de pouvoir suffire en même temps aux méditations que nécessite un commandement étendu et aux détails qui tiennent à l’exécution des plans qu’il faut à chaque instant modifier et changer.
La méditation, travail préparatoire de la décision, et la prise de décision sont l’affaire exclusive du général en chef ; il donne la direction générale du mouvement par des instructions ou des ordres à son chef d’état-major, celui-ci est chargé des détails qui tiennent à l’exécution du mouvement et à l’entretien des armées. Si on ne se conforme point à cette répartition rationnelle du travail, on tombe soit dans une centralisation excessive qui dépasse les limites des forces humaines, soit dans une abdication du commandement qui fait perdre à l’action la fermeté et la vigueur désirables. Tombant dans le premier de ces excès, Napoléon ne laissait à l’état-major de Berthier que ce qu’il ne pouvait faire lui-même.
L’état-major n’avait aucune participation au travail de pensée de l’Empereur, il n’était pas orienté, il n’avait qu’à obéir au doigt et à l’œil. « Tenez-vous-en strictement aux ordres que je vous donne, moi seul je sais ce que je dois faire. » Voilà la consigne de Berthier. Il s’y tient strictement, a une foi aveugle en l’Empereur et se garde de toute idée personnelle. Il expédie les ordres ; major-général, expédiant les ordres de l’Empereur, tel est son titre et sa fonction. Voyons comment ces ordres étaient établis.
La décision prise, l’Empereur, dans son cabinet, dictait un ordre général qui était adressé à Berthier et qui donnait l’ensemble des mouvements à exécuter et des dispositions à prendre par les divers corps. Après en avoir pris connaissance, Berthier remettait cet ordre non point aux officiers de l’État-major général, mais aux employés militaires ou civils de son cabinet particulier. Chacun d’eux y découpait, pour ainsi dire, ce qui concernait sa spécialité et en faisait un ordre particulier, qui n’était qu’un extrait à peu près textuel de l’ordre de l’Empereur. On ne trouve là que des copistes. En un mot, dans les ordres d’opérations, la forme comme le fond étaient de Napoléon.
S’agissait-il simplement d’un rapport à recevoir, d’une question à trancher, d’une réponse à donner, Berthier ne se serait jamais permis d’agir de sa propre initiative. Un acte d’initiative dans ce sens aurait été considéré par Napoléon comme un véritable abus de confiance. Un officier, porteur de dépêches, arrivait-il la nuit, il était introduit auprès du major général, toujours logé à côté de l’Empereur. « Berthier se rendait alors chez l’Empereur, suivi de l’officier, pour que Napoléon pût, au besoin, interroger ce dernier. L’Empereur, s’il était couché, se levait aussitôt, passait sa robe de chambre de molleton ou de piqué blanc et dictait au major général la réponse. Celui-ci la transmettait textuellement aux généraux ou maréchaux en la faisant transcrire en même temps sur son livre d’ordres, avec le nom de l’officier chargé de la porter à destination et l’indication de l’heure à laquelle cet officier était expédié. Avant de donner un ordre subséquent, l’Empereur se faisait représenter le livre d’ordres et y relisait l’ordre précédent. »
L’Empereur dictait, Berthier expédiait, telle était la règle, « Il n’y avait d’exception à cette règle que lorsque, pendant les marches, l’Empereur donnait des ordres verbaux au major général ; dans ces circonstances, celui-ci les dictait à quelqu’un de son entourage, mais, après l’arrivée au quartier général, ces ordres verbaux étaient toujours confirmés par des ordres écrits plus explicites que les premiers. »
Si donc on considère, avec Jomini, le chef d’état-major comme devant être le confident du général en chef, son collaborateur intellectuel, « celui qui le seconde, encore même qu’il serait en état de tout diriger lui-même, prévient ses fautes en lui fournissant de bons renseignements », on doit reconnaître que Berthier n’a pas rempli auprès de Napoléon un pareil rôle, pour lequel il n’avait du reste aucune aptitude. Mais ce n’était pas ce que Napoléon lui demandait. Berthier, comme major général, avait pour fonction d’expédier les ordres de l’Empereur, de donner les ordres de mouvement et d’administration, tenir les états de situation, l’organisation, le personnel, et enfin faire le service actif de guerre près de l’Empereur. Dans ce rôle plus restreint, quoique encore si important, Napoléon appréciait l’exactitude ponctuelle de Berthier, son obéissance passive, exempte de tout commentaire, sa discrétion, sa modestie, sa vigilance, sa prévoyance minutieuse pour l’expédition et la transmission des ordres, toutes qualités qui, dans plus d’une circonstance, assurèrent le succès des opérations. Dans ses Commentaires, Napoléon, racontant sa campagne de 1796, nous a laissé son appréciation sur Berthier. « Il avait (en 1796) une grande activité, il suivait son général dans toutes ses reconnaissances et dans toutes ses courses, sans que cela ralentît en rien son travail de bureau. Il était d’un caractère indécis, peu propre à commander en chef, mais possédant toutes les qualités d’un bon chef d’état-major. Il connaissait bien la carte, entendait bien la partie des reconnaissances, soignait lui-même l’expédition des ordres, était rompu à présenter avec simplicité les mouvements les plus composés d’une armée. » On voit aussi par là l’idée qu’avait Napoléon des fonctions d’un chef d’état-major, le rôle restreint qu’il lui assignait dans sa pensée et qui diffère si profondément de la définition de Jomini.
Mais, quand on porte un jugement sur un homme, il convient de marquer les époques. L’homme se modifie avec les circonstances et suivant les temps. De même que Napoléon, Berthier n’échappe pas à cette règle générale. « Dès 1805, son activité commençait à s’éteindre et il contribuait à gâter l’armée en substituant dans le cœur des officiers l’égoïsme à l’enthousiasme de la gloire. » D’autre part, les effectifs s’accroissent, l’activité prodigieuse de l’Empereur se ralentit aussi, alors apparaît nettement, aux yeux même de Napoléon, l’insuffisance du système qui fait dépendre d’un seul cerveau tous les mouvements des armées. Le 2 juillet 1812, l’Empereur écrit au major général : « L’état-major est organisé de manière qu’on n’y prévoit rien. » Pendant cette campagne de Russie, Berthier, à plusieurs reprises, subit des reproches. « Berthier, je donnerais un bras pour que vous fussiez à Grosbois ; non seulement vous ne m’êtes bon à rien, mais vous me nuisez. » Tout cela prouve que la machine fonctionnait mal et il ne pouvait en être autrement, parce que l’activité de l’esprit ne vivifiait pas le travail des aides d’un commandement aussi étendu.
À la suite de ces cruelles remontrances, Berthier boudait, il ne venait pas dîner, Napoléon l’envoyait chercher, l’attendait pour se mettre à table. Il lui passait les bras autour du cou, lui disait qu’ils étaient inséparables, le raillait sur Mme Visconti, enfin le plaçait lui-même à table en face de lui.
Napoléon n’était pas sans avoir quelque attachement pour celui qu’il appelait son frère d’armes, son fidèle compagnon de guerre, quelquefois même sa femme.
Tout en le considérant comme « un homme bien médiocre », il se plaît à reconnaître que, quand rien ne l’en détourne, il n’est pas sans quelque penchant pour lui. Avec son perpétuel besoin de tout analyser, même ses sentiments, il arrive à se demander pourquoi, lui, qui ne s’amuse guère aux sentiments inutiles, il s’amuse à aimer un homme aussi médiocre. C’est parce qu’« il croit en vous », lui répond Talleyrand. Ce fut une des qualités de Berthier d’avoir inspiré ce penchant. Il fut l’homme de Napoléon, il fut le chef d’état-major qui s’adaptait au génie, à la personnalité du chef qu’il servait. Cette harmonieuse juxtaposition de deux hommes, par tant de côtés si différents, fut, sans aucun doute, un des éléments des chefs-d’œuvre guerriers de l’épopée impériale.
Avec les idées de notre temps, nous considérons Berthier comme un chef d’état-major à compétence restreinte, mais il serait injuste de ne pas reconnaître que, dans cette sphère d’action limitée, il rendit à Napoléon des services très précieux, quoique sans éclat, et y fit preuve de qualités estimables. Pour lui rendre l’hommage que les nouvelles générations lui ont parfois refusé, nous ne saurions mieux terminer cet aperçu de son caractère militaire que par l’appréciation élogieuse de Mathieu Dumas, bien qualifié pour le juger, puisqu’il fut son aide-major général en 1805, et qu’en 1812 il travailla à ses côtés comme intendant général de l’armée. « Pendant dix-neuf années remplies par seize campagnes, presque toutes doubles, d’été et d’hiver, l’histoire de la vie du maréchal Berthier n’est autre que celle des guerres de Bonaparte et de ses opérations dont il dirigea tous les détails d’exécution dans le cabinet et sur le terrain…





























