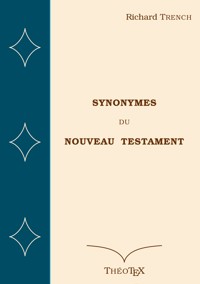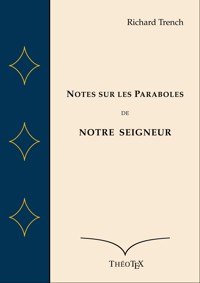Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Pas plus que ceux de l'Ancien Testament, les miracles de Jésus-Christ ne s'accordent avec les données de la science. Comment expliquer qu'un aveugle-né puisse non seulement acquérir tout à coup l'usage de ses yeux, mais encore que son cerveau soit capable d'interpréter ce qu'il voit ? Comment expliquer qu'une masse invraisemblable de matière puisse être créée spontanément, lors de la multiplication des pains et des poissons, à partir de rien, tandis que de gigantesques accélérateurs de particules n'en produisent que des quantités infimes ? L'absurdité de toute tentative de conciliation avec les théories scientifiques est ici manifeste ; et cependant il se trouve aujourd'hui des chrétiens assez timorés ou flagorneurs, pour prétendre qu'il n'existe pas de contradiction entre la science et la foi : il serait plus honnête de nier complètement les miracles que de les considérer comme des singularités sans beaucoup d'importance. Les miracles bibliques démontrent au contraire la totale souveraineté du Créateur sur sa création, et replacent la raison de l'homme dans ses justes limites. Les miracles de Jésus-Christ n'ont d'ailleurs pas été faits pour rabattre le caquet d'une science orgueilleuse, qui n'existait pas encore ; ils sont avant tout une preuve de sa déité ; chacun d'eux met en lumière un aspect particulier et merveilleux du salut qu'il est venu apporter. Richard Chenevix Trench passe ici en revue 33 miracles rapportés dans les Évangiles, en les accompagnant de réflexions édifiantes. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1890.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Note ThéoTEX
Essai préliminaire
Désignations du miracle
Les miracles et la nature
L’autorité du miracle
Les miracles de l’Évangile comparés à d’autres catégories
Les Miracles de l’Ancien Testament
Miracles des évangiles apocryphes
Miracles postérieurs ou ecclésiastiques
Les attaques contre les miracles
Les Juifs
Les païens (Celse, Hiéroclès)
Les panthéistes (Spinoza).
Les sceptiques (Hume)
Les miracles relatifs (semi-rationalisme de Schleiermacher)
Les rationalistes (Paulus)
L’école historico-critique (Woolston, Strauss)
La valeur apologétique des miracles
Les Miracles
L’eau changée en vin
La guérison du fils du seigneur de la cour
La première pêche miraculeuse
L’apaisement de la tempête
Les démoniaques dans la contrée des Gadaréniens
La résurrection de la fille de Jaïrus
L’hémorrhoïsse
La guérison des deux aveugles dans la maison
La guérison du paralytique
La guérison du lépreux
La guérison du serviteur du centenier
La démoniaque dans la synagogue
La guérison de la belle-mère de Pierre
La résurrection du fils de la veuve
La guérison de l’impotent de Béthesda
La multiplication des pains
La marche sur la mer
La guérison de l’aveugle-né
La guérison de l’homme qui avait une main sèche
La femme possédée d’un esprit infirme
La guérison d’un hydropique
La guérison des dix lépreux
La guérison de la fille de la Cananéenne
La guérison d’un sourd-muet
La seconde multiplication des pains
La guérison d’un aveugle à Bethsaïda
La guérison de l’enfant lunatique
Le statère dans la bouche du poisson
La résurrection de Lazare
La guérison des deux aveugles de Jéricho
Le figuier stérile
La guérison de Malchus
La seconde pêche miraculeuse
NOTE THÉOTEX
L’acceptation ou le refus de la réalité des miracles rapportés dans les Évangiles sera toujours la pierre de touche qui permet de séparer, au sein de l’Église, la foi sincère en Jésus-Christ et l’intellectualité hypocrite. Le franc sceptique, pour sa part, nie en bloc tout surnaturel, et c’est son droit. . . jusqu’à ce que l’examen des récits évangéliques, la considération de la psychologie des personnages, les conséquences historiques extraordinaires qui ont résulté de la résurrection de Jésus-Christ, bref tout ce qu’il est convenu d’appeler l’apologétique, lui montrent qu’il doit se tromper quelque part. Alors s’engage en lui une lutte intérieure, non entre sa raison et des raisons, mais entre sa conscience alarmée et l’orgueil foncier de la nature humaine. Il n’y a pas de vraie conversion possible sans une reddition complète quant à l’autorité absolue que Jésus-Christ a exercée sur la matière, et sur la création durant son séjour terrestre.
L’époque de Richard TRENCH a vu se dérouler au sein du protestantisme de formidables combats entre les défenseurs de l’historicité des miracles évangéliques et de multiples partis agressifs, qui s’efforçaient de ruiner la crédibilité de tout fait surnaturel. Un siècle plus tard, les positions se sont décantées : ceux qu’on appelle aujourd’hui les Évangéliques admettent, en principe et ouvertement, la pleine inspiration des Écritures, et par conséquent la réalité des miracles dont elles témoignent. Cependant, il ne faudrait pas s’imaginer que la vieille hache de guerre soit pour toujours enfouie ; la récurrente question de l’origine de l’homme l’a rapidement déterrée, et la science ayant fait de grands progrès depuis que l’archevêque de Dublin écrivit ce petit ouvrage très bien fait, il conviendrait de redéfinir de manière plus serrée, ce qu’est un miracle.
Personne ne pouvant se prétendre sincère chrétien et jeter le doute sur la réalité des miracles opérés par Jésus, la nouvelle hypocrisie religieuse consiste à clamer haut et fort, qu’il n’existe pas de contradiction entre la science et la foi. C’est une totale contre-vérité. En effet, la foi dont nous parlons ici, implique la foi au miracle ; or le miracle n’est miracle que s’il se situe en opposition frontale et irrémédiable, avec les bases de la science.
Le miracle évangélique ne consiste pas en une curieuse coïncidence aussi improbable soit-elle, ou en la manifestation d’une loi naturelle encore inconnue du spectateur, mais il affirme l’exercice d’une volonté divine transcendante qui supplante ponctuellement le fonctionnement ordinaire de la matière. Or la volonté divine n’entre pas dans les règles de jeu de la science, laquelle elle est tenue d’expliquer les phénomènes en appliquant uniquement un petit nombre de principes, qui sont en général des lois de conservation : conservation de la masse, de l’énergie, de la charge etc.
Prenons par exemple le premier miracle accompli par Jésus, aux noces de Cana, et qui a eu pour effet de transformer instantanément, ou dans un temps très court, 4 à 5 hectolitres d’eau en vin. Une telle opération implique la transmutation ou l’apport d’environ dix pour cent de matière, soit une cinquantaine de kilogrammes ! ce qui représente une quantité pharamineuse d’atomes nouvellement créés, et en termes d’équivalence énergétique une puissance déployée supérieure aux plus grosses bombes nucléaires imaginables. Quelle théorie physique pourra jamais rendre compte d’un tel tour de passe-passe ? et quelle absurdité de prétendre, devant le miracle de Cana, que la science et la foi s’harmonisent ensemble, voire se complètent !
En réalité, derrière cette fausse modestie bon enfant, du soi-disant scientifique et pourtant chrétien, intelligent et néanmoins évangélique, se cache en général le désir de gagner dans le milieu ecclésial un ascendant qui n’a pas pu être obtenu ailleurs : les honneurs sont durs à décrocher dans un monde scientifique, où il faut avoir réellement accompli quelque chose, pour figurer dans le Who’s Who. Dans l’Église il suffit de parler, d’articuler quelques mots théologiques à consonance savante, de faire allusion à ses diplômes, pour en imposer à un auditoire restreint et peu instruit. La typologie du grand scientifique à bonnet pointu au royaume des ignorants, mais complètement inconnu ailleurs, est assez caractéristique du milieu évangélique. On y croise régulièrement l’ancien bon élève, assez travailleur pour avoir intégré une école d’ingénieurs ou décroché un doctorat universitaire, mais qui n’étant pas spécialement doué ou passionné pour la recherche scientifique, s’est rapidement tourné vers la philosophie, l’apologétique, la théologie, et autres occupations langagières, qui ont sur la science l’avantage de pouvoir échapper au contrôle de l’expérience.
Que l’on examine la liste des trente-trois miracles étudiés par Richard Trench, on devra confesser que chacun d’eux se pose en contradiction avec une ou plusieurs lois ordinaires du monde terrestre. Si ce n’est pas avec celles de la matière, c’est avec celles de la connaissance, ou de l’information si on préfère.
Citons encore par exemple l’un des plus bizarres : le poisson pêché par Pierre, sur l’ordre de Jésus, dont la gueule contient une pièce d’argent d’un statère, valeur exacte de la taxe qui était réclamée par les portiers du temple pour deux personnes. Aucune loi physique n’interdit à un poisson de transporter une pièce de monnaie dans sa gueule ; par contre toute information doit avoir un support, elle ne voyage jamais du futur vers le présent. Or Jésus n’avait aucun moyen naturel de savoir ce qu’il en était de ce poisson, sa prédiction est tout aussi miraculeuse que la transformation de l’eau en vin. Mais il serait superflu d’insister : ses contemporains, hommes pourtant crédules, comme on l’était en ces temps pré-scientifiques, ont immédiatement su faire la différence entre le surnaturel de ses œuvres et les rumeurs de la légende : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui », confessait Nicodème.
Avant d’entrer sur le terrain de football, le joueur chrétien a peut-être prié pour la victoire de son camp; cependant une fois le match lancé, il n’a plus qu’à se préoccuper de respecter les règles du jeu, comme tous les autres joueurs, qu’ils soient croyants ou non, sans savoir comment Dieu pourra faire qu’il gagne. La science n’est finalement qu’un jeu, d’apparence sans doute un peu plus sérieuse, plus noble et plus exaltante que le football, mais tout de même un jeu qui a ses propres règles, que le scientifique est tenu de respecter, qu’il soit croyant ou non, à savoir : tout prouver, tout démontrer. Autant Dieu se situe au-dessus des règles arbitraires du football, autant il est élevé au-dessus des règles de la science. Ne trouverait-on pas assez prétentieux et insolent quelqu’un qui se vanterait d’être footballeur et néanmoins croyant en Dieu? C’est bien ainsi que l’on doit considérer le poseur scientifique, qui après avoir annoncé son bagage, s’excuse modestement d’être néanmoins chrétien évangélique ; ce qui est une façon de nous dire que l’on peut être intelligent et chrétien, mais qu’il est plus commun d’être chrétien et idiot.
La science et la foi ne se situent pas sur un pied d’égalité ; chez le chrétien la science a le devoir de s’incliner, dès que la foi fait mine de la contredire, quitte à trouver l’explication plus tard, s’il y en a une. L’Église ne devrait pas tolérer de tels empiétements de la vanité profane sur l’enseignement des Écritures. Un miracle qui s’harmonise avec la connaissance scientifique n’est tout simplement pas un miracle, et la motivation qui pousse certains évangéliques à dire le contraire s’explique suffisamment par le désir vaniteux de passer pour intelligent aux yeux du monde.
Pour terminer, signalons que comme pour les Notes sur les Paraboles de Notre Seigneur, le pasteur Paul DUPLAN-OLIVIER1 a traduit assez librement ce livre de Trench sur les miracles de Jésus-Christ, qui dans son édition anglaise de 1908 fait environ le triple de sa traduction. Nous avons ajouté la traduction des quelques notes latines qui restait dans cette dernière.
Phoenix, le 18 mai 2018
1. Paul Duplan-Olivier (1840-1901) était le gendre de Urbain OLIVIER, célèbre poète et romancier suisse.
ESSAI PRÉLIMINAIRE
I. DÉSIGNATIONS DU MIRACLE
Pour obtenir la vraie notion du miracle, il est important d’examiner les diverses désignations que l’Écriture en donne. En effet, le nom d’une chose est une déclaration de son essence, un témoignage de ce que les hommes ont toujours ressenti à son contact ; aussi lorsque nous voulons connaître cette chose, il nous faut commencer par étudier les mots qui la désignent. La Bible parle de « miracles » de « prodiges », de « signes », de « puissances », d’œuvres ».
Le mot « prodige » (τέρας 2) ne désigne que le côté extérieur du miracle ; son sens moral serait entièrement perdu, s’il ne produisait qu’un simple étonnement ou qu’une simple admiration; le même effet pourrait être produit par une cause infiniment moindre. Aussi, les miracles du Nouveau Testament ne sont jamais appelés des « prodiges » sans qu’un autre mot plus caractéristique accompagne ce dernier : « signes et prodiges, » ou « signes, » ou « puissances ». Le miracle considéré comme « prodige, » comme fait extraordinaire qui ne s’explique par aucune loi connue, doit appeler l’attention sur un monde supérieur, engager l’homme à prendre garde à l’appel qui lui est adressé par ce moyen ( Act.14.8-18).
Mais il est aussi un « signe, » (σημεῖον) une indication de la présence et de l’œuvre de Dieu. Ce mot fait bien comprendre son but moral ; les miracles sont des signes et des gages de réalités supérieures (Esa.7.11 ; 38.7) ; ils ont de la valeur, non pas tant en soi que comme manifestations de l’amour et de la puissance de Celui qui les opère, de sa divinité. Ils sont souvent comme des lettres de crédit données à celui qui les accomplit (le Seigneur confirmant le témoignage par des signes ; Marc.16.20 ; Act.14.3 ; Héb.2.4) ; ce sont des actes qui doivent légitimer l’Envoyé de Dieu. Nous lisons, par exemple :« Quel signe nous montres-tu ? » (Jean.2.18) « nous voudrions te voir faire un signe ; » (Matt.12.38) « montre-nous un signe venant du ciel » (Matt.16.1). Saint Paul dit qu’il a « les signes de l’apostolat » (2Cor.12.12), les preuves qu’il est bien réellement apôtre. Dans l’Ancien Testament, Dieu accorde deux « signes » à Moïse, quand il l’envoie délivrer Israël. Il avertit que Pharaon lui demandera de légitimer sa mission, de produire les lettres qui l’accréditent comme ambassadeur de Dieu (Exo.7.9-10). Dieu donna « un signe » au prophète qu’il envoya auprès de Jéroboam (1Rois.13.3). Tout signe n’est pas nécessairement un miracle ; une simple coïncidence, un événement quelconque peuvent être des signes pour le croyant, qui l’assurent de la vérité d’une prédiction. Les anges donnent pour « signe » aux bergers qu’ils trouveront le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche » (Luc.2.12). Samuel donne à Saül trois « signes » pour prouver que Dieu l’a établi roi sur Israël ; le dernier seul a quelque chose de surnaturel (1Sam.10.1-9). Le prophète donne a Héli, comme « signe » de la vérité de ses menaces, la mort de ses deux fils (1Sam.2.34). Dieu donna à Gédéon un « signe » de la victoire qu’il remporterait 3 (Jug.7.9-15). Lorsqu’un homme est convaincu que Dieu lui-même le dirige, il peut voir « un signe » de cette direction dans tel ou tel événement (Gen.24.14-21 ; Jug.6.36-40).
Les miracles sont souvent aussi appelés les « puissances » ou les « œuvres puissantes » de Dieu (δυνάμεις). L’effet donne son nom à la cause, quand il s’agit de « prodiges » ; ici, la cause donne son nom à l’effet 4. La « puissance » réside dans le messager divin ( Act.6.8 ; 10.38) ; Christ est seul « la grande puissance de Dieu » ( Act.8.10). Le mot « puissance » signifie aussi les effets, les diverses manifestations de cette puissance ; ce sont alors des « puissances, » des « œuvres merveilleuses » (Matt.7.22), des « œuvres puissantes » des « œuvres merveilleuses » (Matt.11.20 ; Marc.6.14), des « miracles » ( Act.2.22 ; 19.11).
Ces trois termes qui servent à désigner les miracles et que nous venons d’examiner, se trouvent réunis trois fois ( Act.2.22 ; 2Cor.12.12 ; 2Thess.2.9), quoique dans un ordre différent. Ils servent à décrire les différentes faces d’une même œuvre, que des œuvres diverses. La guérison du paralytique (Marc.2.1-12) était un « prodige, » car tous ceux qui en furent témoins étaient « dans l’étonnement ; » c’était une puissance, car le paralytique se leva, sur l’ordre de Christ, « prit son lit et sortit en présence de tout le monde ; » c’était également « un signe, » car cette guérison témoignait de la présence d’un homme supérieur aux autres, venu pour pardonner les péchés.
Les miracles sont souvent appelés aussi « œuvres (ἔργα), » dans l’Évangile de Jean (Jean.5.36 ; 7.21 ; 10.25,32,38; 14.11-12). Le merveilleux, pour saint Jean, n’est que la manifestation naturelle de Celui qui possède la plénitude de Dieu; en raison de son origine supérieure, il doit faire des œuvres plus grandes que celles de l’homme. Ces miracles sont la circonférence du cercle dont il est le centre. Le grand miracle, c’est l’incarnation; tous les autres en procèdent il n’est pas étonnant que Celui dont le nom est « l’Admirable » accomplisse des œuvres merveilleuses ; ce qui serait surprenant, c’est qu’il ne le fit pas. Ces prodiges sont le fruit, selon son espèce, que porte l’arbre divin ; ce sont des œuvres de Christ.
II. LES MIRACLES ET LA NATURE
En quoi, peut-on se demander, le miracle diffère-t-il des faits ordinaires que nous observons dans la nature ? Car ceux-ci sont également merveilleux ; nous les admirons peu, parce que nous y sommes accoutumés, et cependant ne sont-ils pas des « signes » permanents ?
Quelques-uns ont dit que, puisque tout est miracle, puisque la croissance de l’herbe, le développement de la semence, le lever du soleil sont les effets d’une puissance infinie, comme l’eau changée en vin, ou le malade guéri par une seule parole, il n’y a donc pas de miracle spécial dans les faits dont parle l’Écriture. Tout ferait partie du grand prodige de la nature, qui nous enserre de toutes parts ; il est arbitraire de proclamer certains faits comme spécialement ou exclusivement miraculeux ; tout est miracle, ou rien ne peut être appelé de ce nom. Cette affirmation, qui paraît, à première vue, très juste et profonde, est cependant très fallacieuse. La distinction qu’on établit quelquefois, à savoir que, dans le miracle, Dieu agit d’une manière directe, immédiate, tandis que les autres faits sont soumis à ses lois, cette distinction ne peut être admise, car elle a sa source dans une conception fataliste de l’univers.
L’horloger fabrique sa pendule et l’abandonne ; le constructeur de navires les fait et les lance, d’autres s’en servent ; mais le monde n’est pas une machine que son Auteur abandonne après l’avoir construite, se contentant de la réparer de temps à autre ; Jésus-Christ a dit : « Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et j’agis aussi. » (Jean.5.17) ; il « soutient toutes choses par sa parole puissante » (Héb.1.3). Les lois que Dieu a établies sont l’expression de sa volonté ; cette volonté, pénétrée de sagesse et d’amour, exclut tout arbitraire ; nous pouvons, en toute sécurité, nous reposer sur elle ; nous savons ce qu’elle sera, parce que nous savons ce qu’elle a été, aussi nous l’appelons loi. Toutefois, à chaque moment c’est une volonté libre ; dire que la volonté de Dieu se manifeste plus dans une œuvre spéciale que dans tout autre fait ne suffit donc pas. Tout est miracle ; la création de l’homme est une merveille aussi grande que sa résurrection ; le développement de la semence dans le sillon est aussi extraordinaire que la multiplication des pains entre les mains du Sauveur. Le miracle n’est pas une manifestation plus grande de la puissance de Dieu que les faits naturels dont nous sommes sans cesse les témoins, mais c’est une manifestation différente. Augustin a dit : « L’homme charnel n’a d’autre règle de son intelligence que le témoignage de ses yeux. Il croit ce qu’il a coutume de voir, et refuse toute croyance à ce qu’il ne voit point. Cependant Dieu fait des miracles en dehors du cours ordinaire des choses, parce qu’il est Dieu. La naissance journalière de tant d’hommes qui n’existaient pas est un bien plus grand miracle que la résurrection d’un petit nombre qui existaient, et cependant, on n’a fait aucune attention à ces miracles : leur répétition semble leur avoir ôté leur importance 5 ». Par le moyen des faits que nous venons de rappeler, Dieu parle en tout temps et au monde entier ; ils sont sa grande révélation. « Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l’œil, quand on les considère dans ses ouvrages » (Rom.1.20). Cependant, par le fait même que la nature s’adresse à tous, et sans cesse, le but peut ne pas être atteint, le langage étant trop général, trop universel ; il n’y a là rien de spécial, d’individuel. Mais un miracle accompli en présence de certaines personnes, réclamant leur attention sérieuse, est un langage plus direct ; Dieu a, par ce moyen, quelque chose de particulier à dire, un message spécial. Une causalité divine extraordinaire forme donc l’essence même du prodige ; il y a là une puissance de Dieu autre que celle qui est constamment à l’œuvre. L’activité incessante de Dieu, qui, à l’ordinaire, se dérobe sous le voile de ce que nous appelons les lois naturelles, se découvre entièrement dans le miracle ; la main du divin Ouvrier est clairement révélée. A côté des faits naturels ordinaires, une plus grande puissance se manifeste et se fait sentir avec plus d’énergie 6.
Le miracle, considéré dans son essence, est donc une « chose nouvelle ; » toutefois, ce qui est naturel peut devenir merveilleux pour nous selon les circonstances, selon le but qui doit être atteint. Il est vrai que ce qui peut s’expliquer par la nature et par l’histoire n’est pas, à proprement parler, un miracle ; cependant, le doigt de Dieu peut s’y révéler d’une manière tellement évidente, la marche progressive du règne de Dieu peut y être tellement intéressée, que tout en admettant des causes naturelles, nous pouvons y voir un fait providentiel. Ce n’est pas un miracle dans le sens absolu de ce mot, puisque des causes naturelles peuvent l’expliquer ; toutefois, ce fait peut avoir un caractère miraculeux, étant donné le moment où il se produit, le but qu’il doit atteindre.
Plusieurs des plaies d’Egypte étaient des phénomènes naturels, mais renforcés par la main puissante de Dieu. En soi, il n’y avait rien de miraculeux dans les essaims de mouches qui infestaient les maisons des Égyptiens, ni dans les nuées de sauterelles, ni dans la maladie du bétail. Aucun de ces fléaux n’était inconnu dans le pays, mais leur intensité, leur rapide succession, leur relation avec la parole de Moïse, avec l’épreuve de Pharaon, avec la délivrance d’Israël, tout cela les élevait au rang de miracles (Psa.78.43 ; Act.7.36). Ce n’est pas proprement un prodige, que la découverte d’un statère dans la bouche d’un poisson (Matt.17.27), ou un orage éclatant à telle ou telle époque (1Sam.12.16-19), cependant si ces faits ont pour but de fortifier la foi, de châtier la désobéissance, de produire la repentance, ils ont leur place dans le gouvernement moral du monde, dans le plan de Dieu, et doivent ainsi prendre rang parmi les miracles. Ils peuvent d’autant mieux être envisagés comme tels, si l’événement vient confirmer une prophétie du Seigneur. Il en sera ainsi pour le cœur pieux, pour l’homme qui croit que Dieu règne par sa sagesse, sa justice et son amour : pour lui, de tels faits seront surtout des signes de l’action de Dieu. Souvent les impies, tels que les magiciens d’Egypte, sont forcés de dire : « C’est ici le doigt de Dieu, » (Exo.8.15) lorsqu’il s’agit de miracles dans le sens absolu de ce mot ; mais quand il s’agit des faits dont nous venons de parler, ils ne le diront pas, parce qu’on peut les expliquer d’une manière naturelle.
Il est entièrement faux de prétendre que ces œuvres merveilleuses de Dieu que nous appelons des miracles, soient des violations d’une loi naturelle. Ils dépassent et surpassent la nature, mais ne lui sont pas contraires. Le miracle ne peut contredire la nature, puisque ce qui est contraire à la nature, c’est-à-dire à l’ordre divin, c’est ce qui est en révolte contre Dieu. Le vrai miracle est l’intrusion d’un monde plus élevé et plus pur dans notre monde actuel et troublé par tant de désordres, afin de le mettre, au moins pour un moment, en harmonie avec ce monde plus élevé 7. La guérison des malades n’est pas contre nature, puisque la maladie ne faisait pas partie de l’état primitif de l’homme; la santé est l’état normal, non la maladie. La guérison est le rétablissement de l’ordre primitif. Le miracle n’est donc pas la dérogation à la loi, mais plutôt sa neutralisation, la loi étant suspendue pour un temps; nous en avons de nombreux exemples. Continuellement nous voyons, dans notre monde, des lois inférieures suspendues par de plus importantes, ainsi, des lois physiques supplantées par des lois morales ; cependant, nous ne parlons pas alors de violation d’une loi, ni d’un fait contraire à la nature, mais nous reconnaissons que la loi d’une plus grande liberté l’emporte sur une loi inférieure. Ainsi, quand je lève mon bras, la loi de la gravitation n’est pas pour cela détruite ; elle existe toujours, mais est interrompue par la loi supérieure de ma libre volonté. Les lois chimiques de la décomposition des substances animales subsistent toujours, alors même qu’elles rencontrent un obstacle dans le sel qui préserve ces substances de la corruption. La loi du péché, dans l’homme régénéré, est continuellement tenue en échec par la loi de l’esprit de vie ; cependant cette loi de péché est toujours dans ses membres, prête à réagir, dès que l’action plus énergique de la loi supérieure cessera. Ainsi, ce qui est interrompu, c’est l’effet d’une loi particulière, mais le système général des lois subsiste toujours. Dans le miracle, notre monde actuel est entraîné vers un ordre de choses supérieur ; ce sont alors des lois plus parfaites qui sont à l’œuvre dans le monde, elles prennent la place des lois inférieures, ce qui est leur droit 8.
Les miracles n’étant donc pas contraires à la nature, quoique la dépassant, servent à ennoblir les faits ordinaires, en témoignant de leur source. Christ, guérissant un malade par sa seule parole, prétend, par ce fait même, être le maître de toutes les vertus qui servent à la guérison de nos corps ; il veut nous dire : « Je viens vous rappeler que la puissance de guérir réside en moi » ; il rattache à sa personne tous les moyens de guérison. Quand il multiplie les pains, quand il change l’eau en vin, c’est comme s’il disait : « C’est moi et nul autre qui, par le soleil et la pluie, par les semailles et la moisson, donne la nourriture nécessaire à l’homme; pour vous rappeler ce fait que vous êtes toujours tentés d’oublier, je vous montrerai comment le pain se multiplie dans mes mains, comment l’eau se change en vin, par ma seule parole. » Dans un sens, les œuvres de la nature révèlent la gloire de Dieu (Psa.19.1-6), mais, d’autre part, elles nous cachent cette gloire ; elles devraient nous faire souvenir sans cesse de lui, mais elles peuvent nous conduire à l’oublier. Les miracles proclament la libre volonté de Dieu, ils nous rappellent qu’au dessus des causes et de leurs effets il y a un Ouvrier divin, que le monde ne dépend pas d’une aveugle fatalité. Mais ils ont d’autres buts encore, en rapport avec le salut de l’humanité, auquel ils servent.
2. Τέρας donne en français tératologie étude des monstres. Le mot θαῦμα (français thaumaturge) qui lui est cousin est employé par les Pères grecs, mais jamais tel quel dans l’Écriture. On trouve θαυμάσιον Matt.21.15, et le verbe θαυμάζειν qui traduit l’étonnement éprouvé face au prodige.
3. Les mots τέρας et σημεῖον sont souvent unis dans le Nouveau et dans l’Ancien Testament.
4. Le mot ἐξουσία (autorité) se rattache à cette idée quoiqu’il ne soit employé qu’une fois dans le sens de miracle. Ils sont appelés ἔδοξα (Luc.13.17) en tant que manifestant la gloire de Dieu (δόξα), et Μεγαλεῖα parce que produits par la grande puissance de Dieu
5. Sermon No 242, pour les fêtes de Pâques.
6. Le miracle n’est pas contra naturam, (contre la nature) mais præter naturam (au delà de la nature) et supra naturam (au dessus de la nature).
7. Augustin, Contre Fauste, ch. III : « Cependant ce n’est pas s’exprimer d’une manière inexacte que de dire que Dieu fait quelque chose contre la nature quand il fait quelque chose contre ce que nous connaissons de la nature ; parce que nous donnons aussi le nom de nature au cours de la nature ordinaire et connu de nous, et c’est quand Dieu agit contre ce cours que nous donnons à ses œuvres le nom de merveille et de miracle. »
8. Dans un passage remarquable, l’auteur de la Sapience de Salomon (19.6) montre comment, lors du passage de la mer Rouge, la nature était dominée pour servir au but que Dieu se proposait.
III. L’AUTORITÉ DU MIRACLE
Le miracle se présente-t-il avec un caractère d’autorité incontestable à ceux qui en sont les témoins, en sorte que l’auteur du miracle et sa doctrine soient reconnus aussitôt comme venant de Dieu ? Il ne peut en être ainsi, car, à côté des œuvres qui servent aux progrès du règne de Dieu, il y en a d’autres qui en sont les imitations ou plutôt les caricatures, ce sont celles qui viennent de Satan. L’Écriture lui attribue des miracles bien réels. Ce sont des « prodiges mensongers, » (2Thess.2.9) ils ont pour but d’établir le royaume du mensonge et de l’affermir 9. D’après l’Écriture, nous devons reconnaître que les magiciens d’Egypte étaient en relation avec un royaume spirituel, aussi bien que Moïse et Aaron. Le conflit entre eux et ces derniers acquiert ainsi une signification évidente. La plus grande partie de cette signification est perdue pour nous, si nous ne voyons dans leurs prodiges que de simple tours de sorciers, des œuvres de prestidigitateurs, au moyen desquels ils en imposaient à Pharaon et à ses serviteurs, leur faisant croire que leurs verges étaient changées en serpents, et qu’ils pouvaient changer également l’eau en sang. Il n’y avait pas seulement conflit entre la puissance du roi d’Egypte et la puissance de Dieu ; mais les dieux de l’Egypte, les puissances malfaisantes qui servent d’appui au royaume des ténèbres, étaient en conflit avec le Dieu d’Israël. Leur néant apparaissait promptement; toutefois, le royaume de la lumière et celui des ténèbres se faisaient une guerre ouverte en présence de Pharaon, chacun faisant effort pour s’emparer du roi. Autrement, quel serait le sens de passages tels que celui-ci, dans le cantique de Moïse : « Qui est semblable à toi, ô Éternel, parmi les dieux? » (Exo.15.11) ou cet autre : « J’exercerai le jugement contre tous les dieux de l’Egypte ; je suis l’Éternel (Exo.12.12). La tentation du désert, à laquelle Jésus-Christ fut exposé, n’était qu’une des formes de l’opposition de Satan; il en sera de même à la fin du monde (Matt.24.24 ; 2Thess.2.9 ; Apo.13.13). A chaque grande époque du royaume de Dieu, le combat entre la lumière et les ténèbres se manifeste plus clairement. Si les œuvres de l’antichrist et de ses serviteurs ne sont pas de simples jongleries, elles ne sont pas non plus des miracles dans le vrai sens de ce mot ; elles ne renferment que quelques éléments merveilleux. Ce sont des œuvres de puissance, mais isolées, ne faisant point partie d’un tout organique ; ce n’est pas l’harmonie, mais le trouble qui les caractérise 10 ; ce n’est pas ici la toute-puissance de Dieu dirigeant le monde vers un but de grâce, de sagesse et d’amour, mais le mal pénétrant les replis les plus cachés pour l’épreuve et le perfectionnement des saints.
Le fait que nous venons de signaler, à savoir que le royaume du mensonge a ses prodiges comme le royaume de la vérité, suffirait à lui seul pour nous convaincre que le simple témoignage des miracles ne peut servir à prouver la vérité d’une doctrine : c’est ce que l’Écriture déclare expressément (Deut.13.1-5). La doctrine doit d’abord se légitimer devant la conscience, puis le miracle vient y apposer le sceau du divin. Le premier appel doit être adressé à la conscience, à la nature morale de l’homme. Toute révélation présuppose chez l’homme la faculté de reconnaître la vérité lorsqu’elle lui est présenté, d’y répondre, de voir en elle une amie qui avait été délaissée ; c’est la trouvaille d’un trésor qu’il avait perdu. « Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu, » et la reconnaît comme telle. On peut objecter que, s’il en est ainsi, le miracle n’est pas nécessaire. Sans doute, la vérité s’est accrédité comme étant bonne, comme venant de Dieu, parce que tout ce qui est bon et vrai vient de lui, mais non comme une parole nouvelle procédant directement de lui, un langage nouveau adressé à l’homme. Les miracles sont les lettres de crédit du porteur de cette bonne parole, des signes qu’il a une mission spéciale pour réaliser les desseins de Dieu à l’égard de l’humanité.
Quand la vérité a trouvé un cœur qui la reçoit, quand elle a réveillé des échos dans les profondeurs de l’âme, celui qui en est le messager montre par là qu’il est plus près de Dieu que les autres hommes, qu’il doit être écouté comme étant lui-même la Vérité (Matt.11.4-5 ; Jean.5.36), ou du moins comme étant en rapport direct avec celui qui est la Vérité (1Rois.13.3) ; il peut alors réclamer une soumission sans réserve, l’acceptation, sur sa parole, de faits qui surpassent l’esprit humain, de mystères qui ne peuvent s’expliquer par la raison. Réclamer un signe tel que le miracle de la part de celui qui apporte une nouvelle révélation, un message direct de Dieu, n’est pas une preuve d’incrédulité, mais un devoir pour celui qui reçoit ce message; autrement il pourrait être tenté de prendre quelquefois la parole de l’homme pour celle de Dieu. Ce n’était pas un acte d’impiété, de la part de Pharaon, que de dire à Moïse et à Aaron : « Faites un miracle » (Exo.7.9-10) ; au contraire, il avait raison. Ils vinrent lui dire qu’ils avaient un message de Dieu pour lui ; son devoir était de les mettre à l’épreuve. D’autre part, Achaz faisait preuve d’incrédulité en ne demandant pas un signe de Dieu qui confirmât la parole du prophète (Esa.7.10-13) ; il ne se souciait pas du sceau de la promesse, parce qu’il avait peu d’égards pour la promesse elle-même. Si le miracle doit confirmer ce qui est vrai, d’autre part, lorsque la conscience proteste contre une doctrine, tous les prodiges du monde ne sauraient exiger l’acceptation de cette doctrine-là.