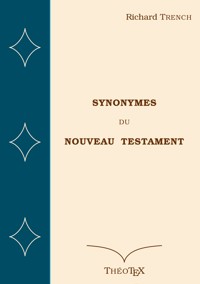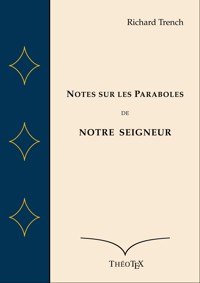
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Les paraboles de Jésus-Christ sont de petits tableaux pédagogiques destinés à enseigner une vérité spirituelle ou morale à l'auditeur, en le forçant à réfléchir ; elles contiennent donc toujours une part énigmatique. Mais contrairement aux charades ou aux rébus dont l'intérêt est épuisé une fois la solution trouvée, les croquis tracés par le fils de l'homme sont des sources de réflexion et d'émerveillement sans fin, parce qu'ils décrivent les problèmes et les choix auxquels sont en permanence confrontées nos âmes. Les erreurs les plus courantes dans l'interprétation des paraboles évangéliques proviennent de ceux qui veulent à toute force y trouver un sens cabalistique, ou mystique, ou dispensationaliste. A cet égard le livre de Richard Chenevix Trench, philologue réputé du Nouveau Testament, constitue un puissant antidote contre ces tendances. Il apporte au lecteur une saine exégèse des trente illustrations paraboliques tirées des évangiles, avec l'appui de tout ce que les commentateurs ont fourni de meilleur, depuis les siècles qu'elles sont étudiées. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1878.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322469192
Auteur Richard Trench. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]De nationalité irlandaise, Richard Chenevix Trench (1807-1886) avait pourtant des racines presque entièrement françaises : du côté paternel, il descendait d'un ancêtre émigré en Angleterre au 16e s., du côté maternel, d'une famille huguenote lorraine assez connue, les Chenevix, ayant fui la France après la révocation de l'édit de Nantes.
C'est de sa mère Melesina, poétesse publiée, que Richard aura hérité ses talents littéraires. Très tôt il aime les livres, et surtout les mots, qu'il étudiera plus tard en philologue, et comme auteur de l'ouvrage qui le rendit célèbre : Synonyms of the New Testament.
La vocation ecclésiastique attendit par contre qu'il soit parvenu à l'âge d'adulte avant de s'imposer à lui. Brillant élève de Cambridge, puisqu'il y fut membre de la société des Apostles, il pensait alors faire avocat. Ayant appris l'espagnol, il s'embarqua vers 1829 dans une aventure politique de soutien aux ennemis du Roi Ferdinand VII, à l'issue de laquelle il n'eut la vie sauve qu'en se réfugiant à Gibraltar.
De retour en Angleterre, il est en 1835 ordonné prêtre de l'église anglicane. La même année il publie une Vie de Justin Martyr toute en vers. Quelques années plus tard paraissent les titres : Notes sur les Paraboles de Notre Seigneur, sur les Proverbes de Salomon, sur les Miracles de Christ, sur les Béatitudes, sur les Sept Églises de l'Apocalypse. Son aménité, sa piété, son esprit large et profond, l'élèveront finalement jusqu'au poste d'archevêque de Dublin. Ses œuvres, encore citées aujourd'hui par les commentateurs de langue anglaise, se caractérisent par une grande érudition, une connaissance très sûre de la littérature chrétienne des premiers siècles, et une sage sobriété dans l'exégèse. Il fut par exemple l'un des premiers à s'opposer à l'interprétation prophético-historique des sept églises de l'Apocalypse, en montrant que cette idée prenait en réalité son origine dans le mysticisme de Joachim de Flore.
Un mot sur la traduction française des Notes sur les Paraboles : elle a été réalisée librement par le pasteur suisse Paul Duplan-Olivier (né à Montreux en 1840). Librement signifie que son volume fait environ la moitié de l'original anglais, qui comprend beaucoup de grandes notes, de citations d'auteurs anciens, de développements philologiques sur les mots ; on compatit sympathiquement à la pénibilité qu'aurait représenté une traduction complète et littérale.
Nous avons toutefois rajouté nous-mêmes une section qui avait été supprimée par Duplan dans l'Introduction (sur les paraboles extra-bibliques), et corrigé quelques erreurs dans le reste de son texte. Les nombreuses citations latines représentant un désagrément certain pour le lecteur ordinaire, conformément au vœu de Trench, parut en 1906 une édition où elles étaient traduites. Nous les avons reprises dans cette édition numérique, et nous avons rétabli les quelques mots en caractères grecs que Duplan avait transcrits en caractères latins : il est au 21me siècle permis à un pasteur d'ignorer le latin, ou comme Sganarelle de demander à ce qu'on fasse comme s'il ne le savait pas, mais non point le grec, qui reste la langue du Nouveau Testament.
Nous croyons faire une œuvre utile en offrant aux théologiens et au public religieux français la traduction du beau livre du Dr Trench sur les « les Paraboles de notre Seigneur », livre qui a eu treize éditions, en Angleterre. - Les qualités qui distinguent l'auteur des « Synonymes du Nouveau Testament » se retrouvent ici ; une vaste érudition s'y associe à une intelligence profonde de l'Écriture ; cet ouvrage est plein de vues originales, qui répandent souvent une vive lumière sur les sujets que nous offrent les récits du Seigneur ; il peut être utile aux pasteurs et, en général, à tous ceux qui étudient les Écritures. Nous n'avons pas, dans notre littérature religieuse française, un livre aussi solide et aussi complet sur les paraboles.
Nous avons dû, pour le mettre à la portée du grand public chrétien, profiter de l'autorisation que nous a donnée l'auteur, de retrancher ou d'abréger certains fragments qui s'adressent exclusivement aux théologiens ; mais ces changements ne diminuent en rien la valeur pratique de l'ouvrage. C'est ainsi que nous avons retranché un chapitre de l'Introduction qui traite des paraboles en dehors de l'Écriture, et de celles que nous trouvons chez les historiens juifs et chez les Pères de l'Église. Il nous a paru que ce chapitre, ne se rattachant pas directement au sujet, pourrait, sans trop d'inconvénients, être éliminé, quoiqu'il soit très intéressant, d'ailleursa. Nous avons dû aussi retrancher ou abréger plusieurs citations des Pères qui auraient trop surchargé la traduction et l'auraient rendue d'un plus difficile accès auprès des lecteurs français. Mais nous avons eu soin de résumer les notes les plus importantes et de conserver l'intégrité du texte même de l'ouvrage. Tout notre désir est que le livre du Dr Trench soit connu et apprécié comme il mérite de l'être, et que, par son moyen, beaucoup d'âmes soient éclairées et affermies dans leur foi au Sauveur !
Paul Duplan
Les auteurs qui ont cherché à définir la paraboleb ont trouvé que ce n'était point une tâche facile que de tenir compte de tous ses traits caractéristiques, en laissant de côté ce qui est superflu et purement accidentel. Plutôt que d'ajouter une nouvelle définition à celles qui ont été déjà donnéesc, je me bornerai donc à signaler ce qui différencie la parabole évangélique de la fable, de l'allégorie et des autres modes semblables de comparaison. En cherchant à la distinguer des autres genres avec lesquels on peut facilement la confondre, et, en justifiant cette distinction, j'aurai contribué à faire ressortir ses caractères essentiels plus clairement que par tout autre moyen.
1. Quelques-uns ont identifié la parabole et la fable, ou du moins n'ont tracé qu'une légère ligne de démarcation entre les deux ; ainsi Lessing et Storr affirment que la fable raconte un événement qui a eu lieu, tandis que la parabole le présente uniquement comme possible. Mais évidemment la différence est plus grande. La parabole veut représenter une vérité spirituelle et céleste ; la fable a un tout autre but. Elle se rattache essentiellement à la terre et ne s'élève pas au-dessus d'elle. Elle n'a jamais un but plus élevé que celui d'inculquer des maximes de prudence, de diligence, de prévoyance et de morale humaines, même quelquefois aux dépens des vertus plus élevées. Elle atteint ainsi le faîte de cette moralité que le monde comprend et admire. Mais elle ne se trouve pas dans la Bibled et ne pourrait y avoir une place, par la nature même des choses, vu le but particulier des Écritures, qui consiste à faire l'éducation spirituelle de l'homme, et non à aiguiser son esprit. La fable recommande ce genre de vertus qui constituent l'instinct chez l'animal et méritent les louanges du monde, mais elle ne fait de l'homme qu'un animal habile. Pour atteindre ce but, elle tire ses exemples du monde inférieure.
Ce monde-là est le domaine principal de la fable. Lorsque des hommes y jouent un rôle, c'est uniquement dans leurs rapports avec le monde inférieur. Au contraire, dans la parabole, le monde des animaux n'y occupe une place que dans ses rapports avec l'homme. Les relations des bêtes entre elles n'ayant rien de spirituel, ne peuvent offrir aucune analogie avec les vérités du royaume de Dieu. Mais la domination de l'homme sur les animaux résultant de la nature supérieure de son intelligence, qui est le don de son Créateur, peut servir, comme dans la parabole du berger et de son troupeau (Jean.10), à illustrer les rapports de Dieu avec l'homme. Il appartient donc à la parabole de revêtir un caractère sérieux et de ne se permettre ni plaisanteries ni railleries à l'endroit des faiblesses et des fautes de l'humanitéf. Elle peut être sévère et indignée, mais elle ne plaisante jamais sur les malheurs des hommes, alors même qu'ils sont mérités ; et son indignation est celle d'un saint amour, tandis que le fabuliste se livre souvent à des railleries amèresg ; il met du sel dans les blessures de l'âme, peut-être avec le désir de les guérir, mais dans un esprit bien différent de celui du Sauveur compatissant lorsqu'il verse l'huile et le vin sur les plaies saignantes de l'humanité.
Une autre différence entre la parabole et la fable consiste en ceci : on ne peut, il est vrai, accuser le fabuliste de manquer à la vérité, puisque ce n'est pas son intention de tromper lorsqu'il attribue le langage des êtres raisonnables aux arbres, aux oiseaux et aux autres animaux, et personne ne peut s'y méprendre ; cependant, un plus grand respect pour la vérité ne permettait pas au Docteur céleste de méconnaître à ce point les lois et la constitution des êtres, même en se faisant accorder cette permission ou en la sous-entendant. A ses yeux, l'univers, tel qu'il est sorti des mains de son Auteur, est une œuvre trop parfaite, il a droit à trop de respect pour être représenté autrement qu'il existe en réalité. Le grand Docteur en paraboles ne s'est jamais permis d'altérer ou de défigurer les lois de la nature. Il ne nous présente jamais des arbres raisonnant comme des animaux, et nous trouverions mauvais qu'il le fith.
2. La parabole diffère du mythe en ce que celui-ci identifie complètement une vérité et son enveloppe. Les distinguer exige un long travail qui ne s'accomplit que dans un âge subséquent et par des hommes qui ne croient plus à la réalité du cadre. Le mythe se présente, non seulement comme le porteur de la vérité, mais comme étant la vérité elle-même ; tandis que, dans la parabole, on voit aussitôt la différence entre le fond et la forme, entre l'amande et sa coque, entre le vase précieux et le vin plus précieux encore qu'il contient.
Il y a un autre genre de mythes qui est le produit artificiel d'une génération réfléchie. On en trouve chez Platon de nombreux et remarquables exemples, qui doivent exprimer quelque importante vérité, donner une forme à une idéei. Telles sont encore ces vieilles légendes auxquelles on attribue un sens spirituel ; c'est alors la lettre qu'on tue pour vivifier l'esprit. Les derniers platoniciens recoururent à ce mode pour expliquer la mythologie grecque. La légende de Narcisse était à leur yeux le voile sous lequel on découvrait la folie de l'homme qui, poursuivant les biens de ce monde, est déçu dans son attente. Ils voulaient justifier cette mythologie de l'accusation d'absurdité ou d'immoralité et en montrer le sens moral, en opposition à la nouvelle vie du christianisme, ne se doutant pas qu'ils ne réussissaient qu'à détruire entièrement la foi en cette mythologie.
3. La parabole se distingue facilement du proverbej, quoique ces deux mots s'emploient souvent l'un pour l'autre dans le Nouveau Testament. Ainsi : « Médecin, guéris-toi toi-même » (Luc.4.23). C'est une parabole, dit le Seigneur. Or, c'était un proverbe. Il en est de même de Luc.5.36, expression proverbiale plutôt qu'une parabole, quoiqu'il soit question de parabole : comparez 1Sam.24.13 ; 2Chr.7.20 ; Psa.44.14. Il y a en outre des proverbes, ainsi nommés par saint Jean, qui ne sont que des allégories. Exemple : Jésus-Christ assimilant ses relations avec son peuple à celles d'un berger avec son troupeau, est introduit en ces termes par l'évangéliste : « Jésus leur dit un proverbe » (Jean.10.6). Saint Jean ne se sert jamais du mot parabole et les synoptiques jamais du mot proverbe. On peut se rendre compte de cette anomalie par le fait que les Hébreux n'avaient qu'un seul mot, maschal, pour désigner la parabole et le proverbe. Les Septante l'ont traduit par le second de ces termes pour le titre du livre de Salomon, tandis qu'ils l'ont rendu ailleurs par le premier. Exemple : 1Sam.10.12 ; Éze.18.2. Le Sauveur met en opposition le parler en proverbes ou en paraboles avec le parler ouvertement.
Quoique tels proverbes, qui sont entrés dans le langage usuel, soient devenus parfaitement clairs, cependant ils sont souvent en eux-mêmes énigmatiques, exigeant pour être compris une certaine perspicacité. Le proverbe est très souvent parabolique, c'est-à-dire qu'il repose sur quelque comparaison explicite ou implicite ; ainsi 2Pi.2.22. Enfin le proverbe n'est souvent qu'une parabole en raccourci. Exemple : l'aveugle conducteur d'aveugles ; on pourrait en faire facilement une parabole.
4. Enfin, la parabole diffère de l'allégorie quant à la forme plutôt que pour le fond. Dans celle-ci, les qualités et propriétés de l'objet ou de la personne qu'on a en vue sont transférées au sujet allégorisé, et lui sont unies au point de ne pouvoir en être séparéesk Exemple : Jésus, dans les chap. 10 et 15 de Jean, se nomme tour à tour le berger, la porte, le cep, etc. De même cette proclamation du précurseur : « Voici l'Agneau de Dieu » (Jean.1). Ainsi Ésaïe.5.1-6 est une parabole dont l'explication est donnée au v. 7 ; tandis que le psaume Psa.80.8-16, qui contient la même image, est une allégorie. L'allégorie ne réclame pas comme la parabole une interprétation qui vienne du dehors ; elle la renferme en elle-même. A mesure que l'allégorie se développe, l'explication la suitl. Ainsi, l'allégorie est à l'égard de la métaphore, comme figure plus développée, dans le même rapport que la parabole en regard d'une simple comparaison isolée. Et comme plusieurs proverbes sont des paraboles en raccourci, plusieurs aussi sont de courtes allégories.
En résumé, la parabole diffère de la fable en ce qu'elle se meut dans le monde spirituel et ne renverse jamais l'ordre naturel des choses ; du mythe, qui confond le sens caché avec le symbole extérieur, tandis que les deux demeurent séparés dans la parabole ; du proverbe, en ce qu'elle est plus développée, non accidentellement et occasionnellement ; de l'allégorie, en ce qu'elle compare une chose à une autre, mais en même temps maintient leur distinction et n'attribue pas à l'une, comme le fait l'allégorie, les propriétés et qualités de l'autre.
Quoique notre Seigneur ait en plus d'une occasion enseigné par des paraboles, avec l'intention de cacher à une partie de ses auditeurs certaines vérités, qu'ils étaient indignes ou incapables d'entendrem, de telle sorte que, comme le dit Fuller, les paraboles étaient alors semblables à la colonne de nuée et de feu qui éclairait les Israélites, mais plongeait les Égyptiens dans l'obscurité, cependant nous pouvons admettre que son but général était le même que celui des autres docteurs qui ont employé cette méthode d'enseignement et qui ont voulu ainsi illustrer ou démontrer les vérités qu'ils avaient à proclamer. (Quintilien a dit : « les similitudes sont un admirable moyen d'éclairer un sujet. Sénèque les nomme : « les béquilles qui soutiennent notre infirmité. » Tertullien n'accorde pas qu'elles obscurcissent la lumière de l'Évangile.) Je dis illustrer ou démontrer, car la parabole n'est pas seulement une illustration mais aussi, en quelque mesure, une preuve. Ces analogies ne servent pas seulement à rendre la vérité intelligible ou plus frappante, comme quelques-uns le prétendentn. L'efficacité des paraboles gît dans l'harmonie pressentie par chacun (mais que les esprits cultivés se plaisent à constater), entre le monde matériel et le spirituel ; harmonie telle que les comparaisons tirées du premier pour faire comprendre les vérités du second sont quelque chose de plus que des images heureusement mais arbitrairement choisies. Ces deux mondes, créés par la même main, tirés du même fond et établis en vue du même but, se rendent témoignage l'un à l'autre. Les choses terrestres sont la copie des célestes. Le tabernacle d'Israël a été construit selon le modèle vu au Sinaï (Exo.25.40 ; 1Chr.28.11-12). La question que Milton met sur les lèvres de l'ange se présente forcément ici : « La terre ne serait-elle que l'ombre du ciel, et les choses qui se trouvent dans ces deux demeures se ressembleraient-elles plus qu'on ne le croito ? »
Entre le type et la chose typifiée il existe plus qu'une correspondance recherchée, ils sont unis par la loi d'une secrète affinité. La relation du Christ avec l'Église, dont il se dit l'époux, nous en offre un exemple (Éph.5.23-32). Et celles du mari et de la femme en ce monde sont une forme inférieure des relations spirituelles de Jésus avec l'Église. Elles reposent sur cette dernière et n'en sont que l'expression.
Quand le Seigneur parle à Nicodème de la nouvelle naissance (Jean.3), ce n'est pas uniquement parce que l'introduction de l'homme dans le monde offre une figure convenable pour représenter ce qui, sans aucun acte de notre part, s'accomplit en nous lorsque nous sommes introduits dans le royaume de Dieu. Les circonstances de notre naissance naturelle ont été préordonnées pour illustrer le mystère de la régénération. Le Seigneur est Roi. Il n'a pas emprunté ce titre aux gouverneurs des États. C'est lui, au contraire, qui leur a prêté le sien. Et non seulement cela, mais il a encore ordonné toutes choses pour que tout vrai gouvernement terrestre, avec ses lois et ses jugements, ses punitions et ses grâces, sa majesté et la crainte qu'il inspire, nous parle de Celui dont le règne s'étend par-dessus tout ; en sorte que l'expression royaume de Dieu n'est pas figurée mais littérale. Ce sont plutôt les royaumes et les rois terrestres qui sont les figures des véritables. Il en est de même du monde de la nature. Le sol inculte, qui ne produit que des ronces, est un type permanent du cœur de l'homme, soumis à la même malédiction ; il ne produira que des épines sans une culture spirituelle vigilante. L'ivraie qui est mélangée au froment pendant un certain temps est également un type du mélange des justes et des méchants. La corruption de la semence dans la terre et son développement du sein de cette corruption est une prophétie de la résurrection ; tous ces rapprochements que nous trouvons dans l'Écriture sont des types très exacts.
Il sera toujours possible à ceux qui n'aiment pas à contempler un monde supérieur de nier cette harmonie. On dira que c'est nous qui transportons dans le ciel les images tirées de la terre ; que la terre n'est pas une ombre du ciel, mais que c'est le ciel, tel que nous l'avons imaginé, qui est une figure de la terre ; que les noms de Père et de Fils, par exemple, sont employés mal à propos quand on les applique aux personnes divines et qu'il vaudrait mieux ne jamais les employer. Mais on répondra que c'est le même Dieu qui siège dans le ciel, sur un trône éclatant, qui remplit aussi des pans de sa robe le temple de Jérusalem et que les caractères qu'il a imprimés sur la nature constituent une écriture sacrée, les hiéroglyphes du Très-Haut. L'homme est placé dans un monde visible, dont il ne doit pas être nécessairement l'esclave, mais qui peut lui servir à s'élever à la contemplation de la vérité éternelle. Il peut s'approprier cette vérité au milieu des choses les plus ordinaires et par leur moyen, en cherchant à découvrir le sens profond qu'elles renferment.
Dieu nous présente donc, outre sa Révélation écrite, une autre révélation plus ancienne encore, sans laquelle on ne peut comprendre celle qui lui a succédé, car la Bible lui emprunte son vocabulaire. Les rois et les sujets, les parents et les enfants, le soleil, la lune, les semailles, la moisson, la lumière et les ténèbres, le sommeil et le réveil, la naissance et la mort, forment une chaîne continue de paraboles pour l'enseignement des vérités révélées qui sont supra-sensibles ; c'est un secours pour notre foi et pour notre intelligencep.
Il est vrai que l'homme est toujours en danger de perdre « la clef de la science » qui doit lui ouvrir les portes de ce palais ; son œil intérieur peut être obscurci, son oreille devenir pesante, en sorte qu'aucune des voix de la nature ne parvient jusqu'à lui, et c'est là, du plus ou moins, la situation de chacun. Pour aucun de nous la nature ne donne tout son enseignement d'une manière habituelle. C'est pourquoi la Bible, avec son emploi presque continuel du langage figuré, est destinée à réveiller dans nos esprits l'intelligence des choses et leur rend la clef de la connaissance obscurcie par le péché, la vraie signatura rerum ; ce sont surtout les paraboles qui doivent produire cet heureux résultat.
Elles ont en outre un rapport frappant avec les miracles. Ceux-ci appelaient l'attention sur les lois de la nature qui, par leurs fonctions journalières, perdent leur caractère merveilleux et n'attirent plus les regards. Les hommes, en effet, avaient besoin d'être stimulés à la contemplation et à l'étude des puissances énergiques qui travaillent en leur faveur. Les paraboles aussi dirigeaient les esprits vers les faits spirituels et vers les enseignements qui sont au fond de tous les procédés de la nature et de toutes les institutions sociales, et qui, quoique invisibles, servent de fondement à toutes choses. Le Christ se mouvait dans ce qui, à l'œil humain, ne semblait plus qu'un monde usé ; il le rajeunit par sa présence et son contact ; alors se révèlent à l'homme les secrets les plus cachés de son existence et de sa destinée. Les hommes durent avouer que le monde extérieur correspondait merveilleusement à un autre monde qu'ils portent au-dedans d'eux et le leur expliquait, et que ces deux mondes se réfléchissaient et projetaient l'un sur l'autre l'éclat le plus glorieux.
C'est sur une telle base que repose l'enseignement parabolique. Ce n'est donc point bâtir en l'air, peindre sur les nuages, que d'affirmer, touchant le monde sensible, qu'il est divin, que c'est le monde de Dieu, de ce même Dieu qui nous enseigne les vérités spirituelles et nous les approprie. Il n'est par conséquent qu'un mensonge, l'affreux rêve des gnostiques et des manichéens, qui voyaient un abîme entre le monde de la nature et celui de la grâce, et donnaient pour auteur au premier un Être imparfait et méchant, et au second un Être bon et parfait. Ce monde, étant celui de Dieu, a part à sa rédemption ; cependant, ce monde racheté, ne l'est, à certains égards, qu'en espérance (Rom.8.20) ; il soupire après l'entière délivrance. Il ne faut pas oublier que la nature, dans sa condition actuelle, de même que l'homme, ne possède encore que la prophétie de sa gloire future, dans l'attente de laquelle « elle gémit et est en travail, » dit saint Paul ; elle a le pressentiment de quelque chose qui doit arriver. Elle souffre de notre malédiction et en cela même elle nous offre les symboles les plus frappants de nos maux ainsi que des moyens d'y remédier. Avec ses orages et ses désolations, ses lions et ses vipères, ses catastrophes et ses fléaux, elle nous annonce la mort et nous en montre les causes, de même que ses opérations bienfaisantes nous prêchent la vie et tout ce qui tend à la restaurer et à la maintenir.
Mais la nature, dans son état actuel, ne rend pas toujours un témoignage très distinct à la vérité de Dieu et à son amour ; quelquefois même elle paraît ne pas les proclamer du tout, mais parler plutôt de discorde et de guerre, et de toutes les funestes conséquences de la chute. Un jour il en sera autrement, un jour elle sera l'expression parfaite de la pensée de Dieu, le pur reflet de sa gloire. Car, sans aucun doute, à la fin des temps la nature ne sera pas détruite, mais transformée ; ce qui est maintenant nature (natura), c'est-à-dire un devenir, aura atteint sa pleine réalisation. La nouvelle création sera le glorieux enfant issu des soupirs et des angoisses de l'ancienne ; pareil au serpent qui rejette sa peau rugueuse et desséchée, le monde actuel déposera ses vêtements souillés pour se parer d'un vêtement saint et glorieux. Quand elle aura été délivrée de la servitude de la corruption, tout ce qu'elle renferme actuellement d'obscur et de navrant disparaîtra. La nature sera un miroir qui réfléchira parfaitement Dieu, car elle ne racontera plus que les merveilles de sa sagesse, de sa puissance et de son amour.
Mais, en attendant, le monde qui subit les conséquences de la chute, n'est plus entièrement propre à exprimer les choses du monde supérieur. Les relations humaines et toute la constitution des choses terrestres, participent à la fragilité qui distingue tout ce qui est de la terre. Sujettes au changement, souillées par le péché, enfermées dans d'étroites limites par la mort, elles sont souvent faibles et passagères ; elles contiennent un élément de péché, tandis qu'elles demeurent des symboles de ce qui est pur et céleste. Elles sont accablées sous le fardeau qui les oppresse. Le père châtie selon son bon plaisir, et non pas uniquement pour le bien de son enfant ; en cela, il n'est pas l'image du Père céleste, qu'il devrait représenter. La semence qui devrait représenter la parole de Dieu, cette parole qui demeure éternellement, finit toujours par périr. Les fêtes, qui sont souvent considérées comme l'image de la pure joie du royaume, de la communion parfaite des fidèles avec leur Seigneur et entre eux, sont mélangées de beaucoup d'éléments charnels, et ne durent que peu de temps. Il y a quelque chose d'analogue à tout cela chez les personnages typiques de l'Écriture, chez ces hommes qui doivent préfigurer l'Homme-Dieu. A cause de leurs péchés, de leurs infirmités et de leur courte durée, ils ne peuvent être des types très exacts. Salomon est un de ces types ; son règne de paix, la splendeur de sa cour, sa sagesse, le temple qu'il construisit, faisaient pressentir celui qui devait venir. Et toutefois, cette gloire de Salomon ne brille que peu de temps ; sa sagesse et la paix de son territoire ne tardent pas à disparaître (1Rois.11.14,23,26) ; ce n'était là qu'une image passagère, et non pas la vraie réalité du royaume de paix.
Nous voyons aussi, dans l'Écriture, des hommes qui ne sont des types de Christ que dans une seule époque de leur vie ; ainsi, Jonas, type de la résurrection ; d'autres qui semblent apparaître subitement comme symboliques, mais qui disparaissent aussitôt comme tels, ainsi Samson. Aucun homme ne peut représenter l'idée divine d'une manière parfaite. On peut bien dire, en parlant de la vérité de Dieu, que « nous portons ce trésor dans des vases de terre » ; le vase de terre apparaît toujours ; l'imperfection est attachée à tout ce qui est humainq. Nul doute que ce ne fût l'imperfection des moyens humains et des choses terrestres, pour caractériser ce qui est spirituel ou céleste, qui inspirait à saint Paul ce désir si vif de « contempler face à face » (1Cor.13.12)r, et qui pressait les mystiques de se retirer le plus possible du présent siècle, pour pouvoir s'élever librement à la connaissance de la vérité. (Thauler « Que nous nous dépouillions et nous nous détournions de toutes les images » ; Fénelon tient le même langage). En faisant de cet isolement la condition indispensable du progrès spirituel, ils ne pouvait qu'égarer les hommes. Car, séparer dans la pensée la forme de son essence, envisager comme un clair symbole telle ou telle image, cela ne dépend pas du plus ou moins de progrès dans la connaissance spirituelle, mais de causes qui peuvent être indépendantes du développement religieux. Celui qui ne possède la vérité que sous l'enveloppe d'un symbole, peut la saisir bien plus fortement, en subir l'influence d'une manière bien plus profonde que tel autre, proclamé très supérieur par les mystiques. Il est vrai cependant, que ceux qui doivent dispenser la vérité aux autres, les conduire aux sources de la vie spirituelle, doivent s'efforcer de devenir maîtres du langage, et de distinguer la forme, l'enveloppe de ce qui est contenu, comme aussi d'être experts dans leurs rapports.
On a dit que le grain semé se débarrasse après un certain temps de son enveloppe. Celle-ci alors se détruit, tandis que le germe pousse et fructifie. De même la Parole de Dieu, déposée dans un cœur d'homme, se dégage de son enveloppe littérale, et produit ses effets sanctifiants. Mais l'image n'est pas très exacte ; elle pourrait facilement conduire au mépris de la parole écrite, sous prétexte qu'on possède la vie spirituelle. L'enveloppe extérieure ne doit pas périr, mais être glorifiée, étant pénétrée entièrement par l'esprit. L'homme est composé d'un corps et d'une âme ; la vérité a besoin également pour lui d'un corps et d'une âme ; mais il doit savoir les distinguer, sans mépriser le corps. C'est ainsi que la sagesse divine a pourvu à ce qui nous concerne ; tous nos efforts pour nous passer d'images sensibles seraient vains. Nous ne pourrions que changer d'images, abandonner les réalités vivantes dont notre cœur a besoin, pour nous plonger dans de métaphysiques abstractions. Le docteur qui voudra donc atteindre l'intelligence et le cœur de ses disciples, ne rejettera pas de ses discours l'élément parabolique ; il en fera au contraire l'usage le plus fréquent possible. Cela exige de nombreux efforts ; car, si tout langage est figuré, cependant un long usage peut facilement lui enlever son trait, ce qui le rendrait propre à éveiller l'attention et à produire une impression profonde, en sorte qu'il faut rechercher de nouvelles formes, comme le faisait celui qui employait habituellement les paraboles ; Il ne présenta aucune doctrine d'une manière abstraite, mais Il les rendait toutes vivantes. Il fit ce qu'il commandait à ses apôtres de faire aussi, pour être des docteurs bien instruits pour le royaume, et capables d'en instruire d'autres (Mat.13.52) ; Il tirait de son trésor des choses vieilles et des choses nouvelles ; au moyen des vieilles, Il faisait comprendre les nouvelles ; Il proclamait l'extraordinaire en se servant des choses familières ; Il aimait à s'élever du connu à l'inconnu. Par sa méthode, Il nous a confié le secret de l'enseignement vraiment utile, propre à remuer les cœurs et les esprits. Il y a un grand charme dans cette manière d'enseigner, qui s'adresse non seulement à l'intelligence, mais aussi au sentiment, à l'imagination, poussant l'homme à l'action ; les choses apprises ainsi restent gravées dans la mémoires.
Si notre Seigneur avait présenté la vérité sans aucune image, plusieurs de ses enseignements auraient été perdus pour ses auditeurs ; ils n'auraient laissé aucune tracet. Mais, leur étant présentés sous une image frappante, ou sous la forme de quelque maxime paradoxale, ils éveillaient l'attention, excitaient l'interrogation, et si la vérité n'était pas toujours immédiatement comprise, les paroles restaient cependant gravées dans la mémoire. (Saint Bernard dit : « Ne faut-il pas tenir voilé ce que tu ne comprends pas dans sa nudité ? ») Les paroles du Sauveur, conservées dans le souvenir des siens, furent pour eux comme une monnaie étrangère qui ne peut être employée que plus tard et dans le pays où elle peut être échangée, mais qui cependant garde toute sa valeur. Lorsque le saint Esprit descendit sur les apôtres, il leur remit en mémoire ce qu'ils avaient vu et entendu, il donna un corps aux enseignements du Maître et les vivifia. Ils ne comprirent pas tout à coup, mais graduellement, à mesure qu'ils croissaient dans la vie spirituelle. Il en est ainsi de toute vraie connaissance, qui ouvre des sources vives dans le cœur, répand des semences de vérité, qui germeront dans ce nouveau sol, et deviendront un grand arbre.
En dehors des paraboles prononcées, il y a eu la parabole en action ; car tout type est une véritable parabole. La constitution lévitique, avec son temple, ses prêtres et ses sacrifices, est appelée de ce nom dans Hébreux.9.9. Le voyage des enfants d'Israël est un type de la vie du chrétien. Dans l'Ancien Testament, on rencontre des personnages qui ne se doutaient point que, dans certains actes de leur vie, ils représentaient un personnage bien plus grand qu'eux et des événements d'une portée infiniment supérieure. Ex. : Abraham chassant Agar et Ismaël (Ga.4.30), David à l'heure du péril et de la détresse (Psa.22), Jonas dans le ventre de la baleine. Dieu a voulu que ses serviteurs enseignassent, quelquefois par une parabole en action, plutôt que d'une autre manière, afin de produire une impression plus profonde. Ainsi, Jérémie brise un vase de potier, pour annoncer la destruction complète de son peuple (Jér.19.1-11) ; il porte un joug, pour représenter l'esclavage prochain d'Israël (Jér.27.2 ; 28.10) ; on pourrait multiplier ces exemples. Dieu enseigne continuellement ses serviteurs par ces mêmes signes. Les grandes vérités du royaume de Dieu passent quelquefois sous les yeux des prophètes en symboles plutôt qu'en paroles. De là leur nom de voyants. Dans le Nouveau Testament, nous en avons des exemples : la vision de Pierre (Act.10.9,16), et toutes les visions de l'Apocalypse. Il en fut ainsi de la manifestation de Dieu en chair, qui rendait l'invisible visible, en montrant la vie divine.
Quant aux paraboles de Jésus-Christ, il y aurait une intéressante étude à faire en caractérisant chacun de nos Évangiles selon les paraboles particulières qu'il contient, et en indiquant, lorsque les mêmes paraboles sont rapportées par plusieurs évangélistes, les traits spéciaux de chaque récit. En essayant une comparaison entre les synoptiques, on dira que les paraboles de Matthieu sont plus théocratiques et celles de Luc plus éthiques, que celles du premier sont plus de jugement et celle du second plus de miséricorde. En conséquence, les premières sont plus majestueuses et les secondes plus touchantes. Matthieu introduit souvent ses paraboles pour expliquer les mystères du royaume de Dieu. C'est un langage inconnu à Luc. Dans les paraboles de Matthieu, Dieu apparaît comme le Roi qui, assis sur le trône, a le mal en horreur, et se tient prêt à punir toute désobéissance des hommes ; plusieurs d'entre elles se terminent par des actes de jugement plus ou moins sévères (Matt.13.42,49 ; 18.34 ; 20.14 ; 21.41 ; 22.7,13 ; 25.12,30). De tels actes de jugement se retrouvent aussi dans les paraboles de Luc, mais moins souvent ; ce dernier proclame surtout la grâce. Telles sont les paraboles de l'arbre épargné par le cultivateur, du Samaritain qui verse l'huile et le vin sur les plaies du voyageur, du père qui tend ses bras à son fils repentant. Même celle de Lazare et du mauvais riche offre aussi un point de vue miséricordieux. On peut donc affirmer qu'à cet égard surtout, les traits caractéristiques des deux évangélistes apparaissent dans toute leur force. Les différences que présentent dans les synoptiques les paraboles du même genre le prouvent encore. Comparez le mariage du fils du roi (Mat.22) et le grand souper (Lu.14). Il y a des rapports entre eux et aussi de notables différences. Comme rien n'est plus ductile que l'or fin, ainsi en était-il de l'enseignement du Christ. Il se prêtait à être diversement moulé et façonné selon les personnes et les besoins des temps. Les évangélistes ont donc diversement reproduit ce qui correspondait le mieux à leurs dispositions d'esprit et au but qu'ils se proposaient. Exemple : dans Matthieu nous avons un roi pour personnage principal, puis un prince royal dont on célèbre les noces. Tout y porte une empreinte monarchique et procède de l'Ancien Testament. Ensuite il y a une double condamnation : celle des ennemis et celle des faux amis. Dans Luc, c'est tout simplement un riche qui donne un festin. Les deux actes de jugement sont sur l'arrière-plan, tandis que la grâce et la compassion de celui qui célèbre la fête sont les motifs qui le pressent d'envoyer à diverses reprises des messagers pour rassembler autour de sa table les plus pauvres et les plus misérables du pays.
Ce sont là quelques directions destinées à encourager les lecteurs de l'Écriture à étudier les paraboles et à tirer un nouveau parti de leur contenuu.
Belles dans leur forme, les paraboles le sont encore plus dans le fond. « Pommes d'or dans des paniers d'argent », elles brillent à la fois par le contenant et le contenuv. En recueillir tout le fruit sans en rien perdre est donc de la plus haute importance. Mais, tout d'abord on se demande : que faut-il envisager dans les paraboles comme ayant une signification utile ? Sur ce point, les opinions les plus diverses se sont produites. Quelques interprètes y cherchent uniquement un rapport général entre le signe et la chose signifiée. D'autres veulent trouver une application aux détails les plus minutieux. D'autres enfin prennent une position intermédiaire. On a prétendu que tel détail n'était qu'un ornement et non l'enveloppe d'une vérité, que tel autre ne servait qu'à donner de la vie, ou un air de vraisemblance au récit, en en reliant les diverses parties. On les a comparées à une harpe, qui ne consiste pas seulement dans un assemblage de cordes ; aux plumes, qui implantées dans la flèche, semblent lui être inutiles et lui sont toutefois indispensables pour atteindre le but. « C'est avec le soc de la charrue, dit saint Augustin, que le sillon est tracé, mais, à cet effet, il faut que les autres parties de l'instrument concourent. Les cordes de la lyre rendent des sons, mais pour cela il faut qu'elles soient montées sur le bois. »
Chrysostome met en garde ses lecteurs contre le danger de trop presser les détails d'une parabole. C'est pourquoi il termine quelquefois l'interprétation qu'il en donne par ces mots : « Ne soyez pas curieux de connaître le reste. » Théophylacte et plusieurs autres interprètes demeurent fidèles au principe qui vient d'être posé. Pareillement Origène, qui exprime ainsi son opinion : « On sait que les ressemblances données par les portraits et les statues ne sont jamais parfaites. L'image peinte sur une surface plane représente bien l'extérieur et le teint d'une personne ou d'un objet, mais n'en donne pas le moule. De son côté, la statue indique les proéminences et les cavités, elle moule mais ne donne pas le coloris ; de même les paraboles, quand elles comparent le royaume des cieux à un objet quelconque, ne font pas porter la comparaison sur toutes les parties de l'image, mais seulement sur certains points que le sujet indiquew. » Tillotson, parmi les modernes, a dit avec raison que les paraboles et leur application ne sont pas deux plans qui se rencontrent sur tous les points, mais plutôt une surface plane et un globe qui, mis en contact, ne se touchent que sur un point.
Saint Augustin, d'autre part, qui adopte souvent le même principe, étend néanmoins l'interprétation des paraboles jusqu'à leurs moindres détailsx. Origène aussi, malgré ce qu'il a dit plus haut, tombe dans le même défaut. Dans les temps postérieurs, Cocceius et ses disciples ont voulu prouver que toutes les parties d'une parabole avaient un sens spécialy. Edouard Irving décrit dans un de ses ouvrages le soin laborieux qu'il a pris de se rendre maître du sens littéral de chaque mot dans les paraboles, afin d'en épuiser toutes les richesses de vérité qu'il contient ; il ajoute : « J'ai été comme un voyageur qui, après avoir franchi les colonnes d'Hercule, entrerait à pleines voiles dans la Méditerranée. Il a vogué entre des rochers hérissés d'écueils, dans des courants impétueux qui exigeaient beaucoup de prudence et d'habileté dans la manœuvre, maintenant l'accès lui est ouvert dans un océan entouré des plus riches et des plus fertiles contrées, où apparaissent des colonies populeuses et des cités splendides. Aussi, le plaisir dont il jouit en face d'un tel spectacle est-il inexprimable et lui fait-il oublier toutes les peines passées. » Ce même auteur proteste, avec d'autres commentateurs, contre la tendance à dépouiller les Écritures de leur sens profond et à répéter : ceci ne sert à rien, cela ne doit pas être pressé, etc., tendance qui empêche de retirer des paraboles les trésors qu'elles contiennent ou de reconnaître cette admirable sagesse avec laquelle les réalités correspondent aux images. Cette classe d'interprètes a observé que, parmi les commentateurs affirmant qu'il faut négliger les détails, il s'en trouve à peine deux qui soient d'accord entre eux ; ce que l'un rejette, l'autre le conserve. « Bien plus, disent-ils, il est évident que plus on pousse loin cette prétention, plus les beautés de la parabole disparaissent. » Par exemple, lorsque Calvin n'admet pas que l'huile des vierges (Mat.25) ait une signification particulière, ni même les vases, ni les lampesz, ou que Storr (qui, pour le dire en passant, ne veut laisser aux paraboles qu'un tronc dépouillé de branchages et de verdure) refuse d'admettre que l'enfant prodigue puisse représenter l'homme qui s'éloigne de son Dieu, l'un et l'autre nous privent à la fois de rapports intéressants et d'analogies instructives. Pour justifier leurs assertions, ils s'appuient sur le fait que notre Seigneur, en interprétant les deux paraboles du semeur et de l'ivraie, nous a donné la règle de l'interprétation de toutes ses paraboles. Or, l'application y descend jusques aux détails minutieux du récit. Les oiseaux qui enlèvent la semence représentent Satan qui ravit du cœur la parole (Mat.13.19), les épines correspondent aux soucis et aux convoitises (Mat.13.22), etc.
En réfléchissant à cette controverse, on s'aperçoit bientôt que des deux parts il y a exagération. Les avocats de l'interprétation sommaire s'attachent trop à leur adage favori : omne simile claudicat (toute comparaison est boiteuse). Leur assertion que si la correspondance entre la parabole et son objet était parfaite, il n'y aurait plus comparaison, mais identité, est sans valeur : deux lignes n'en forment pas une seule, lors même qu'elles se prolongent parallèlement. Dans le système opposé, on court le risque d'introduire dans l'explication des Écritures des jeux d'esprit, des recherches subtiles, plus ingénieuses que solides, qui fassent oublier qu'en définitive la sanctification du cœur par la vérité est le but des écrivains sacrés. A cela on ajoute que presque tous les sectaires pressent le sens des paraboles pour leur faire dire ce qui leur plaît.
Peut-on donner ici une règle absolue ? Cela est difficile. Il faut laisser une certaine latitude au bon sens de l'interprète et à son respect pour la Parole de Dieu. Ils l'empêcheront de se livrer à des recherches curieuses et feront trouver la vraie application spirituelle. La règle qui nous paraît la plus juste a été posée par Tholuck, en ces termes : « Il faut reconnaître que plus une parabole est riche en applications, plus elle est parfaite. Le commentateur doit donc partir de l'hypothèse que chaque point est important. Il ne cessera de s'efforcer d'en faire sortir des enseignements que lorsqu'il ne pourra plus en obtenir qu'en forçant le sens naturel et évident, ou lorsqu'il s'apercevra que tel ou tel détail a été ajouté pour donner du relief au récit et le coordonner. Nous ne devons jamais présumer qu'un trait soit indifférent, à moins qu'en lui accordant de l'importance on ne dérange l'harmonie ou l'unité de la parabole. » Une statue approche le plus de la perfection dans la mesure où l'idée du sculpteur ressort de la disposition et du fini de chaque membre. De même, plus la parabole laisse voir dans toutes ses parties la vérité divine qu'elle recouvre, plus elle ressemble aux vêtements du Christ glorifié, plus aussi elle est belle et profonde, et il faut prendre garde de la dénaturer. « J'aime, dit Vitringa, les auteurs qui retirent des paraboles évangéliques plus que quelques préceptes moraux illustrés. Non que je m'enhardisse à soutenir que, s'il a plu au Seigneur d'employer ce mode d'instruction morale, cela ne s'accorde avec sa parfaite sagesse. Je prétends seulement qu'il me paraît en harmonie avec cette même sagesse d'expliquer ses paraboles de telle sorte que chaque partie reçoive, sans en torturer le sens, une application facile pour l'édification de l'Église. Plus nous extrairons de la divine Parole de solides vérités, lorsque rien dans le texte ne s'y oppose, et plus aussi nous glorifierons la parfaite sagesse. »
Profitant de toutes ces remarques, on posera comme première condition d'une saine interprétation des paraboles, celle d'en saisir fortement la vérité centrale avant d'entreprendre l'explication des détails. Il faudra même savoir la distinguer des vérités sœurs ou secondaires. « On peut comparer la parabole, écrit un auteur modernea, à un cercle dont le centre est une vérité d'ordre spirituel et les rayons sont les circonstances du récit. Aussi longtemps qu'on ne se place pas au centre, on ne peut embrasser le cercle dans toute son étendue, ni la belle unité qui relie tous les rayons convergeant vers un seul but. C'est ainsi qu'après avoir reconnu avec certitude, dans une parabole, l'enseignement spécial qu'elle donne, la vraie signification de tous les détails et leur degré d'importance se manifesteront. Alors nous n'insisterons sur ces points secondaires que dans la mesure où ils font ressortir la vérité centrale. »
Deuxième condition. Expliquer les paraboles en tenant compte du contexte. Comme dans l'interprétation de la fable, l'introduction (προμύθιον) et l'application (ἐπιμύθιον) doivent être étudiées avec soin ; ici ce qu'on a appelé pro-parabola et épi-parabola fournit le plus souvent la clef de l'intelligence du sujet. Combien d'explications de la parabole des ouvriers et de la vigne n'auraient jamais été proposées si on l'avait interprétée dans son harmonie avec ce qui précède et ce qui suit. Ce secours, qui manque rarement à l'interprète, n'est pas toujours donné d'une manière identique et formelle. Tantôt c'est le Seigneur lui-même qui le fournit (Mat.22.14 ; 25.13), tantôt c'est l'évangéliste (Luc.15.1-2 ; 18.1), par quelques mots, avant ou après le récit. Quelquefois cette clé donnée avant et après, comme dans la parabole du débiteur insolvable (Mat.18.23. Voyez Mat.20.1-15, et Luc.12.16-20).