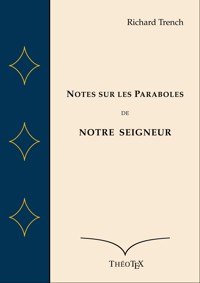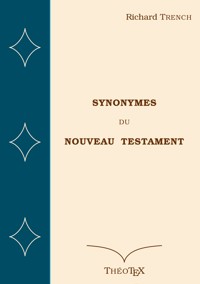
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Cet ouvrage du philologue, exégète, poète et archevêque de Dublin, Richard Chenevix Trench (1807-1886), a connu 5 éditions successives du vivant de l'auteur, et reste aujourd'hui encore un grand classique pour les étudiants du Nouveau Testament. Son principe consiste dans un choix de paires ou de groupes de mots grecs dont les sens sont voisins, et dans l'explication de leurs ressemblances et de leurs différences. Le pasteur Clément de Faye (1824-1902), avait dès 1869 fait paraître une traduction de la deuxième édition, qui comportait alors 91 synonymes détaillés. La présente numérisation ThéoTeX porte à 105 ce nombre, traduits d'après la dernière édition anglaise. Il va de soi que la lecture des Synonymes nécessite un minimum de connaissance de la koiné, la langue grecque commune dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament. Ceux qui s'y intéressent goûteront ici le plaisir de constater combien la diversité de son vocabulaire éclaire souvent et significativement le texte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Préface du traducteur
Introduction
I. Hellénistes
II. Idiome Hellénistique
᾿Εκκλησία, συναγωγή, πανήγυρις Église, synagogue, assemblée
Θειότης, Θεότης Divine nature, Divine personne
῾Ιερόν, ναός Temple, sanctuaire
᾿Επιτιμάω, ἐλέγχω (αἰτία, ἔλεγχος) Reprendre, convaincre (accusation, conviction)
᾿Ανάθημα, ἀνάθεμα Consacré à Dieu, dévoué par interdit
Προφητεύω, μαντεύομαι Prophétiser, deviner
Τιμωρία, κόλασις Vengeance, châtiment
᾿Αληθής, ἀληθινός Véridique, véritable
Θεράπων, δοῦλος, διάκονος, ὑπηρέτης Serviteurs
Δειλία, ϕόβος, εὐλάβεια Couardise, peur, crainte
Κακία, πονηρία, κακοήθεια Malice, malignité, méchanceté
᾿Αγαπάω, ϕιλέω Aimer
Θάλασσα, πέλαγος Mer, étendue océanique
Σκληρός, αὐστηρός Dur (rugueux), austère (âpre)
Εἰκών, ὁμοίωσις, ὁμοίωμα Image, ressemblance, similitude
᾿Ασωτία, ἀσέλγεια Dissolution, impudicité
Θιγγάνω, ἅπτομαι, ψηλαφάω Toucher, manier, palper
Παλιγγενεσία, ἀνακαίνωσις Régénération, rénovation
Αἰσχύνη, αἰδώς Honte de la disgrâce, honte intérieure
Αἰδώς, σωφροσύνη Pudeur, retenue
Σύρω, ἕλκύω Tirer, attirer
῾Ολόκληρος, τέλειος Complet, parfait
Στέφανος, διάδημα Couronne de vainqueur, couronne royale
Πλεονεξία, ϕιλαργυρία Cupidité, avarice
Βόσκω, ποιμαίνω Nourrir, paître
Ζῆλος, ϕθόνος Zèle, envie
Ζωή, ϐίος Vie intensive, vie extensive
Κύριος, δεσπότης Seigneur, maître
᾿Αλαζών, ὑπερήφανος, ὑβριστής Vantard, arrogant, hautain
᾿Αντίχριστος, ψευδόχριστος Antichrist, faux christ
Μολύνω, μιαίνω Souiller, maculer
Παιδεία, νουθεσία Correction, admonition
῎Αφεσις, πάρεσις Pardon, rémission
Μωρολογία, αἰσχρολογία, εὐτραπελία Folie, turpitude, subtilité
Λατρεύω, λειτουργέω Servir, remplir une charge
Πένης πτωχός Pauvre, nécessiteux
Θυμός, ὀργή, παροργισμός Emportement, colère, exaspération
῎Ελαιον, μύρον (χρίω, ἀλείφω) Huile, parfum (oindre, parfumer)
῾Εβραῖος, ᾿Ιουδαῖος, ᾿Ισραηλίτης Hébreu, Juif, Israélite
Αἰτέω, ἐρωτάω Demander, interroger
᾿Ανάπαυσις, ἄνεσις Repos, détente
Ταπεινοφροσύνη, πραότης Humilité, douceur
Πραότης, ἐπιείκεια Mansuétude, clémence
Κλέπτης, λῃστής Voleur, brigand
Πλύνω, νίπτω, λούω Nettoyer, laver, baigner
Φῶς, ϕέγγος, ϕωστήρ, λύχνος, λαμπάς Lumière, lampe
Χάρις, ἔλεος Grâce, miséricorde
Θεοσεβής, εὐσεβής, εὐλαβής, ϑρῆσκος, δεισιδαίμων Piété
Κλῆμα, κλάδος Sarment, rameau
῾Ιμάτιον, χιτών, ἱματισμός, χλαμύς, στολή, ποδήρης, Vêtements
Εὐχή, προσευχή, δέησις, ἔντευξις, εὐχαριστία, αἴτημα, ἱκετηρία Prières
᾿Ασύνθετος, ἄσπονδος Déloyal, intraitable
Μακροθυμία, ὑπομονή, ἀνοχή Longanimité, patience, indulgence
Στρηνιάω, τρυφάω, σπαταλάω S’engraisser, s’amollir, dilapider
Θλῖψις, στενοχωρία Tribulation, angoisse
῾Απλοῦς, ἀκέραιος, ἄκακος, ἄδολος Simple, intègre, innocent, sincère
Χρόνος, καιρός Temps, occasion
Φέρω, ϕορέω Transporter, porter
Κόσμος, αἰών Monde, âge
Νέος, καινός Nouveau, neuf
μέθη, πότος, οἰνοφλυγία, κῶμος, κραιπάλη Beuveries
Καπηλεύω, δολόω Frelater, adultérer
᾿Αγαθωσύνη, χρηστότης Bonté, douceur
Δίκτυον, ἀμφίβληστρον, σαγήνη Filet, épervier, chalon
Λυπέομαι, πενθέω, ϑρηνέω, κόπτω Etre attristé, affligé, se lamenter, se frapper la poitrine
῾Αμαρτία, ἁμάρτημα, παρακοή, ἀνομία, παρανομία, παράβασις, παράπτωμα, ἀγνόημα, ἥττημαζ, πλημμέλεια Péchés
᾿Αρχαῖος, παλαιός Ancien, usé
Βωμός, ϑυσιαστήριον Autel
Μετανοέω, μεταμέλομαι Se repentir
Μορφή, σχῆμα, ἰδέα Forme, façon, apparence
Ψυχικός, σαρκικός Psychique, charnel
Σαρκικός, σάρκινος Charnel, de chair
Πνοή, πνεῦμα, ἄνεμος Souffle, vent
Δοκιμάζω, πειράζω Éprouver, tenter
Σοφία, ϕρόνησις, γνῶσις, ἐπίγνωσις Sagesse, intelligence, connaissance
Λαλέω, λέγω (λαλιά, λόγος) Parler, dire
᾿Απολύτρωσις, καταλλαγή, ἱλασμός Rédemption, réconciliation, propitiation
Ψαλμός, ὕμνος, ᾠδή Psaume, hymne, ode
᾿Αγράμματος, ἰδιώτης Illettré, idiot
Δοκέω, ϕαίνομαι Considérer, paraître
Ζῶον, ϑηρίον Être vivant, bête
῾Υπέρ, ἀντί Pour, en faveur de
Φονεύς, ἀνθρωποκτόνος, σικάριος Meurtrier, homicide, assassin
Κακός, πονηρός, ϕαῦλος Mauvais, méchant, sans valeur
Εἰλικρινής, καθαρός Sincérité, pureté
Πόλεμος, μάχη Guerre, bataille
Πάθος, ἐπιθυμία, ὁρμή, ὄρεξις Passion, convoitise, ardeur
῾Ιερός, ὅσιος, ἅγιος, ἁγνός Sacré, saint, pur
Φωνή, λόγος Voix, parole
Λόγος, μῦθος Parole, récit
Τέρας, σημεῖον, δύναμις, ἔνδοξον, παράδοξον, ϑαυμάσιον Prodiges, signes, puissances, miracles
Κόσμιος, σεμνός, ἱεροπρεπής Modeste, grave
Αὐθάδης, ϕίλαυτος Jouisseur, égoïste
᾿Αποκάλυψις, ἐπιφάνεια, ϕανέρωσις Révélation, dévoilement
῎Αλλος, ἕτερος Autre, différent
Ποιέω, πράσσω Faire, pratiquer
Λαός, ἕθνος, δῆμος, ὄχλος Peuple, multitude
Βαπτισμός, ϐάπτισμα Baptême
Σκότος, γνόφος, όφος, ἀχλύς Obscurité
Βέβηλος, κοινός Profane, commun
Μόχθος, πόνος, κόπος Travail, peine, fatigue
῎Αμωμος, ἄμεμπτος, ἀνέγκλητος, ἀνεπίληπτος Irrépréhensible
Βραδύς, νωθρός, ἀργός Lent, tardif, oisif
Δημιουργός, τεχνίτης Constructeur, artisan
᾿Αστεῖος, ὡραῖος, καλός Beau
PRÉFACE DU TRADUCTEUR
A mon sens, ce qui fait tout particulièrement défaut à la prédication protestante en langue française, c’est la connaissance approfondie des Écritures et l’habitude de les sonder dans les langues originales.
FRÉDÉRIC DE ROUGEMONT
Le docteur Trench est un des philologues les plus distingués de la Grande-Bretagne. Sans parler de tous ses ouvrages d’exégèse, celui dont nous avons entrepris la traduction occupe, depuis une douzaine d’années, le premier rang parmi les livres classiques des Facultés de théologie de langue anglaise. L’original, dans la seconde édition, forme un volume in-8o, de 340 pages.
Un tel ouvrage nous manque complètement en français. Celui de A. PILLON, qui a sa juste valeur, ne s’occupe que de la synonymie grecque en général 1. Entre autres ressources, les Allemands possèdent : De synonymis in Novo Testamento,publié à Leipzig, en 1829, par J. A. H. TITTMANN 2 ; l’opuscule de G. Zezschwitz, Profan-Græcitæt und biblischer Sprachgeist (Gotha, 1859) ; les Christliche Klænge aus rœmischen Classikern, par B. SCHNEIDER (1865), et surtout le bel ouvrage de CREMER, Biblisch-theologisches Wœrterbuch der N. Test. Græcitæt (Gotha, 1866). Mais où puiseront-ils, ces hommes de conscience qui n’ont pas le bonheur de lire l’allemand ou l’anglais, quand ils voudront se rendre un compte exact de la valeur des mots sur lesquels, dans un sens, repose leur foi ?. . . Et si l’illustre ÉRASME n’est pas allé trop loin en posant cet axiome : « Nihil enim inter homines mala lingua nocentius, nihil eadem salubrius, si quis, ut oportet, utatur » (Lingua. Lugd. Bat., 1649, p. 16), dépassons-nous la limite de la vérité en affirmant que l’étude fondamentale, pour un interprète des saintes Écritures, c’est l’étude intelligente et consciencieuse des mots 3 ? Quand un pasteur étend solennellement les mains sur une assemblée et la congédie apostoliquement en ces mots : « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. . ., etc. », est-ce qu’il ne lui importe pas de connaître au juste la signification du terme χάρις, afin de savoir si le fidèle emporte un simple salve païen, ou cette grâce quæ tollit culpam, comme disait BENGEL ? la grâce dont Aristote veut orner le discours, ou cette libre manifestation de l’amour divin dont la χάρις d’après saint Paul, est le centre ?
Autre exemple. Quand « l’homme de Dieu » explique la voie du salut à une âme dont le Maître lui a confié l’instruction, est-ce qu’il lui est indiffèrent de savoir si ἀπολύτρωσις ; n’implique rien de plus (comme le pensait Théophylacte) que ἡ ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ἐπανάκλησις, la simple cessation de la captivité, ou s’il faut ajouter à cette notion celle d’une rançon, d’un λύτρον (Rom.3.24 ; 1Pier.1.18-19)
Ajoutons que plus d’une question dogmatique serait promptement résolue, si l’on remontait au vrai sens du mot. Ainsi, on n’aime pas la doctrine de « la colère de Dieu », même séparée de toute idée de passion humaine. Que καταλλαγή décide. Ce vocable exprime d’abord une réconciliation « qua Deus nos sibi reconciliavit », par laquelle Dieu déposa sa sainte colère et nous rendit sa faveur, réconciliation que Jésus-Christ accomplit pour nous une fois pour toutes sur la croix (2Cor.5.18 ; Rom.5.10). Puis καταλλαγή, dans un sens subordonné, signifie encore la réconciliation « qua nos Deo reconciliamur, » l’abandon journalier, sous l’action du Saint-Esprit, de l’inimitié du vieil homme envers Dieu (2Cor.5.20 ; cf. 1Cor.7.11. Voy. Synonymes).
Enfin, que la prédication serait plus instructive, plus variée et partant plus édifiante, si le prédicateur était plus familier avec le sens intime des magnifiques termes qu’il emploie ! Oui, étudiez à fond les deux vocables ἐπιτιμάω et ἐλέχω, reprendre et convaincre, et voyez ce qu’il sortira d’une telle étude ! Pierre reprend son Maître, sans pouvoir produire la moindre contrition en Celui qui était saint (Matt.16.22 ; cf. Jean.8.46), mais le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement (Jean.16.8 ; voyez encore Jean.3.20 ; 8.9 ; 1Cor.14.24).
Saisir le sens de λούω et de νίπτω, c’est saisir du même coup le sens du passage, très peu clair dans notre traduction, Jean.13.10 : « Celui qui est lavé (ὁ λελουμένος) n’a besoin sinon qu’on lui lave les pieds (πόδας νίψασθαι). » Faute de déterminer la différence qui existe entre ἀγαπάω et ϕιλέω, entre ϐόσκω et ποιμαίνω, qui alternent dans le dialogue si touchant de Jésus avec l’apôtre Pierre (Jean.21.15-17), ce dialogue perd singulièrement de son originalité et de sa force.
L’interprète gagnerait également à bien connaître la valeur de ἐπιχορηγήσατε dans 2Pi.1.5, qu’aucune traduction ne peut rendre et n’oserait peut-être rendre, vu l’idée païenne que renferme dans son origine χορηγέω (fournir le chœur de ce qui est nécessaire aux danses sacrées), mais dont saint Paul a fait la propriété de Jésus-Christ pourvoyant aux besoins de son Église (Col.2.19) et fournissant de la semence au semeur : ῾Ο δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς ϐρῶσιν χορηγήσαι, καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν (2 Cor.9.10).
Produisez une objection sérieuse contre l’importance de l’étude des synonymes du Nouveau Testament. Au point de vue même de la grammaire, vous ne le pouvez. En effet, l’helléniste étudie les dialectes des divers peuples de la Grèce, convaincu qu’il est que ces dialectes ne sont pas plus des patois que la langue des Ibères, dont le basque forme un glorieux débris, n’en est un.
L’helléniste sait parfaitement que ces dialectes sont des langues avec leur syntaxe spéciale, leur littérature particulière, parce qu’il sait parfaitement que le temps et les vicissitudes sociales ont dû réagir sur le sens d’une foule de mots. Eh bien, l’entrée du christianisme dans le monde, le lever de ce soleil de la vérité sur les ombres du judaïsme et sur les ténèbres du paganisme, aurait-il produit un effet moins réel, moins senti que l’invasion, par exemple, du dialecte dorien dans la Sicile, ou du dialecte éolien dans la Béotie et dans l’île de Lesbos ?. . . Quoi ! pour saisir toutes les beautés poétiques de Théocrite ou de Pindare, il ne suffira pas de comprendre la belle langue de l’Attique, celle des Thucydide, des Démosthène, des Platon et des Eschyle, ou la langue épique de l’Ionie, celle d’Homère et d’Hésiode ; il faudra, en outre, se mettre au courant du dialecte dorien et savoir, entre autres choses, que les Doriens mettent Δ pour Ζ et écrivent Δεύς pour Ζεύς ? ; qu’ils préfèrent A à E, et disent γά et non γέ ; quoi ! il ne sera pas permis d’ignorer que les Éoliens mettaient ὕψοις pour ὑψοῦν et γέλαις pour γελᾷν, quelque rare que soit cette forme ; quoi ! il ne faudra pas confondre les Attiques avec les Atticistes, leurs imitateurs, ou Xénophon avec Lucien, — et l’on serait moins scrupuleux quand il s’agit de connaître à fond la langue de l’Évangile ?. . .
La connaissance du grec classique, direz-vous peut-être, suffit pour l’étude du Nouveau Testament. — L’introduction sur l’Héllénisme du professeur Reuss, que nous avons mise à l’entrée de cet ouvrage, est destinée à vous prouver le contraire, ainsi que les 92 articles du docteur Trench qui forment ce volume 4. Non, la synonymie classique ne déroulera jamais, prenons ce cas, tout le sens de πλήρωμα. Elle me dira bien que πληροῦν signifie mettre au complet, par exemple, l’équipage ou le chargement d’un vaisseau ou d’un corps de troupe 5, mais je n’en suis guère plus avancé pour expliquer Jean.1.16 : Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάϱιν ἀντὶ χάριτος ; encore moins Ephés.3.19 : ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ ϑεοῦ, où le vocable signifie l’abondance des bénédictions renfermées dans un être. Voy. aussi Rom.11.25. « Ainsi », écrit le commentateur Hodge, à propos de l’Église, τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου (Ephés.1.23), « ainsi on peut admettre que l’Église est appelée la plénitude de Christ dans ce sens que Christ est la tête et l’Église le reste du corps, le complément qui achève ce corps mystique 6 ». Jamais non plus un dictionnaire du grec classique ne donnera tous les sens de πνεῦμα, et même on peut ajouter à l’article 73 de nos Synonymes du Nouveau Testament, cette note que M. FRÉD. DE ROUGEMONT a bien voulu nous communiquer : « Πνεῦμα signifie 1o l’esprit chez l’homme psychique avant sa régénération, apte à recevoir l’Esprit saint et prompt à vouloir le bien (Matt.26.41) ; c’est le νοῦς de Rom.7.23 ; 2o l’esprit chez l’homme spirituel, rempli de l’Esprit saint ; 3o l’Esprit en Dieu, 1Cor.2.14, et l’Esprit de Dieu ».
A ces considérations philologiques, ajoutons celles de l’ordre moral, et que le pieux archevêque de Dublin prenne ici la parole. Se replaçant devant ses anciens élèves du King’s Collège à Londres, qu’il initiait à la synonymie de nos Livres saints, il ne craint point de déclarer, qu’à part ces leçons du cœur que Dieu seul peut donner, il est peu de chose qu’un professeur doive s’efforcer de produire chez le jeune homme au même degré que l’enthousiasme pour la grammaire et le lexique ! « Nous aurons réellement, dit-il, fait beaucoup pour ceux qui viennent nous demander la science théologique et, en général, des directions qui serviront à leur développement intellectuel, si nous parvenons à leur persuader d’avoir sans cesse ces deux livres dans leurs mains ; si nous pouvons leur faire croire qu’ils tireront de ces trésors plus de science et des connaissances plus solides que de l’étude d’un ouvrage quelconque de théologie qu’ils liront trop tôt et qu’ils digéreront mal ». Il ajoute judicieusement : « Les vocables du Nouveau Testament sont les στοιχεῖα de la théologie chrétienne ; aussi l’élève qui ne commence point par une étude patiente de ces vocables, ne fera jamais de grands progrès, surtout de progrès durables, car ici, comme partout, des déceptions certaines attendent celui qui s’imagine posséder le tout sans en avoir d’abord conquis les parties. Aussi ces deux vers du moyen-âge renferment-ils une vérité profonde :
Qui nescit partes in vanum tendit ad artes ; Artes per partes, non partes disce per artes.
Or, il est de l’essence de l’étude des synonymes de nous forcer à étudier avec attention la valeur des mots, leur valeur précise, relative, absolue, et c’est dans cette recherche que consiste tout le mérite de notre étude comme discipline de l’esprit ». (Préface.)
Nous désirons donc rendre service à ceux qui s’occupent sérieusement de l’étude de nos saints Livres, dans nos pays de langue française, en leur offrant la traduction complète de l’estimable travail du docteur Trench 7. Pour n’obliger personne à s’en remettre uniquement à notre jugement sur son ouvrage, nous allons transcrire l’opinion d’hommes qui en ont pris connaissance dans l’original. Avec leur bienveillante permission, voici quelques extraits de leur correspondance.
Le zélé secrétaire de la Société nationale pour la traduction des saintes Écritures, M. E. PÉTAVEL, nous écrivait, sous la date du 26 août 1866 : « Il est temps que je vous félicite du choix excellent que vous avez fait. Rien de plus intéressant et de plus solide que les travaux lexicographiques de l’archevêque de Dublin, spécialement ses Synonymes du Nouveau Testament ».
M. le docteur A. SCHELER, bibliothécaire du roi des Belges, le savant auteur d’un Commentaire sur l’Œdipe roi de Sophocle et d’un Dictionnaire d’Étymologie de la langue française, apprécie les Synonymes du Nouveau Testament, en ces termes : « Le travail de M. Trench, archevêque de Dublin, est, sans nul doute, une étude qui trahit une connaissance approfondie de la langue grecque tant classique qu’hellénistique. Les articles dont il se compose sont de plus rédigés avec une lucidité et une méthode remarquables, et je ne doute pas que non seulement l’étudiant en théologie, mais aussi le pasteur en fonctions, en s’en appropriant le contenu, n’en retirent tous deux de grandes richesses pour leurs études exégétiques. Une traduction française est un service rendu à la théologie tant catholique que protestante, car le livre offre en outre l’avantage de se tenir absolument en dehors de la polémique confessionnelle » (12 septembre 1866).
Voici maintenant le jugement de l’indépendant et consciencieux annotateur de l’Évangile selon saint Matthieu, M. Henri Lutteroth : « Que de précieux enseignements nous donne l’ouvrage du docteur Trench à l’aide de cette recherche sur la signification exacte des mots, et comme il s’élève quelquefois en ne songeant cependant qu’à faire ressortir la différence entre un terme et un autre ! Il y a dans cet ouvrage tous les éléments d’une histoire des mots du Nouveau Testament, et, grâce au docteur Trench, beaucoup d’entre eux nous disent leur secret de la manière la plus instructive. Vous aurez remarqué comme moi avec quel bonheur il relève la distinction faite déjà par les Anciens entre les prétendus synonymes qui n’auraient pu être employés sans inconvénient l’un pour l’autre à la place qu’ils occupent dans les Évangiles ou dans les Épîtres. Il a tiré de même grand profit de l’étude des mots employés par les Septante dans leur version de l’Ancien Testament, avant de l’avoir été par les écrivains du Nouveau. A chaque pas, l’on rencontre dans ce livre des observations fines ou profondes : aussi n’ai-je pu m’empêcher d’en transcrire bien des passages. Indépendamment de ce qu’on y apprend, on y puise, sans peut-être s’en apercevoir d’abord, la disposition à lire l’Écriture sainte en faisant plus attention aux nuances du sens des mots, en sorte qu’une fois entré dans cette voie, on continuera la lecture des saints Livres avec des préoccupations nouvelles, auxquelles plusieurs devront sans doute de riches résultats », (27 septembre 1866).
Certes, j’aurais bien le droit de m’arrêter après un tel verdict. Il doit inspirer de la confiance. Je ferai cependant connaître encore trois ou quatre opinions.
Le 17 octobre 1866, M. FRÉD. DE ROUGEMONT, auquel la saine exégèse doit de si intéressants travaux, sans parler des lumières qu’il a répandues sur une foule de questions morales, religieuses et scientifiques, nous envoyait les lignes suivantes qu’il accompagnait de quelques notes qui figurent dans la traduction :
« L’auteur des Synonymes du Nouveau Testament, M. TRENCH, nous paraît posséder une connaissance très solide de la langue et de la littérature grecque, tant profane que sacrée, et cette intelligence profonde des saints Livres que peut seule donner une foi vivante. Son esprit fin et délié saisit avec une remarquable netteté les nuances les plus délicates sans se laisser jamais entraîner dans de vaines subtilités, et en même temps il a cette vigueur de pensée qui sait résumer en peu de mots de longues discussions. Les distinctions que M. TRENCH établit entre les synonymes charment par leur clarté et leur simplicité, et, au moment où l’on se croit en pleine grammaire, il fait jaillir à l’improviste de discussions qu’on pourrait croire méticuleuses, de vives lumières sur les dogmes les plus élevés de la Révélation, comme sur les plus humbles devoirs de la vie chrétienne. Son ouvrage, d’ailleurs, est d’une concision à laquelle l’Angleterre ne nous a pas toujours habitués, et, traduit en français, il deviendra le Vade mecum de tous les étudiants en théologie et de tous les pasteurs, ainsi que des laïques qui aiment à lire en grec le Nouveau Testament. Tous prendront plaisir à se convaincre par eux-mêmes de la parfaite exactitude avec laquelle les pensées des écrivains sacrés se réfléchissent et se peignent dans leurs expressions. Si cette clarté d’idées et cette limpidité de style ne suffisent pas pour prouver l’inspiration, elles disposent au moins certainement les esprits impartiaux à l’admettre. Un livre pareil nous faisait entièrement défaut ; d’emblée M. DE FAYE comble cette lacune par la traduction d’un écrit qui, autant que nous en pouvons juger, est le résumé des meilleurs travaux de philologie sacrée que comptent et l’Angleterre et l’Allemagne. Nous croyons donc que M. DE FAYE rend ainsi à nos Églises un service dont il serait difficile d’exagérer l’importance pour les études théologiques ».
L’année ne se terminait point sans que M. le professeur F. GODET, dont le Commentaire sur l’Évangile selon saint Jean fera longtemps l’étude des théologiens, en même temps que la nourriture des âmes sérieuses et contemplatives, ne nous fît aussi connaître son appréciation du livre du docteur Trench : « Les distinctions sont faites avec tact, établies avec une érudition de bon aloi et de bon goût. Malgré l’aridité apparente du sujet, l’ouvrage se lit avec facilité et même avec charme. Je voudrais certainement le voir dans les mains de tous nos étudiants en théologie. Cette philologie à la fois aimable et sérieuse serait pour eux un aliment plus sain que la critique tranchante et superficielle qu’on leur donne aujourd’hui en pâture » (5 décembre).
Enfin, le lendemain de la réception de ces lignes, un professeur voué aux bonnes études, M. S. CHAPPUIS, de Lausanne, nous encourageait aussi à publier notre traduction : « L’ouvrage m’a paru très bon, et mon collègue, M. CLÉMENT, qui en a lu plusieurs articles, le juge excellent. L’un et l’autre nous le verrions avec une vive satisfaction paraître dans notre langue où les bons livres de ce genre font si entièrement défaut » (6 décembre 1866).
Si après ces juges, nous osions dire notre propre pensée sur l’ouvrage que nous avons traduit, nous l’exprimerions en modifiant légèrement les termes d’un synonymiste d’une solide érudition, parlant de l’abbé GIRARD. Nous dirions : « Rien de plus ingénieux que la manière dont le Dr Trench traite la différence des mots. . . Ses articles resteront comme des modèles du genre ; seulement il s’inquiète peu des synonymes psychologiques, il prend ceux qui s’offrent à lui, et de préférence ceux qui présentent des thèmes agréables, sur lesquels peut s’exercer la finesse et la sagacité de son esprit ; il ne va pas aux mots, il faut qu’ils viennent à lui 8 ».
J’ai peu de chose à dire sous le rapport de ma traduction, si ce n’est qu’elle a été consciencieusement revue par deux amis, aussi désintéressés qu’ils sont bien qualifiés pour la tâche qu’ils ont acceptée, qu’il s’agisse de la langue anglaise ou de la connaissance approfondie du grec. Je ne regrette qu’une chose, c’est que je sois le seul qui connaisse l’infatigable bienveillance que M. AUG. SCHELER, docteur en philosophie, et mon collègue, M. LOUIS DURAND, pasteur à Liège, ont déployée dans l’accomplissement d’une œuvre qui, dès l’abord, les a constitués mes correcteurs, j’entends mes maîtres. M. SCHELER semait ici et là quelques remarques au bas des épreuves qu’il me renvoyait : je me suis empressé de les transformer en notes.M. DURAND, après avoir également revu nos pages, a désiré profiter de la permission que m’avait accordée M. le professeur Reuss de faire passer dans notre langue l’important article sur l’HELLÉNISME qu’il a consigné dans la grande Real-Encyklopædie du docteur HERZOG. Tous nous lui en saurons gré.
Je tiens aussi à remercier mon typographe bruxellois, dont l’intelligence peu ordinaire et le zèle éprouvé ont su se frayer un chemin à travers les épaisses broussailles de mes corrections, véritable forêt vierge, mais où les lianes ne formaient guère de charmants festons.
Surtout, je bénis Dieu de ce qu’il m’a permis de mener à bonne fin un travail entrepris en juin 1866 comme diversion aux désolations du choléra qui ravageait alors notre cité. Je dépose humblement ma traduction aux pieds de Celui dont « on admirait les paroles pleines de grâce », et qui attachait une si grande importance à la valeur de nos paroles qu’il n’a pas hésité à dire : ᾿Εκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ (Matt.12.37).
Enfin à tous ceux qui sont appelés à instruire les âmes ou qui désirent s’instruire eux-mêmes dans la Parole de Dieu, qui « seule peut nous rendre sages à salut », je suis heureux de présenter les Synonymes du Nouveau Testament de l’archevêque TRENCH avec le vœu du poète :
Indocti discant et ament meminisse periti.
C. de F.
Etterbeek-lez-Bruxelles, février 1869.
1. Synonymes grecs recueillis dans les écrivains de la littérature grecque.Paris, 1847. L’Histoire de la théologie chrétienne au siècle apostolique, par M. le professeur E. REUSS, facilite la connaissance d’un grand nombre de termes du Nouveau Testament, sans avoir l’aridité d’un dictionnaire. Mais tout naturellement cet auteur n’examine que les mots dont la signification intéresse directement la théologie du Nouveau Testament.
2. Cet ouvrage de TITTMANN, toutefois, qui a le mérite d’avoir ouvert la voie, est bien incomplet, du reste, depuis longtemps il est épuisé. L’excellent travail sur les synonymes du Nouveau Testament, donné par C. G. WILKE, à la fin de sa Clavis Novi Testamenti (Dresde et Leipzig, 1841), a quelque chose de sec par sa grande concision et il est loin de présenter à l’exégète et au prédicateur les mêmes ressources que la publication de l’archevêque Trench. Cette dernière est donc jusqu’ici, même après les travaux de la savante et laborieuse Allemagne, unique dans son genre.
3. Les dispositions morales, dont nous sommes loin de dispenser le traducteur biblique, sont indépendantes de cette étude. (Luc.8.10).
4. Nous avons porté ce nombre à 105 d’après les éditions anglaises ultérieures (ThéoTEX)
5. Synonymes grecs, par A. PILLON. Paris, 1847.
6. Commentaire sur l’Épître aux Romains, II, p. 285. Paris, 1840.
7. Nous disons complète, car nous n’avons retranché que les quelques passages qui ne s’appliquent qu’à la Bible anglaise.
8. E. BARRAULT Traité des Synonymes de la langue latine. Paris, 1853, p. III.
Introduction
Les deux articles dont nous donnons ici la traduction sont de M. Edouard Reuss, le savant professeur de Strasbourg. En allemand, ils portent les titres de Hellenisten et Hellenistisches Idiom, et se trouvent pages 701-712 du tome V de la Real-Encyklopædie für protestantische Theologie und Kirche (1856), publiée, avec le concours d’un grand nombre de théologiens allemands protestants, par le Dr Herzog.
On sait que la Real-Encyklopædie, ce magnifique monument de la science théologique allemande, est complète maintenant, et compte 22 volumes grand in-8o, dont le premier a paru en 1854, à Stuttgart, et le dernier en 1868.
Disons encore, pour ceux qui lisent l’anglais plus volontiers que l’allemand, que les Américains ont commencé, en 1856, à publier à Philadelphie, si ce n’est une traduction complète de l’Encyclopédie, du moins un utile résumé ; mais nous craignons que ce long travail ne soit définitivement interrompu.
L. D.
I. Hellénistes
Hellénistes est le surnom, n’ayant du reste rien d’ironique, que les Grecs de nation donnaient aux étrangers qui adoptaient leurs mœurs, leurs institutions, leur langue ou leurs autres particularités. (Les mots ίζω, ισμός, etc., dérivés de noms propres, impliquent en général la notion de parti, de secte, de tendance.) Pour nous, dans cet article, ce mot présente un intérêt particulier en ce qu’il a surtout sa place dans l’histoire des mœurs et de la civilisation juives, et, par là, acquiert aussi de l’importance pour l’histoire du christianisme primitif.
[Le verbe ἑλληνίζειν, adopter la langue et les mœurs grecques, vivre à la manière des Grecs, ne se rencontre pas dans le Nouveau Testament, mais il est tout à fait classique. Voyez, par exemple, Xénoph., Anab., vii, 3, 25 ; Thucyd., Bell. Pelop., ii, 68. Par contre, le substantif ἑλληνιστής se rencontre pas dans les auteurs grecs profanes, mais revient trois fois dans le Nouveau Testament : Act.6.1 ; 9.29 ; 11.20. Seulement, dans ce dernier endroit, la leçon ῾Ελληνας a pour elle le plus grand nombre de manuscrits. C’est à tort que nos traductions ordinaires, dans les trois endroits indiqués, rendent le mot ἑλληνιστής Grec ; c’est « Juif helléniste » qu’il faut lire. L. D.]
L’histoire ne s’en tient que trop souvent à la marche extérieure des faits. Il est rare de voir explorer et apprécier à fond le développement intérieur d’une nationalité, duquel, cependant, en fin de compte, dépend à peu près tout le reste. C’est ainsi que l’idée qu’on se fait généralement du sujet qui nous occupe, sans être précisément fausse, est cependant superficielle et incomplète. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à jeter un coup d’œil sur le Biblisches Realwœrterbuch (Dictionnaire biblique), de G. B. Winer, sur les commentaires du Nouveau Testament, (ad Act.6.1, etc.), et surtout sur les histoires ordinaires du siècle apostolique.
Par suite de la supériorité de la civilisation grecque, l’hellénisme, dans le sens que nous avons donné à ce mot — ou, si l’on veut, l’hellénisation des nationalités étrangères — avait surgi depuis un temps immémorial et sur une certaine échelle, partout où l’élément grec et l’élément étranger s’étaient trouvés en contact quelque peu intime. C’est ce qui eut lieu, entre autres, en une infinité d’endroits, sur toutes les côtes de la Méditerranée. Mais avec Alexandre le Grand, grâce à de nouveaux principes politiques et à l’emploi de moyens choisis en connaissance de cause, l’hellénisation commença à s’effectuer sur une échelle beaucoup plus vaste. Sous ses successeurs, particulièrement sous les Séleucides et les Ptolémées, elle fut poursuivie systématiquement, et même, au besoin, par la violence.
Le résultat obtenu par tout ce travail, quant au noyau même des peuples hellénisés de l’Asie et de l’Afrique, se manifesta comme des plus chétifs dix siècles plus tard, en présence de l’invasion arabe. La civilisation et la langue grecques n’avaient pu pousser, parmi ces peuples, de racines assez fortes pour résister. Cependant les anciens conquérants n’en avaient pas moins atteint, en leur temps, le but qu’ils s’étaient proposé : la consolidation de leur pouvoir. L’immigration de colons grecs, l’influence de la cour, de l’administration, des institutions militaires, du commerce, de la littérature, la fondation et l’agrandissement d’une infinité de villes, le fait que la population du pays était écartée du foyer de l’activité nationale, tout cela, finalement, opéra plus fortement que l’épée ne l’avait fait, et ce que Rome accomplit plus tard d’une manière plus grande et plus durable, eut aussi lieu ici, et d’autant plus facilement que la population indigène était en grande partie flottante, et que le syncrétisme des religions, bien loin d’empêcher la fusion, la favorisait.
Il y avait aussi, chez les peuples d’origine sémitique, de même que chez les Grecs, le goût du commerce et des voyages qui alors était devenu le trait dominant de la vie des nations. Les Juifs s’y adonnèrent d’autant plus vivement et plus généralement que, pendant des siècles, ce goût avait été comprimé chez eux par des circonstances politiques et géographiques défavorables, et principalement par une législation fondée tout entière sur l’agriculture et la propriété foncière, et antipathique aux tendances caractéristiques de la nation. Le flot de l’immigration grecque ne tarda pas à rencontrer le flot de l’émigration juive, qui se précipitait aussi sur les jeunes cités macédoniennes. Soit de leur plein gré, attirés par l’appât du gain, soit transportés en masse par le fait de la politique despotique des souverains, les Juifs se répandirent bien loin par delà ces villes, sur un rayon toujours plus grand. Partout ils prirent pied et vivifièrent le commerce et l’industrie, partout on vit se développer en eux cet esprit inné de spéculation qui estime avant tout la propriété mobilière et facilement réalisable, et qui est demeuré jusqu’à ce jour le trait saillant de leur caractère.
Les deux courants ne se mêlèrent pourtant pas. Cette même législation, dont le peuple juif avait si facilement rejeté le côté matériel, lui avait inculqué avec des principes religieux et moraux si particuliers, et, qu’on ne l’oublie pas, si supérieurs, une telle crainte personnelle de l’étranger, qu’il ne pouvait être question nulle part, pour des Juifs, de se laisser absorber par l’élément grec. Au contraire, quels que fussent d’ailleurs les points de rapprochement et de contact dans la vie, la foi religieuse, dans tout ce qui s’y rapportait, creusait entre les deux nationalités un abîme infranchissable ; abîme assez grand, non seulement pour mettre cette foi à l’abri de toute séduction et de tout danger, et pour conserver aux mœurs leur cachet propre, mais aussi pour exciter et mettre en jeu toutes les mauvaises passions qui divisent les peuples : l’orgueil, la haine, l’amour des querelles.
Cela étant, il est pour nous du plus grand intérêt de savoir en quelle mesure l’élément juif céda ou résista à l’influence étrangère, ou, en d’autres termes, quelles sphères de la vie publique et privée, quels côtés du caractère national participèrent le plus à l’hellénisation, et s’affaiblirent et se perdirent, quels côtés, d’autre part, conservèrent leur vigueur. C’est la réponse à ces divers points qui nous présentera le tableau du judaïsme hellénistique.
Tout naturellement, il ne saurait s’agir ici des détails de la cuisine et du ménage.
Les arts et les sciences n’étaient point tellement avancés parmi les Juifs qu’ils n’eussent beaucoup à apprendre de l’étranger. Il ne fut sans doute jamais question, parmi eux, d’un esprit guerrier qui, s’inspirant des souvenirs historiques, aurait remué la conscience populaire. Ce qui en existait, se rattachait aux traditions sacrées et aux idées religieuses, et, partant, s’éloignait de la sphère politique ordinaire. En outre, le siècle où l’on se trouvait, ne pouvait manquer d’affaiblir cet esprit. Le commerce, de sa nature, est cosmopolite ; chaque nouveau pas qu’on y faisait, tendait au fond à éloigner de l’esprit de la loi et des prophètes, et cela d’autant mieux que les Juifs s’en rendaient moins compte. En même temps, les deux puissances voisines, jalouses d’étendre leur influence sur le territoire et dans le cœur du peuple juif, placé entre elles, luttaient à l’envi pour lui accorder des avantages matériels. En lui apprenant à recevoir à bras ouverts tout ce qu’on lui présentait, elles tournèrent de plus en plus ses idées vers l’argent et le lucre, et émoussèrent entièrement l’amour-propre national et conservateur, sans parvenir toutefois, il est vrai, à s’attacher la nation par un lien d’affection.
Si le peuple juif n’avait point été si fortement protégé et garanti par sa religion, il eût été, avant tout autre, absorbé parla civilisation et le monde grecs. On en a la meilleure preuve dans l’affectation qu’il apporta à s’approprier les noms grecs, et dans la facilité avec laquelle il sacrifia au génie étranger ce qu’il y a de plus précieux et de plus particulier pour un peuple : la langue. Il en adopta une nouvelle en peu de générations et avec une facilité dont l’histoire aurait peine à citer un second exemple. C’est même ce qui resterait une énigme pour nous, si nous ne savions la part prépondérante que l’intérêt matériel eut dans cette transformation. Même dans la plus grande partie de la mère patrie, en Palestine, elle n’eut point à lutter contre cette masse inerte dont ordinairement le mérite purement passif est de conserver plus longtemps les vieilles mœurs et le vieux langage. Ce fait linguistique est tellement remarquable en son genre, au point de vue psychologique et historico-littéraire, et il rentre tellement dans le domaine des études théologiques spéciales, que nous lui consacrons un article à part, l’article suivant.
Malgré cet empressement et cette merveilleuse aptitude de la part d’un peuple qui avait été élevé depuis des siècles pour le séparatisme le plus strict, à se trouver chez lui au sein de l’étranger, et à oublier la langue de ses pères, aptitude qui lui est restée à un haut degré jusqu’à ce jour, la foi religieuse, comme nous l’avons dit, maintenait la séparation à un degré plus haut encore. En face de ce phénomène, on ne peut s’empêcher d’éprouver un sentiment de surprise et d’admiration, en voyant comment l’organisation politique et religieuse de la communauté de Jérusalem (cette communauté, après le retour de la captivité, devint peu à peu le centre de la nouvelle vie juive), accomplie avec autant de sagesse que d’énergie, créa une nationalité qui, basée essentiellement sur le séparatisme, mêlait d’une manière intime l’élément politique et religieux, vivait de souvenirs et d’espérance autant que du présent, puisait parfois uniquement sa force dans ces souvenirs et dans cette espérance, et s’en servait pour surmonter l’impuissance du moment sans nul détriment spirituel ; nationalité enfin, dont la vitalité ne fut pas même affaiblie par une forte attraction vers le cosmopolitisme, ni anéantie par la perte de la patrie, et qu’aucune révolution ne put atteindre. Nul doute qu’un tel résultat n’eût point été obtenu sans cette tenace austérité connue sous le nom de pharisaïsme, mais qui, la plupart du temps, a été jugée d’une manière partiale et injuste. Un édifice qui dure depuis des milliers d’années et qui s’est montré plus solide même que l’édifice romain, fait l’éloge de l’esprit et de la force des maîtres qui l’ont fondé et élevé. A quelque distance qu’ils fussent de la patrie, et malgré toutes les séductions de la prospérité et de l’adversité, l’apostasie n’a été chez les Juifs qu’un fait exceptionnel. L’esprit de corps, chez eux, propagea partout et promptement la synagogue (au sein des populations grecques, la synagogue helléniste), qui fut tout à la fois le rempart de l’esprit national et le point de mire de l’antipathie étrangère, et, par là même, conserva au peuple juif son existence particulière dans le monde.
Ici nous abordons le côté de notre sujet par où il devient important pour l’histoire du christianisme, et qui manifeste à l’observateur attentif, aussi clairement qu’on peut le désirer, la haute et providentielle connexion qui existe dans les rapports et les destinées des peuples. La transformation des Juifs hébreux en Juifs hellénistes ne présente pas simplement un intérêt statistique et philologique ; ses conséquences eurent une plus haute et plus vaste portée. Ce n’est pas à la surface bruyante des événements que se prépare l’avenir ; c’est à une profondeur où l’œil ne pénètre pas. Le courant qui doit l’amener au jour se forme dans ce huis clos, bien avant que sa force se manifeste aux yeux de tous. L’hellénisation du peuple juif (par où nous entendons maintenant non plus seulement l’adoption par les Juifs des mœurs et de la langue grecques, mais aussi le fait que dans leur foi et leurs doctrines, ils se rapprochèrent de la population grecque ) coïncida avec l’époque où le paganisme, de son côté, s’avançait vers une catastrophe inévitable. L’empire du paganisme sur les esprits était brisé ; la science, le doute, la démoralisation, le minaient à l’envi, et là où tout cela ne se rencontrait pas, une superstition insipide, prosaïque et étrangère prenait la place vacante de la conviction religieuse. Beaucoup d’individus cependant ne trouvaient de satisfaction ni dans l’ivresse des sens, ni dans les abstractions de la philosophie, ni dans la fantasmagorie des mystères et des sciences occultes. Souvent il arriva qu’ils prirent le chemin de la synagogue, y apprirent à connaître le Dieu d’Israël, et y puisèrent dans la prière, les chants et les prédications, une édification que vainement, jusque-là, ils avaient cherchée auprès des autels de leurs dieux. Les femmes surtout, entre les mains de qui se trouvent principalement l’éducation et le bonheur de la famille, fréquentèrent bientôt, et en grand nombre, des exercices de culte à côté desquels la Grèce n’avait rien de semblable à mettre. Personne n’était empêché d’y prendre part ; les relations de la vie civile et du commerce avaient rapproché les nationalités ; d’étroits rapports pouvaient même s’établir par des liaisons de famille, en sorte que, en observant certaines règles générales quant aux habitudes religieuses et domestiques, on en venait de part et d’autre, sans obstacles particuliers, à se rapprocher d’une manière bienfaisante.
Ce fut ainsi que le judaïsme hellénistique fraya la voie, sur une grande échelle, à une connaissance meilleure de la religion au milieu d’une population païenne.
D’un autre côté, le développement particulier qu’il devait subir dans un milieu étranger, n’eut pas, en retour, une influence insignifiante sur les éléments fondamentaux du judaïsme lui-même. Déjà, d’une manière générale, on peut dire qu’au sein des villes commerçantes et populeuses, dans la confusion des langues et le bruit des affaires, où tout ce qui était national et particulier était en quelque façon relégué dans les étroites limites du jour, de l’heure et du lieu; où dominaient, d’ailleurs, exclusivement les affaires communes et les rapports communs; où, pour ainsi dire, un courant d’air plus vif dispersait les lourdes vapeurs des préjugés étroits et locaux, — les Juifs durent en venir peu à peu à juger moins défavorablement ce qui était étranger, à reconnaître ce qui était commun à l’humanité, et à attacher moins de valeur à certains détails de leur monothéisme, sans cependant le mettre en péril, et tout en continuant à le considérer comme leur vrai bien national, leur trésor distinctif. En effet, on ne doit pas oublier qu’à distance de Jérusalem, partout où les pèlerinages au temple ne pouvaient se renouveler assez souvent pour chacun en particulier, le culte public juif ne consistait que dans les exercices mentionnés ci-dessus, et que les sacrifices n’avaient pas lieu. Cette partie du culte devait donc, dans la conscience des hommes réfléchis, perdre de son importance, même à leur insu. Aussi, lorsqu’ils visitaient le sanctuaire, à l’occasion des fêtes, et qu’elle leur apparaissait dans son éclat, ou lorsqu’ils étudiaient la loi, elle excitait le sentiment national ou faisait sur l’esprit telle autre impression, plutôt qu’elle n’éveillait l’idée d’un opus operatum mécanique, comme cela arrivait par la répétition quotidienne, que la masse inintelligente finissait par considérer comme la religion même.
L’Helléniste se débarrassait ainsi de plus en plus, sans le vouloir et sans le savoir, des liens et des formes des ordonnances pharisaïco-lévitiques. Il avait des prédicateurs et pas de prêtres, et cette modification ne résultait nullement d’une critique haineuse ou d’une indifférence équivoque : elle était la conséquence naturelle des circonstances. Nous ne voulons pas dire par là que les Juifs de langue grecque fussent tous, de la même manière, élevés au dessus des vues exclusives des Juifs hébreux. Nous avons la preuve du contraire dans les Actes des apôtres. En général, cependant, la marche de la propagation de l’Évangile démontre précisément de quel puissant secours lui furent les circonstances que nous venons de décrire. Déjà dans la bouche de Jésus, l’Évangile, établissant une distinction entre ce qui est essentiel ou non dans la religion, mettait en opposition les sacrifices et la miséricorde (Matth.9.13 ; 12.7), l’adoration sur Garizim ou Sion et l’adoration en esprit et en vérité (Jean.4.21). L’Évangile reconnaissait la vraie foi aussi en dehors d’Israël (Matth.8.10, etc.), et apportait un salut destiné à toutes les nations. Toutes choses qui, pour le moins, devaient être plus compréhensibles à l’Helléniste, si même de prime abord il ne se sentait pas amené à les accepter. Ceux des disciples, qui furent les porteurs éloquents de cette partie du message, étaient tous Hellénistes, et c’est parmi les Hellénistes que leur prédication trouva le terrain le plus favorable.
En Palestine, où le Juif se sentait chez lui et voulait être son propre maître, le païen, sous quelque forme qu’il se présentât, était doublement mal venu ; sa seule qualité d’étranger lui valait déjà les épithètes de « pécheur, » « impie, » « injuste. » Le préjugé national était la source d’une appréciation morale exagérée de soi-même, et qui créait en même temps une prédisposition contre l’Évangile. Hors de son pays, le Juif avait le sentiment que c’était lui qui était l’étranger, et cela seul suffisait à lui faire accepter le voisinage d’autrui. Il se familiarisait avec l’idée qu’il y a place dans le monde pour toute espèce de gens, ce qui ne pouvait rester sans fruit dans la nouvelle sphère religieuse où la paroi mitoyenne (Éph.2.14) devait tomber, et où un grand renouvellement de l’humanité devait avoir lieu. A Jérusalem, beaucoup ne voulurent pas d’un Évangile qu’ils auraient dû posséder en commun avec des incirconcis ; à Antioche, on avait depuis longtemps en commun avec eux non seulement le marché, mais en quelque sorte aussi la synagogue. La profondeur de l’abîme qui séparait les deux éléments du peuple juif, lorsque l’Église fut fondée, est suffisamment établie par le fait que déjà là où il en est fait mention pour la première fois (Act. ch. 6), il est question d’un désagréable conflit, dont un intérêt extérieur et futile fut évidemment l’occasion, mais dont la véritable cause se trouvait dans l’opposition nationale.
Nous devons laisser à l’exégèse le soin de mettre en œuvre, pour une intelligence plus précise des récits et du texte du Nouveau Testament, les idées que nous venons de développer.
II. Idiome Hellénistique
Idiome ou langue hellénistique est le nom donné communément au dialecte dont se servaient les Juifs qui vivaient parmi les Grecs ou entretenaient des relations suivies avec eux. Ou bien, si l’on aime mieux, l’idiome hellénistique est cette forme particulière de la langue grecque qui prit naissance dans la bouche de l’Orient sémitique, lorsque les deux sphères de la vie juive et de la vie grecque entrèrent en contact et se pénétrèrent l’une l’autre. La première de ces définitions, quoique plus restreinte et même insuffisante historiquement, nous suffit, parce que nous ne connaissons cet idiome que par le cercle étroit du judaïsme, et que l’intérêt que nous y prenons, se rattache précisément à ce cercle.
Cet intérêt n’est pas ici, comme autre part, un intérêt purement philologique, qui s’épuise en considérations et règles grammaticales et syntaxiques. Il n’est pas non plus simplement psychologique, épiant, dans le travail de l’esprit humain, comment il s’efforce de revêtir de formes nouvelles et étrangères, des notions acquises depuis longtemps et profondément enracinées ; comment, par suite de la liaison intime entre la pensée et la parole, il se prête lui-même à une transformation, moitié par force, moitié de plein gré. Sous ce rapport, des phénomènes semblables se retrouvent partout sur le chemin du philologue et de l’historien, et l’influence que par sa richesse en idées nouvelles une conviction religieuse conquérante et pleine de vitalité peut exercer sur une langue qui n’y est pas préparée, est un fait trop commun sur la route du christianisme, pour qu’elle nous apparaisse comme relevant exclusivement de notre présent sujet.
Mais ce qui donne à celui-ci de l’importance, c’est la considération que le mélange des deux éléments, l’esprit juif et la langue grecque (tantôt nous caractériserons ce mélange d’une manière plus précise), a créé, en partie indirectement, par ses rapports avec les derniers développements du judaïsme avant Jésus-Christ, en partie directement par la bouche et la plume des apôtres de Jésus, la forme sous laquelle l’Évangile est parvenu à la connaissance de la plus grande partie du monde ; forme qui, en conséquence, doit en fournir l’intelligence bien au delà des limites du temps et du lieu de sa naissance, et dans une mesure qui ne peut que grandir incessamment. C’est ainsi qu’une chose extérieure en elle-même a été mise en connexion avec les trésors les plus sacrés et les plus élevés de la pensée humaine, non seulement de manière à lui attirer une plus grande attention, et à lui donner de la signification même pour la théologie, mais aussi à l’entraîner, du moins en passant, dans les disputes de parti inséparables de cette dernière.
D’après l’article précédent, il a dû devenir évident pour nos lecteurs que les Juifs n’ont nullement fait connaissance avec la langue grecque par la voie de l’éducation, de l’école, ou des études littéraires, comme c’était par exemple le cas chez les Romains, mais par le contact immédiat de le vie pratique, par les rapports commerciaux et d’autres circonstances semblables. Pour ceux qui sont dans ce cas, la grande affaire n’est pas de pénétrer dans ce que l’esprit de la langue étrangère a de caractéristique, ni de se procurer, par la littérature de cette langue, une intelligence plus profonde de l’élément étranger. L’essentiel, pour eux, est de pouvoir se faire comprendre dans la vie ordinaire, d’amasser une provision de mots assez grande pour suffire aux besoins des rapports matériels et sociaux sans intermédiaire, et d’acquérir la faculté de s’exprimer nécessaire ; toutes choses où il s’agit moins de la correction de l’expression que de formuler clairement sa pensée, moins de la forme que de la chose. Il ne faut pas oublier, non plus, que précisément la partie de la population avec laquelle s’établissent naturellement, dès l’abord, de tels rapports, ne se distingue généralement pas elle-même par une éducation scientifique, ou littéraire, mais que, ayant l’esprit dirigé vers des buts pratiques, elle ne se formalise point de l’imperfection d’un moyen de communication créé grossièrement et rapidement, et n’a pas d’intérêt moral à coopérer à son amélioration.
A cela s’ajoutent encore deux autres circonstances importantes.
Ce fut de la manière indiquée et, paraît-il, avec une étonnante facilité, que les Juifs apprirent la nouvelle langue, soit dans les villes de commerce grecques, soit en Palestine même, dans leurs nombreux rapports avec la domination macédonienne ; mais ils désapprirent en même temps, du moins à l’étranger, tout aussi rapidement leur langue maternelle, ou y renoncèrent peu à peu, même dans le sein de la famille, précisément pour arriver à posséder le grec d’autant mieux. La deuxième et la troisième génération, ainsi que tous les colons venus plus tard qui avaient déjà devant eux, dans leurs parents ou des personnes de même race, une communauté constituée et parlant la nouvelle langue, n’avaient donc plus à apprendre des Grecs, mais trouvaient dans leur entourage naturel toute l’instruction dont ils avaient besoin. Cela même contribua à perpétuer et à fixer au milieu d’eux les imperfections de langage qui, par la force des choses et accidentellement, avaient surgi dès l’abord, puisque maintenant c’étaient des Juifs, et non des Grecs, qui étaient les premiers maîtres des nouveaux élèves.
Que dans des temps plus récents, des Juifs cultivés et savants aient puisé à une source beaucoup plus pure, et cherché à s’approprier la langue classique, c’est ce qui n’entre nullement ici en ligne de compte, un Josèphe, un Philon, et plusieurs auteurs chrétiens des premiers siècles appartenant à la même catégorie, n’étant rangés par personne parmi les représentants de l’idiome hellénistique qui nous occupe en ce moment.
N’allons pas plus loin sans rendre attentif à une circonstance qui, ci-devant, n’a été que très imparfaitement appréciée, et dont l’ignorance a conduit à beaucoup d’erreurs dans l’examen des faits dont il est ici question. Juste au moment où le mélange des peuples commençait à prendre des proportions plus grandioses, à la suite des bouleversements amenés par Alexandre, et surtout par ce bouleversement même, la langue grecque, que les Juifs devaient ou voulaient apprendre, passa par une transformation intérieure. Elle subit même un changement d’une durée assez longue et d’une portée assez grande pour éveiller l’attention des penseurs et occasionner des études d’où sortit, pour la première fois dans l’histoire littéraire, la science philologique.
Cette transformation fut d’une nature multiple.
Le fait sur lequel il y a le moins lieu d’appuyer, c’est que la langue grecque, par suite du développement subit et prodigieux de son horizon géographique, s’accrut d’une quantité de vocables étrangers : mots égyptiens, persans, sémitiques ; noms d’animaux, de plantes, de produits bruts et manufacturés, d’ustensiles et de mainte institution de la vie publique ou privée. Cela n’a ordinairement d’influence sur une langue qu’à un faible degré, à moins de devenir, comme dans l’allemand, une habitude non motivée, un abus.
Ce qui réclame davantage notre attention, c’est que le nouvel ordre politique créa de grands royaumes, et, en conséquence, s’il n’anéantit point les habitudes bornées des Etats de roitelets et de la politique bourgeoise, les repoussa du moins à l’arrière plan, et fit que les idiomes locaux et les dialectes se fondirent en une seule et commune langue universelle grecque, comme c’est le cas partout où la conscience nationale, soit peu à peu, soit à la suite d’un événement puissant, remporte la victoire sur les tendances étroites du particularisme. Sans doute, l’homme du peuple aura continué à parler attique à Athènes, dorique à Sparte, ionique à Halicarnasse, tout comme maintenant les Suisses et les Holsteinois persévèrent à parler des idiomes du haut ou du bas allemand ; mais on se rapprocha réciproquement sur un terrain moyen, surtout dans les nouvelles villes où la population n’avait pas une même origine. Finalement ce rapprochement eut lieu aussi dans la littérature, qui prit une influence croissante et qui arriva en même temps à la conscience d’être une littérature universelle. Vu la supériorité connue de l’esprit athénien, peut-être aussi par suite d’une certaine attraction qui se faisait sentir et grandissait depuis longtemps déjà, cette langue vulgaire, ou mieux cette langue commune (ἡ κοινή), s’édifiait sur la base du dialecte attique ; de même que, par diverses causes, en Allemagne, le dialecte saxon, en France celui qui s’était développé entre la Seine et la Loire, devinrent prépondérants et remportèrent la victoire.
Mais dans la même mesure qu’elle devint commune, se dépouillant ainsi de ce qu’elle avait de local, elle se mélangea : troisième caractère que nous avons à faire ressortir. Elle admit dans son sein un fonds de diverse origine locale, ou bien, en conformité d’autres modes de formation, se créa de nouveaux éléments, inconnus auparavant. Nous savons, en partie par les anciens grammairiens eux-mêmes, qu’il en fut ainsi et comment il en fut ainsi. Ils enregistrent les phénomènes particuliers sous diverses rubriques, ou par ordre alphabétique, ou encore, dans l’occasion, en présentant leurs critiques, et nos bons dictionnaires grecs, surtout ceux du Nouveau Testament, accueillent aujourd’hui soigneusement ces notices. Il se produisit de nouvelles formes d’inflexion, surtout dans les verbes ; les substantifs changèrent leur genre ; certaines désinences caractéristiques, dans la formation des mots, commencèrent à dominer ou à être échangées pour d’autres ; des radicaux perdus reparurent, et des radicaux usités furent remplacés par des dérivés ; des mots connus prirent une nouvelle acception; des expressions figurées, appartenant auparavant au style relevé, devinrent bien commun du langage familier. Par contre, des expressions vulgaires eurent l’honneur d’arriver au droit de bourgeoisie littéraire ; de nouvelles conceptions, et plus encore la force vitale d’une langue qui était en train de devenir le ciment de toute la future bourgeoisie universelle si seulement la nation elle-même avait emboîté le même pas, créèrent continuellement de nouveaux mots, aussi pittoresques et expressifs dans leur composition, que riches et populaires par leur vigueur et leur caractère naturel.
Beaucoup de choses que nous rencontrons pour la première fois dans les monuments de l’époque macédonienne, sont peut-être plus anciennes, mais elles furent alors tirées de l’obscurité de la langue populaire, partout plus riche que celle de la légitimité classique, ou bien d’une province éloignée, et portées dans les foyers mêmes de la nouvelle civilisation métropolitaine.
Cette dernière remarque nous fait faire un nouveau pas.
C’est précisément la race grecque restée, comparativement, le plus en arrière sous le rapport intellectuel, qui, par Alexandre, parvint au pouvoir. En même temps, elle se répandit le plus par suite d’intérêts et de privilèges militaires et administratifs, et acquit l’influence la plus considérable. C’est donc avec raison qu’on a signalé une teinte macédonienne dans le grec moderne. Athènes pouvait bien encore être fière de l’éclat de ses écoles, et les princes syracusains avoir pour poète de cour un poète de langue dorienne, mais il n’y a pas de doute que c’étaient Pydna, Pergame, Antioche, et surtout Alexandrie, qui donnaient le ton non seulement aux mœurs et au caractère du peuple grec, mais aussi et surtout à sa langue. A Alexandrie principalement, toutes les forces vives de la culture sociale, du commerce, de l’art, de la science et de la littérature, s’unirent pour fonder une domination intellectuelle qui se maintint jusqu’au moment où le centre de gravité de l’ancienne civilisation, affaiblie et tirant à sa fin, dut être transféré à Byzance, dans le voisinage des barbares, ces soutiens de l’avenir. C’est donc à juste titre qu’on parle d’un dialecte alexandrin ; ce dialecte, du reste, fut moins celui de la littérature que d’une société qui n’était pas précisément la plus civilisée. Nous le connaissons principalement par les manuscrits du Nouveau Testament qui ont été faits à Alexandrie. Plusieurs même des critiques les plus récents soutiennent que c’est réellement la langue dans laquelle les apôtres ont écrit. Si cette manière de voir était parfaitement établie, on devrait admettre de plus que la forme grammaticale actuelle du texte imprimé du Nouveau Testament, date d’une époque plus récente, alors que la civilisation alexandrine et son influence furent détruites par les Arabes, que Byzance était devenue le centre de la vie littéraire comme de la vie religieuse, et que les formes mêmes du langage commençaient déjà à devenir conventionnelles, parce que, dans la bouche du peuple, elles marchaient vers une prompte et inévitable corruption.
Nous ne pourrions entrer plus avant dans ces recherches, sans nous écarter trop de notre sujet, et, en outre, elles ne nous feraient connaître que des faits extérieurs. Il est plus important pour nous de pénétrer jusqu’au centre et à l’esprit de la chose, et surtout de voir ce que devint la langue grecque entre les mains des Orientaux, principalement dans le domaine religieux.
Nous rencontrons immédiatement un fait d’une grande portée. Il est notoire que le livre de la loi mosaïque a été traduit en grec, à Alexandrie, dès avant le règne du savant Ptolémée 9, à une époque donc où florissait une génération juive dont les pères immédiats avaient été les premiers qui durent s’accommoder à parler grec. L’histoire de cette traduction ne nous est, il est vrai, parvenue que fort entourée de légendes ; mais à coup sûr nous ne nous trompons pas si nous en faisons remonter l’origine à un besoin religieux qui se fit sentir, et non exclusivement à un caprice littéraire de souverain, comme on représente ordinairement la chose. Le souverain a pu veiller à la coopération de littérateurs grecs ; patron avoué de la communauté juive et de ses rabbins, il a pu admettre dans sa bibliothèque un exemplaire dédicatoire que des Juifs, en sujets fidèles, vinrent déposer à ses pieds ; mais avec tout cela, que l’histoire peut admettre, il n’en est pas moins vrai que le merveilleux qui pénètre jusqu’au cœur l’histoire de la traduction des Septante, indique plutôt une origine tenue par l’Église pour sacrée qu’une origine de nature à intéresser seulement le savant de bibliothèque.
Quoi qu’il en soit, le premier coup d’œil jeté dans cette Bible juive alexandrine montre avec quelle faible connaissance de la langue grecque la traduction des livres de Moïse fut entreprise. Les autres livres historiques et prophétiques, traduits dans le cours d’une période qui n’est plus déterminable au##jourd’hui, sont, en général, à la même hauteur scientifique, quoique présentant de sensibles variations de teinte. Il ne s’agit naturellement pas, ici, des méprises causées par l’herméneutique fautive des traducteurs, ni des défectuosités du texte qu’ils ont suivi ; mais bien des exemples innombrables d’expressions grecques détournées de leur sens, de constructions hébraïques où un lecteur en possession de l’hébreu peut seul se reconnaître. Pour beaucoup d’expressions de la vie religieuse et ecclésiastique, sans parler de la vie économique et politique, les expressions grecques équivalentes manquaient réellement. Pour beaucoup d’autres, elles manquaient à des traducteurs complètement illettrés, qui n’avaient à leur disposition que le matériel de la langue du marché et de la bourse. Aussi prirent-ils alors sans hésiter ce qui, dans la vie, était l’équivalent, sans tenir compte de l’usage réel de la langue ; à peu près comme si aujourd’hui un élève de langue allemande, pour écrire du français, prenait dans son dictionnaire la première expression venue, pour n’importe quel rapport des mots.
Nous connaissons depuis longtemps par la Bible cette manière de traduire, et nous ne nous heurtons plus, dans beaucoup de cas, à la phrase hébraïque. Mais que devait penser un Grec quand il entendait, par exemple, les expressions : Toute chair, semence, piège, païens, fruit des reins, cœur droit, calice, langue, bouche d’épée, lèvres de la mer, chercher l’âme, oint, marcher, s’endormir, souillé, susciter semence, regarder à l’apparence, etc., etc. ? L’auditeur juif était dans une meilleure position sous ce rapport, car, après comme avant, tout cela était le langage cher à son cœur, puisque c’était le langage familier à sa nation aussi bien qu’à la synagogue. Les particules, qui sont partout la chose la plus difficile dans l’étude d’une langue, ne lui causaient pas de peine, car elles restaient tout à fait hébraïques ; le serment continue à se revêtir de la formule conditionnelle elliptique ; la copule universelle remplit aussi sous sa nouvelle forme [καί], ses diverses fonctions ; l’état construit sert à exprimer ses rapports accoutumés. Le discours indirect, la construction participiale, la parenthèse, la subordination des phrases, les distinctions subtiles dans le sens des prépositions, suivant les cas qu’elles régissent, des conjonctions et des modes (autant de choses où suent nos élèves de troisième), tout cela disparaissait pour faire place à la construction claire, unie et naïvement élémentaire de l’Ancien Testament.