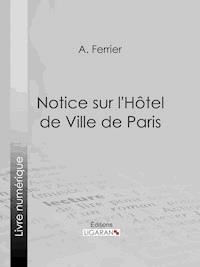
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "La place de Grève, qui servait de marché aux Parisiens depuis une époque très-reculée, fut cédée parle roi Louis VII aux bourgeois de la ville de Paris, dans la première moitié du XIIe siècle, moyennant une somme de septante livres tournois. En 1357, le Prévost des marchands, Étienne Marcel, et les échevins firent l'acquisition, pour la commune, d'un bâtiment appelé la Maison-aux-Piliers, dont une vue nous a été conservée par un missel ayant appartenu à la... "
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La place de Grève, qui servait de marché aux Parisiens depuis une époque très reculée, fut cédée par le roi Louis VII aux bourgeois de la ville de Paris, dans la première moitié du XIIe siècle, moyennant une somme de septante livres tournois. En 1357, le Prévost des marchands, Étienne Marcel, et les eschevins firent l’acquisition, pour la commune, d’un bâtiment appelé la Maison-aux-Piliers, dont une vue nous a été conservée par un missel ayant appartenu à la famille de Jean Jouvenel des Ursins. Avant cette époque, la Hanse parisienne, compagnie de marchands par eau, qui a donné naissance au corps municipal de Paris, avait tenu ses séances dans un bâtiment qu’on appelait la Maison-de-Marchandise, située près de la place du Grand-Châtelet, puis dans le Parloir-aux-Bourgeois, entre l’enclos des Jacobins et la place Saint-Michel.
La Maison-aux-Piliers, qui était, dans son origine, la propriété d’un sieur Jehan le Flamant, fils de Renier, avait été confisquée en 1309 par le roi Philippe-le-Bel, pour cause de délit commis par ledit Jehan. Elle resta dans le domaine royal jusqu’en 1324, époque où Philippe de Valois la donna au Dauphin du Viennois, Guigues, dont les successeurs la possédèrent jusqu’à la mort de Humbert, dernier de ces princes.
La Maison-aux-Piliers, qu’on appelait aussi l’Hôtel-au-Dauphin, fit donc retour au domaine royal en la personne du roi Jean, héritier du Dauphiné, qui la donna à son fils aîné Charles, et ce prince en fit présent à son ami Jean d’Auxerre, receveur des gabelles de la prévôté de Paris. C’est de celui-ci que le Prévost des marchands l’acquit pour la somme de deux mille huit cent quatre-vingts livres.
Ce devait être, pour l’époque, un bâtiment d’une certaine importance. Il avait, dit Sauval : « Deux pignons, deux cours, un poulailler, des cuisines hautes et basses, grandes et petites, des étuves ou bains, une chambre de parade, une autre appelée le Plaidoyer, une chapelle lambrissée, une salle couverte d’ardoises, longue de cinq toises et large de trois, avec plusieurs autres commodités. »
La Maison-aux-Piliers servit d’Hôtel de Ville jusqu’à ce que, les progrès de la population parisienne l’ayant rendu insuffisant, il fut décidé, en 1529, par les officiers municipaux, qu’on demanderait au roi des lettres patentes « pour avoir le droit d’acquérir plusieurs maisons voisines, en les payant à leur juste valeur. » François Ier, jaloux de tout ce qui pouvait contribuer à l’agrandissement et à l’éclat de sa capitale, s’empressa d’accorder l’autorisation demandée et, le 15 juillet 1533, la première pierre du monument que l’on voit aujourd’hui fut posée en présence du Prévost des marchands maître Pierre Viole, sieur d’Athis, conseiller au parlement, des échevins Gervais Larcher, Jacques Boursier, Claude Daniel et Jean Barthélemy.
La cérémonie se fit en grande solennité, dit l’historien Dubreul : « pendant que sonnaient les fifres, tambourins, trompettes et clerons ; artillerie, cinquante hacquebuttes à crocq de la Ville avec les hacquebuttiers d’icelle Ville qui sont en grand nombre. Et aussi sonnaient à carillon les cloches de Saint-Jean-en-Grève, du Saint-Esprit et de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Aussi, au milieu de la Grève, il y avait vin défoncé, tables dressées, pain et vin pour donner à boire à tous venants, et criant le menu peuple à haute voix : “Vive le roy et messieurs de la Ville. ” »
Dominique Boccador, de Cortone, qui avait fait le dessin du nouvel Hôtel de Ville, fut chargé de la direction des travaux, à raison de deux cent cinquante livres de gages. Maître Thomas Choqueur, tailleur d’imaiges, et Charles, painctre, furent engagés, moyennant quatre livres tournois par pièce de sculpture ou de peinture.
Ralentis par les évènements politiques du règne de François Ier, les travaux ne furent achevés qu’en 1608, c’est-à-dire soixante-quinze ans après la pose de la première pierre.
L’Hôtel de Ville se composait alors d’un corps de bâtiment principal dont la porte, donnant sur la place de Grève, conduisait, par un large perron et un escalier de dix-neuf marches qui existe encore aujourd’hui, à la cour en forme de trapèze qui occupe le centre de l’édifice actuel. À ce bâtiment était adossé, du côté du nord, l’ancienne chapelle du Saint-Esprit et une partie de l’hospice du même nom. Du côté opposé, c’est-à-dire vers la Seine, un autre bâtiment était réuni au corps principal par l’ancienne arcade Saint-Jean, sous laquelle passait la rue du Martroy, longeant l’Hôtel de Ville et l’église Saint-Jean qui lui faisait suite à l’ouest. Des maisons particulières, traversées par l’étroite rue de la Mortellerie, séparaient tous ces bâtiments du quai et de la rivière.
Dès le milieu du siècle dernier, les bâtiments de l’Hôtel de Ville de Paris furent trouvés insuffisants pour les besoins de l’administration municipale. Divers projets furent mis en avant. On songea d’abord à l’emplacement de l’hôtel Conti, où fut bâti depuis l’hôtel des Monnaies. On eut aussi l’idée de placer la maison commune sur le terre-plein du pont Neuf, à l’endroit où se trouve aujourd’hui la statue de Henri IV ; on y trouvait une largeur plus grande que la façade de l’ancien Hôtel de Ville ; le prolongement du terrain en arrière, sur le sable vif et le tuf, était facile et n’exigeait point de pilotis. Ce projet fut abandonné, puis repris un moment sous l’Empire, lorsqu’il s’agit du percement d’une rue Impériale entre le Louvre et la barrière du Trône.
Après la Révolution, la création de l’octroi, des contributions indirectes, des poids et mesures, de la caisse de Poissy, obligèrent de louer plusieurs maisons voisines de l’ancien Hôtel de Ville. Il fallut bientôt loger ailleurs le Préfet, le secrétaire général, l’état-major de la garde nationale, la caisse municipale. En 1802, quand la préfecture de la Seine fut jointe à l’administration municipale, on dut songer à un agrandissement considérable. M. Frochot, qui fut le premier Préfet de la Seine, provoqua l’acquisition, par la Ville, de l’emplacement de l’ancienne église de Saint-Jean-en-Grève. Tous les services détachés rentrèrent alors à l’Hôtel de Ville, et la chapelle Saint-Jean fut appropriée aux grandes réunions et cérémonies. Pendant les Cent-Jours, la question de l’agrandissement de l’Hôtel de Ville et de son déplacement pour l’ouverture de la rue Impériale fut encore agitée. On trouve aux archives de la Ville le programme d’un concours publié à ce sujet. L’Empereur voulait que l’Hôtel de Ville ne se trouvât point sur l’alignement, déjà tracé, de la grande rue Impériale, et qu’il pût recevoir, dans les grandes cérémonies, au moins six mille personnes. On proposa de construire un nouvel édifice au fond de la place de Grève agrandie et mise en communication avec Notre-Dame par un pont triomphal. M. le comte de Bondy était alors Préfet de la Seine.
Sous la Restauration, tous les projets relatifs à l’Hôtel de Ville furent suspendus. En 1832, M. de Bondy, redevenu Préfet, les fit étudier de nouveau. Enfin, les évènements politiques de 1834 à 1835 engagèrent son successeur, M. le comte de Rambuteau, à presser auprès du conseil municipal l’exécution d’un agrandissement qui avait aussi pour objet d’isoler l’Hôtel de Ville et d’en faciliter la défense en cas d’émeutes populaires.
Une commission, composée de plusieurs membres du conseil municipal et d’hommes spéciaux, approuva les plans proposés par l’architecte de la Ville, M. Godde, et M. Lesueur fut appelé à l’honneur de partager avec lui cette grande tâche.
Les travaux commencèrent le 20 août 1837. En 1844, les bureaux étaient installés dans l’aile qui donnait sur la rue de la Tixéranderie, aujourd’hui rue de Rivoli, et le Préfet prenait possession de ses appartements à l’entresol de l’aile qui fait face au quai. L’ensemble des constructions était achevé en 1846.
Dans cette restauration de l’Hôtel de Ville, l’ancien corps principal et ses deux pavillons ont été conservés à peu près intacts. L’arcade Saint-Jean, qui donnait passage à la rue du Martroy, est devenue la porte d’entrée de la cour et des appartements privés du Préfet de la Seine. On n’a fait qu’ajouter deux autres corps de bâtiments à peu près de même style, et deux autres pavillons, de manière à doubler la longueur de l’édifice. L’ancienne façade avait soixante mètres de développement ; le nouvel hôtel forme un rectangle dont les grands côtés ont cent vingt mètres et les petits quatre-vingt. Les pavillons extrêmes, sans s’éloigner beaucoup du caractère du reste de la façade, forment une transition assez naturelle du style du XVIe siècle vers l’architecture plus classique des trois autres côtés, qui permet des ouvertures plus larges et plus appropriées aux besoins modernes.
Quatre-vingt-quatorze niches à frontons avaient été réservées dans les entrecolonnements pour recevoir les statues des grands hommes qui ont illustré la ville de Paris. Toutes celles de la façade principale, au nombre de quarante-six, sont déjà occupées par des personnages dont les noms sont inscrits en caractères très visibles sur chaque piédestal.
Pavillon du nord. – En commençant par le troisième étage du pavillon situé au coin de la rue de Rivoli, on trouve :





























