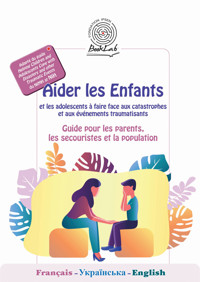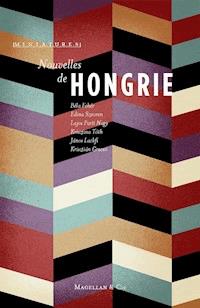
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À la découverte des traditions et de la culture de la Hongrie.
C’est à un voyage rude et puissant en Europe centrale, dans la Mitteleuropa, que nous invite ce nouveau volume de la collection « Miniatures », qui en compte désormais trente-six, sur ce principe de la mise en valeur des rouages intimes d’un pays vu par ses propres auteurs contemporains. Depuis la révolution de 1956 réprimée dans le sang par le pouvoir soviétique, depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et la disparition progressive du rideau de fer, depuis l’ouverture de la Hongrie à l’Europe de l’Ouest et au monde dans la foulée, cette Mitteleuropa ne cesse de se reconstituer à l’intérieur de l’Union européenne, sur les ruines de l’ancien Empire austro-hongrois.
Laissez-vous emporter dans un formidable voyage grâce aux nouvelles hongroises de la collection Miniatures !
À PROPOS DES ÉDITIONS
Créées en 1999, les éditions Magellan & Cie souhaitent donner la parole aux écrivains-voyageurs de toutes les époques.
Marco Polo, Christophe Colomb, Pierre Loti ou Gérard de Nerval, explorateurs pour les uns, auteurs romantiques pour les autres, dévoilent des terres lointaines et moins lointaines. Des confins de l’Amérique latine à la Chine en passant par la Turquie, les quatre coins du monde connu sont explorés.
À ces voix des siècles passés s’associent des auteurs contemporains, maliens, libanais ou corses, et les coups de crayon de carnettistes résolument modernes et audacieux qui expriment et interrogent l’altérité.
EXTRAIT DE ALCOOL
Un vent de tempête avait hurlé toute la journée. J’arrivai à Bátyaberek avec un peu de retard, le soleil était déjà couché. Mes hôtes étaient d’une extrême gentillesse, jamais ils ne m’auraient laissé mettre un pied chez eux sans m’offrir un verre de cette pálinka au sureau qui fait la renommée du pays et constitue, à les croire, le secret de la longévité.
Ce qui est fort vraisemblable puisqu’à l’exemple de Nándi, l’aïeul aux quatre.vingt-dix-sept printemps, tous les hommes de la famille se trouvaient dans un état d’ébriété avancé et n’interrompirent leur bruyante sérénade que pour s’écrouler soudain par terre et fondre en larmes. Je notai à la hâte quelques airs. Fait surprenant, leur répertoire semblait se limiter à des questions de sexualité. Évike, la fille de la maîtresse de maison, me fit savoir que les gens d’ici ne portaient qu’un intérêt relatif aux bergerettes et aux rengaines de brigands.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
C’est à un voyage rude et puissant en Europe centrale, dans la Mitteleuropa, que nous invite ce nouveau volume de la collection « Miniatures », qui en compte désormais trente-six, sur ce principe de la mise en valeur des rouages intimes d’un pays vu par ses propres auteurs contemporains. Depuis la révolution de 1956 réprimée dans le sang par le pouvoir soviétique, depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et la disparition progressive du rideau de fer, depuis l’ouverture de la Hongrie à l’Europe de l’Ouest et au monde dans la foulée, cette Mitteleuropa ne cesse de se reconstituer à l’intérieur de l’Union européenne, sur les ruines de l’ancien Empire austro-hongrois.
Les sept frontières actuelles de la Hongrie, avec l’Autriche, la Slovaquie, l’Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la Slovénie, disent bien à quel point cette terre magyare, forte de dix millions d’habitants, est au cœur de l’Europe centrale. La culture hongroise, c’est d’abord une langue, une langue qui a survécu comme un îlot au milieu d’un océan de parlers indo-européens et dont les nombreux emprunts au slave et au germanique n’ont pas altéré la structure profonde, marquée par l’agglutination et l’harmonie vocale.
C’est ensuite le triangle de création artistique Prague-Vienne-Budapest, l’un des plus fertiles de l’histoire de l’humanité. Musique, peinture, architecture, littérature, cinéma, psychanalyse : le XXe siècle s’inventa notamment dans ces villes. Béla Bartók, Franz Liszt ou György Ligeti pour la musique ; Magda Szabó, Sándor Márai, Dezső Kosztolányi, Péter Esterházy ou Péter Nádas pour la littérature ; István Szabó ou Béla Tarr pour le cinéma – ces noms ont marqué en profondeur la conscience culturelle européenne.
La Hongrie, enfin, traversée, retraversée, ballottée en tous sens par l’histoire européenne, s’est forgée d’elle-même une image qui n’est pas toujours celle que nous lui prêtons. Sentinelle auto-proclamée d’une Europe dont elle s’estime parfois mal-aimée malgré son indéfectible conviction d’en faire partie intégrante, elle nous demande un effort de compréhension plus exigeant sans doute que celui auquel le traitement de l’actualité nous donne droit.
Les six nouvelles réunies dans ce recueil, traduites par un couple emblématique de cette « évidence » européenne (lui est belge, elle hongroise), ont été écrites par des auteurs nés pour la plupart dans la Hongrie communiste. Elles constituent une photographie de la littérature hongroise d’aujourd’hui. Distanciation, ironie, crudité, expressionisme, sens de l’Histoire, allusions politiques marquent ces textes. À l’instar des ponts qui relient Pest l’industrieuse et Buda la vénérable, puissent-ils donner au lecteur l’envie de passer de l’autre côté du miroir et de découvrir cette « île enclavée » en plein centre de notre continent, si éloignée et pourtant si proche.
Grégory Dejaeger et Pierre Astier
ALCOOL
par Béla Fehér
traduit du hongrois par Éva Kovács et Grégory Dejaeger
Un vent de tempête avait hurlé toute la journée. J’arrivai à Bátyaberek avec un peu de retard, le soleil était déjà couché. Mes hôtes étaient d’une extrême gentillesse, jamais ils ne m’auraient laissé mettre un pied chez eux sans m’offrir un verre de cette pálinka1 au sureau qui fait la renommée du pays et constitue, à les croire, le secret de la longévité. Ce qui est fort vraisemblable puisqu’à l’exemple de Nándi, l’aïeul aux quatre-vingt-dix-sept printemps, tous les hommes de la famille se trouvaient dans un état d’ébriété avancé et n’interrompirent leur bruyante sérénade que pour s’écrouler soudain par terre et fondre en larmes. Je notai à la hâte quelques airs. Fait surprenant, leur répertoire semblait se limiter à des questions de sexualité. Évike, la fille de la maîtresse de maison, me fit savoir que les gens d’ici ne portaient qu’un intérêt relatif aux bergerettes2 et aux rengaines de brigands.
Pour le dîner, il y eut du ragoût de chevreuil, grâce à Toni, chef de famille au grand cœur et braconnier, le plus efficace de la région. On raconte en riant qu’une fois, au début du mois de janvier, il s’était tellement enivré dans les champs que les lièvres avaient mangé son pantalon en cuir pendant qu’il ronflait sous les buissons et que, de surcroît, quelqu’un avait fait main basse sur sa mitraillette soviétique. Malheureusement, Toni fait entendre un tel raclement de gorge dès qu’il ouvre la bouche, qu’il est impossible de comprendre un traître mot de ce qu’il dit, et il est, dès lors – perte cruelle –, peu probable que je parvienne à lui soutirer une histoire.
Mis à part quelques aigreurs d’estomac, je passai une bonne nuit de sommeil et dormis jusqu’à l’aube. Au lever du jour, Toni et son frère de lait déboulèrent dans ma chambre en compagnie de six camarades. J’étais assis sur mon lit, m’efforçant de garder bonne contenance, pendant que ces hommes hirsutes, aguerris au combat, enjambaient ma couette avec leurs bottes boueuses en agitant leurs dames-jeannes, l’un d’eux voulant même se coucher à mes côtés. J’ignore combien de temps ces festivités auraient duré si la maîtresse de céans ne s’était mise à les frapper sur la tête à coups de barre de fer.
On me servit du lard poêlé pour le petit déjeuner. Un mets copieux que l’on fit précéder de deux verres d’eau-de-vie, les habitants du lieu refusant catégoriquement de manger la gorge sèche, une pratique qui, ils en sont persuadés, les mènerait droit au tombeau. Je m’interdis toutefois de toucher à la bière, boisson qu’ils affectionnent de grand matin, ainsi qu’en attestaient les dix-sept pintes vides que j’aperçus sur la table. J’aurais aimé que l’oncle Nándi me raconte sa vie au magnétophone, malheureusement il dormait dans la porcherie. C’est en vain que nous le secouâmes. Et nos coups de pied furent sans effet. « Ne vous donnez pas cette peine, nous lança tante Marcsi d’un air fataliste, il a sifflé une bouteille de rhum pâtissier en plus de ses six bières et, dans ces cas-là, il erre en enfer et ne reprend connaissance qu’une fois à table. » Tante Marcsi manifeste, elle aussi, un comportement bizarre. Peinée d’avoir trouvé une bouteille dans la réserve, elle s’aperçut à son grand bonheur qu’elle ne contenait que du thé à la camomille et la siphonna d’un trait avant de se rendre compte qu’il s’agissait de brou de noix. Le temps de constater son erreur, la bouteille y était passée. Elle se plaignit ensuite de vertiges, et je la vis plonger, tête la première, dans le buffet.
Et maintenant, place au boulot ! Je demandai s’il se trouvait au hameau quelque ancêtre disposant d’un répertoire d’airs folkloriques bien fourni. On me recommanda l’oncle Mányai. Évike s’offrit de m’accompagner jusque chez le barde ; elle répugnait à me laisser y aller seul en raison des innombrables ivrognes qui infestaient le village. Je m’aperçus bien vite que la petiote avait la démarche mal assurée, ce qu’elle confirma en allant se cogner contre un poteau électrique. Nous n’étions pas encore à mi-chemin que la pauvre chose s’écroula dans le fossé. Elle m’avoua alors avoir siroté un peu de liqueur de griotte maison, un litre à peine ; c’est la seule chose qui fait de l’effet lorsqu’elle est de mauvaise humeur. Au lieu de m’assister pour collecter les chansons, elle me dit de la retrouver chez le marchand de boissons.
L’oncle Mányai était dans son hangar, parmi les fûts de marc. Il se tenait figé, cramponné à un tube en cuivre, les yeux grands ouverts et le chapeau de guingois sur une oreille. Il serrait dans ses mains calleuses un petit verre à liqueur ébréché que j’eus toutes les peines du monde à lui arracher. Il protesta alors de son innocence et exigea sa libération immédiate. J’eus beau le supplier, il refusa de chanter. Lorsque, dans l’espoir de gagner sa confiance, je me dis prêt à accepter une gorgée de pálinka, il se jeta à mon cou et me dit qu’il n’y avait pas de gorgées, seulement des chopes pleines ! Heureusement, il n’était plus en état de me servir et il s’écroula, inconscient, sur le tas de bois. Quand je revins chez le marchand de boissons, Évike avait oublié qui j’étais. Je commandai une goutte au comptoir. Puis une autre. Puis encore une autre.
C’est vrai que ça aide.
1. Eau-de-vie traditionnelle hongroise. (N.d.T.)
2. Poèmes à forme fixe, très en vogue au XVe siècle, dont le thème est de nature pastorale. (N.d.É.)
LE MEILLEUR BOURREAU DU PAYS
par Edina Szvoren
traduit du hongrois par Éva Kovács et Grégory Dejaeger
Les voisins ont eu un enfant : un petit diablotin tout potelé au visage rond comme un curé de paroisse. L’épouse est femme au foyer depuis des années, son mari est exécuteur – mais aussi, depuis l’introduction de la peine de mort1, le meilleur bourreau du pays. Celui-ci a fait appel aux services d’un ferronnier pour renforcer les serrures de la porte d’entrée et installer devant les fenêtres de leur demi-étage des grilles ornementées au tiers inférieur élégamment cintré – quoi de plus naturel de la part d’un homme soudain conscient de détenir une chose qui lui incombe. Nous qui ne savons pas avoir d’enfants sommes presque jaloux de leur inquiétude.
Nous voyons rarement nos voisins. Mon mari est sans doute un peu gêné de l’estime que nous leur témoignons : leur bonheur respectable, leur modestie. Unique tracas de leur vie insouciante, leur appartement d’une pièce et demie ne permet pas d’accueillir les amis d’enfance de la femme, confinés en province. Le plus souvent, c’est depuis notre balcon, où, après le travail, nous nous installons dans les transats encore maculés de la crème solaire de ma défunte mère, que nous avons l’occasion de saluer nos voisins. Nous apercevons régulièrement, accoudé au parapet du balcon, le mari, vêtu de sa robe de chambre en velours côtelé, en train d’observer à l’aide de jumelles – son « binocle » – le comportement des corneilles qui nichent dans le parc. Il consigne ses observations dans un calepin. Il nous a un jour montré les notes qu’il avait écrites le jour de la conception du bébé. Il nous a tendu son carnet par-dessus le parapet et nous avons lu, tête contre tête, en balbutiant, les trois lignes qu’il avait entourées au feutre. Nous étions émus : les corneilles, elles aussi, avaient construit leur nid ce jour-là. C’était, nous le savions, l’un des moments les plus sublimes de notre vie.
Le petit curé – le diablotin – éclate parfois en sanglots. Si je colle l’oreille contre le mur du séjour, je peux même entendre les gazouillis encourageants de la voisine. Il arrive que j’appelle mon mari à mes côtés. Il me dit parfois que le mur est glacé, alors je pose la paume chaleureuse de ma main sur son visage. J’ai, du reste, oublié de quoi il parlait, l’autre jour, quand il disait que c’était la rétribution divine. Mon époux est la seule personne de mon entourage qui croit au ciel et à l’enfer ; il ne comprend pas comment je peux appeler l’enfant des voisins un diablotin.