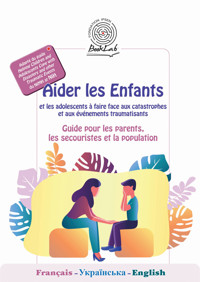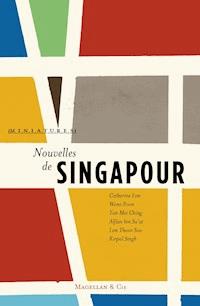
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniatures
- Sprache: Französisch
À la découverte des traditions et de la culture de Singapour.
Singapour, en Occident, évoque d’abord les riches heures de l’époque coloniale, puis l’insolent succès, depuis les années 1960, d’une place financière et commerciale devenue incontournable. En deux générations, l’indépendance acquise en 1965 sous l’impulsion de Lee Kuan Yew, a profondément transformé l’identité du « Gibraltar d’Extrême-Orient ». Le melting pot singapourien (Européens, Chinois, Malais et Indiens), ayant en partage la langue anglaise et sa culture, ne pouvait pas ne pas en venir au « storytelling ». Car cette cité-État est riche d’histoires individuelles.
Quand on pense Singapour et litérature d’hier, l’image d’Hemingway, sirotant un Singapore Sling au bar de l’hôtel Rafles sous les pales des ventilateurs, s’impose. Mais si l’on pense Singapour et littérature d’aujourd’hui, pour mieux la comprendre, alors il faut lire les auteurs de ce recueil, représentants d’une culture mosaïque en plein devenir.
Laissez-vous emporter dans un formidable voyage grâce aux nouvelles singapouriennes de la collection Miniatures !
À PROPOS DES ÉDITIONS
Créées en 1999, les éditions Magellan & Cie souhaitent donner la parole aux écrivains-voyageurs de toutes les époques.
Marco Polo, Christophe Colomb, Pierre Loti ou Gérard de Nerval, explorateurs pour les uns, auteurs romantiques pour les autres, dévoilent des terres lointaines et moins lointaines. Des confins de l’Amérique latine à la Chine en passant par la Turquie, les quatre coins du monde connu sont explorés.
À ces voix des siècles passés s’associent des auteurs contemporains, maliens, libanais ou corses, et les coups de crayon de carnettistes résolument modernes et audacieux qui expriment et interrogent l’altérité.
EXTRAIT
Lee Geok Chan était l’une de mes élèves en formation préuniversitaire. L’une de celles et ceux pour qui de longues heures d’étude assuraient, tout au plus, une réussite de justesse aux examens. C’était une jeune fille pâle, de petite taille, à l’air sérieux, que l’on voyait toujours avec un livre ou une liasse de notes à la main. Son père était tailleur, sa mère blanchisseuse ; il y avait trois frères et deux soeurs. Geok Chan était la deuxième de la fratrie et l’aînée des filles. Son désir de passer l’examen, de trouver un travail et d’aider sa famille la mettait dans un état permanent de tension nerveuse, si bien qu’on la trouvait à tout moment clignant anxieusement des yeux tandis qu’elle notait mot à mot le cours d’un professeur, copiait les notes du tableau avec une application extrême, ou rédigeait une dissertation avec une concentration d’autant plus remarquable compte tenu du bruit et du laisser-aller total qui régnaient autour d’elle dans la classe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
Singapour, en Occident, évoque d’abord les riches heures de l’époque coloniale (la littérature et le cinéma international en ont fixé sur le papier ou sur la pellicule d’inoubliables moments), puis l’insolent succès, depuis les années 1960, d’une redoutable place financière (la quatrième du monde) et commerciale. À y regarder d’un peu plus près, ce succès, similaire à celui de Hong Kong, annonçait d’ailleurs le développement à venir de la Chine continentale.
De culture singapourienne, à proprement dire, il n’en est question que depuis quelques années. Le melting pot de cette cité-État (Européens, Chinois, Malais et Indiens), ayant en partage la langue anglaise et sa culture, ne pouvait pas ne pas en venir au storytelling. Car Singapour, où le sens du collectif est une priorité, un devoir, est riche d’histoires individuelles.
Ce territoire insulaire du sud de la Malaisie faisait partie, au début du XVe siècle, d’un sultanat convoité et exploité successivement par différentes puissances coloniales, jusqu’à ce que, coup de génie, l’Anglais Thomas Stamford Bingley Raffles y installe en 1826 un comptoir commercial, profitant de la situation géographique privilégiée de l’île en Asie du Sud-Est. Durant la colonisation britannique, l’immigration se développa. Les Britanniques firent venir dans la région des travailleurs chinois et indiens pour encourager le commerce et travailler dans les plantations d’hévéas. Compte tenu de l’interdiction faite aux étrangers d’acheter des terres agricoles en Malaisie, ces communautés s’installèrent à Singapour, surnommée alors en Occident le « Gibraltar de l’Extrême-Orient ». La population malaise vit dès lors s’installer là Chinois, Indiens et Tamouls du Sri-Lanka, tandis que continuait à se renforcer une minorité d’origine européenne. En 1965, l’île se libérait des Britanniques et accédait à l’indépendance sous la forte influence de Lee Kuan Yew (né en 1923), le père de la Singapour moderne.
Dans la vieille Europe, hormis au Royaume-Uni, on connaît assez peu, voire pas du tout la littérature de Singapour. C’est une erreur, un préjugé, une ignorance, une absence de curiosité. Car ce sont moins les lieux que les hommes et les femmes qui y vivent qui font la littérature. Et si la world fiction (tant vantée par certains) existe, sur la base d’un métissage culturel et linguistique, c’est bien dans de hauts lieux ultra-modernes comme celui-ci qu’elle fleurit aujourd’hui. Accompagnée en cela par un marché du livre en croissance constante.
Quand on pense à Singapour et à la littérature d’hier, l’image d’Ernest Hemingway sirotant au bar de l’hôtel Raffles un Singapore Sling (mélange de gin, Cherry Brandy, jus d’ananas, jus de citron vert, Cointreau, Bénédictine, grenadine, angostura, servi avec une tranche d’ananas et une cerise confite), sous les pales des ventilateurs, dans la moiteur tropicale, s’impose. Si l’on pense Singapour et littérature d’aujourd’hui, pour en avoir une idée plus juste et sortir de ses préjugés, alors il faut lire ici Alfian bin Sa’at, Kirpal Singh, Catherine Lim, Lim Thean Soo, Tan Mei Ching et Wena Poon.
Pierre Astier
L’ÉLÈVE LEE GEOK CHAN
par Catherine LimTraduit de l’anglais par Claire Mulkai
Lee Geok Chan était l’une de mes élèves en formation préuniversitaire. L’une de celles et ceux pour qui de longues heures d’étude assuraient, tout au plus, une réussite de justesse aux examens. C’était une jeune fille pâle, de petite taille, à l’air sérieux, que l’on voyait toujours avec un livre ou une liasse de notes à la main. Son père était tailleur, sa mère blanchisseuse ; il y avait trois frères et deux sœurs. Geok Chan était la deuxième de la fratrie et l’aînée des filles.
Son désir de passer l’examen, de trouver un travail et d’aider sa famille la mettait dans un état permanent de tension nerveuse, si bien qu’on la trouvait à tout moment clignant anxieusement des yeux tandis qu’elle notait mot à mot le cours d’un professeur, copiait les notes du tableau avec une application extrême, ou rédigeait une dissertation avec une concentration d’autant plus remarquable compte tenu du bruit et du laisser-aller total qui régnaient autour d’elle dans la classe.
Je trouvais toujours difficile de devoir dire à Geok Chan, en réponse à sa demande timide sur la manière dont elle pourrait améliorer son expression écrite, que son anglais était plutôt faible, son usage des mots fréquemment impropre, et qu’elle s’écartait souvent du sujet. Elle acquiesçait docilement d’un signe de tête, mais en même temps la déception se lisait clairement sur son visage. Les cours supplémentaires ne semblaient pas avoir servi à grand-chose et, de semaine en semaine, il me devenait particulièrement pénible de lui tendre une copie, de la voir s’en saisir avec impatience pour vérifier la note, puis d’observer l’expression abattue sur le mince et pâle visage.
Comme tant d’autres, Geok Chan préparait l’examen du A-Level1 pour la fin de l’année. Au cours des derniers mois avant l’examen, elle venait souvent me voir avec un petit sourire nerveux et me tendait un paquet de dissertations à corriger.
L’une de ces dissertations retint mon attention. Elle était meilleure que les autres ; en fait, c’était la meilleure qu’elle eût jamais écrite, et il y avait encore de l’espoir, pour elle, si elle était capable de produire quelque chose de ce genre à l’examen. J’ai oublié les termes exacts du sujet qu’elle avait choisi je ne sais où, mais cela concernait le bonheur. Geok Chan avait écrit avec simplicité et conviction sur sa conception du bonheur ; certains passages étaient, à mon avis, d’un lyrisme remarquable. Je me rendis compte soudain que, libérée des contraintes des sujets de dissertation conventionnels, elle écrivait avec aisance et un plaisir évident.
Je l’appelai et fis des commentaires élogieux sur sa dissertation. Elle rayonnait de fierté. « Si j’écris comme cela pour le General Paper2, est-ce que j’obtiendrai un crédit ? », voulut-elle savoir. Je dus l’avertir, non sans tristesse, que les sujets de dissertation du General Paper n’étaient pas de nature à permettre cette spontanéité. Je l’encourageai cependant à continuer d’exprimer ses sentiments intimes.
« Ils sont en moi tout le temps. Je n’arrivais pas à les exprimer avant, maintenant je pense que j’en suis capable », dit-elle en clignant des yeux, non avec nervosité, mais avec une sorte de joie fébrile.
Le matin de l’examen, Geok Chan a été tuée dans un accident de la route. Elle marchait sur le trottoir, juste devant l’école, et s’apprêtait à franchir les grilles quand un camion est arrivé à toute allure, a franchi comme un fou le terre-plein central et a percuté la jeune fille. Elle est morte sur le coup. C’était la mort la plus cruelle que j’aie jamais connue ; mes collègues et moi avons longtemps pleuré la disparition de cette fille bien, sérieuse, qui avait toujours fait de son mieux, et dont la seule ambition était de gagner assez d’argent pour aider sa famille.
La dissertation sur le bonheur qui m’avait surprise par sa force et son lyrisme se trouvait au milieu d’une pile de copies non corrigées sur mon bureau, presque comme un souvenir, car Geok Chan avait repris toutes ses autres dissertations et m’avait en quelque sorte confié celle-ci. Quand je suis allée voir ses parents, lesquels étaient trop accablés de chagrin pour dire quoi que ce soit, j’ai emporté cette dissertation avec moi et l’ai remise à son frère aîné, qui s’est contenté de la mettre de côté avec les autres affaires d’école de sa sœur, entassées sur une petite table en bois, dans le modeste logement social de deux pièces.
Le souvenir de ce petit corps sous des feuilles de papier journal, sur la chaussée, continua de me perturber pendant des jours et des jours. Le sang avait coulé abondamment ; j’avais jeté un rapide coup d’œil avant de me détourner et de revenir en hâte dans la salle des professeurs, d’où nous avions été appelés par les cris frénétiques des élèves témoins de l’horrible accident. Mais la scène me resta longtemps à l’esprit, et il était inévitable que plusieurs d’entre nous rêvent de Lee Geok Chan dans notre sommeil.
Je rêvai qu’elle s’approchait de moi avec un poème sur le chagrin ou quelque chose de ce genre et me demandait de le noter. Un de mes collègues rêva d’elle exactement comme elle était ce jour-là, sous les journaux, sur une chaussée mouillée, juste devant la grille de l’école.
Dans l’effervescence d’une nouvelle année scolaire, quand de nouveaux visages enthousiastes envahirent les couloirs de l’école, Lee Geok Chan fut bientôt oubliée. De temps à autre, cependant, quelque chose venait la rappeler à notre mémoire et nous nous souvenions alors de ce jour affreux de décembre.
L’une de ces occasions fut la publication des résultats de l’examen en mars. Les élèves commencèrent à arriver à l’école très tôt le matin, dès qu’ils apprirent par le journal que le ministère de l’Éducation communiquerait les résultats ce jour-là. La liste informatique avec le nom de Geok Chan comportait les notes pour les matières suivantes : histoire, langue chinoise et le General Paper. Elle avait obtenu un crédit en chinois, mais avait raté l’histoire et le General Paper.
Il devait y avoir une erreur concernant le General Paper : comment cette épreuve avait-elle pu être notée ? Geok Chan était morte avant de passer l’examen. Sa mort avait eu lieu le matin ; l’épreuve se déroulait à deux heures de l’aprèsmidi.
C’était une note très basse, la plus basse dans l’échelle. Si un ordinateur devait commettre une erreur à propos de quelqu’un qui était déjà mort, commentèrent certains d’entre nous avec un rire gêné, il aurait pu pécher par excès de générosité !
Le frère aîné de Geok Chan vint chercher la feuille de résultats, ce qu’il fit d’un air détaché, sans un regard pour les indications portées sur la feuille, et disparut presque aussitôt.
Je vérifiai tout d’abord auprès du ministre de l’Éducation qu’il n’y avait pas eu d’erreur sur la liste ; puis j’écrivis une lettre très polie au Cambridge Syndicate of Examiners, en leur demandant pourquoi la dissertation de la candidate Lee Geok Chan avait obtenu une note aussi basse. La procédure était laborieuse, impliquant énormément de paperasserie : il y avait des formalités à respecter, dont le paiement d’une somme d’argent non négligeable.
Cambridge mit un mois pour répondre. Je reçus un simple communiqué officiel disant que la candidate avait été complètement hors sujet, car elle avait écrit un texte sur le bonheur alors qu’aucun sujet ne ressemblait de près ou de loin à celui-là. Le communiqué ajoutait que, en soi, la dissertation méritait des éloges pour sa force d’expression et de sentiment mais, étant donné qu’elle ne tenait aucun compte des sujets donnés à l’examen, on ne pouvait lui attribuer aucune note.
La sensation croissante d’excitation et de terreur qui s’empara de moi tandis que je lisais le communiqué était quelque chose dont je n’avais jamais fait l’expérience jusqu’alors. Impossible de contenir les pensées qui se pressaient dans mon esprit : j’en rediscutai bientôt avec mes collègues. Ce n’est pas possible, ce n’est pas possible, disions-nous encore et encore. Mais nous avions beau, encore et encore, nous creuser la tête, élaborer toutes sortes d’hypothèses, il n’y avait aucune explication au fait que la dissertation qui avait été envoyée à Cambridge avec des milliers d’autres, et qui avait été corrigée et notée, était la dissertation d’une élève morte.
Incapable d’en rester là, j’écrivis de nouveau à Cambridge et demandai, de toute urgence, qu’on me retourne la copie de la candidate Lee Geok Chan. J’ajoutai que j’étais prête à payer toute somme d’argent que les autorités jugeraient raisonnable pour les dédommager de leur peine.
Craignant probablement qu’une démarche de ce type ne crée un précédent pour des parents ou des enseignants anxieux qui auraient l’intention de passer au peigne fin une copie corrigée et d’argumenter en faveur d’une meilleure note, le Cambridge Syndicate rejeta la demande. Leur politique n’avait jamais été, et ne serait jamais, de retourner des copies corrigées aux candidats. Tout ce qu’ils étaient disposés à faire était de fournir un document au sujet de la copie, et cela, ils l’avaient déjà fait.
Mais il ne s’agit pas d’une copie ordinaire, c’est une personne morte qui l’a rédigée, avais-je envie de crier, exaspérée, quand je lus la réponse. Je me rendis compte qu’il serait pratiquement impossible de donner cette explication dans le langage limité de la correspondance officielle. J’essayai, néanmoins, tant j’étais désireuse de découvrir le fin mot de l’histoire, mais Cambridge choisit de ne pas répondre à mes demandes, jugeant sans doute que j’étais une excentrique à ne pas prendre au sérieux.
Je les suppliai presque de m’envoyer une copie dactylographiée de la dissertation de la candidate, de sorte que les corrections et la note puissent rester confidentielles, mais ils durent mal interpréter le ton de ma lettre, et s’offusquer, car ils finirent par me répondre qu’ils n’entretiendraient plus aucune correspondance sur ce sujet.
Je tentai de trouver de l’aide auprès de la famille de Geok Chan, mais en vain. Le frère aîné avait été nommé dans une autre ville ; les frères et sœurs plus jeunes ne semblaient pas capables de me comprendre, et les parents parlaient un dialecte que je ne comprenais pas. De toute manière, ils étaient encore trop affligés pour faire autre chose que secouer tristement la tête ou élever la voix pour maudire le chauffeur du camion qui avait tué leur fille.
Cela fait maintenant plus de dix ans que Lee Geok Chan est morte. Je ne suis pas satisfaite de l’explication que mes collègues ont finalement adoptée. Il s’agirait d’une coïncidence, la dissertation de Geok Chan et celle de quelqu’un d’autre auraient été interverties ; après tout, il y avait des milliers de copies à corriger et des confusions de ce genre n’étaient guère surprenantes. Mais le sujet était si particulier. Il traitait du bonheur, protestai-je, précisément le sujet sur lequel elle avait écrit avant l’accident. Et les qualités de fraîcheur et d’expressivité étaient exactement celles que j’avais remarquées dans cette ultime dissertation qu’elle m’avait montrée. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il y a eu une erreur, alors, ont dit certains de mes collègues. Coïncidence, erreur, les mots ont jeté un voile sur ce qui demeure, à ce jour, un mystère.
1. Lee Geok Chan étudie, à Singapour, dans un Junior College, où les élèves préparent en deux ans le GCE-A-Level (General Certificate of Education-Advanced Level), qui leur donne accès à des études universitaires. (N.d.T.)
2. Le General Paper est l’une des épreuves du GCE-A-Level. (N.d.T.)
L’HOMME QUI AVAIT PEUR DES DAB
par Wena PoonTraduit de l’anglais par Alexis Bernaut
Chang attendait sa petite-fille dans la touffeur immobile de la voiture.
Il stationnait devant les portes de l’école de filles de Fairleigh, l’école privée la plus chère de l’Ontario, selon son fils. Une chose était sûre : les uniformes des écolières n’avaient pas l’air bon marché. Des vestes en laine bleu marine et des kilts de tartan pour l’hiver. Des blouses blanches impeccablement repassées et de jolies petites jupes de tennis pour l’été. Tout cela n’était pas du goût de Chang. Bien trop apprêté, avait-il fait remarquer à Sylvie lorsqu’elle avait défilé, chez eux, toute fière de se montrer dans ses différentes tenues.
L’enfant était ravie. Ce n’était qu’un aperçu de la suite, disait-elle. Elle avait déjà constaté que les uniformes des écoliers canadiens, en pure laine et coton, étaient de qualité supérieure. Rien de comparable avec ces vêtements en polyester qu’elle devait porter à Singapour et qui la grattaient. Voilà des tenues qui vous mettaient en valeur, plutôt que vous rabaisser ! Toutes ses camarades de classe, à Singapour, s’étaient montrées jalouses et ne lui avaient plus adressé la parole jusqu’à son départ. Elle allait avoir de la neige à Noël. Et, disait encore Sylvie, peut-être y aurait-il de vieux manoirs aux cheminées fumantes. Et des chevaux tirant des calèches. Après tout, expliquait-elle à ses camarades, à la récréation, en ouvrant son atlas de poche, l’Ontario était tout proche de l’Île-du-Prince-Édouard. C’était là qu’habitait Anne, de la maison aux pignons verts. Toutes ses amies adoraient Anne… la maison aux pignons verts1. Les petits boutons de rose de leurs âmes s’ouvraient à l’évocation de l’univers du Canada édouardien. Elles rêvaient de jupes longues, de bals et de garçons