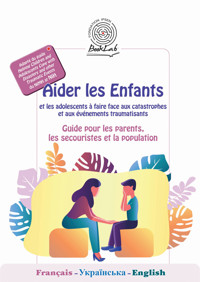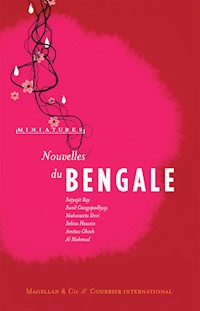
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Deux cent trente millions de personnes dans le monde parlent le bengali. Cette langue, la plus orientale des langues indo-européennes, dérivée du sanscrit, est mâtinée d’arabe et de persan. C’est la langue officielle du Bangladesh et, en Inde, du Bengale occidental; elle unifie des régions, des traditions et des couches sociales auxquelles l’Histoire a plus d’une fois imposé sa discorde. Des auteurs comme Bankim Chandra Chatterji ou Rabindranâth Tagore, Prix Nobel de littérature en 1913, ont apporté un rayonnement international à la littérature bengalie.
Les auteurs contemporains bénéficient aujourd’hui de la même effervescence. Ils puisent leurs sujets dans l’actualité sociale et politique la plus brutale, comme dans une nature baignée de douceur et dans des traditions millénaires. Et le lecteur francophone est surpris par cette liberté formelle qui offre à cette littérature les conditions de son génie. Les six auteurs réunis ici, pour certains déjà célèbres en Occident, participent par leur écriture à l’éternel questionnement de l’homme, où qu’il soit.
Alors que la mondialisation des échanges progresse, que le monde devient un pour tous, des mondes-miniatures s’imposent, des pays et des régions entières affirment leur identité, revendiquent leur histoire ou leur langue, réinvestissent pleinement leur espace. Quoi de plus parlant qu’une miniature, la nouvelle, pour lever le voile sur ce monde-là, celui d’une diversité infinie et porteuse d’espoir ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Ouvrage traduit avec le concours du Centre national du livre
Nous tenons à remercier Philippe Benoît, Christiane Besse, Arup De, Laurent Jalicous, Naveen Kishore, Michèle Mercier et Marielle Morin pour leur aide précieuse.
Avant-propos
Deux cent trente millions de personnes dans le monde parlent le bengali. Autant dire qu’en cette langue s’est toujours exprimée et s’exprime encore une littérature riche et variée.
Cette diversité qui a participé à son succès tient à une convergence de facteurs linguistiques et historiques. La langue d’abord, la plus orientale des langues indo-européennes, dérivée du sanscrit, est mâtinée d’arabe et de persan. C’est la langue officielle du Bangladesh et, en Inde, du Bengale occidental ; elle unifie donc envers et contre tout des régions, des traditions et des couches sociales auxquelles l’Histoire a plus d’une fois imposé sa discorde.
Mais cette mosaïque culturelle ne s’arrête pas aux frontières du Bengale qui a subi, avant toute autre région de la péninsule, l’influence coloniale de l’Occident. Au XIXe siècle, les Britanniques font du Bengale leur centre administratif et de Calcutta la capitale de l’Inde qui devient alors un haut centre culturel, point de rencontre obligé entre intellectuels et artistes d’Orient et d’Occident.
La littérature bengalie s’était brillamment illustrée dès le Moyen Âge et jusqu’au XVIIIe siècle à travers une poésie mystique souvent transmise oralement. Sa renaissance survient au XIXe siècle au contact de l’Occident dans lequel elle puise un renouveau formel en explorant des genres poétiques tels que le sonnet et bien sûr la fiction. Le bouillonnement créatif du Bengale semble alors inépuisable. Apparaissent des auteurs comme Bankim Chandra Chatterji (1838-1894) fasciné par les épopées historiques de la littérature anglaise. Puis surgit dans ce paysage renaissant Rabindranâth Tagore, Prix Nobel de littérature en 1913, qui apporte à la littérature bengalie un rayonnement international. La force de son œuvre tient à la façon dont sa formation occidentale s’est coulée dans les racines les plus profondes de sa tradition bengalie. L’universalité de cette culture bengalie s’impose, illuminée par une expression aussi moderne qu’atypique.
La liste des grands auteurs de cette époque serait trop longue à établir. Celle des auteurs contemporains n’a rien à lui envier. Poètes, nouvellistes, romanciers, essayistes, la littérature bengalie bénéficie aujourd’hui de la même effervescence et de la même diversité. Elle puise ses sujets dans l’actualité sociale et politique la plus brutale, dans la cruauté des injustices, mais aussi dans une nature baignée de douceur et dans des traditions millénaires. Bien qu’il soit impossible d’enfermer cette littérature aux multiples facettes dans quelques qualificatifs réducteurs, le lecteur francophone est avant tout surpris par cette proximité de la douceur et de la violence et par cette liberté formelle qui offre à la littérature les conditions de son génie.
Choisir six textes à présenter au lecteur francophone relevait du défi. Nous avons choisi six auteurs, pour certains déjà célèbres en Occident, pour d’autres quasi inconnus, six monstres sacrés de la littérature bengalie du Bangladesh, du Bengale occidental ou d’Occident, qui, par leur écriture, participent à l’éternel questionnement de l’homme, où qu’il soit.
Laure PÉCHER
Satyajit Ray (2 mai 1921-23 avril 1992), originaire de Calcutta et issu d’une famille aisée, est un des plus grands réalisateurs bengali qui connut le succès dès son premier film Pather Panchali (1956, primé à Cannes). Outre son œuvre cinématographique, il a écrit de nombreuses nouvelles, des histoires pour enfants et des récits traduits dans le monde entier et souvent adaptés au cinéma. Il doit son goût pour la littérature à son père, lui-même écrivain et poète.
Le Journal de Pikoo n’a quant à lui jamais été traduit en français jusqu’à ce jour. C’est pourtant un des textes les plus célèbres de Satyajit Ray qui l’a adapté à l’écran, d’abord pour la télévision, puis au cinéma sous la forme d’un court-métrage considéré comme un des chefs-d’œuvre du cinéma indien. « Pikoo est un film très complexe, a dit Satyajit Ray dans une interview donnée au Cineste Magazine. C’est une déclaration poétique » […] « Si une femme doit être infidèle, si elle doit avoir une relation en dehors du mariage, elle ne peut s’autoriser aucun épanchement à l’égard de ses enfants, dans ce cas-là, à l’égard de son fils. »
REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES
Parmi les nombreux ouvrages de l’auteur, on peut citer un essai traduit en français Écrits sur le Cinéma (Paris, Éditions Jean-Caude Lattés, 1983) et la série policière des aventures de Feluda, Lalmohan Babu et Tapesh publié aux éditions Kailash dont Les Aventures de Feluda (1998), Bollywood Bombay (2006) et Le Christ de Tintoretto (1997).
LE JOURNAL DE PIKOO
J’écris mon journal. J’écris mon journal dans un cahier bleu tout neuf tout bleu. J’écris assis sur mon lit. Grand-père aussi écrit son journal tous les jours mais pas maintenant parce qu’il est malade. Je sais le nom de sa maladie, c’est tombose coronanienne. Papa n’écrit pas de journal. Maman non plus ni dada1. C’est seulement moi et grand-père. Mon cahier est plus gros que le sien. C’est Onukul qui me l’a apporté, il a coûté vingt roupies, Maman me les avait données avant. Je vais écrire tous les jours, tous les jours quand il n’y a pas école. Aujourd’hui il n’y a pas école, c’est pas dimanche, mais il y a grève aujourd’hui. Ça arrive souvent, c’est cool. J’ai de la chance c’est un cahier à lignes, alors mon écriture ne va pas de travers. Dada arrive à écrire droit sans lignes et papa aussi bien sûr mais il a pas le temps. Dada non plus. Ni maman. Maman ne va pas au bureau, elle travaille juste à la maison. Maman n’est pas là maintenant, elle est sortie avec oncle Hitesh, elle a dit qu’elle allait me donner quelque chose, quelque chose qu’elle achètera à New Market. Maman me donne souvent des choses depuis quelque temps. Un taille-crayon, une montre pour mettre au poignet mais elle marque tout le temps trois heures, une canne de OK, un ballon. Et aussi un livre, les Contes de Grimm, avec plein d’images. Qui sait ce qu’elle va m’amener aujourd’hui ? Peut-être un fusil à air comprimé, je lui ai dit, on verra bien, qui sait. Dhingra a tué un merle avec. Moi je ferai pareil avec le moineau qui vient tous les jours sur le balcon. J’appuierai et il tombera tout mort. Hier soir une bombe a pété très fort. Papa a dit une bombe Maman a dit non, non c’est un coup de fusil, peut-être la police, papa a dit non, une bombe. Ces temps-ci on entend souvent des grands boums par la fenêtre. Tiens ! Un klaxon ! C’est sûrement la voiture d’oncle Hitesh. Je la connais, une Standard Herald, ça veut dire que maman est rentrée.
Hier maman a rapporté un fusil à air comprimé de New Market. C’est oncle Hitesh qui me l’a donné. Il a dit : Pikoo babu c’est pour toi, c’est pas ta maman, c’est mon cadeau à moi. Oncle Hitesh a acheté un bracelet pour sa montre, une belle montre Tissot. Je me suis trompé en lisant le nom et il m’a expliqué qu’il ne fallait pas prononcer le t à la fin. Mon fusil à air comprimé est très bien et très grand. Il y a une boîte avec des plombs, beaucoup. Plus de cent. Oncle Hitesh m’a appris. J’ai tiré en l’air et Onukul a fait un saut. Le moineau n’est pas venu hier ni aujourd’hui. Il est malin. Il viendra sûrement demain. Et moi je me tiendrai prêt. Papa a dit quand il est rentré du bureau : pourquoi un fusil ? Maman a dit ça te dérange ? Papa a dit c’est déjà la guerre quel besoin d’un fusil à la maison ? Maman a dit qu’est-ce que ça peut faire ? Papa a dit tu n’as aucune jugeote. Maman a dit pourquoi tu cries à chaque fois que tu rentres du bureau. Papa a dit c’est faux. Puis papa s’est mis à parler en anglais et maman aussi. Maman parlait très vite comme au cinéma. J’ai vu Jerry Lewis et Clint Eastwood et un film hindi, j’y suis allé avec Miludi, mais il n’y avait pas de bagarres, ah ! mon stylo.
J’ai mis dans mon stylo à encre l’encre verte de papa. Pour ça j’ai pris le compte-gouttes que maman avait utilisé quand elle était enrhumée. Aujourd’hui j’écris mon journal sur le bureau de papa. Le téléphone a fait dring dring dring il y a un instant et j’ai couru décrocher. J’ai dit allô et j’ai été surpris d’entendre papa qui m’a dit c’est toi Pikoo ? J’ai dit oui c’est moi. Papa m’a demandé : maman est là ? J’ai dit non. Papa m’a demandé où est-elle ? J’ai répondu : maman est allée au cinéma avec oncle Hitesh, voir un film, un film pour les grandes personnes, c’est pourquoi maman n’est pas là. Papa a dit : ah bon ! Et il a raccroché. J’ai entendu le bruit. Après j’ai fait le numéro un sept quatre et j’ai écouté l’horloge parlante. Je le fais de temps en temps, mais j’y comprends rien à ce qu’elle dit. Le moineau est venu aujourd’hui. J’étais près de la fenêtre avec mon fusil à air comprimé. Et le moineau est venu comme d’habitude. J’ai tiré mais le plomb a touché le mur de la maison de Dhingra et il a fait un petit trou. Le moineau a eu très très peur et il s’est envolé. Dada a mis dans le mille hier sur la terrasse. Il a posé un pot de yaourt sur le réservoir d’eau, le plus petit pot qu’il a trouvé et de très loin il a visé et il l’a éclaté en mille morceaux, ils sont même tombés dans la rue. J’ai dit si ça tombe sur la tête de quelqu’un quelle histoire ! Mon frère est beaucoup plus grand que moi, il a au moins douze ans, c’est pour ça qu’il est très fort. Il va au lycée, mais moi seulement à l’école encore. Il sort tous les jours mais moi je reste à la maison. Des fois je fais que regarder des films et j’ai vu aussi une fois une pièce de théâtre pour enfants. Dada est rentré très tard hier soir et papa l’a grondé beaucoup. Dada a parlé très fort, tellement que je me suis réveillé et que j’ai pas pu finir mon beau rêve. Dans mon rêve je voyais que j’étais sur un cheval qui allait très vite tagada tagada tagada et Dhingra arrivait pas à m’attraper et oncle Hitesh m’a donné un nouveau fusil, un revolver en fait, qui s’appelait Fissot et grand-père était un cow-boy il me dit : viens, poussin, on va au Victoria Memorial2, et là mon rêve s’est arrêté. Il faut que j’aille aux toilettes.