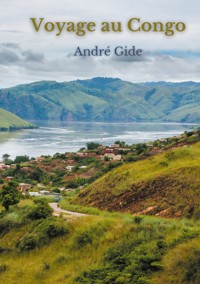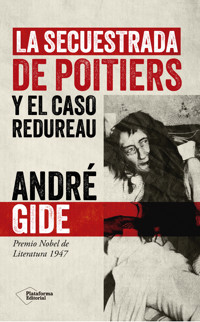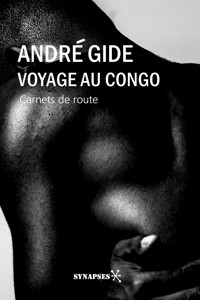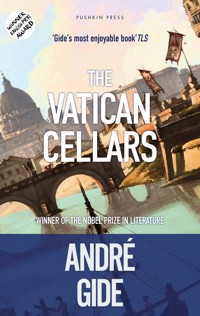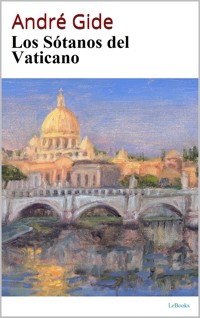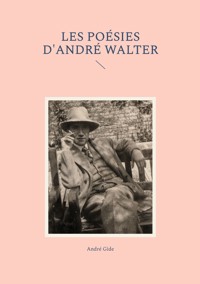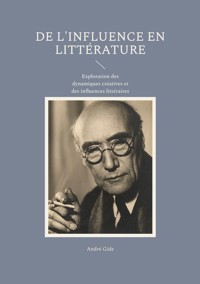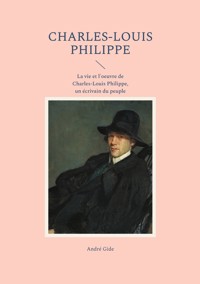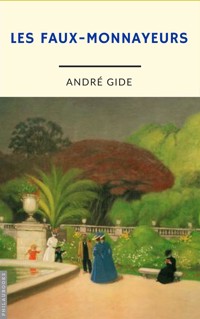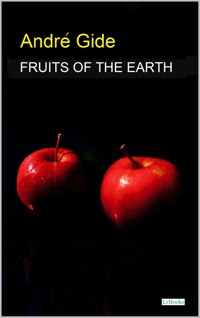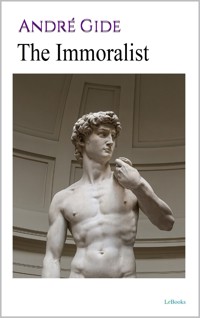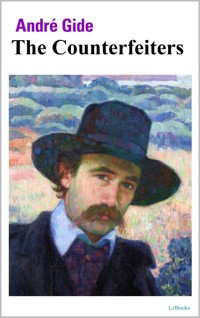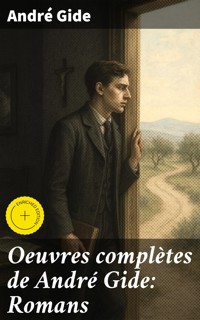
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les "Oeuvres complètes de André Gide: Romans" offrent un panorama riche et nuancé de l'œuvre romanesque de cet auteur majeur du XXe siècle. À travers des récits tels que "Les Nourritures terrestres" et "L'immoraliste", Gide adopte un style élégant et introspectif, mêlant philosophie et réflexions sur la condition humaine. Dans un contexte littéraire marqué par le symbolisme et le surréalisme, il questionne les normes sociales et explore des thèmes comme la quête d'identité, le désir et la quête de soi, souvent en opposition à l'hypocrisie de la société bourgeoise de son époque. André Gide, né en 1869, a été un intellectuel engagé, marqué par ses propres contradictions personnelles et ses voyages dans des cultures différentes. Influencé par ses expériences en Afrique et ses lectures philosophiques, Gide a cherché à refléter dans son œuvre ses luttes intérieures et sa vision radicale de la liberté individuelle. Ses idées sur l'homosexualité, la morality et la libre pensée étaient novatrices, ce qui a conduit à des controverses entourant sa personne et son œuvre. Je recommande chaleureusement cette compilation aux lecteurs avides de comprendre la profondeur existentialiste et le style lyrique de Gide. Ses romans, riches en symboles et en réflexions, sont essentiels pour quiconque s'intéresse à la littérature moderne et à l'exploration des complexités de l'âme humaine. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction approfondie décrit les caractéristiques unifiantes, les thèmes ou les évolutions stylistiques de ces œuvres sélectionnées. - La Biographie de l'auteur met en lumière les jalons personnels et les influences littéraires qui marquent l'ensemble de son œuvre. - Une section dédiée au Contexte historique situe les œuvres dans leur époque, évoquant courants sociaux, tendances culturelles и événements clés qui ont influencé leur création. - Un court Synopsis (Sélection) offre un aperçu accessible des textes inclus, aidant le lecteur à comprendre les intrigues et les idées principales sans révéler les retournements cruciaux. - Une Analyse unifiée étudie les motifs récurrents et les marques stylistiques à travers la collection, tout en soulignant les forces propres à chaque texte. - Des questions de réflexion vous invitent à approfondir le message global de l'auteur, à établir des liens entre les différentes œuvres et à les replacer dans des contextes modernes. - Enfin, nos Citations mémorables soigneusement choisies synthétisent les lignes et points critiques, servant de repères pour les thèmes centraux de la collection.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Oeuvres complètes de André Gide: Romans
Introduction
Sous le titre Oeuvres complètes de André Gide: Romans, le présent volume réunit l’intégralité des Cahiers d’André Walter dans leur architecture originelle, bipartite, sous les rubriques Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir. L’objectif est de restituer, au sein de la section consacrée aux romans, un texte fondateur où la fiction se confond avec l’aveu. Cette réunion ne cherche pas l’exhaustivité de l’ensemble de la production de Gide, mais offre un jalon décisif de sa veine romanesque, en donnant à lire l’œuvre comme un tout cohérent, selon le tracé voulu par l’auteur, et en rendant sensible l’économie interne du diptyque.
Œuvre de jeunesse et premier roman publié de Gide, Les Cahiers d’André Walter se présentent comme la matrice d’une aventure littéraire où la sincérité a valeur de méthode. On y découvre un sujet qui tente de se saisir lui-même dans l’écriture, au point de faire de la page le miroir d’une conscience en devenir. La portée de ce volume, au sein de la section Romans, tient ainsi à son rôle généalogique: on y voit naître des obsessions, des motifs et des gestes artistiques qui irrigueront durablement l’ensemble de l’œuvre gidenne, sans que le texte perde son autonomie romanesque.
Les textes ici rassemblés occupent un seuil entre plusieurs genres. Ils relèvent d’abord du roman, par leur projet narratif et la construction d’un personnage, mais empruntent au journal intime sa forme fragmentaire, sa temporalité et son adresse à soi. À ces deux pôles s’ajoutent des pages de prose lyrique, méditative, où l’aveu et l’examen de conscience prennent la place d’une intrigue au sens traditionnel. En ce sens, cette section des Oeuvres complètes présente une fiction d’expérimentation, et témoigne de la manière dont Gide fait jouer roman, journal et essai moral à l’intérieur d’un même dispositif.
La Table des matières, placée en ouverture, souligne la logique du diptyque et guide la traversée de l’ouvrage. Elle signale l’alternance des registres et l’articulation des deux cahiers, permettant d’apprécier l’économie d’ensemble sans divulguer la progression intime qui s’y dessine. L’architecture liminaire ainsi rappelée n’est pas un simple découpage: elle constitue une pensée formelle, une manière d’ordonner l’incertain. Le plan met en évidence les reprises, échos et contrepoints qui structurent la lecture, et il rappelle que l’unité de l’œuvre s’entend comme dialogue entre deux tonalités complémentaires.
Le Cahier Blanc s’ouvre sur la prémisse d’une aspiration à l’absolu. Le narrateur, s’adressant à lui-même, tente d’accorder exigence spirituelle et idéal de pureté avec l’élan d’un sentiment naissant. Cette partie explore la possibilité d’une harmonie entre vœu d’élévation et désir, interrogeant le ressort intime d’une vocation et la discipline d’un cœur qui veut se tenir au plus près d’un idéal. La narration y demeure volontairement proche de l’aveu, dans une prose qui épure l’expérience pour la porter à sa clarté, sans renoncer aux ambiguïtés de la vie intérieure.
Le Cahier Noir prend pour prémisse la confrontation du même sujet à la part sombre de son examen. Il s’agit moins d’un retournement que d’un approfondissement: les mêmes questions s’y éprouvent sous l’angle de la lucidité, du doute et des tentations qui défont les certitudes trop vite acquises. Ce cahier donne voix à une gravité nouvelle, où la quête d’authenticité se mesure à l’épreuve du réel et à la résistance des élans premiers. Le récit, toujours à la première personne, y durcit son questionnement moral, tout en conservant la liberté formelle qui fait la singularité de l’ensemble.
Les thèmes qui unifient ce volume rejoignent ceux de l’œuvre entière de Gide: recherche d’authenticité, tension entre désir et devoir, examen scrupuleux des mobiles, volonté de se dégager des conformismes de pensée. L’écriture apparaît comme une ascèse et comme une expérience de liberté, où chaque page tente d’accorder le mouvement de la vie à une éthique de la vérité. La mise en cause des illusions, la tentation de l’absolu et le patient travail de lucidité constituent une dramaturgie intérieure qui, tout en restant fictionnelle, donne une forme lisible à des interrogations humaines durables.
La signature stylistique se reconnaît dans la variété des rythmes et l’alliance d’une prose musicale avec la netteté de l’analyse. Les segments brefs, les reprises et les variations installent une respiration singulière, entre ferveur et sécheresse volontaire. Gide fait du doute une méthode, et de l’oscillation une force productive: les contradictions apparentes ne sont pas des faiblesses, mais l’espace où s’invente une parole plus ajustée. L’économie du détail, l’art de la nuance et la pudeur de l’ellipse composent un tissu romanesque qui se nourrit d’un sens aigu de la forme.
Cette forme romanesque, infusée de journal intime, annonce une modernité où le moi devient lieu d’expérience plutôt que objet figé. Le dispositif des cahiers autorise une polyphonie discrète: voix claire et voix sombre se répondent, non pour se neutraliser, mais pour faire apparaître la vérité comme un mouvement. Ce choix structurel, décisif pour la compréhension de l’ensemble, montre comment Gide substitue au récit linéaire une dynamique d’essais, de tentatives, où l’on avance par approches successives. La fiction se fait alors laboratoire de conscience et exploration méthodique de l’incertain.
L’importance durable de ce livre tient aussi à la place de Gide dans la littérature du XXe siècle, où son exigence de probité morale et formelle a exercé une influence notable. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1947, il a imposé une manière de conjuguer liberté et rigueur qui irrigue de nombreux lecteurs et écrivains. Dans les Cahiers, on perçoit déjà cette combinaison d’audace et de précision: audace d’exposer un sujet à son propre scrupule, précision de construire une forme ajustée à cette épreuve. Le présent volume permet de mesurer cette cohérence dès l’origine.
Le lecteur trouvera ici, au fil des deux cahiers, une invitation à la confrontation patiente avec les enjeux mis en place dès la première page. La Table des matières indique le parcours sans le prescrire, laissant à chacun la liberté de circuler, de comparer, de revenir. La symétrie du diptyque n’est pas un miroir parfait: elle ouvre des passages, des résonances, des dissonances. C’est dans ces écarts que se déploie la lecture romanesque, attentive aux transformations de la voix, aux glissements du ton, aux décisions intérieures qui se dessinent sans être proclamées.
Ainsi conçu, ce volume de la section Romans fait apparaître l’unité profonde d’une démarche. Réunir Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir, c’est restituer un roman dans sa pleine amplitude, là où la fiction est indissociable d’un exercice de vérité. L’ambition n’est pas de conclure, mais de rendre sensible la continuité d’un mouvement: écrire pour mieux voir, raconter pour se comprendre, styliser pour approcher le réel au plus près. En cela, ces œuvres constituent moins une origine qu’un principe vivant, dont la portée dépasse le contexte de leur genèse et demeure active pour le lecteur d’aujourd’hui.
Biographie de l’auteur
André Gide (1869-1951) occupe une place centrale dans la littérature française de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe. Romancier, essayiste et diariste, il a exploré la tension entre désir individuel, morale sociale et quête d’authenticité. Son œuvre, diverse et souvent controversée, a contribué à redéfinir le roman moderne et l’essai d’idées. Couronné par le prix Nobel de littérature en 1947, Gide demeure une référence pour la liberté de ton et la rigueur de la conscience. La présente collection, articulée en deux volets — Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir —, propose un chemin de lecture à travers ses étapes décisives.
Formé dans une culture protestante exigeante et sensible aux courants symbolistes de la fin de siècle, Gide affirme très tôt une voix singulière. Ses débuts avec Les Cahiers d’André Walter (1891) annoncent un écrivain partagé entre ascèse et exaltation, attiré par l’analyse intérieure et la mise à l’épreuve de soi. Au tournant du XXe siècle, il fréquente des milieux littéraires où se redéfinissent les formes et les critères du goût, et participe, au début du siècle, à l’élan qui donnera la Nouvelle Revue Française, foyer d’exigence esthétique. Ces influences nourrissent une écriture qui conjugue lucidités morale et expérimentation formelle.
S’ouvrant à une éthique de la liberté, Gide publie Les Nourritures terrestres, manifeste d’émancipation et d’appel à l’expérience sensible, puis développe, dans L’Immoraliste et La Porte étroite, l’examen de consciences aux prises avec l’injonction morale. La réception de ces œuvres est contrastée: fascination pour l’ardeur et réserve face aux audaces. Dans la présente collection, Le Cahier Blanc met en perspective cet apprentissage de la liberté et le façonnement de la voix gidienne, attentive au désir comme à la faute. Il rappelle combien l’écriture, chez Gide, naît d’un trajet intérieur exigeant, plutôt que d’un programme idéologique.
La maturité de Gide se lit dans des fictions qui interrogent la responsabilité et la forme romanesque. Les Caves du Vatican introduit la figure provocatrice de l’acte gratuit, tandis que Les Faux-monnayeurs invente un roman-laboratoire, réflexif, polyphonique, où l’écriture se regarde faire. Parallèlement, le Journal accompagne la genèse des textes et aiguille leur éthique de sincérité. Le Cahier Noir de cette collection insiste sur ce versant plus ombré: le doute, l’ironie, la mise à nu des illusions. Il montre un écrivain qui, loin de conclure, teste les limites, complexifie ses positions et met sa propre voix à l’épreuve.
Les essais d’intervention prolongent ce travail de vérité. Dans Corydon, dialogues publiés après de longues réticences, Gide conteste des préjugés dominants et défend la légitimité d’expériences marginalisées. Ses voyages nourrissent aussi une critique documentée: l’enquête menée en Afrique équatoriale dans Voyage au Congo expose des abus coloniaux; plus tard, Retour de l’URSS, suivi de Retouches à mon Retour de l’URSS, relate une désillusion politique et ravive un vif débat public. L’écrivain y revendique une probité qui peut déplaire, mais demeure au cœur de sa méthode: observer, revenir sur ses pas, réviser ses jugements à la lumière des faits et de l’examen intérieur.
Reconnu de son vivant, Gide joue un rôle moteur dans la vie littéraire française, notamment autour de la Nouvelle Revue Française, où s’affermissent des exigences de style, de probité et d’audace. Son autobiographie, Si le grain ne meurt, et son Journal prolongent l’œuvre de fiction en espace d’examen, sans spectaculaire ni confession complaisante. La consécration du prix Nobel en 1947 salue une trajectoire déjà influente. Dans ses dernières années, l’écrivain continue de publier, de relire, d’annoter, fidèle à une idée de la littérature comme discipline de soi, ouverte au risque de la contradiction et au mouvement de la pensée.
Après sa disparition, l’héritage gidien demeure vivace: ses romans et essais nourrissent l’histoire du modernisme, et son Journal reste un modèle d’éthique de l’écrivain. La vigueur de ses interrogations sur la liberté, la norme et la responsabilité continue d’éclairer le débat public. La présente collection, avec Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir, offre une entrée lisible dans cet univers: un versant de l’initiation et des promesses, un versant de l’examen critique et des revers. Ensemble, ils dessinent un auteur pour qui la littérature fut une mise à l’épreuve de soi, durablement actuelle.
Contexte historique
Cette collection rassemble Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir, deux volets qui constituent le premier roman publié d’André Gide, Les Cahiers d’André Walter (1891). Écrits à la fin des années 1880 et au seuil des années 1890, ces textes naissent dans la France de la IIIe République, au cœur du moment fin-de-siècle. Ils portent l’empreinte d’une jeunesse lettrée, formée aux humanités, et d’une conscience morale issue d’un milieu protestant. À travers la forme du cahier, Gide explore l’introspection, dans un paysage intellectuel où dominent psychologie morale, symbolisme et culte du moi. Leur tonalité contrastée suggère une interrogation sur l’idéal et ses ombres.
Le cadre politique est celui d’une République consolidée après les crises des années 1870, qui entreprend de former des citoyens par l’école. Les lois scolaires de Jules Ferry (1881-1882) instaurent l’instruction gratuite, laïque et obligatoire, renforçant un horizon de rationalité civique. Ces réformes irriguent la culture des lycées et des classes préparatoires, où la discipline de l’esprit, l’argumentation et l’examen de soi sont valorisés. Chez un jeune écrivain comme Gide (né en 1869), ce contexte renforce la pratique du journal et de l’essai intime, que l’on retrouve dans Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir, façonnés par l’idée d’une éducation intérieure.
Sur le plan littéraire, la période est marquée par l’épuisement du naturalisme et la montée du symbolisme et de la décadence. Autour de Mallarmé et d’éditeurs d’avant-garde, se développe un goût pour les écritures de la suggestion, de la musique verbale et du rêve. Les premiers livres de Gide paraissent à la Librairie de l’Art Indépendant, dirigée par Edmond Bailly, haut lieu de cette mouvance. La prédilection pour des formats brefs, des tirages limités et des réseaux de revues spécialisées favorise des expérimentations formelles. Les deux Cahiers s’inscrivent dans cet horizon, combinant prose poétique, fragments et examen de la sensibilité.
La forme du « cahier » s’inscrit dans une tradition de l’intime, alors très en vogue. Le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel, largement diffusé à partir des années 1880, nourrit l’idée d’une écriture du moi qui se scrute sans relâche. En France, Paul Bourget et Maurice Barrès popularisent une psychologie morale et le « culte du moi » (fin des années 1880). Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir dialoguent avec ces tendances: l’écriture y devient laboratoire de soi, cahier d’essais spirituels et esthétiques. L’oscillation entre candeur et crise s’y inscrit comme un geste de modernité introspective, plus que comme récit d’aventures.
Les bouleversements politiques de la décennie précédente laissent un arrière-plan d’incertitude. La crise boulangiste (1887-1889) a ébranlé le régime et suscité un débat sur la fragilité des institutions. En 1889, l’Exposition universelle et la tour Eiffel exposent, à l’inverse, une confiance prométhéenne dans le progrès technique et la puissance nationale. Ce contraste alimente le climat fin-de-siècle, où coexistent volontarisme et malaise. Les Cahiers de Gide relèvent de cette tension: repli analytique, mais à l’écoute d’un monde qui change, où l’héroïsme public cède la place à des combats intérieurs, étalonnés sur des critères éthiques et esthétiques.
La question religieuse traverse la France de la fin du XIXe siècle. La laïcisation de l’État s’accompagne d’un renouveau catholique, tandis que subsistent de vigoureuses minorités protestantes. Gide, issu d’un milieu protestant, grandit dans une éthique de rigueur et d’examen de conscience. En 1892, le « Ralliement » promu par Léon XIII tente d’apaiser les tensions entre Église et République, signe d’un débat vif autour de la foi et de la modernité. Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir reflètent ces tiraillements: y affleure une méditation sur la pureté, l’ascèse, la tentation et la responsabilité, sans déclaration dogmatique ni polémique militante.
Les avancées scientifiques et médicales donnent un vocabulaire nouveau aux troubles de la sensibilité. À la Salpêtrière, Charcot étudie hystéries et névroses; Pierre Janet publie dès 1889 sur les « obsessions » et l’automatisme psychologique. La notion de neurasthénie, diffusée à la Belle Époque, popularise l’idée d’un épuisement nerveux du moderne. En 1892, Max Nordau dénonce une « dégénérescence » fin-de-siècle. Dans cet environnement, l’écriture des Cahiers adopte une attention clinique aux inflexions de l’âme: notations, repentirs, scrupules, exaltations. La souffrance morale y devient objet d’analyse, non de simple plainte romantique, dans une veine d’auto-observation rigoureuse.
À la même époque, la médecine et le droit façonnent des discours nouveaux sur la sexualité. L’ouvrage de Krafft-Ebing (Psychopathia sexualis, 1886) participe à une classification des conduites, qui circule en Europe. Ces discours, encore marginaux dans le grand public, atteignent les milieux lettrés et nourrissent l’attention au désir, à la pudeur, au non-dit. Sans programmatique, Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir privilégient une écriture de l’allusion et du scrupule, où l’exactitude morale importe autant que l’aveu. Plus tard, l’œuvre de Gide dialoguera ouvertement avec ces questions, mais l’atmosphère de 1890 en porte déjà les signes.
L’écosystème des revues et des petites maisons est crucial. La loi sur la liberté de la presse (1881) facilite une floraison de périodiques. Mercure de France (fondé en 1890) et La Revue blanche (1891) accueillent des expériences symbolistes et critiques. La Librairie de l’Art Indépendant publie des textes à tirage restreint, proches de cénacles d’auteurs et d’artistes. Les premiers romans de Gide circulent d’abord dans ce microcosme, où la valeur littéraire se discute entre pairs. Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir y trouvent lecteurs et relais, avant toute consécration institutionnelle, au sein d’une République des lettres fragmentée mais inventive.
La modernité urbaine de la Belle Époque, avec ses cafés, salons et concerts, façonne l’imaginaire des jeunes écrivains. Paris attire les provinciaux, accélère les rencontres entre disciplines, et impose des rythmes nouveaux. Affiches, vitrines éclairées, spectacles et expositions confortent une économie du regard et du désir. À l’inverse, la vie bourgeoise valorise retenue et respectabilité. Entre ces pôles, l’écrivain cherche une voie intérieure. Les deux Cahiers privilégient le retrait et la notation privée, mais la présence diffuse de la grande ville — prospère, bruyante, tentatrice — se lit en sourdine dans l’alternance des enthousiasmes et des scrupules.
L’horizon colonial pèse sur la France des années 1880-1890: protectorat sur la Tunisie (1881), expansion en Afrique et en Indochine, débats sur la « mission civilisatrice ». Gide voyagera en Afrique du Nord en 1893-1894, voyages décisifs pour son évolution personnelle et littéraire. Même si Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir précèdent ces séjours, la curiosité pour l’ailleurs, le désir d’échapper aux étouffements moraux, s’inscrivent dans un climat où l’exotisme irrigue les arts. L’idée d’un dehors susceptible de déplacer les normes — souci majeur de la génération — affleure dans la tension entre idéal intérieur et horizons ouverts.
La formation scolaire de Gide se rattache à une culture classique exigeante: latin, grec, rhétorique et thèmes moraux. Son père, Paul Gide, professeur de droit, meurt en 1880; sa mère, issue d’une famille protestante normande, veille à une éducation rigoureuse. Ce double héritage — intellectuel et religieux — donne aux cahiers une langue précise, volontiers aphoristique, et un rapport scrupuleux à la vérité de soi. L’esthétique du fragment prolonge l’exercice scolaire vers la méditation personnelle. Le Cahier Blanc, avec sa visée d’élévation, et Le Cahier Noir, plus ombreux, manifestent les faces d’un même projet d’édification intérieure.
À partir de 1894, l’Affaire Dreyfus fracture l’espace public français. La question de la justice, du rôle des savants et des écrivains, et de la responsabilité devant la vérité devient centrale. Gide appartiendra, au tournant du siècle, à une génération d’auteurs pour qui la position intellectuelle ne peut se réduire à l’esthétisme. Relus après 1900, les cahiers de 1891 apparaissent comme l’atelier d’une conscience: la probité, l’examen de soi, la défiance envers les conformismes y sont déjà actifs. Cette relecture ne change pas leur objet, mais éclaire la façon dont une sensibilité s’y appareille pour le débat civique à venir.
La fin du siècle voit les arts dialoguer étroitement. Le wagnérisme inspire symbolistes et décadents; Debussy propose, dès 1894, une poétique musicale de l’ellipse et de la nuance. La peinture nabi et l’art du livre (typographie, couvertures soignées) créent un environnement où forme matérielle et style sont indissociables. Les Cahiers de Gide, publiés chez un éditeur d’avant-garde, participent de ce goût pour l’objet-livre et la « musique » de la prose. Le rythme discontinu, la variation des intensités, le primat de la suggestion sur la démonstration rapprochent ces textes d’une esthétique commune aux arts du temps.
La réception initiale des Cahiers est celle, classique, des œuvres de jeunesse parues dans des circuits restreints: remarques attentives de pairs, notoriété limitée, puis rééditions au fil de la consécration de l’auteur. À mesure que Gide publie d’autres romans et essais, ces textes gagnent valeur de matrice: on y repère des germes thématiques et formels. Loin d’être de simples curiosités, Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir témoignent de la cohérence d’un parcours. Leur publication d’origine chez Edmond Bailly, avec des moyens modestes mais un fort capital symbolique, en a fixé l’auréole d’ouvrages d’initié.
Après la Première Guerre mondiale, le paysage intellectuel change: le traumatisme collectif, la psychanalyse désormais visible en France, et les débats sur l’authenticité modifient la lecture des œuvres fin-de-siècle. Lorsque Gide publie Les Faux-monnayeurs (1925) puis reçoit le prix Nobel (1947), ses premiers écrits sont relus comme les notes de fond d’une recherche éthique et formelle. Des critiques y voient l’annonce d’un roman polyphonique et d’une probité intellectuelle rares. Sans qu’il soit nécessaire d’en dévoiler la trame, Le Cahier Blanc et Le Cahier Noir apparaissent alors comme des études d’âme qui ont résisté aux modes.
Enfin, la postérité multiplie les angles: histoire des idées, études de genre, sociologie de la littérature. Le regard contemporain insiste sur la situation d’un jeune auteur pris entre discipline morale et désir d’invention. Les deux Cahiers réfractent, chacun à sa manière, les contradictions d’une époque: laïcisation et ferveur, progrès et angoisse, cosmopolitisme et scrupules. En cela, la collection n’illustre pas seulement une biographie: elle commente son temps par le biais de l’écriture intime. Les lecteurs ultérieurs y ont trouvé un miroir des crises modernes, sans cesser d’y entendre la voix singulière d’André Gide.
Synopsis (Sélection)
Le Cahier Blanc
Roman en forme de journal où un narrateur jeune et idéaliste consigne sa quête d’une pureté morale et d’un amour sublimé, sous le signe de la clarté et de l’exaltation. Les notes fragmentaires tissent une introspection lyrique, attentive aux élans de l’âme, aux exigences de l’absolu et aux séductions de l’esthétique. On y perçoit déjà les tensions gidiennes entre désir et devoir, sincérité et mise en scène de soi, dans une prose musicale et scrupuleuse.
Le Cahier Noir
Contrepoint du précédent, ce cahier expose la face sombre et critique de la même conscience, travaillée par le doute, l’ironie et les tentations du sensible. Le récit démonte les illusions de l’idéal, confronte les contradictions intimes et pousse l’aveu jusqu’au trouble, avec une lucidité parfois caustique. La structure en miroir et la voix incertaine font affleurer le motif récurrent de la dualité chez Gide, dessinant une évolution du lyrisme vers l’analyse, de l’absolu vers l’ambigu.
Oeuvres complètes de André Gide: Romans
Les Cahiers d'André Walter
Table of Contents
Table des matières
LE CAHIER BLANC
Attends,
Que ta tristesse soit un peu plus reposée,–pauvre âme, que la lutte d'hier a faite si lasse.
Attends.
Quand les larmes seront pleurées, les chers espoirs refleuriront.
Maintenant tu sommeilles.
Berceuses, escarpolettes, barcarolles,
Le chant des pleureuses alanguit les chutes.
Il te faudra prier bien sagement ce soir, et que tu croies. Cela te reste, qui ne te sera pas ôté. Tu diras: Le Seigneur est ma part et mon héritage; quand tous m'abandonneraient, tu ne me laisseras pas orphelin.
Et puis tu dormiras,–car ne réfléchis pas encore: les jours amers ne sont pas assez loin.
Endors le souvenir au gré des rêves.
Repose.
Jeudi.
Écrit des lettres...
J'ai tâché de lire, de penser... La fatigue assoupit ma tristesse; il me semble l'avoir rêvée.
Maintenant, sous les arbres;
L'ombre est pacifiante.
*
Que la nuit est silencieuse. J'ai presque peur à m'endormir. On est seul. La pensée se projette comme sur un fond noir; le temps à venir apparaît sur le sombre comme une bande d'espace. Rien ne distrait de la vision commencée. On n'est plus qu'elle.
Il ne faut pas que l'âme s'alanguisse en ses rêveries mélancoliques,–mais qu'elle se réveille enfin et recommence à vivre.
⁂ Quelque soir, revenant en arrière, je redirai ces mots de deuil; maintenant cela m'écœure d'écrire: la phrase n'est pas pour ces choses, émotions trop pures pour être parlées;–j'ai peur qu'une rhétorique, d'ailleurs impuissante, ne profane; par haine des mots que j'ai trop aimés, je voudrais mal écrire exprès. Je romprai les harmonies, fussent-elles fortuites:
Que tu reposes en paix, ma mère. Tu as été obéie.
Certes, l'amertume de cette double épreuveétonne encore mon âme; pourtant, pas trop de tristesse; ce qui domine, c'est l'orgueil d'avoir vaincu.Tu me connaissais bien si tu pensais que l'excès même de cette vertu m'exciterait à la suivre. Tu savais que les routes ardues et téméraires m'attirent, que ma volonté aime les poursuites insensées, à cause du rêve, et qu'il faut un peu de folie pour rassasier mon orgueil.
Tu les as fait tous sortir pour me parler à moi seul,– c'était quelques heures seulement avant la fin: «André», m'as-tu dit,–«mon enfant, je voudrais mourir reposée.» Je savais déjà ce que tu me dirais et j'avais rassemblé mes forces. Tu te hâtais de parler, car ta fatigue était grande: «Il serait bon que tu quittes Emmanuèle...Votre affection est fraternelle,–ne vous y trompez pas... L'habitude d'une vie commune l'a fait naître. Bien qu'elle soit ma nièce, ne me fais pas regretter de l'avoir comme adoptée depuis qu'elle est orpheline.– Je craindrais en vous laissant libres, que ton sentiment ne t'entraîne et que vous ne vous rendiez malheureux tous les deux,–tu comprendras pourquoi. Emmanuèle a déjà bien souffert: je voudrais tant qu'elle puisse être heureuse. L'aimes-tu assez pour préférer son bonheur au tien?»
Alors tu parlas de T***qui venait d'accourir, appelé par les tristes nouvelles.–«Emmanuèle l'estime», dis-tu.–Je savais bien. Et, comme je ne répondais rien encore: «Ai-je trop compté sur toi, mon enfant,–ou pourrai-je mourir tranquille?»
J'étais épuisé des épreuves récentes; j'ai dit:–«Oui, mère», sans comprendre et parce que je voulais aller jusqu'au bout–avec seulement le sentiment de me jeter dans une nuit obscure.
Je suis sorti; quand on m'a rappelé, j'ai vu près de ton lit Emmanuèle, la main dans celle de T***. Tous nous nous sommes agenouillés; nous avons prié. Ma pensée était inerte,–puis tu t'es endormie.
Après les ennuis cérémonieux qui distraient, nous avons communié ensemble. Emmanuèle était devant moi; je ne l'ai pas regardée, et pour ne pas penser à elle et m'empêcher de rêver, je répétais: «Puisqu'il faut que je la perde, que je te retrouve au moins, mon Dieu,–et que tu me bénisses d'avoir suivi la route étroite.»
Puis je suis parti; je viens ici,parce que je ne pouvais pas rester.
Jeudi.
J'ai travaillé pour que l'esprit s'occupe; c'est dans l'effort qu'il se sent vivre.–Sorti toutes les pages écrites qui me rappellent autrefois. Je les veux toutes relire, les ranger, copier, les revivre. J'en écrirai de nouvelles sur des souvenirs anciens.
Je délivrerai ma pensée de ses rêveries antérieures, pour vivre d'une nouvelle vie; quand les souvenirs seront dits, mon âme en sera plus légère; je les arrêterai dans leur fuite: une chose n'est pas tout à fait morte qui n'est pas encore oubliée. Enfin je ne veux pas m'en aller, sans même détourner la tête, de ce qui m'aura tant charmé durant toute ma jeunesse.–Puis pourquoi chercher après coup les raisons d'une volonté prise, comme pour s'excuser de l'avoir? J'écris parce que j'ai besoin d'écrire –et voilà tout. La volonté qu'on raisonne en devient plus débile: que l'action soit spontanée.
Et c'est bien plutôt, avec l'ambition ravivée, l'idée du livre si longtemps rêvé, d'ALLAIN,qui de nouveau maintenant se réveille.
20avril.
L'air est si radieux ce matin que malgré moi mon âme espère–et qu'elle chante, et qu'elle adore avec un désir de prières.
E pero leva su! Vinci l'ambasciaCon l'animo che vince ogni battagliaSe col suo grave corpo non s'accascia...E dissi: «Va, ch'io son forte ed ardito»...
21avril.
Pas un événement: la vie toujours intime–et pourtant la vie si violente. Tout s'est joué dans l'âme; il n'en a rien paru. Comment écrire cela? Rien où la pensée se raccroche et les passions, à la fin si profondes, nées je ne sais plus d'où–de toujours–insensiblement accrues.
⁂ L'éducation d'une âme; la former à soi–une âme aimante, aimée, semblable à soi pour qu'elle vous comprenne, et de si loin que rien ne puisse entre les deux qui les sépare; tisser et lentement des nœuds si compliqués, un tel réseau de sympathies, qu'elles ne puissent plus se détacher mais s'en cheminent parallèles par la force de l'habitude entretenue.
Lundi.
Nous apprenions tout ensemble; je n'imaginais de joies qu'avec toi partagées; et toi tu te plaisais à me suivre: ton esprit vagabond voulait aussi connaître.
Ce furent les Grecs d'abord,et, depuis, toujours préférés: l'Iliade, Prométhée, Agamemnon, Hippolyte,– et quand, après en avoir eu le sens, tu voulais entendre l'harmonie des vers, je lisais:
· · · · · · · · · · · · · · · Τενέδοιό τι ἰφι ἀνάσεις Σμινθεῦ........ Τέκνον, τί κλαίεις; τιδέ σε φρένας ἵκετο πένθος;22 Αἵρετέ μου δέμας, ὀρθοῦτε κάρα λέλυμαι μελέων σύνδεσμα, φίλαι. Αῖ, Αῖ, πῶς ἄν δροσερᾶς ἀπὸ κρηνῖδος καθαρῶν, ὑδάτων πώμ᾽ ἀρυσαίμην......
Puis ce fut le Roi Lear;
Le vent de la mer souffle à travers l'aubépine...
L'âpreté violente de Shakespeare nous laissait brisés d'enthousiasme: la vraie vie n'avait pas de ces enlèvements.
Les Paroles d'un croyantnous secouaient à leur souffle prophétique. Depuis, il est vrai, tu trouvais l'éloquence de Lamennais un peu bien populacière. Je t'en ai voulu de cela que je sentais pourtant juste,– parce que l'émotion débordede ces pages, et qu'elle est toujours belle.
Puis nous reprenions les lectures de l'enfance, faites d'abord classiquement avec des admirations déflorantes: Pascal, Bossuet, Massillon... mais au charme spécieux du Carême, nous préférions la rhétorique nombreuse des oraisons funèbres, ou la sévérité janséniste...
Et tant d'autres encore–et tous les autres.
⁂ Puis, avec les ambitions révélées, ce fut Vigny, Baudelaire,–Flaubert, l'ami toujours souhaité! Nous nous étonnions à sa rythmique savante. Les subtilités rhétoriques des Goncourtaffilaient notre esprit; Stendhalle faisait plus alerte, et plus ergoteur... (?)
ΣΥΜΠΑθΕΙΝ: souffrir ensemble,–se passionner ensemble.
«J'ai vu le Sphinx qui s'enfuyait du côté de la Libye; il galopait comme un chacal.»
Je le déclamais à très haute voix en en développant tout d'abord l'étendue, puis en faisant saillir, sitôt après, le dactyle; et nous frémissions tous les deux aux bondissements superbes de la phrase.
T*** nous a relu l'autre soir, m'écrivais-tu, le Voyage en Orient de du Camp et de Flaubert; il nous a redit la chère apostrophe scandée; mais, que T*** nous la lise ou que je la lise moi-même, c'est par ta voix toujours que je l'entends.
⁂ C'était dans la Tentation encore: «O Fantaisie, emporte-moi sur tes ailes pour désennuyer ma tristesse.» –«Égypte! Égypte! tes grands Dieux immobiles ont les épaules blanchies par la fiente des oiseaux, et le vent qui passe sur le désert roule la cendre de tes morts!»–«Le printemps ne reviendra plus, ô Mère éternelle!»–«Tu n'imagines pas la longue route que nous avons faite. Voilà les onagres des courriers verts qui sont morts de fatigue...»
.....
Et tant d'autres...; après que nous étions lassés de les redire,d'en faire résonner toutes les harmoniques, dont le souvenir vibrant nous poursuivait longtemps encore, de sorte que nous en lisions le refrain obsédant l'un sur les lèvres de l'autre,–sans parler.
⁂ Je te racontais mes ambitions; tu souriais, t'efforçant de paraître incrédule; et le livre que je rêvais d'écrire, je l'appellerai ALLAIN, te disais-je...
.....
Allain! l'œuvre rêvée;–d'abord je la voyais mélancolique et romantique, lorsqu'à l'éveil des sens, j'errais dans les bois, cherchant les solitudes, plein d'inquiétudes inconnues; lorsqu'un chant de vent dans les pins balancés me semblait chanter mes langueurs au gré des strophes récitées; que je pleurais aux feuilles tombantes, aux soleils couchants, à l'eau fuyante des ruisseaux,et qu'au bruit de la mer je restais songeur tout le jour.
Puis métaphysique et profonde, quand l'esprit commença de s'éveiller aux doutes... enfantins peut-être, mais qui déjà me troublaient si fort. Il n'est pas deux façons de douter.
D'abord, je n'y voyais, dans ce livre, qu'un caractère exposé, sans suite, sans intrigue.
Puis, l'idée m'est venue, à contempler notre amour, au lieu d'un vain personnage qui déclamerait sur ces choses, de les faire vivre et s'agiter immédiatement, avec la passion de ce qu'on a vécu.
25avril.
Ils ne comprendront pas ce livre, ceux qui recherchent le bonheur. L'âme n'en est pas satisfaite; elle s'endort dans les félicités; c'est le repos, non point la veille: il faut veiller. L'âme agissante, voilà le désirable–et qu'elle trouve son bonheur, non point dans le BONHEUR, mais dans le sentiment de son activité violente.–Donc la douleur plutôt que la joie, car elle fait l'âme plus vivace; quand elle ne prosterne pas, les volontés s'y exaspèrent: on souffre, mais l'orgueil de vivre puissamment sauve des défaillances. La vie intense, voilà le superbe: je ne changerais la mienne contre aucune, j'y ai vécu plusieurs vies, et la réelle a été la moindre.
Intensifier la vie et garder l'âme vigilante: elle ne se plaindra plus alors, nonchalante, mais s'amusera de sa noblesse.
§ Le grand frisson, à la fois moral et physique, qui vous secoue au spectacle des choses sublimes, et que chacun de nous croyait seul avoir, de sorte qu'il n'en parlait pas à l'autre,–quelle joie quand nous le découvrîmes l'un chez l'autre pareil: ce fut une grande émotion. Quelle source de joies, après, en lisant, de l'éprouver ensemble; il nous semblait nous unir dans un même enthousiasme. Et ce frisson, bientôt, nous le sentîmes l'un par l'autre; la main dans la main et très proches, nous nous y confondions éperdument.
Et, quand nous lisions, par ma voix, tantôt déclamante ou grisée, je savais les accents, aux passages aimés qui nous feraient frissonner ensemble.
Insensés! vous aussi, vous ne m'aurez point crue.
.....
Skamandros, Simoïs, aimés des Priamides.
–Les noms seuls, ces noms grecs aux terminaisons larges, éveillaient en nous des souvenirs si splendides, que d'avance ils soulevaient les enthousiasmes latents, aux éclats de leurs sonorités.
C'était un soir d'été que nous revenions de H***. On nous avait laissés tous deux assis au haut de la voiture; les autres s'étaient enfermés. La route était longue et la nuit tombait vite. Un même châle nous enveloppait tous deux, qui faisait nos fronts proches.
«Sœurette, lui dis-je, j'ai sur moi l'Évangile; si tu veux nous en lirions ensemble, pendant qu'il fait encore un peu de jour.–Lisons», me dit Emmanuèle. Et, quand j'eus fini de lui dire:–«Si tu voulais, ma sœur, nous prierions ensemble?–Non, dit-elle, prions à voix basse, sinon nous penserions à nous plus qu'à Dieu.» Et nous nous tûmes; mais je pensais encore à toi.
La nuit était venue.–«Que songes-tu?» me dit-elle. Et moi je récitai:
«Le crépuscule ami s'endort dans la vallée.» Alors elle: «Adieu, voyages lents, bruits lointains qu'on écoute.Le rire du passant, les retards de l'essieu:Les détours imprévus des pentes variées,Un ami rencontré, les heures oubliées,L'espoir d'arriver tard dans un sauvage lieu...»
Et je repris:
«Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente,Rêver sur mon épaule en y posant ton front?»
Et tous deux, comme il se faisait tard, nous sommes endormis, songeurs, pressés l'un contre l'autre, les mains jointes...
... Puis soudain un brutal réveil, comme d'un rêve: c'est un chariot indistinct sur la route et qu'on heurte,– des bruits de voix, des bruits de chaîne, sans rien voir,– des aboiements–une faible lumière qui dessine les vitres d'une ferme voisine, soupçonnée. Tous deux un peu tremblants, nous serrions plus près encore, confiés l'un dans l'autre.
Songeant aux chariots lourds et noirs qui, la nuitPassant devant le seuil des fermes avec bruit,Font aboyer les chiens dans l'ombre...
Pendant notre sommeil, on avait allumé les lanternes. Nous regardions, amusés, la masse obscure des buissons dépassés surgir de l'ombre: nous cherchions des formes connues qui nous disentsi la route était encore longue. –Puis des bruits de pas: un passant attardé, brusquement éclairé dans une saccade de lumière;–et dans les raies de la lumière projetée, fuyantes en avant de nous sur la route, l'ombre des papillons de nuit qui s'en venaient heurter aux vitres des lanternes.–Je me souviens, quand nous traversions les champs vides, de l'air plus tiède qui soufflait sur nos fronts comme une douce caresse, avec le parfum des terres humides labourées. Nous écoutions chanter les grenouilles...
–Puis enfin l'arrivée, les rires de nouveau, le foyer, la lampe et le thé qui réchauffe;–mais tous deux nous gardions dans l'âme le souvenir d'une intimité plus secrète.
Pas le paysage lui-même: l'émotion par lui causée. –Le coucher des soleils disparus; l'apaisement des soirs emplit encore mon âme. O la paix des rayons sur la plaine!
Sitôt après le repas, nous courions vers l'étang; il s'irisait au reflet des nuages.
(Juin86.
«C'est une poésie exquise. Tout s'apaise; le vent se calme, et l'étang assoupi n'a bientôt presque plus de rides. C'est l'heure où les bœufs viennent boire; leurs pieds agitent l'eau qui se moire autour d'eux; un enfant les conduit.–Le soleil s'est couché; plus de couleurs, rien que des teintes, des reflets d'or que l'eau renvoie aux choses et qui les enveloppent toutes. Déjà une rive est dans l'ombre, incertaine, mystérieuse. La nuit monte dans la vallée.–et bientôt tout s'endort au chant nocturne des grenouilles.»
A L* M***, te souviens-tu, à la nuit tombante, nous allions jusqu'aux menhirs. Les moissonneurs attardés s'en revenaient sur leurs charrettes pleines, et leurs chants alternés se répondaient puis se perdaient en s'éloignant. Les grillons bruissaient dans les blés.–Nous regardions longtemps l'ombre s'étendre sur la mer violette et du fond des vallées monter comme une autre marée peu à peu noyant toutes formes. Un à un dans le lointain des côtes, les phares s'allumaient, et dans le ciel, plus claires, une à une, les lointaines étoiles. Vénus luisait étincelante; nous rentrions doucement, les yeux caressés de sa lumière amie...
... Et la nuit descendait sur notre âme ravie.
Le matin tu vaquais aux soins du ménage; je voyais ton tablier clair circuler dans les longs couloirs; je t'attendais sur l'escalier, aux portes de la cuisine; j'aimais t'aider et te voir diligente; nous montions dans la lingerie si grande–et parfois, tandis que tu rangeais le linge, je t'y poursuivais d'une lecture commencée.
Je t'appelais alors «Marthe», parce que tu t'agitais pour bien des choses.
Mais, le soir, c'était «Marie» de nouveau; ton âme après les soins du jour redevenait contemplative.
... On t'avait fait habiter la chambre de Lucie.Il semblait que la chère morte ne l'eût pas quittée tout entière. Quand tu vins, les choses d'elle autrefois parurent la reconnaître et revivre. Je revoyais tout: et la table et les livres,–l'obscur des grands rideaux sur le lit et la chaise où je venais lire,–le vase avec les fleurs que je t'avais cueillies... Au milieu de tout cela, tu vivais d'une vie comme passée déjà et ancienne: sa mémoire partout éparse autour de toi te faisait plus pensive. Le soir, je retrouvais son profil disparu dans l'ombre de ta tête penchée,–ta voix, quand tu parlais, me faisait souvenir. Et bientôt votre mémoire à toutes deux se confondait indécise.
Ilsétaient confiants en nous et nous l'étions l'un dans l'autre; nos chambres étaient voisines.–Te souviens-tu de ce beau soir où je suis venu te retrouver après que nous les avions quittés pour dormir?
(Août87.)
«Tout dort autour de nous et par la fenêtre grande ouverte aux étoiles, dans le repos de cette nuit d'été, nous viennent bien parfois quelques chants tristes d'oiseau nocturne ou le frémissement des feuilles mouillées quand un souffle les agite, si doucement qu'on croit un murmure d'amour.
Nous sommes seuls tous deux dans ta chambre, éperdus de tendresse et de fièvre. Dans la caresse de l'air, l'odeur des foins, des tilleuls, des roses; dans le mystère de l'heure, dans le calme de la nuit, quelque chose d'ineffable fait que les larmes coulent et que l'âme veut s'échapper du corps, s'évanouir dans un baiser.
L'un contre l'autre, si près qu'un même frisson nous enveloppe, chanter la nuit de mai avec des mots extraordinaires, puis, quand toute parole s'est tue, rester longtemps, croyant cette nuit infinie, les yeux fixés sur une même étoile, laissant sur nos joues approchées nos larmes se mêler, et se confondre nos âmes en un immatériel baiser.»
Plus tôt levés que les autres,nous courions vite au bois, quand le temps était clair. Il frissonnait sous la rosée fraîche. L'herbe étincelait aux rayons obliques; dans la vallée que des brumes encore faisaient plus profonde et comme irréelle, c'était un ravissement. Tout s'éveillait, chantait aux heures nouvelles: l'âme adorait confusément.
Excités peu à peu par l'ivresse de ces choses, nous voulûmes voir le lever des soleils; c'était folie, car les jours étaient longs. Je venais le matin, dès l'aube, frapper doucement à ta porte; ton sommeil était léger; tu te levais, t'apprêtais hâtive. Mais la maison dormait encore, toutes les portes étaient closes; nous ne pouvions sortir. –Alors, dans ta chambre, la fenêtre ouverte à la fraîcheur limpide, transis un peu quoique l'un près de l'autre serrés, nous regardions longuement pâlir les dernières étoiles et se colorer les brumes. Puis, quand les teintes s'étaient faites lumières, leur empourprement accompli, aux premiers rayons, nous retournions dormir, étourdis d'un vertige de joie, la tête un peu lassée, vide et comme sonore des chansons matinales.
Mardi.
Multiplier les émotions. Ne pas s'enfermer en sa seule vie, en son seul corps; faire son âme hôtesse de plusieurs.Savoir qu'elle frémisse aux émotions d'autrui comme aux siennes; elle oubliera ses douleurs propres en cessant de se contempler seule. La vie du dehors n'est pas assez violente; de plus âpres frémissements sont dans les enthousiasmes intimes. Que l'admiration la soulève; plus altière elle sera et plus les vibrations larges. Les chimères plutôt que les réalités; les imaginations des poètes font mieux saillir la vérité idéale, cachée derrière l'apparence des choses.
Que jamais l'âme ne retombe inactive; il la faut repaître d'enthousiasmes.
(1887.)
«Plan de conduite.
Liberté: la raison la nie.–Quand même elle ne serait pas, encore faudrait-il y croire.
Les influences certes nous modèlent: il les faut donc discerner.
Que la volonté partout domine: se faire tel que l'on se veut. Choisissons les influences.
Que tout me soit une éducation.»
(3juin87.)
«Je voudrais parler de bien des choses; mais toutes se pressent ensemble. Je voulais fixer un peu ma symbolique qui se dessine;... puis cette vision dans Notre-Dame, à travers les grilles du maître-autel, d'enfants de chœur en surplis blancs, à la lueur des lampes: tous chantaient, des chants clairs; l'impression de chœur d'anges;–une chute en mineur obstinément répétée, inattendue toujours, montait jusqu'à la voûte...–et je voulais parler aussi, ... mais ma pensée ondule incertaine, bercée sur les sonorités récentes d'un quatuor entendu.–J'écris parce que la poésie déborde de mon âme, –et les mots n'en sauraient rien dire: l'émotion plane sur la pensée;–l'harmonie seule...
alors des mots, des mots sans suite, des phrases frémissantes, quelque chose comme de la musique.
Il est minuit; j'ai sommeil, mais je ne pourrai pas dormir: je me consume d'amour. Tout dort autour de moi;–je suis seul et je pleure. L'air est tiède; dehors il pleut, une pluie de printemps qui féconde toute la nature. Et ce chant de violoncelle, dont je me souviens dans la nuit, alanguit mon délire, berce, apaise et console; la pensée s'endort reposée: douleur, folie, amour, extase!...
... Résigne-toi, mon âme; pleure et prie très longtemps par cette douce nuit qui t'enivre.
Pleure et résigne-toi, mon âme, prie!»
.....
(1887,)
«... Ou de la chair qui se déguise. On la trouve partout, l'impure! elle se revêt spécieusement.
Certes, quand on songe à ce qui fait la poésie..., quelle poussée de désirs! et les nerfs si vibrants au charme des couleurs à cause d'un peu de fluide épars dans l'être;... ah! quelle prose! quelle sale prose au fond de tout cela.
Pourtant, c'est ce qui fait la fleur, suprême poésie de la plante... et les pétales diaprés se déploient sous les étamines dressées, comme un lit somptueux des amours inconscientes. O l'inconscience du poète!–aveuglement! croire à la muse inspiratrice quand c'est la puberté qui l'inquiète; puis se promener par les nuits claires avec l'illusion qu'on chante à l'idéal... et, quand le vers ne vient pas, donner cours au flot de poésie qui l'oppresse dans d'amoureux ébats entre les bras d'une courtisane.–Certes, le dérivatif est sublime!–O pourtant! ce qui fait que l'homme se croit Dieu!–Les belles nuits claires alors... une action réflexe que les vers (Musset)... Les chiens aussi aboient après les clairs de lune!
§ Ce qui est pur et ce qui souille–nous ne le pouvons savoir; la connexion des deux essences, si subtile; leurs causes, si mutuellement mélangées;–tant l'ébranlement de l'une retentit en l'autre. L'abondance du sang fait le cœur généreux: si Swift avait connu l'amour, peut-être il aurait écrit des cantiques... Et tu me dis, ami. qu'il ne faut pas se soucier du corps, mais bien le laisser paître aux lieux qu'il convoite;– mais la chair corrompt l'âme, une fois corrompue! on ne peut mettre du vin pur en des vaisseaux qui se pourrissent! La chair fait l'âme à soi, si l'âme ne la domine d'abord;–il faut qu'elle se l'asservisse.
–Alors romantique parce que mon sang bouillonne... Tant pis! l'illusion de l'idéal est bonne et je la veux garder.»
(Poubazlanec, sept. 87.)
«Ton conseil est admirable, ô Ar***.–Et ta doctrine! «Dégager l'âme en donnant au corps ce qu'il demande!» dis-tu;–et tu m'estimerais plus lorsque je l'aurais fait... Mais, ami, il faudrait que le corps demande des choses possibles; si je lui donnais ce qu'il demande, tu crierais le premier au scandale;– et pourrais-je le satisfaire?
Admirable, ta quiétude! tu t'es dit: à quoi bon la lutte? il ne faut pas que l'âme s'épuise en des combatsindignes d'elle,– et, te soumettant d'avance, tu t'es épargné le combat.–Mais ne sais-tu donc pas que la gangrène de la chair attaque l'âme?– Pour moi, je n'ai pas un désir que toute mon âme n'en soit ébranlée.
§ Et tu te donnes en exemple.–Certes, je t'admire: ta philosophie est grande, et tu prends la vie comme elle finira peut-être par me prendre;–mais ce que je ne t'ai pas dit, ce que tu ne sauras pas. de peur que ton aimable calme ne s'en trouble, c'est le grand effondrement de mes rêves, quand tu m'as conté tout cela, la désillusion sur toi-même;–ah! je te croyais plus altier... Et des larmes sur mon orgueil blessé, dont, pour la première fois, je soupçonnais la vanité; un écœurement, oui jusqu'à la nausée, en regardant la vie, la vie qu'il fallait vivre.– J'aime mieux mon rêve,–mon rêve!...
Tu souriais en disant ces choses, je souriais en les écoutant, mais je ne comprenais plus tes paroles; une seule pensée grisait mon cœur de larmes: il est retourné près de cette fille, et elle ne l'a pas reconnu!–Pas reconnu, Seigneur, est-ce possible?... mon âme en a pleuré toute la nuit.–A quoi bon cette tristesse? Ces choses-là devaient être. Pourquoi l'aurait-elle reconnu? Elle en avait tant vu depuis,–puis, malgré soi, le souvenir des traits s'efface.–Il t'avait tout donné pourtant! Le savais-tu seulement? Avait-il osé te le dire?–Que cela est lugubre, lugubre! Ah fi! si c'est là la vie qu'il faut vivre...
J'aime mieux mon rêve, Seigneur! j'aime mieux mon rêve.»
(Juillet87.)
«J'en hais jusqu'à l'approche, et ces mots sifflés à l'oreille, intonations triviales ou subtiles, voix de goules et ou de sirènes; je les hais! je les hais tout entières.–Et, quand je marche dans la rue, je quitte les trottoirs, je cours hâtif sur les pavés; je les vois de loin qui se retournent, vont et viennent... et leurs gestes, leurs propos soupçonnés m'intriguent malgré tout;–j'aimerais savoir...
C'était il y a deux ans. pour la première fois et l'unique d'ailleurs, car maintenant je suis attentif et je marche loin d'elles,–une chantait un refrain triste; un peu moqueur, mais tendrement, et d'une voix si frêle, alanguie... Comme je passais auprès d'elle, elle s'est retournée. avec un geste, sans cesser de chanter.–C'était la première fois, une première nuit de printemps; l'air était si tiède et la mélodie énervante... les larmes me sont jaillies des yeux; malgré moi. je me suis écarté, j'ai pris le large. Elle a ri très haut; une autre qui rôdait auprès s'est écriée: «Faut pas avoir peur comme ça, mon joli garçon!...» L'émotion était si violente que j'ai pensé m'évanouir; le sang m'est monté au visage; une rougeur de honte, de honte pour elles;–l'impression d'une souillure, rien que d'avoir entendu leurs paroles. Mes tempes battaient, mes yeux se brouillaient pleins de larmes: je me suis enfui.
Mais je me souviendrai, par cette nuit de printemps affolante et si tiède, de cette ombre chantante aux reflets du gaz et sous les marronniers fleuris; puis cet éclat de rire, aigu comme une chose qui se brise;–et les larmes que j'ai pleurées. Oui, je m'en souviendrai toujours; c'était une extraordinaire poésie!
J'écris ces choses ce soir parce que la saison est la même, que l'air est aussi tiède et que tout m'aide à me souvenir. J'avais joué le scherzo de Chopin que je me rappelle encore, puis j'ai couru dans la campagne, grisé de sonorités, d'harmonies. Le ciel était sans lune, mais clair d'étoiles; quoiqu'il n'y eût pas de nuages, la pluie s'est mise à tomber, une pluie tiède, presque une rosée;–
Et le parfum est monté dans l'air, de la poussière d'été qui se mouille.»
Vendredi.
Comme j'y pensais encore, obsédé, malgré moi, j'ai rêvé cette nuit que je suivais un chemin bordé d'ombres, où des deux côtés se tordaient des couples nus, embrassés; je ne voyais pas les corps mêmes, mais je soupçonnais les étreintes. Un grand vertige m'a pris, et, pour ne pas chanceler, je marchais au milieu du chemin, seul et très droit, les yeux levés pour ne rien voir, les bras dressés au-dessus de ma tête. Au ciel luisaient quelques étoiles. J'entendais les baisers dans l'ombre.
Je lisais dans L'APOCALYPSE les paroles aux mystérieuses promesses:
Tu as près de toi quelques hommes qui n'ont pas sali leurs vêtements; ils marcheront en vêtements blancs parce qu'ils en ont été jugés dignes. Celui qui vaincra, je le vêtirai de vêtements blancs. A celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée,– un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom qu'aucun autre n'aura pu connaître...
Alors je méditais et je faisais des résolutions vertueuses.
Mes rêves étaient superbes; j'écrivais:
(Mars. 1886,)
«Je voudrais à vingt et un ans, à l'âge où la passion se déchaîne, la dompter par un labeur forcené et grisant. Je voudrais, tandis que les autres courent les plaisirs, les fêtes et les débauches faciles, goûter les voluptés farouches de la vie monastique. Seul, absolument seul, ou peut-être entouré de quelques blancs chartreux, de quelques ascètes; retiré dans une agreste chartreuse, en pleine campagne, dans un pays sublime et sévère. Je voudrais une cellule nue: coucher sur une planche, un oreiller de crin sous la tête; auprès, un prie-Dieu, simple. énorme; sur le support, la Bible toujours ouverte; au-dessus, une lampe toujours allumée;–et dans l'insomnie, trouver des extases violentes, éperdument penché sur un verset, dans la nuit enveloppante, effrayante.–Aucun bruit. que peut-être parfois les grandes clameurs des montagnes, les voix lugubres des glaciers, ou les cantiques de minuit chantés sur une seule note par les chartreux qui veillent.
Vivre profondément sans plus que le temps vous poursuive. Manger quand j'aurais faim; dormir n'importe quand,–alors que j'aurais fait ma tâche. Je porterais le manteau blanc, la cuculle et les sandales. Dans ma cellule, une table de chêne, immense, et dessus, tout ouverts, des livres. Un grand lutrin pour travailler debout; dessus, un livre ouvert, Au-dessus du lit, des livres rangés. Je lirais la Bible, les Védas, Dante, Spinoza, Rabelais, les Stoïques; j'apprendrais le grec, l'hébreu, l'italien; –et ma pensée se sentirait orgueilleusement vivre. Des débauches de science, d'où l'esprit sortirait stupéfié, brisé, comme Jacob de sa lutte avec l'Ange, mais comme lui vainqueur.Et, quand la chair exaspérée regimberait à cette gêne dans un sursaut de désirs,–alors, la discipline fouaillant le corps et qui se taira bien sous la douleur!–Ou bien, dans la montagne, une course insensée, par-delà les rochers jusqu'aux neiges, et que la chair haletante en eût crié merci: épuisée, vaincue..., ou peut-être dans la neige profonde se plonger,–et trouver dans ce contact glacé comme un frisson extraordinaire.»
§ Quand j'étais enfant, très jeune, dans l'ignorance des choses pourtant entrevues:–«Plus tard, pensais-je, plus tard je n'aurai pas de maîtresses; mes amours tout entières iront vers l'harmonie.» Je rêvais des nuits d'amour devant l'orgue; la mélodie m'apparaissait, presque palpable fiction, comme une Béatrice nuageuse
«fior gittando sopra e d'interno»
comme une Dame élue, immatériellement pure, à la robe traînante aux reflets de saphir, aux replis profonds azurés, aux lueurs pâles, aux formes lentes, musicales. J'espérais qu'elle prendrait toutes mes tendresses. J'étais enfant, je ne pensais qu'à l'âme; déjà je vivais dans le rêve; mon âme se libérait du corps; et c'était exquis, ce rêve des choses meilleures. Puis je les ai tant séparés que maintenant je n'en suis plus le maître; ils vont chacun de leur côté, le corps et l'âme; elle, rêve des caresses toujours plus chastes; lui, s'abandonne à la dérive.
La sagesse voudrait qu'on les mène ensemble, qu'on fasse converger leurs poursuites, et que l'âme ne cherche pas de trop lointaines amours où le corps ne participe.
«Ils ne plaignent pas: ils accusent. Ils n'expliquent pas: ils condamnent. Ce qu'ils ne comprendront jamais, ce sont les luttes pour CROIRE, ces impossibilités parfois, quand pourtant quelque peu de raison proteste encore. Ils s'imaginent qu'il suffit de vouloir!, .. et le plus admirable, c'est qu'ils pensent croire avec leur raison. Ce qui surtout m'égare, c'est la fausse religion; la bigoterie et le mysticisme factice me font parfois douter qu'il y en ait une vraie. Ils ne se doutent pas, les bigots, de tout le mal que leur exemple peut faire à ceux qui sont vraiment altérés du vrai Dieu; ils ne se doutent pas, dans leur quiétude, qu'ils sont souvent eux-mêmes un objet de scandale...»
(Minuit, 30déc. 87.)
«Écrire... quoi?–Je suis heureux.
J'ai peur d'oublier.–J'aimerais qu'au-delà des temps, le souvenir de mon bonheur demeure.
Si l'on pouvait, dans l'ennui de la tombe, revivre incessamment sa vie et sentir doucement, comme dans un songe de la nuit, les amertumes et les joies, mais lointaines, de sorte qu'on n'en souffre pas plus que du souvenir des douleurs.–J'ai peur d'oublier.
Sur ces feuilles je veux fixer, comme on garde des fleurs séchées dont le parfum effacé vous rappelle, je veux fixer les souvenirs de ma jeunesse fuyante, pour que plus tard je me souvienne.
Aujourd'hui je lui ai parlé: je lui ai dit mes rêves radieux et mes superbes espérances. Aujourd'hui j'ai compris qu'elle m'aimait encore. Je suis heureux!... qu'écrirais-je?
J'écris, car j'ai peur d'oublier.
Et tout cela n'est déjà plus que dans mon souvenir...
Mais peut-être que le souvenir des choses anciennes, au-delà du tombeau, subsiste encore.»
C'était dans une misérable chambre; de pauvres gens pleuraient leur enfant mort (7février87).J'étais venu sans le lui dire–pour qu'elle ne le sache qu'après. Je leur apportais quelque argent; j'aurais voulu les consoler. Je m'efforçais de leur parler, mais je m'embarrassais d'idées trop hautes; ma tristesse à les voir certes était sincère, mais je la sentais si différente; je ne sais pasme faire humble. Je n'osais leur parler du ciel, n'y croyant pas assez moi-même; je restais indécis, gêné, bien que mon cœur débordât.–Mais voilà que la porte s'ouvre: Emmanuèle entre.–«Toi? Emmanuèle!»–Elle passe devant moi sans s'étonner, comme sans me voir. La voici près du lit où l'enfant repose; elle regarde sa figure pâlie et je vois ses yeux s'emplir de larmes.–Je m'approche alors, et de ma main je cherche à saisir la sienne.–«Laisse», fait-elle, en me repoussant. Puis, s'étant mise à genoux, elle prie à voix haute une prière très triste; moi, reculé dans l'ombre, je me sentais si humble!... Puis elle s'en va: je l'accompagne. Et, tout en marchant, j'attendais toujours quelques mots sur notre rencontre surprise, mais son émotion trop forte ne la laissait pas s'étonner;–seulement, et comme pour expliquer la brusquerie de son départ, ou plutôt gênée du silence:–«Laissons-les, me dit-elle; il est bon qu'ils s'affligent. Ne les consolons pas encore; les consolations ne seraient pas sincères. L'espérance leur sera meilleure quand ils auront pleuré.–Il faudra revenir;–on ne se dégage pas d'un bienfait commencé; c'est une obligation: il faut aller jusqu'au bout...»–Mais, sitôt rentrés, posant son front sur ma joue, elle me dit tout bas: «Mon frère». Son émotion maintenant débordait: comme elle relevait les yeux je la vis toute pleurante;–pour moi, je défaillais de tendresse, mais l'aveu de sa frêle faiblesse voulait que je sois fort.
Je lui demandai, l'osant à peine, car nous avions tous deux une pudeur exagérée pour ces sortes de choses, je lui demandai de retourner là-bas ensemble.–Elle y fut admirable de douceur, de patience et de zèle,–et ne s'occupait pas de moi; je ne m'occupais guère que d'elle, m'évertuant à l'action pour qu'un sourire me récompense... Pourtant cela ne dura pas; elle me dit une fois: «Prends garde! c'est pour moi, plus que pour eux, que tu t'agites.» D'ailleurs, pour un nouveau temps, je fus séparé d'elle.
§ Providence: toute leur vie est basée sur une hypothèse; s'il leur était prouvé qu'ils s'abusent, ils n'auraient plus leur raison d'être. Mais qui le leur prouverait? Ils ne sauront jamais s'ils ont eu tort de croire. S'il n'y a rien, ils ne s'apercevront de rien.–En attendant, ils croient; ils sont heureux ou se consolent d'espérances. L'âme qui doute est éperdue.
§ «Philosopher?–Quelle arrogance! Mais avec quoi philosopher? la raison? Mais qui nous en garantit la justesse? d'où vient l'autorité qu'on lui accorde? Notre seule assurance serait de la croire donnée par un Dieu providentiel,–mais, ce Dieu, cette raison le nie.
Si nous la prétendons née seule, par une lente tranformation, une successive adaptation aux phénomènes, elle pourra bien discuter les phénomènes, mais au-delà?...
Si même nous la reconnaissons venue de Dieu, rien encore n'en garantit la justesse.
Nous ne pouvons qu'opiner. L'affirmation est coupable: elle veut s'imposer et saccage autour d'elle.–Étroits esprits de croire que leur vérité est la seule! La vérité est multiple, infinie, nombreuse autant que les esprits pour y croire;–et aucunes ne se nient que dans l'esprit de l'homme.»
§ «Tous ont raison. Les choses DEVIENNENT vraies; il suffit qu'on les pense.–C'est en nous qu'est la réalité; notre esprit crée ses Vérités. Et la meilleure ne sera pas celle que la raison surtout approuve: les sentiments mènent l'homme et non pas les idées.On reconnaît l'arbre à ses fruits;–la doctrine à ce qu'elle suggère.
La meilleure sera celle qui dira les mots d'amour pour que l'homme avec joie se dévoue; qui soutiendra dans l'amertume par la vision des félicités promises à ceux qui pleurent; qui nommera la douleur épreuve, et fera que l'âme malgré tout espère; la meilleure sera celle qui le plus console: Seigneur! à qui irions-nous? tu as les paroles de la vie éternelle!
Et la raison se moquera; mais, malgré que la philosophie proteste, le cœur aura toujours besoin de croire.»
«ΣΥΜΠΑθΕΙΝ–souffrir ensemble; vibrer ensemble. L'imagination, c'est la toute puissante; même pour l'émotion du cœur: car ce qui fait le cœur charitable, c'est la puissance d'imaginer les douleurs d'autrui en soi, de les faire siennes. La vie de l'âme en est ainsi multipliée. Puis la douleur s'allège à se sentir compatie.
Le cœur frémissant aux émotions de tous, et malgré l'espace ou le temps; cela, volontairement quoique spontanément; Voilà ce qu'il faut.»
Lire à haute voix, les soirs d'automne; eux rassemblés entre le foyer et la lampe. Ainsi ce fut Hoffmann et Tourgueneff.
Tous écoutaient, mais ma voix avait des inflexions pour toi seule: je te lisais par-dessus eux.
Nous apprenions ensemble l'allemand, bien que le sachant déjà; mais les leçons nous étaient un prétexte de lire, et penchés sur le même livre, pour traduire, nous amusions nos esprits aux subtilités rhétoriques des équivalences.
Ainsi nous connûmes die Braut von Messina, die Heimkehr, die Nordsee.
L'allemand a des allitérations chuchotées qui mieux que les français disaient les songeries embrumées.
Un soir qu'il pleuvait et que tous rassemblés avions déjà longtemps causé–«André, si tu lisais un peu», me dit V***.Je commençai l'Expiation qu'Ellene connaissait pas.
C'est bien une des choses les plus douces: par l'inflexion subtile des paroles lues, fait affluer dans l'âme amie les enthousiasmes dont déborde la sienne. ΣΥΜΠΑθΕΙΝ: se passionner ensemble.
Je ne te voyais pas; tu t'étais assise dans l'ombre; pourtant j'ai senti ton regardlorsque je lus:
«Et leur âme chantait dans les clairons d'airain.»
Le sommeil se couchait; l'ombre du crépuscule envahissait la salle. N'y voyant plus assez pour lire, je fermai le livre et récitai:
«Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques!...»