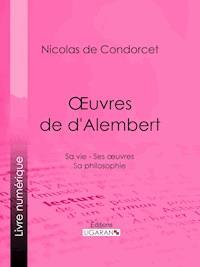
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "D'Alembert n'a rien dans sa figure de remarquable, soit en bien, soit en mal. On prétend (car il ne peut en juger lui-même) que sa physionomie est pour l'ordinaire ironique et maligne. À la vérité, il est très frappé du ridicule, et peut-être a quelque talent pour le saisir. Ainsi, il ne serait pas étonnant que l'impression qu'il en reçoit se peignit souvent sur son visage. Sa conversation est très inégale, tantôt sérieuse, tantôt gaie."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FAIT PAR LUI-MÊME
ET ADRESSÉ, EN 1760, À MADAME ***.
D’Alembert n’a rien dans sa figure de remarquable, soit en bien, soit en mal. On prétend (car il ne peut en juger lui-même) que sa physionomie est pour l’ordinaire ironique et maligne. À la vérité, il est très frappé du ridicule, et peut-être a quelque talent pour le saisir. Ainsi, il ne serait pas étonnant que l’impression qu’il en reçoit se peignît souvent sur son visage.
Sa conversation est très inégale, tantôt sérieuse, tantôt gaie, suivant l’état où son âme se trouve, assez souvent décousue, mais jamais fatigante ni pédantesque. On ne se douterait point, en le voyant, qu’il a donné à des études profondes la plus grande partie de sa vie. La dose d’esprit qu’il met dans la conversation n’est ni assez forte ni assez abondante pour effrayer ou choquer l’amour-propre de personne, et, ce qui est heureux pour lui, c’est qu’il ne lui vient pas plus d’esprit qu’il n’en montre ; car il le laisserait voir, ne fût-ce que par l’impuissance absolue où il est de se contraindre sur quoi que ce puisse être. Tout le monde est donc à son aise avec lui sans le moindre effort de sa part, et on s’en aperçoit bien, ce qui fait qu’on lui en sait bon gré. Il est d’ailleurs d’une gaieté qui va quelquefois jusqu’à l’enfance, et le contraste de cette gaieté d’écolier avec la réputation bien ou mal fondée qu’il a acquise dans les sciences fait encore qu’il plaît assez généralement, quoiqu’il soit rarement occupé de plaire : il ne cherche qu’à s’amuser et à divertir ceux qu’il aime ; les autres s’amusent par contrecoup, sans qu’il y pense et qu’il s’en soucie.
Il dispute rarement, et jamais avec aigreur. Ce n’est pas qu’il ne soit, au moins quelquefois, attaché à son avis ; mais il est trop peu jaloux de subjuguer les autres pour être fort empressé de les amener à penser comme lui.
D’ailleurs, à l’exception des sciences exactes, il n’y a presque rien qui lui paraisse assez clair pour ne pas laisser beaucoup de liberté aux opinions, et sa maxime favorite est que, presque sur tout, on peut dire tout ce qu’on veut.
Le caractère principal de son esprit est la netteté et la justesse. Il a apporté dans l’étude de la haute géométrie quelque talent et beaucoup de facilité, ce qui lui a fait en ce genre un assez grand nom de très bonne heure. Cette facilité lui a laissé le temps de cultiver encore les belles-lettres avec quelque succès. Son style, serré, clair et précis, ordinairement facile, sans prétention, quoique châtié, quelquefois un peu sec, mais jamais de mauvais goût, a plus d’énergie que de chaleur, plus de justesse que d’imagination, plus de noblesse que de grâce.
Livré au travail et à la retraite jusqu’à l’âge de plus de vingt-cinq ans, il n’est entré dans le monde que fort tard, et ne s’y est jamais beaucoup plu ; jamais il n’a pu se plier à en apprendre les usages et la langue, et peut-être même met-il une sorte de vanité assez petite à les mépriser. Il n’est cependant jamais impoli, parce qu’il n’est ni grossier ni dur ; mais il est quelquefois incivil par inattention ou par ignorance. Les compliments qu’on lui fait l’embarrassent, parce qu’il ne trouve jamais sous sa main les formules par lesquelles on y répond. Ses discours n’ont ni galanterie ni grâce : quand il dit des choses obligeantes, c’est uniquement parce qu’il les pense, et que ceux à qui il les dit lui plaisent. Aussi le fond de son caractère est une franchise et une vérité souvent un peu brutes, mais jamais choquantes.
Impatient et colère jusqu’à la violence, tout ce qui le contrarie, tout ce qui le blesse, fait sur lui une impression vive dont il n’est pas le maître, mais qui se dissipe en s’exprimant. Au fond, il est très doux, très aisé à vivre, plus complaisant même qu’il ne le paraît, et assez facile à gouverner, pourvu néanmoins qu’il ne s’aperçoive pas qu’on en a l’intention ; car son amour pour l’indépendance va jusqu’au fanatisme, au point qu’il se refuse souvent à des choses qui lui seraient agréables lorsqu’il prévoit qu’elles pourraient être pour lui l’origine de quelque contrainte, ce qui a fait dire avec raison à un de ses amis qu’il était esclave de sa liberté.
Quelques personnes le croient méchant, parce qu’il se moque sans scrupule des sots à prétention qui l’ennuient ; mais, si c’est un mal, c’est le seul dont il est capable : il n’a ni le fiel ni la patience nécessaires pour aller au-delà, et il serait au désespoir de penser que quelqu’un fût malheureux par lui, même parmi ceux qui ont cherché le plus à lui nuire. Ce n’est pas qu’il oublie les mauvais procédés ni les injures ; mais il ne sait s’en venger qu’en refusant constamment son amitié et sa confiance à ceux dont il a lieu de se plaindre.
L’expérience et l’exemple des autres lui ont appris en général qu’il faut se défier des hommes ; mais son extrême franchise ne lui permet pas de se défier d’aucun en particulier. Il ne peut se persuader qu’on le trompe, et ce défaut (car c’en est un, quoiqu’il vienne d’un bon principe) en produit chez lui un autre plus grand, c’est d’être trop aisément susceptible des impressions qu’on veut lui donner.
Sans famille et sans liens d’aucune espèce, abandonné de très bonne heure à lui-même, accoutumé dès son enfance à un genre de vie obscur et étroit, mais libre ; né, par bonheur pour lui, avec quelques talents et peu de passions, il a trouvé dans l’étude et dans sa gaieté naturelle une ressource contre le délaissement où il était ; il s’est fait une sorte d’existence dans le monde sans le secours de qui que ce soit, et même sans trop chercher à se la faire. Comme il ne doit rien qu’à lui-même et à la nature, il ignore la bassesse, le manège, l’art si nécessaire de faire sa cour pour arriver à la fortune. Son mépris pour les noms et pour les titres est si grand, qu’il a eu l’imprudence de l’afficher dans un de ses écrits, ce qui lui a fait, dans cette classe d’hommes orgueilleux et puissants, un assez grand nombre d’ennemis, qui voudraient le faire passer pour le plus vain de tous les hommes ; mais il n’est que fier et indépendant, plus porté d’ailleurs à s’apprécier au-dessous qu’au-dessus de ce qu’il vaut.
Personne n’est moins jaloux des talents et des succès des autres, et n’y applaudit plus volontiers, pourvu néanmoins qu’il n’y voie ni charlatanerie ni présomption choquante ; car alors il devient sévère, caustique et peut-être quelquefois injuste.
Quoique sa vanité ne soit pas aussi excessive que bien des gens le croient, elle n’est pas non plus insensible ; elle est même très sensible, au premier moment, soit à ce qui la flatte, soit à ce qui la blesse ; mais le second moment et la réflexion remettent bientôt son âme à sa place, et lui font voir les éloges avec assez d’indifférence, et les satires avec assez de mépris.
Son principe est qu’un homme de lettres qui cherche à fonder son nom sur des monuments durables doit être fort attentif à ce qu’il écrit, assez à ce qu’il fait, et médiocrement à ce qu’il dit. D’Alembert conforme sa conduite à ce principe : il dit beaucoup de sottises, n’en écrit guère et n’en fait point.
Personne ne porte plus loin que lui le désintéressement ; mais il n’a ni besoins ni fantaisies. Ces vertus lui coûtent si peu, qu’on ne doit pas l’en louer ; ce sont plutôt en lui des vices de moins que des vertus de plus.
Comme il y a très peu de personnes qu’il aime véritablement, et que d’ailleurs il n’est pas fort affectueux avec celles qu’il aime, ceux qui ne le connaissent que superficiellement le croient peu capable d’amitié. Personne cependant ne s’intéresse plus vivement au bonheur ou au malheur de ses amis ; il en perd le sommeil et le repos, et il n’y a point de sacrifice qu’il ne soit prêt à leur faire.
Son âme, naturellement sensible, aime à s’ouvrir à tous les sentiments doux. C’est pour cela qu’il est tout à la fois très gai et très porté à la mélancolie ; il se livre même à ce dernier sentiment avec une sorte de délices, et cette pente que son âme a naturellement à s’affliger le rend assez propre à écrire des choses tristes et pathétiques.
Avec une pareille disposition, il ne faut pas s’étonner qu’il ait été susceptible, dans sa jeunesse, de la plus vive, de la plus tendre et de la plus douce des passions. Les distractions et la solitude la lui ont fait ignorer longtemps. Ce sentiment dormait, pour ainsi dire, au fond de son âme ; mais le réveil a été terrible : l’amour n’a presque fait que le malheur de d’Alembert, et les chagrins qu’il lui a causés l’ont dégoûté longtemps des hommes, de la vie et de l’étude même. Après avoir consumé ses premières années dans la méditation et le travail, il a vu, comme le sage, le néant des connaissances humaines ; il a senti qu’elles ne pouvaient occuper son cœur, et s’est écrié avec l’Aminte du Tasse : « J’ai perdu tout le temps que j’ai passé sans aimer. » Mais, comme il ne prenait pas aisément de l’amour, il ne se persuadait pas aisément qu’on en eût pour lui. Une résistance trop longue le rebutait, non par l’offense qu’elle faisait à son amour-propre, mais parce que la simplicité et la candeur de son âme ne lui permettaient pas de croire qu’une résistance soutenue ne fût qu’apparente. Son âme avait besoin d’être remplie, et non pas tourmentée ; il ne lui fallait que des émotions douces : les secousses l’auraient usée et amortie.
Jean Le Rond d’Alembert, de l’Académie française, des Académies des sciences de Paris, de Berlin et de Pétersbourg, de la Société royale de Londres, de l’Institut de Bologne, de l’Académie royale des belles-lettres de Suède, et des Sociétés royales des sciences de Turin et de Norvège, est né à Paris, le 16 novembre 1717, de parents qui l’abandonnèrent en naissant : dès l’âge de quatre ans, d’Alembert fut mis dans une pension, où il resta jusqu’à douze. Mais à peine avait-il atteint sa dixième année, que le maître de pension déclara qu’il n’avait plus rien à lui apprendre, qu’il perdait son temps chez lui, et qu’on ferait bien de le mettre au collège, où il était capable d’entrer en seconde. Cependant, la faiblesse de son tempérament fit qu’on ne le retira de cette pension que deux ans après, en 1730, pour lui faire achever ses études au collège Mazarin ; il y fit sa seconde et deux années de rhétorique avec assez de succès pour que le souvenir s’en soit conservé dans ce collège. Un de ses maîtres, janséniste fanatique, qui aurait voulu faire de son disciple un des élèves, et, peut-être un jour, un des arcs-boutants du parti, s’opposait fort au goût vif que le jeune homme marquait pour les belles-lettres, et surtout pour la poésie latine, à laquelle il donnait tous les moments que lui laissaient les occupations de la classe ; ce maître prétendait que la poésie desséchait le cœur ; c’était l’expression dont il se servait ; il conseillait à d’Alembert de ne lire d’autre poème que celui de saint Prosper sur la grâce.
Son professeur de philosophie, autre janséniste fort considéré dans le parti, et, de plus, cartésien à outrance, ne lui apprit autre chose pendant deux ans que la prémotion physique, les idées innées et les tourbillons.
En sortant de philosophie, du collège Mazarin, il fut reçu maître ès arts à la fin de 1735 ; il étudia ensuite en droit, et fut reçu avocat en 1738. Le seul fruit que d’Alembert remporta de ces deux années de philosophie, ce fut quelques leçons de mathématiques élémentaires, qu’il prit au même collège sous M. Caron, qui y professait alors cette science, et qui, sans être un profond mathématicien, avait beaucoup de clarté et de précision. C’est le seul maître qu’ait eu d’Alembert. Le goût qu’il avait pris pour les mathématiques se fortifiant de plus en plus, il se livra avec ardeur à cette étude pendant son cours de droit, qui lui laissait heureusement beaucoup de temps. Sans maître, presque sans livres, et sans même avoir un ami qu’il pût consulter dans les difficultés qui l’arrêtaient, il allait aux bibliothèques publiques, il lirait quelques lumières générales des lectures rapides qu’il y faisait, et, de retour chez lui, il cherchait tout seul les démonstrations et les solutions. Il y réussissait pour l’ordinaire ; il trouvait même souvent des propositions importantes qu’il croyait nouvelles ; et il avait ensuite une espèce de chagrin, mêlé pourtant de satisfaction, lorsqu’il les retrouvait dans des livres qu’il n’avait pas connus. Cependant les jansénistes, qui n’étaient plus ses maîtres, mais qui le dirigeaient encore, s’opposaient à son ardeur pour les mathématiques de la même manière et par les mêmes raisons qu’ils avaient combattu son goût pour la poésie ; ils conseillaient à d’Alembert de lire leurs livres de dévotion, qui l’ennuyaient beaucoup ; cependant, par une espèce d’accommodement, et comme pour leur faire sa cour, le jeune homme, au lieu de leurs livres de dévotion, lisait leurs livres de controverse ; il y trouvait du moins une sorte de pâture pour son esprit, qui en avait besoin, pâture qui donnait à son avidité quelque espèce d’exercice. Cette complaisance du jeune homme ne contentait pas ses austères directeurs, dont à la fin il se dégoûta, fatigué de leurs remontrances. Cependant d’autres amis, moins déraisonnables, dissuadaient aussi d’Alembert de l’étude de la géométrie, par le besoin qu’il avait de se faire un état qui lui assurât plus de fortune. Ce fut par cette raison qu’il prit le parti d’étudier en médecine, moins par goût pour cette profession que parce que les études qu’elle exige étaient moins éloignées que la jurisprudence de son étude favorite. Pour se livrer entièrement à ce nouveau genre de travail, d’Alembert abandonna d’abord l’étude des mathématiques ; il crut même éviter la tentation en faisant transporter chez un ami le peu de livres qu’il avait ; mais peu à peu, et presque sans qu’il s’en aperçût, ces livres revinrent chez lui l’un après l’autre, et, au bout d’un an d’étude de médecine, il résolut de se livrer entièrement à son goût dominant et presque unique. Il s’y livra si complètement, qu’il abandonna absolument, pendant plusieurs années, la culture des belles-lettres, qu’il avait cependant fort aimées durant ses premières études ; il ne la reprit que plusieurs années après son entrée dans l’Académie des sciences, et vers le temps où il commença à travailler à l’Encyclopédie. Le discours préliminaire qui est à la tête de cet ouvrage, et dont il est auteur, est, si on peut parler ainsi, la quintessence des connaissances mathématiques, philosophiques et littéraires que l’auteur avait acquises pendant vingt années d’études.
Quelques mémoires qu’il donna à l’Académie des sciences, en 1739 et en 1740, entre autres un Mémoire sur la réfraction des corps solides, qui contenait une théorie curieuse et nouvelle de cette réfraction, et un autre Mémoire sur le calcul intégral, le firent désirer dans cette compagnie, où il entra en 1741, à l’âge de vingt-trois ans.
En 1746, il remporta le prix à l’Académie de Berlin, sur lacause générale des vents, et l’ouvrage couronné lui valut de plus l’honneur d’être élu membre de cette Académie sans scrutin et par acclamation.
En 1752, le roi de Prusse lui fit offrir la survivance de la place de président de l’Académie de Berlin, qu’occupait encore M. de Maupertuis, alors très malade. Le refus que d’Alembert fit de l’accepter n’empêcha point ce prince de lui donner, en 1754, une pension de douze cents livres, première récompense que d’Alembert ait reçue.
À la fin de cette même année, 1754 il fut élu par l’Académie française à la place de M. l’évêque de Vence.
Au mois de juin 1755, il alla à Wesel, sur l’invitation du roi de Prusse, qui était pour lors dans cette ville. Ce prince le combla de bontés, et l’admit à sa table.
À la fin de la même année, il fut reçu, à la recommandation du pape Benoît XIV, membre de l’Institut de Bologne. D’Alembert n’avait point sollicité cette place ; le pape ne le connaissait que de réputation, et, quoiqu’il y eût alors, dans l’Institut de Bologne, une loi qui défendit de recevoir de nouveaux académiciens jusqu’à ce qu’il en fût mort trois, Benoît XIV désira qu’on dérogeât à cette loi en faveur de d’Alembert.
En 1756, Louis XV lui accorda une pension de douze cents livres sur le trésor royal, et l’Académie des sciences lui donna en même temps le titre et les droits de pensionnaire surnuméraire, quoiqu’il n’y eût aucune place de pensionnaire vacante : ce qui ne s’était encore fait pour personne.
Cette même année 1756, la reine de Suède, sœur du roi de Prusse, ayant formé une académie des belles-lettres qui devait s’assembler dans son palais et qu’elle voulait présider elle-même, fit écrire à d’Alembert par M. le baron de Scheffer pour lui offrir dans cette académie une place d’associé étranger, que d’Alembert accepta avec reconnaissance.
À la fin de 1762, l’impératrice de Russie, Catherine II, lui proposa de se charger de l’éducation du grand-duc de Russie son fils ; et lui offrit pour cet objet jusqu’à cent mille livres de rente, par le ministre qu’elle avait alors à Paris, M. de Sotikof. D’Alembert refusa de s’en charger. L’impératrice insista, et le pressa de nouveau par une lettre écrite de sa main : mais son attachement pour sa patrie et pour ses amis le fit résister encore à cette seconde tentative.
D’Alembert ayant communiqué cette lettre à l’Académie française, cette compagnie arrêta, d’une voix unanime, qu’on l’insérerait dans les registres, comme un monument honorable à un de ses membres et aux lettres.
En 1763, immédiatement après la conclusion de la paix, il alla, invité par le roi de Prusse ; passer quelques mois à la cour de ce prince, qui le logea auprès de lui dans son palais, l’admit tous les jours à sa table, et le combla de marques de bonté, d’estime, et même de confiance.
Cette même année, il reçut aussi l’accueil le plus honorable à la cour de Brunswick-Wolfenbuttel, où il était allé à la suite du roi de Prusse.
Le roi de Prusse fit tout son possible, pendant que d’Alembert était auprès de lui, pour l’engager à accepter la place de président de l’Académie de Berlin, vacante depuis 1759 par la mort de M. de Maupertuis. Les mêmes motifs qui avaient empêché d’Alembert de se rendre aux désirs de l’impératrice de Russie ne lui permirent pas d’accepter les offres de Frédéric, malgré toutes les obligations qu’il avait à ce prince. Il lui représenta d’ailleurs qu’il y avait dans l’Académie de Berlin des hommes du premier mérite, dignes à tous égards de cette place, et qu’il ne voulait ni ne devait en priver ; ce qui n’empêcha pas le roi de Prusse d’écrire de sa main à d’Alembert, deux jours avant son départ de Berlin, qu’il ne nommerait point à la place de président jusqu’à ce qu’il lui plût de venir la remplir.
D’Alembert est auteur d’un livre intitulé : de la Destruction des jésuites en France, par un auteur désintéressé. Cet ouvrage, le seul qui ait été écrit avec impartialité sur cette affaire, produisit son effet naturel ; il mécontenta les deux partis. Il parut au commencement de 1765 ; et, prude temps après, la mort de M. Clairaut ayant laissé vacante dans l’Académie une pension à laquelle d’Alembert avait plus de droits qu’aucun autre de ses confrères, et par son ancienneté et par ses travaux, le ministre Saint-Florentin refusa constamment, pendant six mois, de mettre d’Alembert en possession de cette pension, quoique l’Académie l’eût demandée pour lui dès le lendemain de la mort de M. Clairaut, et l’eût redemandée ensuite à différentes reprises. Le ministre céda enfin, grâce aux remontrances de cet illustre corps, au cri public, et on peut même ajouter à celui de tous les savants de l’Europe, qui, indignés de la manière dont leur confrère était traité, s’en expliquaient ouvertement. Le roi de Prusse fit en cette circonstance plus d’efforts que jamais pour attirer d’Alembert auprès de lui ; mais, quelque forte que fût la tentation, il eut encore le courage de résister. Ce prince, loin d’être offensé d’un refus si constant et presque si opiniâtre, redoubla pour d’Alembert de bontés et d’intérêt, et l’aurait consolé par là, s’il avait eu besoin de l’être, de la manière dont on le traitait en France.
D’Alembert avait été mieux traité par le comte d’Argenson, prédécesseur de Saint-Florentin dans le département des académies. C’est à ce ministre qu’il fut redevable de la pension de douze cents livres que le roi lui accorda en 1756 sur le trésor royal ; il lui en témoigna publiquement sa reconnaissance en 1758, en dédiant à ce ministre la seconde édition du Traité de dynamique, un an après sa retraite du ministère, et lorsqu’il n’y avait plus de grâces à en attendre. D’Alembert a toujours été plus jaloux de se montrer reconnaissant des bienfaits obtenus qu’empressé d’en obtenir ; il n’a dédié ses ouvrages qu’au roi de Prusse, son bienfaiteur, et à deux ministres disgraciés, dont le second était le marquis d’Argenson, frère du comte, et qui honorait aussi d’Alembert de ses bontés.
D’Alembert a donné, en 1767, un Supplément à son ouvrage sur la destruction des jésuites. Ce supplément consiste en deux lettres : dans la première, l’orateur rectifie quelques méprises légères qui lui étaient échappées ; il répond à quelques critiques qu’on avait faites de son ouvrage dans des brochures jansénistes, et, à cette occasion, il peint les fanatiques de ce parti avec les couleurs qu’ils méritent : dans la seconde lettre, d’Alembert parle de l’édit du roi d’Espagne qui a expulsé les jésuites de ce royaume, et fait à ce sujet des réflexions dictées par l’humanité et par la philosophie ; il y rappelle un beau trait d’une lettre qu’il avait reçue du roi de Prusse. « Quoique invité, dit ce prince, par l’exemple des autres souverains, je ne chasse point les jésuites, parce qu’ils sont malheureux ; je ne leur ferai point de mal, étant bien sûr d’empêcher qu’ils n’en fassent ; et je ne les opprime point, parce que je saurai les contenir. »
En 1768, d’Alembert ayant prononcé à l’Académie des sciences, en présence du roi de Danemark, un discours qui a été imprimé dans le volume de l’Académie pour l’année 1768, et dans différents journaux, l’infant, duc de Parme, en fit une traduction italienne qu’il envoya écrite de sa main à d’Alembert ; il y joignit peu de temps après une lettre, aussi écrite de sa main et pleine de témoignages d’estime pour les lettres en général et pour d’Alembert en particulier.
D’Alembert a reçu aussi plusieurs lettres écrites de la main de l’impératrice Catherine, du roi de Danemark, du prince royal de Prusse et des princes de Brunswick. Le roi de Prusse lui a beaucoup écrit de lettres qui feraient le plus grand honneur aux lumières, aux connaissances, à la philosophie et à la bonté du monarque, si le respect eût permis à d’Alembert de les rendre publiques.
Ce prince donna encore une nouvelle preuve de générosité à d’Alembert. Ce savant ayant résolu d’aller en Italie pour rétablir sa santé, et n’ayant pas assez de fortune pour faire ce voyage à ses frais, s’adressa au roi de Prusse, qui avait eu la bonté de lui faire souvent des offres à ce sujet, et qui ordonna à son banquier de lui faire toucher six mille livres. Des raisons particulières ne lui ayant permis d’aller que jusqu’en Languedoc et en Provence, il remit à son retour à Paris, au banquier du roi de Prusse, environ quatre mille livres qui lui restaient, et qu’il n’avait pas dépensées. Le roi de Prusse fit écrire à son banquier de remettre ces quatre mille livres à d’Alembert, qui ne les accepta que sous les ordres réitérés du roi.
Outre les ouvrages de philosophie et de littérature publiés par d’Alembert, il a donné quinze volumes in-4° sur les mathématiques. Il a revu toute la partie de mathématiques et de physique générale de l’Encyclopédie. D’Alembert a donné en outre à l’Encyclopédie un nombre assez considérable d’articles de littérature ou de philosophie.
PAR CONDORCET.
Jean Le Rond d’Alembert naquit à Paris le 16 novembre 1717.
Nous ne cherchons point à lever le voile dont le nom de ses parents a été couvert pendant sa vie ; et qu’importe ce qu’ils ont pu être ? les véritables aïeux d’un homme de génie sont les maîtres qui l’ont précédé dans la carrière ; et ses vrais descendants sont des élèves dignes de lui.
Exposé près de l’église de Saint-Jean-le-Rond, d’Alembert fut porté chez un commissaire qu’heureusement l’habitude des tristes fonctions de sa place n’avait point endurci ; il craignit que cet enfant débile et presque mourant ne pût trouver dans un hospice public les soins, les attentions suivies, nécessaires pour sa conservation, il en chargea une ouvrière dont il connaissait les mœurs et l’humanité ; et c’est de ce hasard heureux qu’a dépendu l’existence d’un homme qui devait être l’honneur de sa patrie et de son siècle, et que la nature avait destiné à enrichir de tant de vérités nouvelles le système des connaissances humaines.
Cet abandon, qui peut-être n’était même qu’apparent, ne dura que très peu de jours : le père de d’Alembert le répara aussitôt qu’il en fut instruit ; il fit pour l’éducation de son fils, et pour lui assurer une subsistance indépendante, ce qu’exigeaient la nature et le devoir : sa famille regarda d’Alembert, tant qu’il fut inconnu, comme un parent à qui elle devait des soins et des égards ; et, lorsqu’il fut devenu célèbre, elle s’honora de ces liens que la reconnaissance avait resserrés.
D’Alembert fit ses études au collège des Quatre-Nations, et les fit d’une manière brillante, indice quelquefois trompeur de ce qu’un homme doit être un jour.
L’importance que le cardinal Mazarin eut la faiblesse ou l’imprudence de donner aux disputes des amis de Saint-Cyran avec les jésuites, avait produit des troubles qui, après quatre-vingts ans, agitaient encore la France, et dont le progrès des lumières a depuis presque anéanti jusqu’au souvenir ; mais, en 1730, il n’y avait aucun corps, aucun collège, pour ainsi dire aucun homme, qui, par zèle religieux, par politique ou par désœuvrement, n’eût embrassé un des deux partis.
Les maîtres de d’Alembert étaient de celui qu’on appelait janséniste, car, dans les disputes de ce genre, on cherche toujours à rendre ses adversaires odieux par un nom de secte dont ils ont grand soin de se défendre ; espèce d’hommage qu’ils rendent à la raison. D’Alembert fit, dans sa première année de philosophie, un commentaire sur l’épître de saint Paul aux Romains, et commença comme Newton avait fini ; ce commentaire donna de grandes espérances à ses maîtres : les hommes distingués dans la littérature ou dans les sciences montraient alors presque seuls à la nation l’exemple d’une indifférence salutaire : on se flatta que d’Alembert rendrait au parti de Port-Royal une portion de son ancienne gloire, et qu’il serait un nouveau Pascal.
Pour rendre la ressemblance plus parfaite, on lui fit suivre des leçons de mathématiques ; mais bientôt on s’aperçut qu’il avait pris pour ces sciences une passion qui décida du sort de sa vie : en vain ses maîtres cherchèrent à l’en détourner, en lui annonçant que cette étude lui dessécherait le cœur (ils ne sentaient pas sans doute toute la force de l’aveu que renferme cette expression). D’Alembert fut moins docile que Pascal : jamais on ne put lui faire regarder l’amour un peu exclusif des vérités certaines et claires comme une erreur dangereuse, ou comme un penchant de la nature corrompue.
En sortant du collège, il jeta un coup d’œil sur le monde, il s’y trouva seul, et courut chercher un asile auprès de sa nourrice ; l’idée consolante que sa fortune, toute médiocre qu’elle était, répandrait un peu d’aisance dans cette famille, la seule qu’il pût regarder comme la sienne, était encore pour lui un motif puissant : il y vécut près de quarante années, conservant toujours la même simplicité, ne laissant apercevoir l’augmentation de son revenu que par celle de ses bienfaits, ne voyant dans la grossièreté des manières de ceux avec lesquels il vivait qu’un sujet d’observations plaisantes ou philosophiques, et cachant tellement sa célébrité et sa gloire, que sa nourrice, qui l’aimait comme un fils, qui était touchée de sa reconnaissance et de ses soins, ne s’aperçut jamais qu’il fût un grand homme : son activité pour l’étude, dont elle était témoin, ses nombreux ouvrages dont elle entendait parler, n’excitaient ni son admiration, ni le juste orgueil qu’elle aurait pu ressentir, mais plutôt une sorte de compassion : « Vous ne serez jamais qu’un philosophe, lui disait-elle ; et qu’est-ce qu’un philosophe ? – c’est un fou qui se tourmente pendant sa vie, pour qu’on parle de lui lorsqu’il n’y sera plus. »
Dans cette maison, d’Alembert s’occupait presque uniquement de géométrie, achetant quelques livres, allant chercher dans les bibliothèques publiques ceux qu’il ne pouvait acheter : souvent il se présentait à lui des vues nouvelles, il les suivait, il goûtait déjà le plaisir de faire des découvertes ; mais ce plaisir était court, il consultait les livres, et voyait avec un sentiment un peu pénible que ce qu’il croyait avoir trouvé le premier était déjà connu : alors il se persuada que la nature lui avait refusé le génie, qu’il devait se borner à savoir ce que les autres auraient découvert, et il se résigna sans peine à cette destinée ; il sentait que le plaisir d’étudier, même sans la gloire, suffirait encore à son bonheur. Cette anecdote, que nous tenons de lui-même, nous paraît un fait moral bien précieux ; il est rare de pouvoir observer le cœur humain si près de sa pureté naturelle, et avant que l’amour-propre l’ait corrompu.
Cependant on fit apercevoir à d’Alembert qu’avec une pension de douze cents livres on n’était pas assez riche pour renoncer aux moyens d’augmenter son aisance ; on lui fit sentir la nécessité de prendre un état, car celui de géomètre n’en est pas un, et même les places où les connaissances mathématiques sont nécessaires ne donnent pas cette heureuse indépendance que le jurisconsulte et le médecin sans fortune obtiennent dès les premiers pas de leur carrière. D’Alembert étudia d’abord en droit et y prit des degrés, mais il abandonna bientôt cette étude : l’ouvrage de Montesquieu n’existait point encore, on ne prévoyait pas la révolution qu’il devait produire dans nos esprits ; l’étude du droit ne pouvait paraître que celle de l’opinion, de la volonté, du caprice des hommes, qui, depuis trente siècles, avaient joui ou abusé du pouvoir, en Grèce, à Rome et chez les barbares : comment un jeune géomètre n’eût-il pas été bientôt dégoûté de pareils objets, sur lesquels il trouvait à exercer sa mémoire bien plus que sa raison ? Il préféra donc la carrière de la médecine ; mais la passion de la géométrie lui faisait encore négliger ses nouvelles études, et il prit le parti courageux de se séparer des objets de sa passion ; ses livres de mathématiques furent portés chez un de ses amis, où il ne devait les reprendre qu’après avoir été reçu docteur en médecine, lorsqu’ils ne seraient plus pour lui qu’un délassement, et non une distraction.
Cependant, poursuivi par ses idées, il demandait de temps en temps à son ami un livre qui lui était nécessaire pour se délivrer de cette inquiétude pénible que si peu d’hommes connaissent et que produit le souvenir confus d’une vérité dont on cherche en vain les preuves dans sa mémoire ; peu à peu tous ses livres se retrouvèrent chez lui : alors, bien convaincu de l’inutilité de ses efforts pour combattre son penchant, il y céda, et se voua pour toujours aux mathématiques et à la pauvreté ; les années qui suivirent cette révolution furent les plus heureuses de sa vie, il se plaisait à en répéter les détails : à son réveil, il pensait, disait-il, avec un sentiment de joie, au travail commencé la veille, et qui allait remplir la matinée ; dans les intervalles nécessaires de ses méditations, il songeait au plaisir vif que le soir il éprouvait au spectacle, où, pendant les entractes, il s’occupait du plaisir plus grand que lui promettait le travail du lendemain.
En 1741, il entra dans l’Académie des sciences ; il s’en était fait connaître par un Mémoire où il relevait quelques fautes échappées au père Reinau, dont l’Analyse démontrée était alors regardée en France comme un livre classique ; et c’était en l’étudiant pour s’instruire que le jeune géomètre avait appris à le corriger.
Il s’était occupé ensuite d’examiner quel devait être le mouvement d’un corps qui passe d’un fluide dans un autre plus dense, et dont la direction n’est pas perpendiculaire à la surface qui les sépare : lorsque cette direction est très oblique, on voit le corps, au lieu de s’enfoncer dans le second fluide, se relever et former un ou plusieurs ricochets, phénomène qui avait amusé les enfants longtemps avant la découverte des premiers principes des sciences, et que cependant, jusqu’à d’Alembert, on n’avait pas encore bien expliqué.
Deux ans après son entrée à l’Académie, il publia son Traité de dynamique.
Dans la science du mouvement, il faut distinguer deux sortes de principes : les uns sont des vérités de pure définition, les autres sont ou des faits donnés par l’observation, ou des lois générales déduites de la nature des corps considérés comme impénétrables, indifférents au mouvement, et susceptibles d’en recevoir : de ces derniers principes, celui de la décomposition des forces était le seul vraiment général qui fût connu jusqu’alors ; et, joint à ces vérités de définition, sur lesquelles Huyghens et Newton n’avaient rien laissé à découvrir, il avait suffi pour établir leurs sublimes théories, et pour résoudre ces problèmes de statique, si célèbres dans le commencement de ce siècle. Mais, si les corps ont une forme finie, si on les imagine liés entre eux par des fils flexibles, ou par des verges inflexibles, et qu’on les suppose en mouvement, alors ces principes ne suffisent plus, et il fallait en inventer un nouveau ; d’Alembert le découvrit, et il n’avait que vingt-six ans : ce principe consiste à établir l’égalité, à chaque instant, entre les changements que le mouvement du corps a éprouvés et les forces qui ont été employées à les produire, ou, en d’autres termes, à séparer en deux parties l’action des forces motrices, à considérer l’une comme produisant seule le mouvement du corps dans le second instant, et l’autre comme employée à détruire celui qu’il avait dans le premier : ce principe si simple, qui réduisait à la considération de l’équilibre toutes les lois du mouvement, a été l’époque d’une grande révolution dans les sciences physico-mathématiques. À la vérité, plusieurs des problèmes résolus dans le Traité de dynamique l’avaient déjà été par des méthodes particulières ; différentes en apparence pour chaque problème, elles n’étaient sans doute réellement qu’une seule et même méthode, sans doute elles renfermaient le principe général qui y était caché, mais personne n’avait pu l’y découvrir : et, si on refusait, sous ce prétexte, à d’Alembert la juste admiration qu’il mérite, on pourrait, avec autant de raison, faire honneur à Huyghens des découvertes de Newton, et accorder à Wallis la gloire que Leibnitz et Newton se sont disputée.
Les découvertes successives qui forment les sciences naissent les unes des autres ; celle qui appartient exclusivement à un seul homme est due à son génie aidé des travaux de ceux qui l’ont précédé, lui ont aplani la carrière, et ne lui ont plus laissé qu’un dernier obstacle à vaincre : mais, parmi ces découvertes, il en est qui, par leur étendue, leur influence sur le progrès général des sciences, la nombreuse suite de théories nouvelles qui n’en sont que le développement, semblent former une classe particulière, et mériter à leur inventeur un rang à part dans le nombre déjà si petit des hommes de génie.
Telle a été celle du principe de d’Alembert ; déjà, en 1744, il l’avait appliqué à la théorie de l’équilibre et du mouvement des fluides, et tous les problèmes résolus jusqu’alors par les géomètres étaient devenus en quelque sorte des corollaires de ce principe : mais il avait fallu employer en même temps les hypothèses ingénieuses de Daniel Bernoulli, que leur accord avec les phénomènes les plus généraux de l’hydraulique permettait presque de regarder comme des faits. Dans la théorie des fluides, comme dans celle du mouvement des corps susceptibles de changer de forme, le principe de d’Alembert, lorsqu’on l’employait seul, conduisait à des équations qui échappaient aux méthodes connues, et cette première découverte semblait rendre nécessaire celle d’un nouveau calcul ; d’Alembert en eut encore l’honneur : dans un ouvrage sur la théorie générale des vents, couronné par l’Académie de Berlin, en 1746, il donna les premiers essais du calcul des différences partielles ; l’année suivante, il l’appliqua au problème des cordes vibrantes, dont la solution, ainsi que la théorie des oscillations de l’air et de la propagation du son, n’avaient pu être données que d’une manière incomplète par les géomètres qui l’avaient précédé, et ces géomètres étaient ou ses maîtres ou ses rivaux.
L’invention de ce calcul est encore une de ces découvertes destinées à être dans les sciences une époque mémorable ; elle le mérite d’autant plus, qu’en donnant un nouvel instrument d’un usage très étendu elle a montré en même temps la route qu’il fallait suivre pour en former d’autres du même genre ; et toutes les parties de l’analyse où l’on considère des équations dont l’intégrale peut contenir des fonctions arbitraires de quantités variables doivent être regardées comme des branches du calcul de d’Alembert, quels que soient la forme de ces arbitraires et le système de différentiation qui les ait fait évanouir.
Dans cette pièce sur la théorie des vents, il ne considéra que l’effet qui peut être produit par l’action combinée de la lune et du soleil sur le fluide dont la terre est enveloppée ; il examina quelle figure l’atmosphère doit prendre à chaque instant, en vertu de cette action, la force et la direction des courants qui en résultent, et les changements que doit produire sur leur direction et sur leur vitesse la forme des grandes vallées qui sillonnent la surface du globe.
Les changements de température, produits dans l’atmosphère par la présence du soleil sont une autre cause générale, régulière, et susceptible d’être mesurée ; d’Alembert se borne à en remarquer l’existence : il aurait fallu, pour la calculer, adopter quelque hypothèse sur les lois de la dilatation de l’air, sur l’intensité de l’action de la chaleur du soleil aux différentes hauteurs, et pour des couches d’air plus ou moins denses ; ses recherches n’eussent servi qu’à donner une preuve de plus de son génie pour l’analyse, mais sans conduire à aucun résultat réel ; il n’eût travaillé que pour la gloire, et il voulait réserver ses forces pour des ouvrages utiles aux progrès des sciences.
Il lui restait encore à donner un moyen d’appliquer son principe au mouvement d’un corps fini, d’une figure donnée ; et, en 1749, il résolut le problème de la précession des équinoxes. L’axe de la terre ne répond point toujours au même lieu du ciel, mais il se dirige successivement vers tous les points d’un cercle parallèle au plan de l’orbite terrestre ; et, par une suite de ce mouvement, les équinoxes et les solstices répondent, dans la même période, à toutes les parties du zodiaque : ce phénomène, connu sous le nom de précession des équinoxes, a été observé par les anciens ; Hipparque en avait supposé la période de vingt-cinq mille deux cents, et les modernes, par des observations plus exactes, l’ont fixée à environ sept cent vingt ans de plus. Ce mouvement en longitude n’est pas le seul qu’éprouve l’axe de la terre ; il en a un autre en latitude, bien plus petit, qui n’est qu’une espèce de balancement, et dont la période est de dix-huit seulement ; cette nutation n’a été découverte que dans ce siècle par Bradley, et jusqu’à lui on la confondait avec les mouvements irréguliers, propres aux étoiles fixes. Newton attribuait avec raison la précession des équinoxes à l’effet de l’attraction de la lune et du soleil sur la terre ; il savait que notre planète est un sphéroïde aplati vers les pôles, et que ces deux astres, étant mus dans des plans où ils n’agissent pas d’une manière semblable sur les parties semblablement disposées autour de l’axe de la terre, doivent altérer son mouvement de rotation ; mais ce n’était pas assez. Newton avait appris le premier aux philosophes à n’admettre pour vraies que des explications calculées, qui rendent raison du phénomène en lui-même, de sa quantité et de ses lois ; aussi essaya-t-il de déterminer l’effet de l’attraction de la lune et du soleil sur le mouvement de l’axe de la terre ; mais les méthodes d’analyse et les principes mêmes de mécanique nécessaires pour une solution directe manquaient à son génie, et il fut obligé d’admettre des hypothèses qui ne le conduisirent à un résultat conforme à l’observation que par la compensation des erreurs produites par chacune d’elles : vingt-trois ans après sa mort, cette limite qu’il semblait avoir posée n’avait pas été franchie ; d’Alembert en eut la gloire, il expliqua également le phénomène de la nutation, nouvellement découvert, et répara l’honneur de la France, ou plutôt du continent, qui jusqu’alors n’avait eu rien à opposer aux découvertes de Newton.
Un seul géomètre, Euler, eût pu disputer cette gloire à d’Alembert ; mais, en donnant une solution nouvelle du problème, il avoua qu’il avait lu l’ouvrage de d’Alembert, et fit cet aveu avec cette noble franchise d’un grand homme qui sent qu’il peut, sans rien perdre de sa renommée, convenir du triomphe de son rival.
En 1752, d’Alembert publia un Traité sur la résistance des fluides, auquel il donna le titre modiste d’Essai, et qui est un de ses ouvrages où l’on trouve le plus de choses originales et neuves.
La simple supposition que chaque élément de la masse fluide, en changeant de forme à chaque instant, conserve le même volume, lui suffit pour appliquer son principe aux questions les plus difficiles, et il est conduit à des équations de la nature de celles dont sa nouvelle analyse peut donner la solution : les réflexions sur les causes générales des vents contenaient le germe de ces découvertes ; mais ici elles sont développées, et la théorie du mouvement des fluides est enfin véritablement assujettie au calcul.
À la même époque, d’Alembert avait donné, dans les Mémoires de l’Académie de Berlin, des recherches sur le calcul intégral, où la méthode de Jean Bernoulli, pour les fonctions rationnelles, était perfectionnée ; où, par un usage adroit des substitutions, il entendait cette méthode à plusieurs classes de fonctions irrationnelles ; où il réduisait à une même expression toutes les imaginaires sous quelque forme qu’elles se présentent, quelle que soit l’équation à laquelle elles doivent satisfaire, où il donnait la théorie des points de rebroussement de la seconde espèce, dont plusieurs géomètres célèbres, et Euler lui-même, avaient combattu l’existence ; où enfin il proposait une méthode d’intégrer les équations linéaires d’un ordre quelconque, intégration importante, qui est le fondement de toutes les méthodes d’approximation pour les équations différentielles, et, par conséquent, dans l’état actuel de l’analyse, la clef de toutes les questions de l’astronomie physique. Euler avait publié avant lui une méthode également générale pour ces équations ; mais le géomètre français l’avait prévenu aussi sur quelques autres points.
D’Alembert n’a donné aucun grand ouvrage sur le calcul ; ses Mémoires même, à l’exception de ceux que nous venons de citer, et d’un petit nombre d’autres, ont pour objet des questions de mécanique ; mais il a répandu dans tous de nouvelles méthodes d’analyse, ou des remarques importantes sur les méthodes déjà connues, et on lui doit en grande partie les progrès rapides que le calcul intégral a faits dans ce siècle. Il semblait seulement que l’idée de quelque application utile était nécessaire pour réveiller son génie, qui déployait alors toute sa finesse, toute sa profondeur et toute sa fécondité.
C’est ainsi que d’Alembert s’était montré, à trente-deux ans, le digne successeur de Newton en résolvant le problème de la précession des équinoxes, dont la solution confirme, par une preuve victorieuse, la théorie de la gravitation universelle, en se consacrant comme lui à l’étude des lois mathématiques de la nature, en créant comme lui une science nouvelle, en inventant aussi un nouveau calcul, mais dont personne n’a contesté la découverte à d’Alembert, ou n’a voulu la partager.
Tant qu’il n’a été que géomètre, à peine était-il connu dans sa patrie ; borné à la société de quelques amis, n’ayant jamais vu, parmi les gens en place, que MM. d’Argenson, deux ministres qui, par les agréments de leur esprit, auraient été des particuliers aimables ; réduit au nécessaire le plus simple, mais heureux du plaisir que donne l’étude et de sa liberté, il avait conservé sa gaieté naturelle dans toute la naïveté de la jeunesse. Content de son sort, il ne désirait ni fortune ni distinctions ; et il n’en avait point obtenu, parce qu’il est plus commode de les accorder à ceux qui les demandent qu’à ceux qui savent les mériter. Sa gaieté, des saillies piquantes, le talent de conter et même de jouer ses contes, de la malice dans le ton avec de la bonté dans le caractère, autant de finesse dans la conversation que de simplicité dans la conduite ; toutes ces qualités, en le rendant, par leur réunion, à la fois estimable et amusant, le faisaient rechercher dans le monde. On aimait en lui cette bonhomie, si touchante quand elle se trouve dans les hommes supérieurs, chez qui pourtant elle est bien moins rare que dans ceux qui n’ont que la prétention de l’être.
Cependant un roi, déjà illustré par cinq victoires, et dont la gloire devait croître encore, avertit enfin la France qu’elle avait un grand homme de plus ; ses bienfaits vinrent chercher d’Alembert, et il y joignit des témoignages d’estime et d’amitié fort au-dessus de ses bienfaits.
Peu de temps après, d’Alembert reçut une pension du gouvernement ; il la devait à l’amitié de M. le comte d’Argenson, qui aimait les gens d’esprit et n’en était point jaloux, parce que lui-même avait beaucoup d’esprit. Cette jalousie est plus commune qu’on ne le croit, et elle a été souvent le motif secret de l’indifférence ou de la haine de quelques ministres pour les hommes de génie que le hasard avait fait naître dans le même pays et dans le même siècle.
La tranquillité de d’Alembert fut altérée dès que sa réputation fut plus répandue. Lorsque son goût pour la littérature et ses méditations sur la philosophie étaient un secret connu seulement de ses amis, borne aux yeux de tous les autres à l’étude des sciences abstraites, il échappait à leur jugement ; apprécié par un petit nombre de rivaux ou de disciples, admiré d’eux seuls, sa gloire n’offensait encore personne.
Mais il s’était lié, depuis sa jeunesse, par une amitié tendre et solide avec un homme d’un esprit étendu, d’une imagination vive et brillante, dont le coup d’œil vaste embrassait à la fois les sciences, les lettres et les arts ; également passionné pour le vrai et pour le beau, également propre à pénétrer les vérités abstraites de la philosophie, à discuter avec finesse les principes des arts, et à peindre leurs effets avec enthousiasme ; philosophe ingénieux et souvent profond, écrivain à la fois agréable et éloquent, hardi dans son style comme dans ses idées ; instruisant ses lecteurs, mais surtout leur inspirant le désir d’apprendre à penser, et faisant toujours aimer la vérité, même lorsque, entraîné par son imagination, il avait le malheur de la méconnaître.
Une traduction de l’Encyclopédie anglaise de Chambers, qui avait été proposée à Diderot, devint entre ses mains l’entreprise la plus grande et la plus utile que l’esprit humain ait jamais formée. Il se proposa de réunir dans un dictionnaire tout ce qui avait été découvert dans les sciences ; ce qu’on avait pu connaître des productions du globe, les détails des arts que les hommes ont inventés, les principes de la morale, ceux de la politique et de la législation, les lois qui gouvernent les sociétés, la métaphysique des langues et les règles de la grammaire, l’analyse de nos facultés, et jusqu’à l’histoire de nos opinions. D’Alembert fut associé à ce projet, et ce fut alors qu’il donna le discours préliminaire de l’Encyclopédie.
Il y trace d’abord le développement de l’esprit humain, non tel que l’histoire des sciences et celle des sociétés nous le présentent, mais tel qu’il s’offrirait à un homme qui aurait embrassé tout le système de nos connaissances, et qui, réfléchissant sur l’origine et la liaison de ses idées, s’en formerait un tableau dans l’ordre le plus naturel ; il verrait la morale et la métaphysique naître de ses observations sur lui-même ; la science des gouvernements, et celle des lois, de ses observations sur la société. Excité par ses besoins, il voudrait acquérir la connaissance des productions de la nature, et celle des moyens de les multiplier et de les employer. Le désir de soulager ses maux lui ferait inventer toutes les sciences sur lesquelles la médecine s’appuie, et dont le but est de perfectionner ou de rendre plus sûr l’art de guérir ; l’envie naturelle de connaître les propriétés les plus générales des corps le conduirait aux vérités de la chimie et de la physique. Bientôt, dépouillant successivement ces corps de toutes leurs qualités, pour ne conserver que le nombre et l’étendue, il formerait toutes les sciences mathématiques, il déterminerait ensuite pour chaque science l’objet qu’elle doit se proposer, la méthode qu’elle doit suivre, le degré de certitude auquel elle peut atteindre. Forcé de les séparer pour en pouvoir saisir et embrasser chaque partie, il observerait encore les liens imperceptibles qui les unissent, les secours qu’elles peuvent se prêter et leur influence réciproque.
Dès le moment où d’Alembert fut connu pour mériter une place distinguée parmi les philosophes et les écrivains, il eut et il mérita toujours depuis d’avoir les ennemis que les succès dans les lettres et dans la philosophie ne manquent jamais d’attirer, c’est-à-dire la foule de ceux pour qui la littérature est un métier, et la classe plus nombreuse encore de ces hommes aux yeux de qui la vérité ne paraît qu’une innovation dangereuse.
Il publia, peu de temps après, des mélanges de philosophie, d’histoire et de littérature, qui augmentèrent le nombre de ses détracteurs. Les Mémoires de Christine montrèrent qu’il connaissait les droits des hommes, et qu’il avait le courage de les réclamer.
L’Essai sur la société des gens de lettres avec les grands déplut à ceux des littérateurs qui trouvaient dans cette société une utilité réelle ou l’aliment d’une vaine gloire, et qui furent blessés de voir exposer aux yeux du public la honte des fers qu’ils n’osaient rompre ou qu’ils ambitionnaient de porter. On ne peut mieux juger cet Essai qu’en rapportant la réponse d’une femme de la cour à des hommes qui reprochaient à d’Alembert d’avoir exagéré le despotisme des grands et l’asservissement qu’ils exigent : « S’il m’avait consultée, je lui en aurais appris bien davantage. »
Peut-être devons-nous en partie à cet ouvrage le changement qui s’est fait dans la conduite des gens de lettres, et qui remonte vers la même époque. Ils ont senti enfin que toute dépendance personnelle d’un Mécène leur ôtait le plus beau de leurs avantages : la liberté de faire connaître aux autres la vérité lorsqu’ils l’ont trouvée, et d’exposer dans leurs ouvrages non les prestiges de l’art d’écrire, mais le tableau de leur âme et de leurs pensées ; ils ont renoncé à ces épîtres dédicatoires qui avilissaient l’auteur, même lorsque l’ouvrage pouvait inspirer l’estime ou le respect ; ils ne se permettent plus ces flatteries toujours d’autant plus exagérées qu’ils méprisaient davantage, au fond du cœur, l’homme puissant dont ils mendiaient la protection ; et, par une révolution heureuse, la bassesse est devenue un ridicule que très peu d’hommes de lettres ont eu le courage de braver.
Les occupations littéraires de d’Alembert ne lui avaient point fait négliger les mathématiques. Une foule d’articles insérés dans l’Encyclopédie montrent, dans une exposition en apparence élémentaire, et le génie d’un géomètre et le coup d’œil d’un philosophe.
C’est dans le même espace de temps qu’il composa ses recherches sur différents points importants du système du monde. Il y perfectionna sa solution du problème des perturbations des planètes, déjà connue depuis plusieurs années de l’Académie et des savants. Deux géomètres en partageaient la gloire avec lui. Tous trois, à peu près dans le même temps, donnaient une solution à ce problème. Le fond de leur méthode était le même : tous trois avaient trouvé, par un premier calcul, que le mouvement de l’apogée de la lune n’était que la moitié de ce qu’il est réellement ; tous trois, en calculant un terme de plus, avaient reconnu la conformité des résultats du calcul et de l’observation.
Cette concurrence, qui subsista également dans l’application de la même méthode aux mouvements des comètes, produisit une longue discussion entre d’Alembert et Clairaut, car Euler resta simple spectateur. Lorsqu’on examine les disputes de ce genre longtemps après le moment où elles se sont élevées, lorsque le temps a calmé les premiers mouvements de l’amour-propre, lorsque l’amitié même, dont le zèle est quelquefois plus durable, peut considérer de sang-froid les objets de la discussion, souvent on s’étonne de l’importance qu’on y avait attachée. On pourrait demander ici pourquoi d’Alembert n’imita point la tranquillité d’Euler, et comment, lorsque le mérite d’avoir résolu le problème ne lui était point contesté, lorsqu’il ne partageait avec personne ni la gloire d’avoir découvert un principe fondamental de la mécanique, et de l’avoir appliqué soit à la théorie des fluides, soit au mouvement des corps finis, ni celle d’avoir inventé un nouveau calcul, il pouvait mettre tant de prix à la part plus ou moins grande qu’il devait obtenir dans l’honneur de la solution d’un problème moins difficile ; mais il est un effort presque impossible à notre faiblesse : celui de supporter tranquillement l’injustice. Peut-être le sentiment de nos forces, qui fait souffrir tant de maux avec constance, est-il plus propre à fortifier qu’à détruire ce mouvement de la nature indignée, qu’il ne faut pas confondre avec la vanité ou avec la jalousie.
D’Alembert éprouvait alors les effets de cette injustice ; depuis qu’il s’était placé parmi les gens de lettres du premier ordre, on s’était rendu plus difficile sur sa réputation comme géomètre. Le public, qui laisse assez paisiblement les mathématiciens (dont il ne connaît que les noms) régler les rangs entre eux, et se distribuer la gloire à leur gré, n’eut pas la même indulgence pour un géomètre littérateur et philosophe ; quelques savants profitèrent de cette disposition générale, ils essayèrent modestement de faire croire qu’ils étaient au moins ses égaux ; et souvent des étrangers, qui n’avaient pas le même intérêt de déprimer sa réputation, ont été frappés de la contradiction qu’ils observaient entre l’opinion des sociétés de Paris et le jugement de l’Europe. D’Alembert crut voir la suite de la même injustice dans la manière dont sa solution du problème des trois corps était appréciée par quelques personnes (ce n’étaient pas celles qui l’avaient résolu ou qui auraient pu le résoudre), et il défendit avec chaleur des droits qu’il eût abandonnés même par amour-propre, si on avait été juste envers lui.
Dans ses Recherches sur le système du monde, d’Alembert examina la question de la figure de la terre. Newton doit être regardé comme celui qui l’a traitée le premier, car Huyghens avait démêlé seulement l’influence que le changement de la force centrifuge aux différentes latitudes devait avoir sur la force de gravité, mais sans avoir bien connu la vraie direction et la véritable loi de la pesanteur. Newton résolut le problème en regardant la terre comme un solide homogène de révolution. Cléraut en donna la solution dans l’hypothèse d’une densité variable, mais la même dans chaque couche concentrique, et en supposant par conséquent que la force de la pesanteur est toujours perpendiculaire à la surface. Ces suppositions, quelque naturelles qu’elles paraissent, sont un peu arbitraires, et d’Alembert traita le problème d’une manière plus générale et plus rigoureuse, en supposant seulement la figure peu différente d’une sphère, et la densité assujettie à une loi quelconque.
On sait que dans ces questions on suppose à la terre une figure telle, que, si elle était fluide, ses parties resteraient en équilibre, et qu’elle conserverait la même figure, sans aucun autre changement que les oscillations produites dans la masse fluide par l’action des corps célestes. Cette supposition fit découvrir à d’Alembert qu’il existait pour les fluides deux états d’équilibre : l’un fixe, auquel la masse reviendrait après avoir éprouvé un petit dérangement, et l’autre non fixe, qu’un léger mouvement suffit pour détruire sans retour ; observation qui, s’étendant à toutes les espèces de corps, est très importante dans l’application des principes de la mécanique aux phénomènes de la nature.
Telles avaient été les découvertes de d’Alembert lorsqu’en 1756 l’Académie lui donna le titre de pensionnaire surnuméraire ; cette distinction, accordée à son génie et à ses ouvrages, prouve que les compagnies savantes ont quelquefois assez d’équité, ou entendent assez bien les intérêts de leur gloire pour honorer dans un de leurs membres un mérite et des talents supérieurs ; si leur justice est plus lente, elle est aussi plus éclairée que celle des particuliers. Quelques académiciens, animés d’un zèle sans doute respectable par ses motifs, s’opposaient à cette violation de l’usage ; ils alléguaient les inconvénients de l’exemple : « Eh bien ! leur répondit M. Camus, si un autre prétend à la même distinction, et qu’il ait autant de titres, il faudra bien l’accorder encore. »
En 1759, d’Alembert publia ses Éléments de philosophie.
Il y développe les premiers principes et la véritable méthode des différentes sciences ; il montre les écueils qu’on doit éviter dans chacune quand on ne veut pas risquer de s’égarer : il est peu de livres qui, dans un si petit espace, renferment plus de vérités ; et l’auteur, par la clarté avec laquelle il les analyse, par la propriété des expressions et la précision de son style, a su rendre ces vérités usuelles et accessibles aux lecteurs les moins familiarisés avec les idées abstraites. En retranchant un petit nombre de pages, où il est aisé de reconnaître les sacrifices que des convenances du moment ont exigés, cet ouvrage mérite d’entrer dans l’éducation de tous les hommes qui cherchent à s’instruire, parce qu’il est également propre à donner des idées justes sur tous les objets de nos connaissances à ceux qui ne veulent en approfondir aucun, et à préserver les savants des préjugés que l’étude à laquelle ils se livrent pourrait leur donner. On sait que chaque science a les siens, dont l’étendue des connaissances ou le génie ne saurait nous garantir, qui nuisent au progrès de la science même, et dont la philosophie est le seul préservatif.
On trouve dans ces éléments la solution d’une question importante, déjà discutée dans la préface du Traité de dynamique. Les philosophes disputaient encore pour savoir si les lois du mouvement sont d’une vérité nécessaire ou contingente : c’est-à-dire, si elles sont, les unes des vérités de définition, les autres des conséquences absolues de l’étendue et de l’impénétrabilité des corps, ou bien si ces lois sont l’effet d’une volonté libre, qui les a établies pour conserver l’ordre de l’univers. D’Alembert résolut la question, et montra que ces lois sont nécessaires ; la découverte de son principe lui donna les preuves de cette vérité, et on peut regarder cette partie de son ouvrage comme une découverte en métaphysique, celle de toutes les sciences où jusqu’ici il a été le plus rare d’en faire de vraiment dignes de ce nom.
D’Alembert établit pour principe de morale l’obligation de ne pas regarder comme légitime l’usage de son superflu lorsque d’autres hommes sont privés du nécessaire, et de ne disposer pour soi-même que de la portion de sa fortune qui est formée non aux dépens du nécessaire des autres, mais par la réunion d’une partie de leur superflu.





























