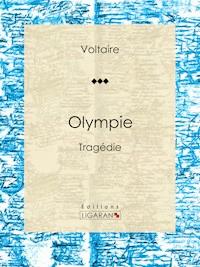
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "CASSANDRE : Sostène, on va finir ces mystères terribles. Cassandre espère enfin des dieux moins inflexibles : Mes jours seront plus purs, et mes sens moins troublés ; Je respire. SOSTÈNE : Seigneur, près d'Éphèse assemblés, Les guerriers qui servaient sous le roi votre père, Ont fait entre mes mains le serment ordinaire : Déjà la Macédoine a reconnu vos lois; De ses deux protecteurs Éphèse a fait le choix."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335067460
©Ligaran 2015
Dans sa brillante jeunesse, Voltaire avait mis quinze jours à ébaucher Zaïre. Il ne lui en avait fallu que huit pour esquisser Rome sauvée, à cinquante-six ans. À soixante-huit ans, six jours lui suffisent pour mettre sur pied Olympie, ou la Famille d’Alexandre. Il écrit au cardinal de Bernis, le 26 octobre 1761 : « La rage s’empara de moi un dimanche, et ne me quitta que le samedi suivant. J’allai toujours rimant, toujours barbouillant ; le sujet me portait à pleines voiles. La pièce est tout faite pour un cardinal. La scène est dans une église, il y a une absolution générale, une confession, une rechute, une religieuse, un évêque. Vous allez croire que j’ai encore le diable au corps en vous écrivant tout cela. Point du tout, je suis dans mon bon sens. Figurez-vous que ce sont les mystères de la Bonne Déesse, la veuve et la fille d’Alexandre retirées dans le temple ; tout ce que l’ancienne religion a de plus auguste, tout ce que les plus grands malheurs ont de touchant, les grands crimes de funeste, les passions de déchirant, et la peinture de la vie humaine de plus vrai. »
Mais la révision fut longue, comme toujours. La nouvelle tragédie ne fut représentée sur le Théâtre-Français que le 17 mars 1764. « On va nous donner encore, écrit Fréron à l’abbé Gossart, une rapsodie tragique de Voltaire, intitulée Olympie, et tout le monde lui applique son titre : ô l’impie ! »
Voltaire feint de croire que le jeu de mots ne s’adresse qu’à la pièce : « Ô l’impie ! n’est pas juste, écrit-il à d’Alembert, car rien n’est plus pie que cette pièce ; et j’ai grand-peur qu’elle ne soit bonne qu’à être jouée dans un couvent de nonnes le jour de la fête de l’abbesse. »
Olympie fut assez favorablement accueillie ; elle eut dix représentations dans sa nouveauté. Voltaire avait emprunté ce sujet au Cassandre de La Calprenède. « Il convenait au génie, dit Laharpe, d’oser nous montrer la fille d’Alexandre se précipitant dans les flammes du bûcher qui va consumer sa mère, et la dignité des personnages relevait encore cette action grande et tragique. Mais il eût fallu nous intéresser davantage à cet amour d’Olympie pour Cassandre et à celui de Cassandre pour Olympie, puisque au sacrifice de cet amour tient tout l’effet de ce dénouement funeste, puisque Olympie ne se jette dans le bûcher que pour ne pas épouser Cassandre, puisque Cassandre se tue de désespoir d’avoir perdu Olympie. Or, dès le premier acte, l’auteur les a placés tous deux dans des circonstances qui, rendant leur union impossible, ne permettent pas qu’on s’intéresse à un amour dont il n’y a rien à espérer. »
Cette tragédie est celle peut-être que Voltaire, dans sa vieillesse, prit le plus à cœur. Il faut voir, dans la correspondance de l’année 1766, quelle joie lui cause le succès d’Olympie sur le théâtre de Genève ; le 3 novembre il écrit à d’Argental : « La troupe de Genève, qui n’est pas absolument mauvaise, se surpassa hier en jouant Olympie ; elle n’a jamais eu un si grand succès. La foule qui assistait à ce spectacle le redemanda pour le lendemain à grands cris. » Le 7 novembre, il écrit au même : « On est toujours fou d’Olympie à Genève, on la joue tous les jours. Le bûcher tourne la tête ; il y avait beaucoup moins de monde au bûcher de Servet, quand vingt-cinq faquins le firent brûler. » Il y a dans les Mémoires rédigés par M. Coste sous le nom de Marie-Françoise Dumesnil, en réponse aux Mémoires d’Hippolyte Clairon, une anecdote à propos de cette dernière actrice et d’Olympie. Louis XV avait témoigné l’envie de voir les Grâces de Saint-Foix. La Comédie est mandée à Versailles pour jouer Olympie, et les Grâces comme petite pièce. Mais le roi avait conseil à neuf heures ; il ne fallait pas perdre de temps. Mlle Clairon jouait Olympie. Les actrices, notamment Mlle d’Oligny, qui jouaient dans les Grâces, devaient faire partie du cortège d’Olympie ; mais afin qu’elles n’eussent pas à changer de costume après la grande pièce, et que la petite pût commencer tout de suite, M. de La Ferté, intendant des menus-plaisirs, décida que les comédiennes seraient remplacées dans le cortège par des choristes de l’Opéra. Mlle Clairon : « Si l’on change quelque chose à la pompe théâtrale d’Olympie, je ne jouerai point. » Et, se retournant vers Mlle d’Oligny et ses compagnes : « Et vous, mesdemoiselles, je vous défends de vous laisser remplacer. » En vain M. de La Ferté insiste ; Mlle Clairon répète son ultimatum : « Je ne jouerai point. » Il fallut laisser les comédiennes dans son cortège. La tragédie traîne en longueur. Louis XV s’impatiente : il tire sa montre ; neuf heures sont sonnées ; il se lève et sort en disant à haute voix : « On m’avait promis les Grâces. » Tel était le ton qu’avaient pris, même à la cour, les fameuses actrices de cette époque. Et qui faillit être puni ? Ce fut Fréron, qui inséra dans son journal une plainte de Saint-Foix, et qui n’évita d’aller en prison que par l’intercession du roi de Pologne.
Cette tragédie parut imprimée en 1763 ; elle fut jouée à Ferney, et sur le théâtre de l’électeur palatin. M. de Voltaire, alors âgé de soixante-neuf ans, la composa en six jours. C’est l’ouvrage de six jours, écrivait-il à un philosophe illustre, dont il voulait savoir l’opinion sur cette pièce. L’auteur n’aurait pas dû se reposer le septième, lui répondit son ami. Aussi s’est-il repenti de son ouvrage, répliqua M. de Voltaire ; et quelque temps après il renvoya la pièce avec beaucoup de corrections. Olympie a été traduite en italien et jouée à Venise, sur le théâtre de San-Salvatore, avec un grand succès.
CASSANDRE, fils d’Antipatre, roi de Macédoine.
ANTIGONE, roi d’une partie de l’Asie,
STATIRA, veuve d’Alexandre.
OLYMPIE, fille d’Alexandre et de Statira.
L’HIÉROPHANTE, ou grand-prêtre, qui préside à la célébration des grands mystères.
SOSTÈNE, officier de Cassandre.
HERMAS, officier d’Antigone.
PRÊTRES
INITIÉS.
PRÊTRESSES
SOLDATS
PEUPLE.
La scène est dans le temple d’Éphèse, où l’on célèbre les grands mystères. Le théâtre représente le temple, le péristyle, et la place qui conduit au temple.
Le fond du théâtre représente un temple dont les trois portes fermées sont ornées de larges pilastres : les deux ailes forment un vaste péristyle. Sostène est dans le péristyle, la grande porte s’ouvre. Cassandre, troublé et agité, vient à lui : la grande porte se referme.
Cassandre, Sostène.
À part.





























