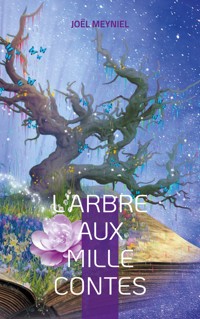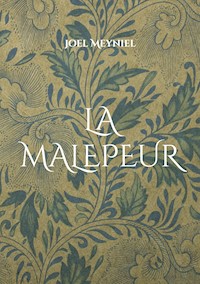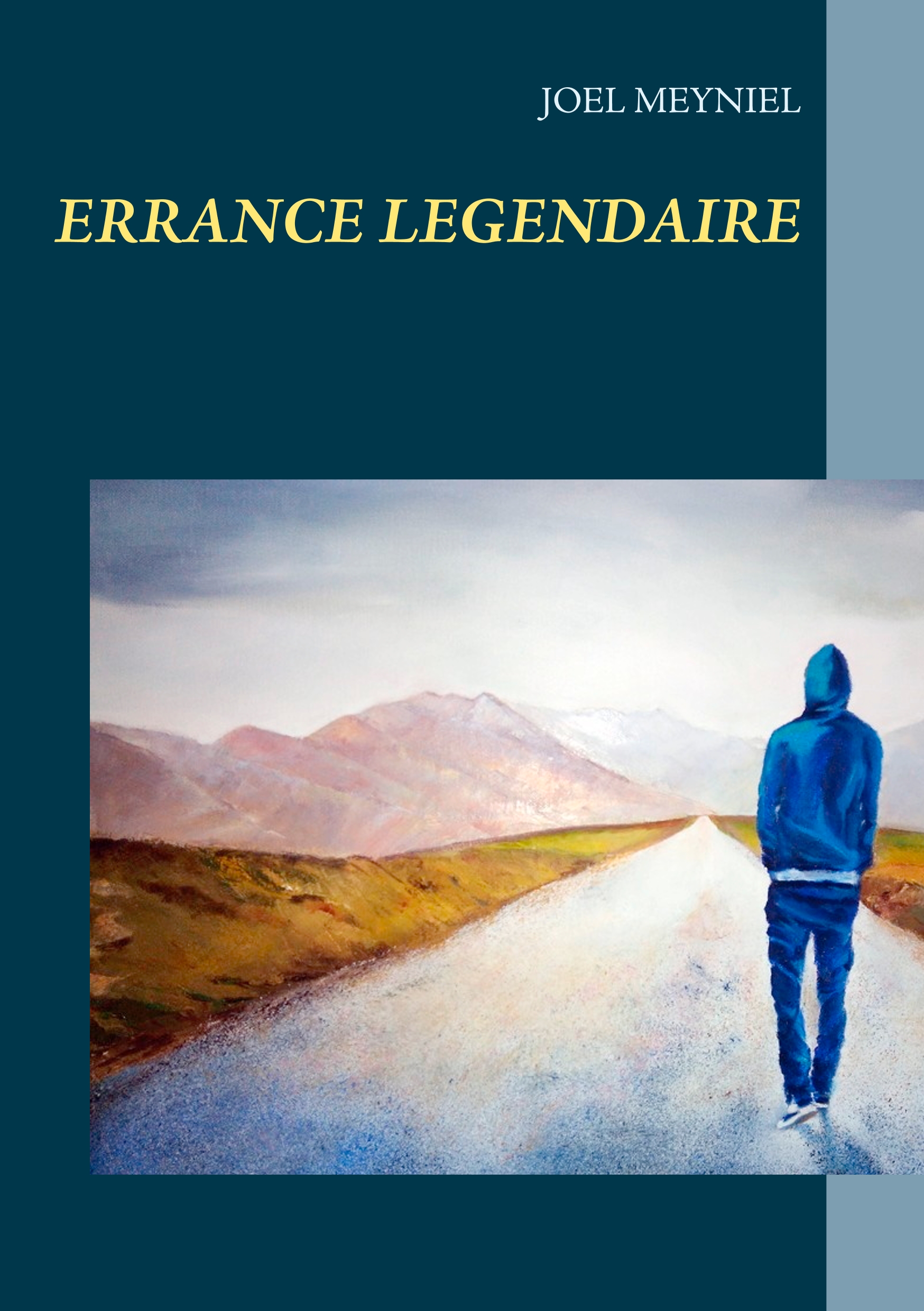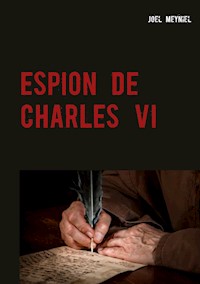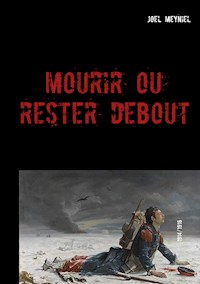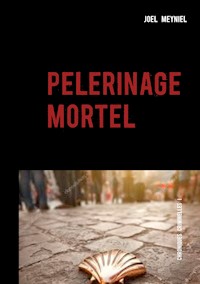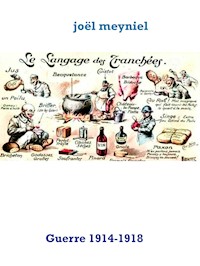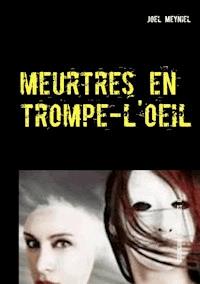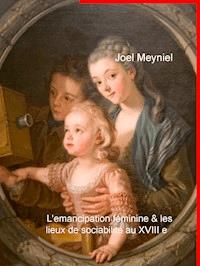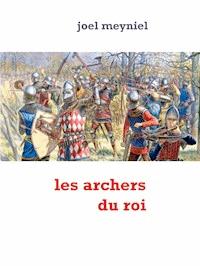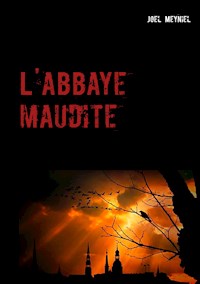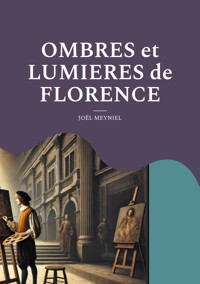
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À Florence, le quattrocento transforme le monde des arts. Mais, il est très imbriqué dans la sphère politique, par l'action du mécénat. Cette renaissance artistique ne va pas sans des ombres et des lumières qui créent un climat de fébrilité et de violence. Un jeune apprenti découvre des dessins appartenant à Léonard de Vinci dans l'atelier de son maître. L'un d'eux le captive particulièrement. Malgré les risques, il décide de concrétiser le projet du grand maître. Il se retrouve ainsi mêlé dans les intrigues des grandes failles florentines.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le grand Maître da Vinci est connu pour son écriture en miroir, ses difficultés pour écrire et ses nombreuses taches.
DU MÊME AUTEUR
Chez BoD
Brochés et E. Books
Chroniques criminelles.
Pèlerinage mortel,
Chroniques criminelles I, Paris 2016.
Meurtres en trompe-l’oeil,
Chroniques criminelles II, Paris 2017.
L’abbaye maudite,
Chroniques criminelles III, Paris 2018.
Espion de Charles VI,
Chroniques criminelles IV, Paris 2020.
Les fleurs du sel,
Chroniques criminelles V, Paris 2021.
La malepeur,
Chroniques criminelles VI, paris 2023.
Les Réssusciteurs,
Chroniques criminelles VII, Paris 2024.
Et pourtant, un jour… Paris 2024.
Histoire
Mourir ou rester debout, Paris, 2016.
Le symbolisme dans l’archerie, Paris, 2018.
Errance légendaire, Paris, 2020.
E. Books
Le symbolisme dans l’Archerie, Paris 2017.
Les Archers du roi, Paris, 2017.
De l’arc au canon, Paris, 2017.
L’émancipation féminine au XVIIIe siècle, Paris, 2017.
Chez ÉMOTION PRIMITIVE
Le symbolisme dans l’Archerie, Paris 2022.
(Édition revue et augmentée).
Chez THE BOOKEDITION
Sur la voie de Tours, Paris 2024.
L’ire divine, Paris 2024.
Rester debout, Patris 2024.
Photo couverture : Création de l’auteur .
Légende carte de Florence au 15e siècle.
1 Cathédrale Santa maria del Fiore.
2 Hôpital des Innocents dont Vincenzo Borghini est prieur. Premier orphelinat au monde.
3 Couvent Sainte Catherine de Sienne dont Sœur Plautilla Nelli est prieure.
4 Ponte Vecchio.
5 Palazzo Vecchio/ Seigneurie, résidence des de’Médici, duc de Florence.
6 Basilique Santa Croce.
7 Basilique San Lorenzo.
8 Basilique Santa Maria Novella.
9 Palais Pitti. En travaux. Futur résidence du Duc.
10 Basilique Santo Spirito
11 Logis de la famille de Filippo Gaetano. 11 via Della Chiesa.
12 Logis et boutique de bijouterie de la famille du Maître Ghirlandaio, via dell’ Ariento.
13 Atelier du Maître Ghirlandaio. 35 Via Guelfa.
14 Logis du tueur de renom Montesecco, 25 via del Melarancio.
15 Logis et boutique de la famille de Fabiano Pogni.
16 Le palais des de’ Pazzi, à l’angle de la via Borgo degli Albizi et de la via del Proconsolo.
Personnages principaux
(Photos libre de droits)
Filippo Gaetano. Garzone chez Ghirlandaio
Fabiano Pogni.
Garzone chez Ghirlandaio
Catarina de’ Pazzi.
Domenico Bigordi, dit Domenico Ghirlandaio.
Antonia di ser Paolo di Simone Paoli. Epouse de Domennico Ghirlandaio.
Lorenzo di Piero de' Medici dit le Magnifique.
Leonardo di ser Piero da Vinci, dit Leonardo da Vinci.
Michelagolo di Lodovico Buonarroti Simoni.
Jacopo de’ Pazzi.
Francesco de’ Pazzi.
Renato de’ Pazzi.
Jean Fouquet.
Maddalena Serristori, l’épouse légitime de Jacopo de’ Pazzi.
Nicolas Machiavel.Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. Humaniste florentin.
Montesecco. Tueur professionnel.
Guglielmo de’ Pazzi .
Giuliano de’Médici.
Desiderio Fancelli. Garzone chez Ghirlandaio.
Luca Ferro. Garzone chez Ghirlandaio.
Bianca Maria di Piero de' Medici. Fille aînée de Piero de' Medici et de Lucrezia Tornabuoni, et sœur aînée de Lorenzo le Magnifique et de
Alessandro Zanella. Chanteur de musique sacrée et profane.
Francesco Salviati. Archevêque de Pise.
Adriano Landino Garzone chez Ghirlandaio.
L’Histoire, avec un grand « H », se révèle généralement l’oeuvre d’un État, ou encore de vainqueurs. C’est donc souvent une version partielle, voire tronquée, qui correspond à leurs intérêts. Soulignons que c’est souvent une vision masculine des événements qu’on présente.
En tant qu’auteur, j’ai toujours pour objectif de replacer les événements dans leur contexte ou d’en approcher le plus possible.
On nomme cela la socio histoire.
De quoi s’agit-il ?
La socio histoire représente une approche de plusieurs disciplines qui s’inspire de la sociologie.
Elle vise à éclairer et à comprendre l’influence de l’histoire sur le présent.
Elle cherche à interpréter les pratiques individuelles en les replaçant dans leur contexte social et historique.
La sociologie historique ne se contente pas d’analyser les événements actuels, mais cherche plutôt à comprendre les mécanismes qui ont conduit à leur déroulement.
J’évite d’utiliser la « conjoncture » comme explication facile et préfabriquée. Au lieu de cela, je m’efforce d’établir un lien entre des circonstances spécifiques, des comportements sociaux et une situation politique réelle.
Je m’appuie sur la démarche de mon directeur de recherche à la Faculté, le professeur Daniel Roche, l’un des fondateurs de cette approche sociohistorique.
Je relate une histoire fictive sur un fond d’événements réels. Je mêle des personnages réels et imaginaires dans un contexte historique pour rester fidèle à la réalité.
Cette méthode ne rejette en rien l’utilisation des sciences sociales ni l’intégration des outils de l’ethnographe et du statisticien.
Cela permet d’envisager notre passé à travers un prisme analogue à notre présent.
Au-delà des grandes effervescences marquantes, on comprend que leurs préoccupations nous ressemblaient souvent plus que ce que l’on pense souvent.
Ainsi, déclarer que « c’était mieux avant » n’est pas toujours vrai. Bien des problèmes sont et restent les mêmes à travers les époques.
Je vous invite à vous transporter au XVe siècle, époque à laquelle se déroule cette histoire.
Je vous souhaite de savourer le chemin de l’histoire en parcourant les pages suivantes, au rythme qui vous convient, jusqu’à la conclusion, le dénouement.
C’est avec joie que j’imagine d’autres yeux parcourant ce même chemin que j’ai eu, le plaisir d’écrire.
À présent, partons pour le XVe siècle.
Sommaire
Chapitre I
Tours. 1442.
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Tours. 1468.
Chapitre V
Tours. 1469.
Chapitre VI
Chapitre VII
Florence. 1472.
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Tours 1477.
Chapitre XXXIV
EPILOGUE
ANNEXE
I
Tours. 1442.
J’ai vu le jour dans le Val de Loire, à Tours, vers 1420, mais personne n’en est certain.
Je m’appelle Jean, Jean Fouquet.
Je suis un artiste aux multiples facettes, capable de réaliser des portraits, des oeuvres religieuses, des enluminures et des motifs décoratifs pour les tapisseries ou les vitraux.
En vérité, mes compétences sont plutôt diversifiées.
Mon atelier se trouve dans le Vieux-Tours, qui est composé de différents quartiers qui se sont unis au fil du temps. Il se divise en deux secteurs principaux : le quartier de Saint-Gratien et celui de Châteauneuf.
On y découvre divers endroits remarquables, tels que : Notre-Dame-la-Riche, Saint-Martin, Saint-Giuliano, Saint-Gatien et Saint-Pierre-des-Corps.
Le quartier Saint-Gatien a été bâti sur les vestiges d’une villa gallo-romaine, elle-même érigée sur une colline inondable de la Varenne1.
C’est le premier secteur à s’être développé, avec l’installation d’un castrum au IVe siècle.
Il est délimité par l’ancienne cité des Turones et capitale de la IIIe lyonnaise de Caesarodunum2.
Au cours du premier millénaire, il est devenu le centre du pouvoir diplomatique et ecclésiastique de la ville.
La cathédrale a été construite sur les ruines de l’amphithéâtre où les chanoines, communément appelés le cloître de la Psalette, ont élu domicile.
Cette appellation provient du son des psaumes qui résonnaient dans l’école de musique voisine.
Le plus ancien récit concernant cette abbaye date du VIe siècle et est attribué à l’évêque et chroniqueur Grégoire de Tours. Il décrit un réfectoire, une salle de sommeil et un portique avec une galerie couverte par des voûtes soutenues par des colonnes ou des piliers.
Le second secteur, appelé Châteauneuf, a été érigé comme protection du lieu de pèlerinage célèbre de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Cet ensemble religieux, porte le nom de « Martinopole ». Il fut bâti autour du tombeau de Saint-Martin, qui se trouvait initialement sur une butte près du fleuve.
À l’instigation de Louis IX, le château et la cathédrale furent ensuite reconstruits sur les fondations de l’édifice antérieur.
Grâce à l’intégralité de ses châteaux, à son statut de site de procession très prisé et à la fréquente visite des souverains en Touraine, la ville devint une véritable capitale de la France à compter de 1430.
Elle Vu naître le premier projet sur l’industrie de la soie, voulu par Louis XI.
Actuellement, tout le monde s’accorde à dire que la France se trouve à un moment crucial de son histoire, que ce soit sur le plan politique ou artistique.
Sur le plan politique, elle fait face à une situation de division, que l’on appelle une « faide » ou une « faida »3.
Pour mieux comprendre, il est nécessaire de remonter dans le passé, en 1328, qui correspond à l’année suivant la mort de Louis X, surnommé le Hutin, survenue deux ans après celle de son père, Philippe le Bel. Ce décès marque la fin du « miracle capétien ».
Depuis 987, tous les rois capétiens ont toujours eu des héritiers mâles. Avec sa première femme, Marguerite de Bourgogne, qui fut accusée d’adultère, Louis X n’eut qu’une fille, Jeanne de Navarre. Sa seconde épouse, Clémence de Hongrie, était enceinte lorsqu’il décéda. Elle mit au monde un fils, Jean Ier, mais il ne vit que quatre jours avant de mourir.
Pour la première fois de l’histoire, l’héritière directe du trône de France est une femme, Jeanne de Navarre. Cette décision revêt une grande importance, car elle servira de précédent pour régler la question de la succession au trône en 1328.
La reine Marguerite a commis une infidélité, ce qui a justifié l’écartement de sa fille Jeanne et l’accession au trône de France Philippe V le Long, frère de Louis X le Hutin, comme roi de France. En réalité, cette démarche est d’ordre géopolitique. Elle découle du refus d’accepter qu’un étranger puisse épouser la reine et régner sur le pays. Le choix du monarque français repose sur l’hérédité et le sacre, mais l’élection reprend ses droits en cas de problème.
Les Capétiens avaient soigneusement adopté des mesures légales pour consolider leur pouvoir en intégrant les fiefs de leurs vassaux décédés sans héritiers mâles à leur trône. Philippe le Bel avait introduit la « clause de la masculinité », selon l’expression de Jean Favier, en révisant, la veille de sa mort, le statut de l’apanage du Poitou. En raison de ce statut, « faute d’héritier mâle, il reviendrait à la Couronne de France ».
La loi salique n’est pas invoquée lors du choix du nouveau roi de France. Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard, vers 1350, qu’un bénédictin de l’abbaye de Saint-Denis, qui tient la chronique officielle du Royaume, argue cette loi pour renforcer la position du roi de France dans le duel de propagande qu’il livre à Édouard III d’Angleterre.
Cette loi date de l’époque des Francs. Elle stipule que les femmes sont exclues de la « terre salique », le terme salique provenant de la rivière Sala4, aux Pays-Bas, terre des Francs saliens. Cette loi a été répétée, adaptée à la situation et utilisée comme argument de poids dans les débats sur la légitimité du roi.
Après le bref règne de Philippe V, qui mourut sans laisser de fils, son frère cadet, Charles IV, monta sur le trône en 1322, bénéficiant du précédent établi par son aîné. Cependant, son règne fut aussi court que celui de son frère aîné. Avant de mourir, il demanda que, si sa femme donnait naissance à un fils, celui-ci devienne roi. Si c’est une fille qui naît, les aristocrates doivent décider qui portera la couronne.
Lorsque le troisième et dernier fils de Philippe le Bel décède en 1328, la question dynastique se pose : Isabelle de France, dernière fille de Philippe le Bel, a un fils, Édouard III, qui règne sur l’Angleterre.
Peut-elle transmettre un droit qu’elle n’est pas ellemême autorisée à exercer selon la coutume établie dix ans plus tôt ?
Édouard III postule pour le trône, mais c’est en fin de compte Philippe VI de Valois qui est élu. Il est le fils de Charles de Valois, frère cadet de Philippe le Bel, et il descend donc, par les mâles, de la postérité capétienne. Les pairs de France rejettent l’idée d’un roi étranger, appliquant la même logique de souveraineté nationale que dix ans auparavant. Édouard III d’Angleterre, avec quelques réserves, rend finalement hommage à Philippe VI en tant que vassal de la Guyenne.
Édouard III, après avoir prêté allégeance et reconnu Philippe VI comme son roi, a dû accepter certaines concessions dans la région de la Gascogne. Il se réserve cependant le droit de réclamer les territoires arbitrairement confisqués. De plus, il s’attend à ce que ses actions en Écosse ne soient pas entravées. Philippe VI persiste à appuyer David Bruce. Édouard III utilisa son droit de naissance pour justifier le début du conflit.
Un affrontement familial armé5 avec à la fois des faides, des chevauchées et caractéristiques nouvelles des expéditions militaires rapides, souvent menées pour piller ou déstabiliser qui sont entrecoupées de batailles avec les Anglais, depuis 1337.
Bien que je me questionne parfois sur la possibilité que les deux parties aient un peu raison dans cette confrontation.
Nos structures médiévales se transforment, ce qui indique une transition vers un renouveau.
Mais quel renouveau ?
Je l’ignore.
Les États voisins, fragmentés, sont différenciés par une expansion des monarchies, des rivalités de pouvoir entre différentes dynasties et l’émergence de divisions religieuses.
Depuis le début du siècle, l’art s’est caractérisé par une prédominance marquée du style gothique sur tout le continent.
Ce mouvement artistique se distingue par son raffinement, son élégance et son ornementation abondante, avec des lignes fines et gracieuses, ainsi que des formes allongées et avenantes. Les couleurs sont éclatantes et majestueuses, avec de nombreux détails décoratifs.
Malheureusement, les sujets traités restent sacrés et limités dans leur diversité.
Il n’y a aucun progrès.
Tout paraît immobile.
L’exemple le plus marquant est l’art de l’enluminure, pratiqué par les miniaturistes de l’époque.
Cependant, si la plupart des aspects sont encore gothiques, il existe une exception remarquable.
Cette singularité s’épanouit particulièrement en Italie.
*
C’est dans cet endroit qu’un renouveau a vu le jour.
Cette résurgence a commencé au début du siècle dernier, émergeant des profondeurs de l’Italie du Nord. Elle se caractérise par une réappropriation des principes de l’Antiquité gréco-romaine, avec un intérêt grandissant pour l’humanisme, la perspective et les proportions.
Cette démarche est alimentée par la redécouverte des textes de l’histoire ancienne. Elle prône l’étude de la philosophie, de la littérature, des sciences et des expressions d’un idéal esthétique.
Les souverains et les négociants prospères occupent une place centrale dans ce mouvement. En effet, ils soutiennent financièrement les beaux-arts ainsi que les savants. Leur contribution permet l’émergence d’originales connaissances et d’une pensée tournée vers l’individu et son potentiel.
En France, par nature, nous sommes réfractaires au changement, comme bien souvent. Nous sommes aussi circonspects face à des apparences jugées trop innovantes, en raison de notre attachement aux traditions gothiques, de la prééminence des écoles flamandes et de notre isolement par rapport aux courants italiens.
Voilà pourquoi nous mettons du temps à accepter et à intégrer ce changement, particulièrement dans le domaine de la peinture.
Je pense en comprendre les raisons.
Il y a plusieurs explications possibles à cette résistance initiale.
Le passage à des concepts tels que la perspective, le naturalisme et l’humanisme, promus par ce mouvement de renouveau, suscitent de la méfiance, car il remet en question des styles bien établis depuis des décennies.
La plupart des artistes préfèrent rester dans leur zone de confort, sans prendre de risques ni relever de défis, plutôt que de s’aventurer dans l’inconnu.
Ils ont tendance à ne pas vouloir modifier leurs habitudes, soit par paresse, soit par crainte de l’effort requis. Cela les amène à préférer le statu quo, par peur du changement ou attachement à l’immobilisme.
Nous sommes satisfaits de notre situation présente et n’avons aucune envie de l’échapper, ni même de sortir de notre aire de facilité pour faire face à une nouvelle condition imprévisible.
À ma décharge, je dois admettre que les contacts directs avec l’Italie sont relativement rares au cours de la première moitié du XXe siècle.
Les échanges culturels se sont principalement concentrés sur quelques régions, telles que la cour des ducs de Bourgogne, où l’influence flamande prédominait.
Notre éloignement physique par rapport aux centres artistiques italiens a entravé la propagation.
Plutôt que de regarder vers l’Italie, la plupart de mes condisciples sont davantage tournés vers le nord de l’Europe, en particulier vers les Flandres et la Bourgogne.
Les maîtres flamands, connus pour leur naturalisme soigné et leur souci du détail, exercent une emprise majeure sur leur travail.
Leurs méthodes, telles que l’utilisation de la peinture à l’huile, sont en effet uniques, mais elles s’écartent des spécificités italiennes en matière de perspective linéaire ou de composition humaniste.
Ce penchant pour l’art flamand freine l’assimilation des idées italiennes.
La plupart de nos commandes proviennent de l’Église ou de la noblesse. Ces mécènes sont très attachés aux représentations religieuses traditionnelles. Elles rejettent les innovations inspirées par une vision plus terre-à-terre de la nature et du corps humain, les considérant en général comme étant trop mondaines ou impies. Cette résistance à l’évolution des styles artistiques empêche l’introduction des courants italienne dans notre région.
Il est vrai que les fonds financiers sont souvent consacrés à des dépenses militaires et à la gestion de l’instabilité liée au conflit avec l’Angleterre, ce qui entrave les investissements dans des acquisitions de bon goût.
Cette situation a également entraîné une certaine résurgence de styles locaux plus traditionnels et une attitude plus réservée envers l’adoption d’autres tendances.
L’intégration des techniques innovantes est lente, notamment parce qu’on a un accès restreint aux oeuvres et aux méthodes de travail des grands maîtres italiens. Enfin, la notoriété des artistes n’est pas très importante. Ce qui manque, ce n’est pas l’élan inventif ni l’inspiration. Nous peignons plutôt pour immortaliser de diverses personnalités, et non pour assurer notre propre renommée.
Il est impératif de trouver un motif convaincant à l’intérieur de nos communautés pour nous libérer de notre indifférence envers toutes les autres choses que l’admiration de nos pairs.
Nous sommes loin des efforts anonymes de nos prédécesseurs du XIe et du XIIe siècle, pour passer sous silence leur individualité créatrice, d’ailleurs, tout à fait voilée.
De nos jours, la pensée est beaucoup moins libre qu’aux époques précédentes et, sans chercher à les juger, nous avons perdu notre innocence naturelle.
L’art s’est transformé en une forme rigide et répétitive, une corvée ennuyeuse et maladroite.
L’idéal gothique souffre du même mal que la philosophie et la poésie.
Nous avons délaissé la délicatesse et la subtilité.
Nous avons besoin d’une voie d’éclairage.
*
Les échos de l’Italie se font de plus en plus entendre. Les récits de voyageurs, les missives d’érudits, les oeuvres d’artistes et de philosophes italiens s’épanouissent dans les cercles royaux et les salons humanistes.
Le « Quattrocento » est, pour moi, comme pour tout le monde, un aimant irrésistible.
C’est là que des génies ont transformé notre vision de l’art, de l’architecture, de la personne. J’imagine ces villes animées où les idées circulent librement.
C’est pour toutes ces raisons que je me résous d’aller voir de plus près ce qu’il en est.
Ce déplacement comporte des risques.
L’espoir est plus puissant que la crainte.
Il annonce le début d’une métamorphose intérieure.
Je décide d’entreprendre l’écriture d’un journal de mon séjour. Ce ne sera pas uniquement un voyage géographique, mais aussi intellectuel et spirituel. Je me rapprocherai ainsi de la quintessence de ce qu’on appelle l’Homme nouveau.
J’ignorerai alors que j’allais faire l’expérience des dissensions qui agitent la ville.
Je m’y rendais pour y voir ses lumières, pas ses côtés sombres.
Voici mes péripéties.
*
1 Plaine alluviale.
2Caesarodunum est le nom de la ville du Haut-Empire qui a précédé Tours, dans la plaine alluviale séparant la Loire du Cher.
3 Du vieux français feide, faide (« querelle de famille, brouille ancestrale »), attesté en latin médiéval faida (731), emprunté à l’ancien bas-francique * fēhida (« vendetta, inimitié »), continué par le néerlandais vete et comparable à l’allemand Fehde, au vieil anglais fǣN hþ (u).
4 Aujourd’hui Yssel.
5 Au Moyen-Âge, on n’utilise pas le mot guerre qui est certes d’origine ancienne, dérivant du francique, une langue germanique, « werra », qui signifiait « désordre » ou « querelle ». Le vocable a progressivement évolué pour désigner une rivalité à grande échelle.
Mais la notion contemporaine de « guerre » ne correspond pas exactement à celle du Moyen-Âge. À cette époque, le concept était souvent plus localisé, fragmenté, et moins institutionnalisé qu’aujourd’hui, et l’expression n’avait pas les mêmes connotations qu’il a prises par la suite. Donc, pour parler des différends médiévaux, le terme « conflit armé » ou « hostilité » est plus neutre et précis pour ne pas imposer les connotations modernes du mot « guerre ». Cet affrontement, que l’on nommera, plus tard, sous le vocable de « Guerre de Cent Ans » s’est étendu sur plus d’un siècle (1337-1453), a profondément marqué l’Europe médiévale. Ce conflit sanglant a eu des répercussions considérables sur de nombreux aspects de la société, y compris l’art.
II
Cette lueur transalpine est pour moi une étincelle suffisante pour me diriger vers l’origine de cette clarté nocturne.
Le hasard effectue parfois bien les choses, et c’est ainsi qu’un grand artiste de la cour de Bourgogne a fait une halte à Tours.
J’ai profité de son passage pour en savoir plus.
C’est ainsi que j’ai connu Hans Memling, un peintre allemand d’influence flamande, qui s’était établi à Bruges.
Avant de s’installer à Bruges, Memling travailla dans l’atelier bruxellois de son mentor Rogier Van der Weyden.
Les similitudes stylistiques entre ces deux artistes montrent qu’ils étaient proches. Memling a après développé un genre plus personnel, caractérisé par la sérénité et la douceur, qui est ensuite devenu une référence pour ses contemporains.
— Cher Maître, formé dans la tradition gothique pure, j’aimerais me distinguer.
Pour ce faire, j’envisage de me lancer dans un voyage en Italie, dans l’espoir de me laisser imprégner de l’esprit d’innovation qui y règne. Je cherche à combiner harmonieusement l’ancien et le moderne dans mon propre style.
— Cette idée est remarquable, mon cher ami.
— Il me semble que maître Van der Weyden et vous-même avez déjà effectué un tel périple, ayant ainsi gagné une réputation flatteuse.
Pourriez-vous m’éclairer sur la situation actuelle ?
Qu’avez-vous appris ? Pouvez-vous me le dire ?
Fort aimablement, il me répond.
— Pourquoi pas, si cela peut vous être utile ?
Tout d’abord, sachez que je suis au courant de votre travail et que je l’apprécie grandement.
Chaque miniature que vous créez est en réalité un petit tableau à part entière.
Vos mises en page sont audacieuses et témoignent d’une maîtrise étonnante. Vos bâtiments et paysages de Paris ou d’ailleurs sont représentés avec un réalisme saisissant.
— Merci beaucoup. Ils me touchent droit au coeur. Cependant, je ne suis pas entièrement satisfait de mon travail. Je pense pouvoir aller plus loin.
— Je partage votre opinion, mon cher Fouquet. Soyez convaincu de la sincérité de ma remarque.
Je ferai tout mon possible pour clarifier cette question.
— Qu’est-ce qui distingue particulièrement ce mouvement artistique ?
— Il s’agit d’une réaction contre l’esthétique byzantine.
Connaissez-vous cet esthétisme ?
— Malheureusement, je dois avouer que non.
— En bref, l’esthétique byzantine a fortement influencé l’art religieux de diverses cultures, notamment dans le monde orthodoxe, mais aussi en Europe occidentale, avec des répercussions sur l’art roman et gothique.
L’art byzantin a prospéré dans l’Empire byzantin, s’étendant du IVe au XVe siècle. Il est profondément marqué par la pratique chrétienne traditionnelle. Ses traits distinctifs sont son orientation vers des thèmes liturgiques, la conception de scènes bibliques, de saints, de la Vierge Marie, du Christ Pantocrator, du Tout-Puissant et d’anges.
Ces sujets revêtent une importance tant spirituelle que didactique. Ils étaient utilisés pour instruire les croyants, qui manquaient de connaissances, sur des préceptes religieux. Ils sont caractérisés par un genre stylisé et abstrait.
Les proportions sont souvent allongées, sans perspective ni ombres.
Leurs icônes, ces représentations sacrées, sont centrales.
Elles ne se contentent pas d’être des portraits, elles sont vraiment élevées au rang d’objets de dévotion. Elles obéissent à des principes rigoureux de composition et de symbolisme.
Les images ne cherchent pas à dépeindre fidèlement la réalité, mais plutôt à idéaliser les sujets pour exposer en postulat leur sainteté.
Les personnages sont habituellement montrés de face, dans des poses statiques et rigides.
Cette approche artistique met en évidence l’importance de l’âme sur le plan spirituel, plutôt que de se concentrer sur l’apparence physique.
La dorure est partout présente, incarnant la lumière divine et l’immatérialité.
L’or est systématiquement utilisé comme fond dans les mosaïques et les icônes. Le bleu, le rouge et le vert sont couramment employés, souvent dans des teintes vives, créant ainsi un contraste saisissant avec les arrièreplans jaunes.
En Italie, vous découvrirez le contraire.
L’objectif est de représenter les corps naturels de manière réaliste.
L’Antiquité est devenue l’étalon-or, tandis que la philosophie humaniste érige l’être humain comme point central de l’univers.
— Comment cette évolution s’est-elle produite ?
— Suite à la prise de Constantinople par les Ottomans, les érudits et artistes byzantins se sont exilés en Italie.
— J’aperçois maintenant le lien. Néanmoins, quel rapport avec notre sujet ?
— Ce bouillonnement et ce mélange de cultures ont créé un climat d’effervescence dans toute la botte.
— L’accueil des étrangers a toujours été mitigé.
— Cependant, ils ont été chaleureusement acceptés dans les États pontificaux.
— Cela me surprend.
— Cela est dû en partie à leur talent artistique dans le domaine de la religion.
En vérité, il y a un lien.
Les papes souhaitaient embellir la ville du Vatican, effaçant ainsi les marques de la Rome impériale.
Les donneurs d’ordres et les financiers ont fait appel à certains artistes orientaux, ce qui a donné lieu à l’introduction de nouvelles techniques dans la peinture et la fresque.
Cela a également entraîné l’émergence d’une représentation du monde plus centrée sur la personne et s’éloignant de la Sainte Trinité, de la religion et de la gloire de Dieu, qui étaient les seuls thèmes auparavant.
C’est de cette manière que l’humanisme a surgi.
La vision d’un individu au coeur de l’univers, plutôt qu’une divinité suprême, en lieu et place de la Divinité.
— Cette proposition est vraiment séduisante.
— À tel point que, après cette initiative de la papauté, à une véritable compétition entre les cités-États pour s’offrir les services de ces artistes.
Des villes comme Florence, Bologne, Ferrare, Urbino, Bari, Padoue, Naples et Ravenne ont joué un rôle clé dans ce renouveau grâce à leurs échanges abondants.
— Florence est-elle une cité culturelle importante, selon vous ?
— Grâce à l’influence des de’Médici, les disciplines artistiques ont subi une transformation radicale. Cosme de’Médici eut recours au mécénat et participa à l’École florentine.
Son objectif était d’insuffler de l’audace et de l’Antiquité, du courage et de la ferveur à la population de cette cité encore fragile, qui devait se défendre de ses voisines, voire des nations étrangères à l’Italie.
La fonction allégorique est ici directe.
Il est important de noter que Florence tire profit des carrières de marbre de Carrare de la région.
— C’est captivant.
— Vous verrez, sur place, la lumière qui émane des toiles, la délicatesse des formes a instauré d’innovants canons, bravant les codes qui maintiennent nos travaux enluminés dans un carcan.
C’est également le début d’une nouvelle ère sociétale.
La bourgeoisie apparaît progressivement et supplante la féodalité.
Les commanditaires ne sont plus exclusivement des personnages religieux qui ne commandent que des représentations de thèmes sacrés.
C’est ainsi que l’art du portrait, le « ritratto », a émergé. Il met en scène d’honnêtes hommes aux côtés des figures divines, qui étaient auparavant montrées seules dans les peintures du « Trecento ».
On peint désormais des traits de citoyens qui veulent exposer leur statut en engageant des imagiers de talent.
La variété des méthodes picturales donne naissance à différents styles.
— Et qu’en est-il de plus ?
— Nous créons des formes arrondies, nommées « Tondos ».
Les dimensions des oeuvres ont considérablement rétréci par rapport aux immenses triptyques d’époques passées, rendues possibles grâce aux progrès techniques.
Les artistes n’ont plus à se soucier des interdits concernant la représentation du corps humain.
Comme vous le savez, le nu n’est pas toléré dans un contexte liturgique, mais seulement associé à l’état de nature de la Genèse.
Cette contrainte a disparu.
Les anachronismes semblent être ignorés.
— L’Église ne paraît pas s’en préoccuper.
— Cette liberté de ton reste toutefois soumise aux autorités morales.
— Tout de même, de l’anatomie dans une oeuvre sacrée !
— Rassurez-vous, pour éviter toute désapprobation, les artistes utilisent des symboles équivoques dans leurs compositions, ainsi que des expressions faciales qui vont jusqu’à une érotisation sculpturale du sujet représenté.
Ils doivent toujours garder leurs analyses graphiques secrètes, loin de leurs clients, des chefs religieux et des courtisans enrichis.
Les tableaux sont devenus l’aboutissement d’une forme d’art ludique entre l’artiste et son mécène, grâce à des messages cryptés dissimulés dans les détails ou à des révélations indirectes.
— Merci beaucoup, maître.
— Je vous en prie. J’apprécie grandement nos discussions sur ce mouvement artistique en plein essor. N’hésitez pas, lancez-vous dans l’aventure !
*
Après avoir surmonté les épreuves de la Praguerie de 1440, une rébellion des aristocrates à laquelle le dauphin Louis participa, une trêve générale fut conclue en 1444. La bureaucratie royale quitta Poitiers et Bourges, où elle s’était installée temporairement, pour s’établir à Paris, où elle subit une réorganisation.
Les ordonnances de 1439 et de 1445 ont permis au monarque de disposer d’une force permanente composée de compagnies de gens d’armes, confortées par une artillerie reconstruite et une infanterie auxiliaire de francs-archers.
Ces ordonnances ont mis fin aux abus des routiers.
Après mon entretien, je me sentis encore plus convaincu. J’en profitai pour élaborer un itinéraire de voyage.
Je décidai de partir en l’année 1443 pour un périple dans les villes de Turin, Gênes, Massa, Pise, Sienne, Florence, Bologne, Modène, Mantoue, Bergame et Milan.
Je cherche à m’imprégner de toutes les sources disponibles en explorant ce que chaque lieu a d’unique, en particulier le raffinement byzantin pour les couleurs, avec un chromatisme très spécifique, allant de l’orange vif au rouge, en passant par le vert amande, et un jeu subtil d’oppositions entre les tons chauds et froids.
Je souhaitais me rendre à Pérouse, mais on m’a dissuadé de le faire en raison des tensions entre les familles Baglioni, Oddi et Michelotti. Elle avait été transformée en champ de bataille.
Tout comme dans de nombreuses villes de Toscane et d’Ombrie, les personnes les plus influentes et les plus riches ont élevé de majestueuses tours.
*
Ma quête en Italie, de 1443 à 1447.
Juin 1447
Quatre ans se sont écoulés.
Je pense avoir saisi les particularités de ce renouveau italien.
Il met surtout en évidence les contrastes d’ombre et de lumière, ce qui donne aux sujets une apparence plus sculpturale.
À présent, c’est à mon tour de m’exercer.
*
III
De nos jours, voyager est une aventure palpitante, une quête remplie de périls et de découvertes.
C’est toujours un véritable périple.
Bien que je ne sois plus de première jeunesse, je suis prêt à affronter tous les défis, même les routes poussiéreuses.
Avec trois autres compagnons, nous nous installons sur une charrette, une sorte de caisse directement posée sur les roues et qui nous fait subir tous les chocs, car rien ne les atténue.
Le comble de l’horreur est atteint lorsque nous réalisons que le train avant ne pivote pas, ce qui signifie que nous ne pouvons pas tourner.
C’est vous dire nos tourments.
Pour être franc, entreprendre ce voyage n’est pas un agrément.
Pour être honnête, il faut vraiment une importante volonté ou une nécessité impérieuse pour se lancer dans une telle aventure.
Les moyens de transport sont très sommaires.
Les déplacements sur de longues distances se font principalement à l’aide de la force animale ou de la marche.
Le choix du matériel roulant dépend de divers facteurs, notamment le type de terrain, les ressources disponibles et votre position sociale.
Les litières, des sortes de cabines ou de chaises charriées par des porteurs humains ou des chevaux, sont réservées à la noblesse et aux personnes fortunées.
Elles offrent un certain confort, mais leur utilisation est relativement lente. De plus, elles ne correspondent pas à mes moyens financiers.
Il y a bien sûr le coursier, principale solution de circuler sur de grande distance. Là encore, il faudrait que je sache monter cet animal. Je ne pense pas être en mesure d’effectuer le voyage jusqu’à Florence de cette façon.
Il ne me reste plus que les charrettes ou les chariots, tirés par des chevaux, des boeufs ou des mules, pour nous, les gens peu fortunés.
Ces véhicules, habituellement en bois avec des roues recouvertes de fer, servent à transporter des bagages ou des vivres.
Ils sont lourds et se meuvent lentement, ce qui allonge considérablement les trajets.
Les voies de circulation sont généralement étroites et boueuses en hiver, poussiéreuses en été, rarement pavées, à l’exception des routes romaines encore en usage.
Cela rend les déplacements surtout inconfortables et dangereux dans certains territoires.
Les accidents sont courants, les charrettes ont tendance à basculer.
On doit se méfier des épidémies fréquentes et dévastatrices qui déciment les régions que nous traversons, comme la peste, la variole et le typhus.
Grâce à l’intervention divine, notre souverain a enfin réussi à éliminer ces « routiers » qui terrorisaient notre pays.
Je ne souhaite pas évoquer l’insalubrité et la promiscuité dans les refuges, qui contribuent à la propagation des maladies.
Il faut aussi miser sur les intempéries auxquelles nous serons exposés.
Les forêts sont des endroits particulièrement dangereux. On peut y rencontrer des bêtes féroces, certaines pouvant même s’avérer mortelles pour l’homme, sans compter celles qu’on appelle « bandits », et qui aiment attaquer les gens, pensant qu’ils transportent leurs richesses.
Je ne dois pas oublier non plus que nous sommes toujours en guerre contre les Godons6.
Bien que privés du soutien de la population, ils ont progressivement été repoussés de notre territoire grâce aux interventions héroïques de Jeanne d’Arc.
Mais il existe encore des zones qui peuvent nous causer des soucis.
Les cités peuvent être le lieu de soulèvements populaires.
L’alimentation est souvent rare, et de mauvaise qualité.
Pour économiser de l’espace, je n’emporte que l’essentiel, quelques vêtements, de la nourriture, de l’argent et une lettre de recommandation.
En résumé, se déplacer s’apparente à une expédition palpitante, mais également à une épreuve exigeante.
Il est nécessaire de posséder une endurance physique et mentale remarquable.
Il est crucial de rédiger un testament en tout temps, en cas de fatalité.
Ah ! Quel effort pour couvrir autant de terrain !
La charrette avance à pas comptés, tirée par des chevaux fatigués qui cahotent sur des routes accidentées.
Je rêve d’un mode de transport différent.
Pourquoi ne pas concevoir une machine qui fonctionnerait sans relâche, ignorant l’épuisement des animaux ?
Des roues qui tourneraient sans interruption, ne nécessitant ni fouet ni repos.
Un engin rapide et silencieux.
Je donnerais tout pour vivre l’ère où les voyages seront faciles, où mille lieues pourront être parcourues en un instant.
Peut-être que les générations futures connaîtront cette expérience que je n’ose qu’envisager…
Ne serait-il pas merveilleux d’avoir un moyen d’évoluer à terre sans avoir besoin de s’arrêter ni de se concentrer, comme le font nos chevaux ?
Je souhaite imaginer une machine résistante qui avancerait sans effort, animée par une force mystérieuse, un peu comme s’il s’agissait d’une magie, peut-être par le feu ou l’eau, à la manière des inventions farfelues des savants alchimistes.
Imaginez… Un engin qui se déplace de lui-même, mû par une puissance qui gît au plus profond de ses entrailles, sans que l’homme n’ait à fournir de l’énergie ni à redouter l’essoufflement des bêtes de somme.
À quoi pourrait-il bien ressembler ?
Une sorte de grande boîte hermétique, peut-être, avec des sièges confortables où les passagers seraient à l’abri des intempéries. Nous pourrions avoir des roues plus solides que celles de nos charrettes, peut-être en un matériau encore inconnu, pour ne pas avoir à craindre les chemins caillouteux et les fossés.
Et si ce véhicule pouvait se mouvoir à une allure fulgurante plutôt que lentement, empruntant de longues voies lisses et rectilignes, spécialement conçues pour lui, sans aucun obstacle pour entraver sa progression !
J’imagine qu’un tel moyen pourrait traverser le pays en une journée, transportant des personnes et des marchandises d’une ville à l’autre sans interruption.
Peut-être même qu’il pourrait être si grand qu’il voiturerait des dizaines, voire des centaines de passagers en même temps. Chacun pourrait ainsi découvrir de nouveaux horizons sans se fatiguer.
Ce serait à la manière qu’un dragon de fer, puissant et rapide, qui servirait les humains sans jamais se lasser.
Un char qui fonctionnerait sans chevaux, mais grâce à une mécanique complexe, comme un coeur battant au centre.
Une idée folle, peut-être, et pourtant…
Quelqu’un devrait transformer cette vision en réalité !
Le monde serait révolutionné, et le voyage deviendrait une source de plaisir plutôt qu’une épreuve !
*
Une fois qu’on a quitté Tours par l’une de ses portes, on marche sur des sentiers étroits, boueux en hiver, poussiéreux en été.
En compagnie de mes malheureux compagnons, nous avons dû nous frayer un chemin à travers les bois, franchir des cours d’eau à la nage ou emprunter des bacs. Les hébergements sont peu nombreux et spartiates. Nous devons habituellement nous loger dans des monastères ou chez des agriculteurs.
En substance, la nourriture se compose principalement de pain, de fromage, de jus de raisin et de fruits.
On dort dans des lits collectifs, souvent infestés de puces.
La mauvaise chère et les variations de climat font que les maladies sont répandues et les traitements très limités. Une banale grippe peut menacer votre existence.
Après avoir visité la région de la Bourgogne, réputée pour son vin et ses paysages vallonnés, le prochain arrêt sera la traversée des Alpes, une étape difficile, même en été.
En hiver, il est impossible de passer, car les avalanches y sont courantes.
Une fois arrivé en Italie, on se dirige directement vers Florence.
Ces conjonctures vous initier aux épreuves de votre résistance physique et mentale.
Bien que j’aie rencontré des obstacles, je ne ressens aucun regret.
Ce périple devait accroître ma culture et approfondir mes connaissances en art.
Le jeu en vaut la chandelle.
*
6 Origine : le juron « Goddam ! » (« Que Dieu me maudisse ! »), utilisé comme insulte envers les Anglais à l’époque.
IV
Tours. 1468.
Mon périple en Italie est terminé.
J’ai laissé derrière moi le soleil transalpin pour un ciel d’argent froid de Tours, bercé par le climat caressant de la vallée de la Loire.
Ce ciel, souvent voilé de brumes matinales et de nuages apaisants, adoucit l’éclairage. Il y a quelque chose de paisible et de mystérieux dans cet éther, une anamorphose qui paraît flotter au-dessus des toits d’ardoises et des châteaux environnants.
Les nuances sont plus subtiles, oscillant entre un bleu pâle et un gris perle, tandis que la lumière filtrée donne aux paysages et aux pierres anciennes une aura d’élégance discrète.
Cette atmosphère s’harmonise avec l’architecture raffinée et l’ambiance érudite qui caractérisent la région, comme si la Loire, elle-même, inspirait une douce contemplation.
Contrairement à celui de Tours, le ciel de Florence luit sous le soleil, éclatant d’un bleu pervenche vif et profond, presque azur. Il est rarement voilé par des nuages et semble enlacer la ville de ses teintes chaudes.
Ce dôme céleste méditerranéen met en valeur les pierres brûlantes et dorées des palais et des églises, plaçant en évidence la richesse des fresques et des sculptures de la Renaissance florentine. Un reflet lumineux anime les tons et les épaisseurs, une brillance qui insuffle de l’inspiration aux artistes, tout comme une toile vierge attendrait impatiemment d’être ornée de chefs-d’oeuvre.
Ce ciel est franc, rayonnant, et sa lueur directe semble encourager l’audace et la passion, en opposition au ciel plus discret de ma ville.
Ainsi, tandis que mon espace incite à la méditation et au calme, celui de Florence exhorte à la production et à l’énergie, chaque sphère imprégnant la ville de sa personnalité distincte.
En l’an de grâce 1450, une occasion s’est offerte à moi de composer un recueil de deux pièces pour Étienne Chevalier, fils de Jean Chevalier, un juriste et procureur laïc de l’abbaye Saint-Père de Melun.
Après avoir obtenu son diplôme en droit, Étienne Chevalier s’est fait remarquer pour ses services auprès de Charles VII. Il est devenu secrétaire royal, puis conseiller et président de la chambre des comptes en 1449, superviseur général des revenus publics, avant de finalement être nommé trésorier du royaume en 1452. Cette directive visait à embellir la chapelle funéraire de la collégiale de Notre-Dame de Melun.
C’est pour cette raison que j’ai intitulé cette oeuvre « Le Diptyque de Melun ».
J’avais là une occasion de mettre en pratique ce que j’ai pu apprendre en Italie.
Mon ambition était de créer une harmonie entre la dévotion religieuse et la conception réaliste.
J’entrepris ce projet en 1452.
Sur le premier panneau, je représentai la Vierge et l’Enfant, et sur le deuxième, Étienne Chevalier, le donateur.
En 1458, je terminai enfin cette composition.
Quand je la regarde aujourd’hui, je me rends compte, au premier regard, que les deux vues semblent si différentes qu’on a de la difficulté à croire qu’elles appartiennent à la même oeuvre.
L’effacement de la Madone s’oppose à la substance des personnages masculins, à l’abondance des anges et à la rigidité des colonnes.
Pourtant, l’Enfant Jésus, perché sur les cuisses de sa mère, désigne bel et bien le puissant trésorier de Charles VII.
J’ai recouvert le bord du volet droit d’un velours bleu brodé et orné de motifs décoratifs.