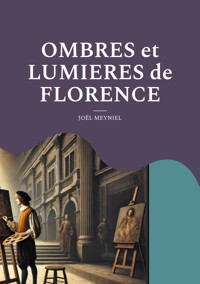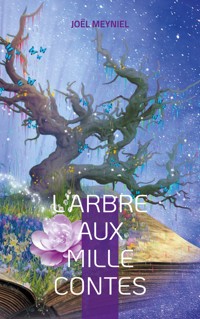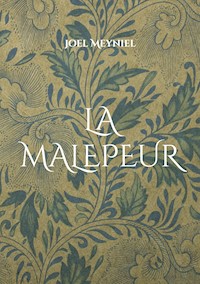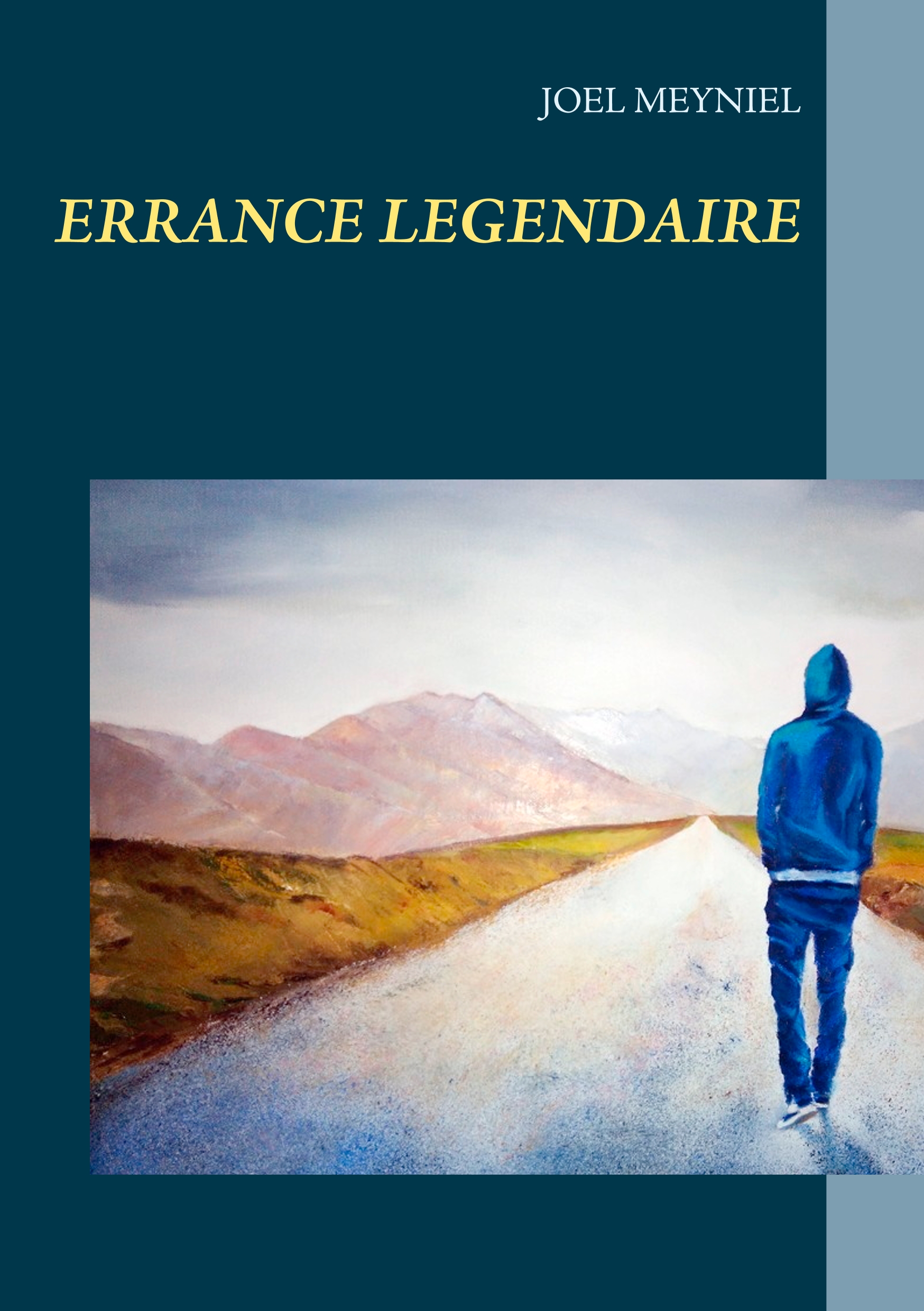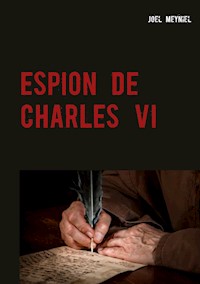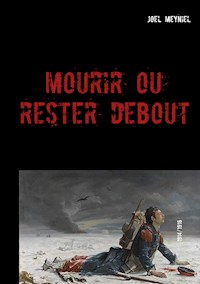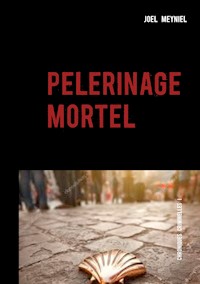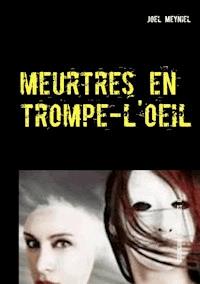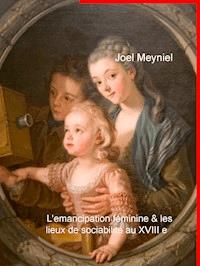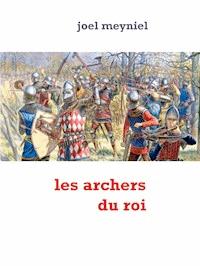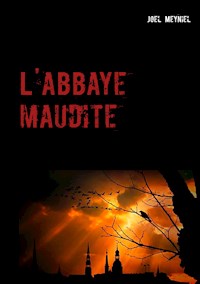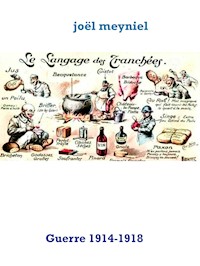
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Bleuet, tu me parais bien mince, méfie-toi des abeilles ou tu finiras dans l'autochir..." Que de perplexité devant une telle phrase. Dans les tranchées, on pouvait entendre ce langage composé de différents argots: argot parisien, militaire, colonial, tournures régionales, auquel venait s'ajouter le langage militaire. Un siècle plus tard, ce vocabulaire, souvent pertinent, drôle ou incongru, n'est pas toujours transparent à nos oreilles. Ce livre replace dans leur contexte, en les expliquant, les termes et les expressions des poilus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
vocabulaire des tranchées
APage de copyrightA
LE LANGAGE DES TRANCHÉES
(1914-1918)
JOËL MEYNIEL
Àmon grand-père,
AVANT-PROPOS
La langue est un moyen d’expression entre les hommes qui se compose de mots identifiés permettant, à tout à chacun, de communiquer de manière orale et écrite.
Il y a pourtant des cas où le langage oral semble nous dépasser. Nous parlons d’autre chose que ce que nous voulons dire où nous ne savons pas où plus comment le dire.
Plusieurs « générations d’oubli » ont suffi à les mettre irrémédiablement hors d’atteinte alors que les écrits peuvent toujours être consultés.
C’est la raison pour laquelle, ce glossaire. Il ne se prétend pas exhaustif, à chacun de le compléter au fil des lectures. Les collégiens, les lycéens, les enseignants, les passionnés pourront, ainsi, utiliser pendant cet événement dramatique qui a profondément marqué le monde en ce début du XXe siècle.
À près d’un siècle d’écart, le langage des soldats de la guerre de 1914-1918, témoin d’un immense brassage linguistique, dans un conflit qui a mobilisé autant d’individus, est loin de paraître transparent. Des mots sont apparus, d’autres ont disparu avec le conflit, certains ont changé de sens, sans oublier toute une terminologie militaire. Ce livre a été conçu pour se familiariser avec le vocabulaire.
Les mots que nous utilisons dans le langage de tous les jours reflètent souvent notre histoire. Ils soulignent la diversité de leurs origines, surtout quand il s’agit de mots concrets et de réalités que l’on a pu emprunter aux uns et aux autres. Si les guerres n’épargnent rien, ni personnes, il existe au moins un domaine de la vie sociale qui ne soit pas affecté par les guerres, c’est celui du langage, bien au contraire.
Des mots sont apparus et ont disparu avec le conflit, d’autres ont changé de sens, beaucoup sont incompréhensibles aux non-initiés à l’art de la guerre ou n’évoquent rien de bien précis pour un lecteur d’aujourd’hui.
Combien de lecteurs n’ont-ils pas été déroutés à la lecture de témoignages d’anciens combattants, par des mots comme un « V.B. », un « fusant » ou encore un « cabot ».
Les mots utilisés par les générations passées sont loin de nous être transparents.
Le langage militaire et celui des tranchées sont un mélange d’argot des casernes, d’argot parisien, d’argot colonial, de provincialismes, de parler régional couvrant l’ensemble du territoire métropolitain et colonial et d’apports nouveaux (troupes étrangères Alliées ou non) forgés au gré des circonstances de la vie quotidienne des soldats. Pour de nombreux poilus ce sont des mots nouveaux.
Ces mots seront véhiculés en partie par le brassage des combattants ou par les lettres envoyées dans leurs foyers. Si certains sont tombés dans l’oubli, d’autres sont passés dans la langue familière et survivent aujourd’hui encore.
Si les soldats ont un vocabulaire spécifique, les états-majors ont, eux aussi, leur vocabulaire, qui n’est pas, lui non plus, toujours aisé de comprendre.
Aujourd’hui, l’effacement progressif de ce vocabulaire décrit, lui, notre paresse ou notre manque de curiosité. Pourtant, que de richesse sont à notre disposition.
Bernard Pivot proposait en 2004, une opération de sauvegarde des mots oubliés. J’ai voulu relever le défi en créant cette sauvegarde de ce vocabulaire de la « Grande Guerre ». Certes, je n’ai pas la prétention d’être exhaustif, mais je pense en avoir regroupé les principaux.
J’espère que ce précis de vocabulaire permettra à tous ceux qui s’intéressent à cette période, collégiens, lycéens, enseignants, passionnés, de se familiariser avec le langage employé par les acteurs du conflit.
Il faut noter que si les termes argotiques et techniques occupent, ici, une place importante, ce n’est pas un dictionnaire complet de l’argot ou des armes utilisées. Pour des dictionnaires complets dans ces différents domaines, le lecteur pourra se reporter aux ouvrages cités en bibliographie.
Aasen
Obusier Aasen se compose d’un tube en acier se chargeant par la culasse, avec un simple volet mobile, se rabattant autour d’une charnière. Au-dessus du tube, un canon de fusil, débouchant dans le tube, est muni d’une culasse mobile cette dernière porte un taquet pour pouvoir verrouiller en même temps le canon de fusil et le tube. Dans le canon de fusil on peut introduire une cartouche de chasse du calibre 8 renfermant une charge de poudre noire.
Le projectile, la grenade Excelsior se compose d’une tête portant un système de percussion.
Abeille
Dans l’argot des combattants, ce mot désigne les balles, les petits éclats d’obus, sans doute en raison du sifflement qu’elles produisent.
Abri(cf. Défense accessoire, Cagna, Casemate Gourbi, Guitoune)
Lieu où l’on peut se mettre à l’abri du danger et /ou des intempéries. Il est généralement creusé en contrebas dans le flanc d’une tranchée. Il est souvent trop petit pour contenir tous les hommes d’une portion de tranchée, qui ne peuvent que s’y relayer. Les officiers et sous-officiers disposent d’un abri spécifique.
Accroche-cœur
Terme utilisé par les combattants pour désigner une décoration.
Active
L’armée d’active comprend avant la mobilisation les militaires professionnels et les conscrits effectuant leur service militaire, par opposition à l’armée de « réserve », constituée des hommes ayant déjà effectué leur service et de l’armée dite « territoriale » constituée des hommes de plus de trente-cinq ans à la date de la mobilisation.
Adrian
— Le casque Adrian, du nom du sous-lieutenant Adrian, adjoint au directeur d’intendance au ministère de la guerre qui l’a conçu. Ce casque, en tôle d’acier de couleur bleutée, est distribué dans les gares régulatrices aux détachements de fantassins français qui quittent les dépôts à partir de septembre 1915. Il existe en trois tailles.
― La baraque Adrian (même origine), est une construction provisoire en bois et métal longue de trente mètres et démontable, destinée au cantonnement des soldats, des blessés ou à servir d’entrepôt. Les baraques Adrian ont également été utilisées dans l’immédiat après-guerre pour pallier les destructions des régions du front.
Aero,Aéroplane (cf. Taube, Zeppelin)
Nom donné aux avions civils et de guerre par les contemporains, à cette époque.
En France, le berceau de l’aviation et en Grande-Bretagne, les stratèges croient peu en l’usage militaire de l’avion. Le War Office voit dans l’aviation un « sport coûteux », défendu par quelques individus dont les idées n’ont aucun intérêt.
Pourtant l’avion est incontestablement l’arme la plus novatrice. En fait l’avion n’est pas, dans un premier temps, une arme, même si durant la guerre, les hommes en font un usage militaire. Tout au plus s’agit-il pour eux d’une plate-forme d’observation pour suivre les déplacements des troupes ennemies ou d’une aide pour régler le tir des artilleries. Dans les escadrilles, on innove au fil des jours. Dans un premier temps, les équipages s’arment de pistolets qu’ils utilisent lors de brèves rencontres avec des avions d’observation adverses. La première victoire aérienne est enregistrée en Octobre 1914, un avion français, un Voisin abattant un avion allemand, un Aviatik. Fin 1915, les Allemands mettent au point un système permettant le tir à travers l’hélice qui leur donne au-dessus du front la maîtrise du ciel que les Français reconquièrent en 1916 grâce à deux excellents avions, le Nieuport 3 et le Spad 3
La technique dite de la « chasse » va voir le jour fin 1915, avec des escadrilles où les meilleurs pilotes deviennent des "as*"1 après avoir atteint le score de cinq victoires. Les exploits guerriers des Guynemer, Mannock, Bishop, Fonck, Boelcke, von Richthofen sont utilisés par la propagande des différents pays pour soutenir le moral des troupes. Les performances des avions augmentent rapidement, passant de 120 à plus de 200 km /h, l’altitude atteinte grimpe de 3000 à 7 000 mètres. Les techniques de combat aérien sont mises au point, avec l’usage de mitrailleuses synchronisées tirant à travers le disque de l’hélice. Au même moment, des escadrilles de bombardement mènent des missions au-dessus du territoire ennemi. À l’arrière, une industrie se met en place dans de multiples usines avec une production en masse de cellules et de moteurs, sans oublier l’ouverture d’écoles militaires assurant la formation des pilotes. En 1914, la France compte 200 pilotes pour 120 appareils, en 1918 elle passe à 12 000 pilotes pour 4 400 appareils. C’est la guerre qui fera de l’aviation un secteur, en rapide développement, de l’industrie et des transports. En 1917, les industries aéronautiques produisent des appareils remarquables, le Sopwith Camel anglais, le Spad XIII et le Bréguet XIV français, l’Albatros ou le bombardier lourd Gotha* V pour les Allemands. Les tactiques évoluent également. En 1917, le temps des missions individuelles est bel et bien révolu. Les sorties se font par escadrille, voire par groupe de cinquante appareils échelonnés à diverses altitudes. Des patrouilles, relayées en permanence, surveillent les abords du front. Pour pallier leur infériorité numérique, les Allemands emploient le système des « cirques volants », des groupes aériens circulant le long du front, dirigés par un « as » réputé. Les alliés concentrent sur les lieux de grande offensive des escadrilles d’élite.
Nos aviateurs pour survoler les lignes ennemies sans crainte des balles des Mauser et des obus lancés par des canons spéciaux, doivent monter à une altitude de 2200 à 2800 mètres. Pour résister au froid très vif qui règne à ces hauteurs, ils sont obligés de revêtir des fourrures et de chausser des sabots bourrés de paille. Ils ont besoin d’un manteau en peau de chèvre, et quelquefois aussi d’un masque facial, car il fait très froid en haute altitude…
Aérostat
Appareil dont la sustentation dans l’air est dû à l’emploi d’un gaz plus léger que l’air.
Aérostier
-Observateur à bord d’un aérostat.
-Pilote d’un aérostat.
Agent de liaison
Soldat chargé de transmettre des ordres et des informations au sein de l’armée, en particulier lors d’une opération qui rend impossible l’usage du téléphone. Les agents de liaison interarmées (chargés de la communication entre la troupe et l’artillerie par exemple) ou inter unités (d’une compagnie à une autre par exemple) ne sont pas permanents et sont nommés, comme le montrent de nombreux témoignages, dans l’instant, quand la situation l’exige. Cependant, certains officiers choisissent de définir un ordre de roulement journalier ou hebdomadaire et dressent pour cela une liste d’hommes choisis parmi leurs subordonnés. Connaissant par avance leur tour, les hommes savent immédiatement qui doit partir avec l’ordre à transmettre en poche, d’où, peut-être, l’impression d’un rôle permanent. Il existe par ailleurs des officiers d’état-major dont la fonction principale est de transmettre ordres et rapports entre les différents échelons de commandement, ou entre un service de l’armée et un organisme civil (l’agent de liaison du ministère de la guerre au GQG, par exemple).
Agilité
L’agilité, vitale pour la survie, est la première arme du fantassin conscient et organisé. C’est pour cela qu’avant un assaut, le poilu expérimenté vérifie avec soin la résistance de ses bretelles, de ses lacets de souliers, les boutons de culotte, les ceintures. Tout ce qui sert à amarrer ses habits. En cas de retraite stratégique, aucun de ces éléments ne doit céder, laissant sinon, le soldat en très mauvaise posture.
Agréable(bien)
Bath, Maous
Alboche(cf. Boche, Bochie, Fritz, Schleuh)
En 1914, c’est un terme infamant. C’est la pire insulte que l’on puisse proférer. L’apparition de ce mot remonte à la seconde moitié du XIXème siècle (1860).
All-big-gun-ship(cf. Dreadnought)
Aller au jus
C’est se précipiter à l’assaut de la tranchée ennemie et affronter « les moulins à café* » adverses.
Alliance défensive
C’est une alliance qui fonctionne en cas d’attaque ennemie. Si un pays est attaqué, ses alliés entrent en guerre à ses côtés.
Allouf
C’est une déformation du mot arabe pour désigner le porc.
Ambulance
Le paquebot.
Ambulance(cf. Autochir, Brancardiers)
— Véhicule de transport des blessés (sens actuel du terme).
— Unité médico-chirurgicale, qui existe au niveau du corps d’armée. On parle de l’ambulance N° 2 /142 c’est-à-dire la n° 2 du régiment N° 142, par exemple.
Ami
Poteau, copain.
Amoché
Terme argotique pour désigner quelqu’un de blessé, touché, détruit.
Ampoule
Ampoule remplie, de gaz lacrymogène utilisée par les Allemands, pour débusquer des tranchées, les combattants ennemis…
Cette ampoule en verre, de 1,5 cm de diamètre et 3,5 cm de haut environ se terminant en cône, prend place dans une cartouche de lance-fusées. Elle est remplie d’ un produit lacrymogène qui provoque des brûlures des yeux, et sert à empêcher le port du masque à gaz.
Anastasie(cf. Censure)
Surnom donné à la censure des journaux, lié à la représentation graphique d’une vieille femme dotée de grands ciseaux.
Annonce aux familles
Lorsqu’un soldat tombe au combat, il faut prévenir la famille. Pour cela, il n’y a pas de règles générales. L’usage veut qu’un officier écrive à la famille, mais les camarades le font souvent. Les familles sont prévenues officiellement par le Maire de la commune à la campagne, par les gendarmes en ville. Mais avec le temps, les usages se sont banalisés et moins de formes ont été prises pour annoncer la mort d’un soldat. Les effets personnels sont normalement renvoyés aux familles, du moins ce qu’il en restait (argent, bijoux, papiers, photographies) par les officiers ou les camarades.
Anti-dérapant
Autre terme pour désigner le vin.
Antipyrine
Médicament à noyau benzénique, antipyrétique et analgésique destiné à combattre la fièvre et la douleur.
Antonios
Surnom donné aux soldats portugais.
Apache
Terme argotique pour désigner un voyou.
Appelé(cf. Conscrit)
Aramon
Terme utilisé pour désigner du vin rouge ordinaire. Nom d’un cépage dans le Midi.
Arbeit
Terme allemand pour désigner le travail.
A.R.C.H.
AmericanReliefClearingHouse, Comité central des secours américains qui est chargé de l’envoi et de la répartition des aides reçus pour les soldats.
Celles-ci prennent la forme de sommes d’argent, parfois énormes, de colis à destination des poilus nécessiteux, d’envois de vivres, de médicaments ou de vêtements.
Arditi
Ce sont les unités d’assaut italiennes créées en juillet 1917 par le lieutenant-colonel Giuseppe Bassi. Leur entraînement intensif tendait à former de nouveaux combattants sur les plans physiques, techniques mais également moraux. Après la guerre, les divisions d’Arditi furent peu à peu dissoutes, pour être supprimées en 1920, mais d’anciens Arditi ont participé à l’exploitation de Fiume d’Annunzio et aux Squadre fascistes.
ARF
Appareil respiratoire filtrant.
Argone
Bataille d’Argonne. La forêt d’Argonne est située entre Reims et Verdun. On ne peut la traverser que par une vallée centrale, la vallée de Biesme. Cet itinéraire est celui emprunté par tous les envahisseurs de notre histoire. C’est un des secteurs les plus disputés et les plus dangereux du front occidental de septembre 1914 à septembre 1915. La guerre s’y est faite dans des conditions les plus dures, en raison des particularités géographiques de cette région humide et au relief accidenté. La bataille d’Argonne est engagée peu après le repli stratégique, en août 1914, de la 3èmearmée française (Sarrail), venue s’appuyer sur la place de Verdun, en face de la 5èmearmée allemande (Kronprinz). Il est impossible aux historiens d’énumérer tous les combats presque journaliers, de ce front de l’Argonne.
ARI
Appareil respiratoire isolant.
Armée française
L’armée française en 1914 est organisée de la manière suivante :
L’infanterie est composée de plusieurs armées identifiées par un chiffre romain. Chacune est dirigée par un général d’armée, par exemple Dubail pour la I ère armée.
L’armée est composée de « corps d’armée », eux-mêmes subdivisés en « divisions » regroupant chacune plusieurs « brigades ». La brigade regroupe des « régiments » constitués de « bataillons » répartis en « compagnies » d’environ 250 hommes.
La compagnie est constituée de « sections » regroupant 4 « escouades » de 16 hommes aux ordres d’un caporal. Deux escouades constituent une « demi-section » sous la responsabilité d’un sergent-chef.
Le tableau ci-dessous récapitule la constitution moyenne d’une armée sachant que le nombre d’unités pouvait varier à n’importe quel échelon.
UNITÉ
NOMBRE D’UNITÉS DE RANG INFÉRIEUR
EFFECTIFS
GRADE DU CHEF D’UNITÉ
ESCOUADE
0
16
Caporal
SECTION
4
64
Sous-lieutenant ou adjudant-chef
PELOTON (Infanterie)
Réunion de 2 sections
128
1 Commandent
COMPAGNIE
4
256
Capitaine ou lieutenant
faisant fonction
BATAILLON
4
1024
Commandant ou
Capitaine faisant fonction
RÉGIMENT
3
3072
Colonel
BRIGADE
2
6144
Général de brigade
DIVISION
2
12 288
Général de division
CORPS D’ARMÉE
2
24 576
Général de corps d’armée
ARMÉE
5
122 880
Général d’armée
Les régiments d’infanterie sont soit d’« active * », hommes normalement sous les drapeaux ou de « réserve* », c’est-à-dire regroupant les mobilisables ayant accompli leur service militaire ainsi que ceux qui y avaient échappé pour diverses raisons : omission, sursis, réforme, exemption etc.
Au début de la Grande Guerre, la ventilation des hommes suivant leur année de naissance était la suivante :
ARMÉE D’ACTIVE
De 1891 à 1892 (et une partie des hommes nés en 1893)
RÉSERVE DE L’ARMÉE ACTIVE
De 1890 à 1881
ARMÉE TERRITORIALE
De 1880 à 1875
RÉSERVE TERRITORIALE
De 1874 à 1869
Chaque régiment de réserve est rattaché à un régiment d’active dont il prend le numéro, plus 200, exemple, le régiment de réserve du 13eR.I., était le 213eR.I.
Les lieux de recrutement et de garnison sont les mêmes et souvent les réservistes de 1914 sont incorporés dans les réserves de leur régiment initial.
Toutefois, l’infanterie regroupe d’autres unités : Chasseurs, Unités coloniales, Légion étrangère, Fusiliers marins, etc. aussi, le tableau ci-dessous, établi par Philippe Constant est une aide précieuse pour s’y retrouver :
RÉGIMENTS D’INFANTERIE DE LIGNE
Infanterie coloniale
BATAILLONS DE CHASSEURS
Tirailleurs Sénégalais
RÉGIMENT DE MARCHE DE LA LÉGION
Artillerie de Campagne
ZOUAVES
Régiments de Cavalerie endivisionnée Hussards
TIRAILLEURS ALGÉRIENS
Chasseurs à cheval
RÉGIMENTS MIXTES (Zouaves et Tirailleurs)
Dragons
TIRAILLEURS MAROCAINS- RÉGIMENT COLONIAL DU MAROC
Cuirassiers
Armistice
C’est l’arrêt des combats, mais sans mettre fin à la guerre, dans l’attente de la négociation d’un traité de paix qui, lui, mettra fin à la guerre.
Principaux armistices de la guerre de 1914-1918 :
Armistice avec la Bulgarie : signature à Sofia le 29 septembre 1918
Armistice avec la Turquie : signature à Moudros le 30 octobre 1918
Armistice avec l’Autriche : signature à Villa Guisti le 3 novembre 1918
Armistice avec les Allemands : signature à Rethondes le 11 novembre 1918
Le lundi 11 novembre à Rethondes, à 2 h15, les quatre parlementaires allemands, Erzberger, Oberndorff, Winterfeld et Wanselow prennent place autour de la grande table rectangulaire du wagon-salon du maréchal Foch. En face d’eux sont assis, comme lors de la première séance plénière de la veille, l’amiral Wemyss, le contre-amiral Hope et le général Weygand, qui entourent le chef des armées alliées.
D’entrée, Foch prend la parole. Il annonce que le texte définitif de l’armistice va être arrêté et demande au général Weygand d’en donner lecture. Cette lecture est longue, très longue, d’autant plus que les interprètes doivent se relayer pour la donner à leur tour en version allemande.
À la demande de Foch, les deux délégations se mettent d’accord pour dater les déclarations à 5 heures.
CONDITIONS DE L’ARMISTICE CONCLU AVEC ALLEMAGNE
Cessation des hostilités, sur terre et dans les airs, six heures après la signature de l’armistice.
Évacuation immédiate des pays envahis : Belgique, France, Luxembourg et Alsace-Lorraine. Évacuation effectuée dans les quinze jours.
Rapatriement, dans le même délai, de tous les prisonniers de guerre, otages ou condamnés politiques.
Abandon par les armées allemandes de 5 000 canons, 25 000 mitrailleuses, 3 000 Minenwerfer* et 1 700 avions de chasse et de bombardement.
Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes. Ces pays seront administrés par les autorités locales sous le contrôle des troupes d’occupation alliées.
Dans les pays occupés, les installations militaires seront livrées intactes.
Aucun ouvrage d’art (ponts, voies ferrées…) ne devra être détruit. Il sera livré 150 000 wagons et 5 000 machines. Il sera livré en outre, 5 000 camions automobiles.
Le commandement allemand est tenu de signaler tous les emplacements de mines.
Les Alliés pourront exercer le droit de réquisition.
Les troupes allemandes devront également abandonner les territoires qui ne leur appartenaient pas au 1 août 1914: Autriche-Hongrie, Turquie, Roumanie et Russie…
Évacuation de toutes les troupes allemandes stationnées en Afrique orientale.
Réparation financière des dommages. Restitution des trésors.
Livraison de tous les sous-marins (y compris les mouilleurs de mines).
Les navires de surface désignés par les Alliés seront désarmés. Le choix des Alliés portera sur 6 croiseurs de bataille, 10 cuirassés d’escadre, 8 croiseurs légers et 50 destroyers.
La durée de l’armistice est fixée à trente-six jours.
La lecture de ce texte est d’autant plus longue, qu’après chaque article ; Erzberger prend la parole pour essayer d’en obtenir, sinon la suppression tout au moins un adoucissement. La discussion durera jusqu’à 5 h 12.
Ainsi, l’armistice pourra prendre effet à 11 heures. Dès le départ des parlementaires allemands, Foch s’empresse de rédiger le télégramme annonçant l’armistice, qu’il va faire diffuser immédiatement à tous les chefs militaires sous ses ordres.
Armurier
Soldat responsable de l’entrepôt et de l’entretien des armes.
Arrière
C’est le territoire et la population d’un pays en guerre situés en dehors de la zone des combats. Terme péjoratif qui inclut surtout les « embusqués* » et les « planqués * ».
Artiflots(cf. Artilleur)
Mot d’argot pour désigner les artilleurs. Le mot est une fusion d’artilleur et de fiflot*, troupier*, le deuxième appartenant à l’argot parisien.
Artillerie
L’artillerie de campagne française est supérieure à toutes les autres en ce qui concerne la précision et la manœuvre des feux, mais elle compte trop sur son canon de « 75 ». Il s’agit, certes d’une arme remarquable, très mobile, dotée d’une cadence de tir rapide (12 coups minute) grâce à son frein et à son récupérateur qui remet aussitôt les tubes en batterie. Mais le commandement français a négligé l’artillerie lourde dont les matériels modernes (155 Rimailho) n’existent qu’en très petit nombre (104 seulement lors de l’entrée en guerre) et sont postés à l’arrière.
Les attelages des régiments d’artillerie avec la cavalerie suivent l’infanterie à trois jours. Pour chacun des attelages, six chevaux prennent la route, tirant soit un canon, soit une voiture-caisson, soit la forge, ou bien encore un fourgon de batterie. Les attelages sont flanqués d’un sous-officier, chef de pièce. La première pièce de tir se compose d’une voiture-canon et de sa voiture-caisson. L’attelage à six chevaux, est conduit de la banquette de l’avant-train, ou par un homme monté sur le premier cheval, à gauche. Les artilleurs, les conducteurs et les servants sont répartis sur les banquettes des coffres. Suivent les trois autres attelages, puis deux caissons, qui constituent la « cinquième pièce », intermédiaire entre les canons et les approvisionnements. Ces cinq-là forment la batterie proprement dite. Ensuite, vient l’« échelon », six lourdes voitures chargées de coffres pleins d’obus, attelées chacune de six forts chevaux, et puis la forge et le chariot de batterie. La colonne d’un groupe d’artillerie dépasse les 2 kilomètres. L’artillerie française se croit correctement pourvue en 1914 avec un total de 6 millions de coups de « 75 » et une capacité de production journalière de 6000 coups. Elle ne se doute pas qu’elle tirera 250 millions de coups de canon en 51 mois de guerre et qu’il faudra produire par jour 39 000 coups d’artillerie lourde et 223 000 coups de « 75 », ni qu’il faudra chaque jour 1 000 tonnes de munitions par km2 sur le front d’engagement.
L’artillerie allemande est d’entrée de jeu directement associée au combat de rupture. C’est pourquoi les divisions et les corps d’armée sont non seulement dotés d’un canon de « 77 » (semblable mais inférieur au « 75 ») mais encore d’obusiers lourds de 105 et de 150. Enfin, sachant que les systèmes fortifiés devront être détruits, l’armée allemande s’est dotée d’une puissante artillerie à base d’obusiers de 210 et de quelques pièces de 305 et de 420.
Artilleur(cf. Artiflot)
Soldat de l’artillerie, corps affecté au maniement des canons, obusiers, etc.
Artisanat des tranchées
La guerre de position a contraint les soldats à l’inaction et à l’immobilité. Pour tromper l’ennui, le soldat taille, coupe, lime et cisèle. Avec les cartouches, les douilles, les fléchettes, etc., il fait des briquets, des coupe-papier, des encriers, des crucifix, et bien d’autres objets encore.
As
Personne qui excelle dans son domaine. Pendant la guerre désigne les « as » du ciel, les pilotes d’élite et réputés comme Manfred Von Richthoffen (dit le Baron Rouge) chez les Allemands, ou Guynemer chez les Français. Pour être déclaré « As » il faut avoir abattu au moins 5 appareils ennemis.
As de carreau(cf. Havresac)
Dans le vocabulaire du poilu surnom donné au sac du soldat.
Aumônier militaire
Une loi de 1880, précisée par des décrets en 1881 et 1913, fixe le statut des aumôniers titulaires en temps de guerre. Recrutés en priorité dans les classes d’âges non mobilisables ou parmi les exemptés, ils sont gérés par le service de santé et affectés aux groupes de brancardiers divisionnaires* (G.B.D.) et de corps d’armée* (G.B.C.), à raison d’un prêtre par G.B.D., de deux prêtres, d’un rabbin et d’un pasteur par G.B.C.
Ils n’appartiennent pas à la hiérarchie militaire, même s’ils perçoivent une solde de capitaine et sont soumis aux règlements de discipline de l’armée. En 1914 sont institués les aumôniers catholiques volontaires (A.V.C.). Ils reçoivent une solde de lieutenant. Il y a deux volontaires par division en plus du titulaire qui les coordonne. Enfin, les jeunes prêtres mobilisés comme soldats exercent aussi leur ministère, comme aumôniers bénévoles mais ne sont pas officiellement reconnus. Il y a eu pendant cette guerre un petit millier de clercs, auxquels il faut ajouter quelque 30 000 prêtres et séminaristes mobilisés. Dans le même temps, on a compté 70 aumôniers protestants en plus de 500 pasteurs mobilisés et 46 aumôniers israélites.
Ausweis(cf. Certificat d’identité)
Mot allemand signifiant laissez-passer.
Autochir(cf. Ambulance, Blessure, Brancardier)
Abréviation d’Ambulance Chirurgicale Mobile (A.C.M.).Unité médico-chirurgicale qui existe au niveau du corps d’armée. Expérimentée dès novembre 1914, elle est équipée d’une salle d’opération mobile à 2 tables avec matériel de stérilisation et de couchage nécessitant trois camions. Son personnel comprend 2 chirurgiens et 25 infirmiers. Cependant, elle ne peut fonctionner qu’en s’accolant à une formation médicale plus lourde. Des perfectionnements seront apportés en février 1915 :
Un premier camion contenant la chaudière, un grand autoclave horizontal, un petit autoclave vertical, deux bouilloires, un radiateur, le linge pour médecins.
Un second camion contenant les appareils de radiographie, les parois d’une baraque opératoire de 70 m2, le matériel chirurgical et la pharmacie.
Un troisième camion transportant le groupe électrogène et faisant fonction de « magasin ». Il y a 23 A.C.M., une dans chaque armée en 1917.
AVC(cf. Aumônier)
Aumônier volontaire catholique.
Azor(cf. Barda, Paquetage)
Dans le vocabulaire du poilu autre terme pour désigner le barda.
B
Bague
Les bagues de poilus sont fabriquées à partir de l’aluminium de fusées allemandes fondues. L’aluminium (pour la plupart) récupéré, sur le terrain, provient des têtes d’obus allemands… Ils les ont ciselées, avec des limes. Les poilus, en ont fabriqué des milliers, pour leur femme, ou leur marraine de guerre, pour leur enfant, ou tout simplement, pour faire du commerce (ils les vendaient à d’autres poilus, moins doués !) elles ont souvent une symbolique sculptée dessus : un trèfle à 4 feuilles, une fleur, un fer à cheval, une enclume, des ailes d avion, un écusson, une croix, un cœur, un obus… mais on en trouve aussi en forme de ceinturon… Quelques fois elles sont rehaussées, de cuivre de douilles d’obus, ou un morceau de verre… Parfois un prénom gravé dessus, une date, un lieu. Ils ont même organisé des concours récompensés…
Baïonnette(cf. Fourchette, Rosalie, Tue-boches, Tire-boches)
1)Épéeou lame qui se fixe au bout du fusil permettant d’utiliser ce dernier comme une arme de pique. Le plus souvent utilisée comme patère ou comme bougeoir. Quatre types de baïonnette différents ont été utilisés par les armées au cours de la guerre. Ces baïonnettes, dites « épées-baïonnettes » différent par la forme de leur garde et du support de fixation, mais possèdent une longueur de lame fixe de 520 mm. Le dernier type, utilisé par les Allemands, appelé « baïonnette-sabre » dispose d’une lame plus courte de 400mm.
2) Titre d’un journal satirique apparu en 1915, initialement intitulé « A la baïonnette ».
3) Charge ou attaque à la baïonnette : attaque avant laquelle on fixe les baïonnettes sur les fusils. L’expression est ambiguë, car la baïonnette est en fait rarement employée lors des combats (on compte seulement environ 0.30 % de blessés à l’arme blanche sur l’ensemble de la guerre).
Baïonnette-sabre
Une arme de lâches
« Vous avez vu dans le matin, la grossière silhouette de ce soudard poméranien qui veut imposer au monde la « culture allemande ».
Aujourd’hui, voyez par quelles armes il compte l’emporter sur ses ennemis. Voici la photographie d’un sabre-baïonnette ramassé hier parmi les morts qui gisaient dans un petit village au nord de Meaux et à 8 kilomètres environ de cette ville.
Ce sabre-baïonnette a le dos taillé en dents de scie. Et ce n’est pas la fantaisie cruelle d’un soldat barbare qui seule a créé cette arme, digne d’un Indien Toba ou d’un Malais : non, car beaucoup d’autres sabres semblables étaient épars sur le sol et quelques-uns ont été relevés par des personnages officiels pour être montrés " à qui de droit ". Il est aisé de se convaincre, en outre, qu’ils ont été façonnés à la machine et que cette cruauté est d’origine officielle.
Un engin de torture ; une baïonnette à crochets ; une arme blanche déshonorée. Voilà ce dont S. M. l’empereur Guillaume a pourvu ses soldats. »
(Article, non signé, extrait du journal « Le Matin » du 12 septembre 1914)
Ballon captif
Boudin cavaleur, saucisse, cigare, dracken.
Bande molletière
C’est un des éléments de l’équipement des fantassins français, constitué d’une bande de 2,20 mètres de long, en drap de laine enroulée autour du mollet.
Banquette(cf. Créneau, Parapet)
Dispositif aménagé dans la tranchée de première ligne permettant à un soldat de s’installer en position de tir, généralement couchée ou inclinée.
Barbelé(cf. Brun, Chevaux de frise, Défense accessoire, Queue de cochon ; Réseau)
— Fil de fer garni de pointes, dit barbelé. Élément important du « système-tranchées », placé devant les tranchées de première ligne afin d’empêcher ou de ralentir l’avance des troupes adverses. Le fil barbelé est fixé sur des montants, fréquemment installé en plusieurs lignes successives, dénommés réseaux*. Leur mise en place et leur réparation, effectuées généralement de nuit, constituent une part importante des travaux des combattants aux tranchées. Des ouvertures sont aménagées dans les barbelés afin de permettre le passage des soldats pour les patrouilles et les « coups de main * ». Les préparations d’artillerie avant une offensive ont pour but de détruire au moins partiellement les barbelés adverses.
― Le terme barbelé désigne aussi chez les soldats un alcool fort de mauvaise qualité.
Barda(cf. Azor, Paquetage)
En argot des combattants le terme désigne l’équipement du soldat. Le terme prend souvent une connotation négative en raison du poids de celui-ci qui dépasser les 35 kg, et de la pénibilité qu’il y a à s’équiper ou se déséquiper aux tranchées.
Comment porte t- on tout ce « Barda » ?
Tout d’abord, on enroule sur son pantalon des bandes molletières* de 2.20m. Sur la capote, on porte les bretelles de suspension* et le ceinturon porte baïonnette de cuir noir en 1914 et de cuir fauve en 1915.
Du côté gauche s’accroche au ceinturon, la baïonnette, l’outil individuel, une cartouchière ventrale, le poignard de tranchée réglementaire ou de fabrication artisanale. La musette personnelle, où l’on range les vivres et les effets personnels, est portée en bandoulière du côté gauche. Du côté droit se trouve une cartouchière ventrale. Le bidon de deux litres avec le quart est porté en bandoulière du côté droit pour éviter qu’il ne s’entre choque avec la baïonnette. Dans le dos, il y a une cartouchière dorsale et le havresac*.
Barrage
Dans les tranchées les barrages sont de véritables cloisons épaisses faites de sacs de terre empilés qui atteignent la hauteur de la tranchée. Ils ont même parfois un mètre d’épaisseur. On y emménage une espèce de meurtrière par où passe une arme, une mitrailleuse la plupart du temps.
Barrage,le tir de(cf. Éclat, Fusant, Percutant, Tir d’artillerie)
Tir d’artillerie défensif violent et serré effectué en avant des troupes ennemies pour empêcher la progression de l’ennemi, arrêter leur attaque ou leur interdire un débouché.
Le barrage est dit roulant lorsqu’il se déploie en fonction d’un horaire arrêté à l’avance (ex : 100 mètres toutes les trois minutes) et que l’infanterie doit suivre derrière les obus pour arriver sur les tranchées adverses avant que les défenseurs ne soient sortis de leurs abris. On ne peut arrêter la progression d’un tel barrage qui met en jeu un grand nombre de canons. Parfois l’infanterie avance trop vite et tombe sous les coups de l’artillerie amie, plus fréquemment l’infanterie se trouve arrêter par des éléments résiduels et on dit alors que le « barrage décolle », c’est-à-dire qu’il part plus en avant laissant les fantassins en rase campagne face à un ennemi qui est à nouveau en place dans ses tranchées et qui la cloue sur place. Le barrage roulant est une innovation tactique apparue à l’été 1916.
Barrage roulant
Tir d’artillerie, minuté pour précéder l’avance des fantassins abrités ainsi derrière un véritable écran d’obus. Le rythme de la marche est même prévu : 100 mètres toutes les 3 minutes. Pour que l’état-major placé à l’arrière et l’artillerie puissent localiser les soldats et éviter de leur tirer dessus, on demande aux hommes de coudre au dos de leur capote un grand rectangle de calicot blanc. Il semble que cela soit une idée du général Passaga.
Bataille de la Marne (4-10 septembre 1914)
Bataille où s’affrontent 56 régiments d’infanterie et 9 de cavalerie Franco-britanniques contre 46 régiments d’infanterie et huit de cavalerie Allemands. 105 000 morts et disparus, 122 000 blessés chez les premiers ; 113 000 morts et disparus, 173 000 blessés chez les seconds. Comme au temps de la Révolution et de l’Empire les Français la gagnèrent « avec les pieds », c’est-à-dire grâce à l’infanterie.
Batailles meurtrières
DATES
BATAILLES
PERTES
FRANÇAISES
4-22 août 1914
4-10septembre 1914
Bataille des frontières
Bataille de la Marne
250 000 morts
Janvier-mars 1915
Mai 1915
Mai-juin 1915
Offensive de Champagne
Offensive d’Artois
Offensives allemandes
232 000 morts
107 000 morts
Février-juillet 1916
Bataille de Verdun
221 000 morts
Juillet-août 1916
Bataille de la Somme
104 000 morts
Avril 1917
Juillet 1917
Offensive du Chemin des Dames
Offensive de Champagne
78 000 morts
Juillet-novembre 1918
Offensive générale alliée
131 000 morts
Bataillon(cf. Brigade, Compagnie, Corps, Division, Escouade, Peloton, Régiment, Section)
Fraction d’un régiment subdivisé en plusieurs compagnies. En 1915, le bataillon d’un régiment (2 ou 3 bataillons selon les cas par régiments) comprend un état-major, un petit état-major et 4 compagnies, environ 1 000 hommes au total. Dans certains cas, le bataillon est une unité autonome qui n’est donc pas comprise dans un régiment et qui relève directement du commandement de la brigade ou de la division (bataillon de chasseurs à pied ou alpins, bataillon de tirailleurs sénégalais…). Le bataillon est en général commandé par un capitaine ou un commandant.
Bâton
Abréviation argotique pour désigner le bataillon.
Batterie(cf. Artiflot, Feuille de calcul, Pièce, Servant)
Ensemble coordonné de canons, faisant partie d’un régiment d’artillerie. Elle est commandée par un capitaine secondé par deux lieutenants. Elle se décompose au front en deux éléments : la batterie de tir proprement dite, sous les ordres directs du capitaine et des lieutenants, avec les quatre canons et leurs servants et les téléphonistes commandés par un brigadier ; les échelons, installés plus loin en arrière, sous les ordres d’un adjudant, rassemblent les chevaux et tout le matériel autre que les canons. Au repos, les deux éléments sont regroupés.
Baveux
Journal qui pratique le « bourrage de crâne ».
Bébé
Terme familier pour désigner un projectile d’artillerie de tranchée
Bec / Bec de gaz(cf. Percée, Coup)
Dans l’argot des combattants, désigne l’échec d’une opération militaire, en particulier d’une offensive. Le terme est repris et adapté de l’argot parisien, dans lequel un « bec de gaz » désigne un policier.
Becquetance :
Terme familier pour désigner la nourriture
Bertholite
Nom donné à un gaz de combat utilisé par les Allemands durant la Première Guerre mondiale. Il s’agit d’un synonyme pour le dichlore (chlore à l’état gazeux). C’est un gaz jaune-vert (chlore signifie « vert » en grec) deux fois plus lourd que l’air. D’une odeur suffocante très désagréable et extrêmement toxique, il endommage les voies respiratoires des personnes qui l’inhalent. Avec une dose suffisante, le gaz provoquait la mort par asphyxie.
Bidoche(dit aussi Barbaque)
Terme familier pour désigner la viande, en général mauvaise (dure, grasse, etc.). En Berry bide désigne une vieille brebis, barbi étant la brebis.
Bidon
Le bidon modèle 1877 de 2 litres. Au départ, il était réservé aux corps expéditionnaires hors Europe. Il est ensuite distribué aux hommes combattant en France à partir des offensives de printemps 1915. On peut les retrouver avec une housse en velours ou peint en moutarde. Mais certains modèles seront livrés "nus" avec simplement une couche de vernis.
Biffin(Artiflot, P.C.D.F., Fiflot, Troufion, Troupier)
Mot d’argot détourné de son sens original de chiffonnier et adopté par dérision par les fantassins pour se définir. Le biffin est celui, miséreux, qui gagne sa vie en récupérant et revendant les objets usagés dont les autres ne veulent plus. Le fantassin est assimilé à cet être errant, sans ressources, sale, mal habillé, rejeté par la société bien pensante.
Bilan humain de la guerre
Cette comptabilité est celle d’hôpitaux et de cimetières.
Les puissances alliées et associées
Les empires centraux
Détail des pertes françaises au total 1 356 000
Officiers
36 000
Hommes de troupes françaises
1 245 000
Indigènes de l’Afrique du Nord
35 000
Indigènes coloniaux
35 200
Étrangers (Légion étrangère)
4 300
À ces chiffres, établis au plus près de la vérité, il faut ajouter ceux d’un cruel excédent de décès dans la population civile :
― Par coups de guerre, par exemple : Nancy : 500 morts, Amiens : 600, Arras : 1 200, Reims : 3 400
― Par usure physique et morale, épidémies et une grave diminution du nombre des naissances,
— 1 500 000 mutilés de guerre durent recevoir des pensions.
Billet
Bifton.
Billet de banque
Fafiot.
Binoculaire(cf. Scherenfernrohr)
Biplan
Un biplan est un avion pourvu de deux paires d’ailes, l’une au-dessus de l’autre. Si une des paires d’ailes est moitié plus petite que l’autre, on parle plus précisément de sesquiplan.
Cela permet de diminuer l’envergure pour une surface alaire donnée, donc de faciliter la construction et le stockage de l’avion, mais a l’inconvénient d’augmenter la traînée par multiplication par deux des tourbillons marginaux.
Les avions à trois paires d’ailes sont des triplans.
Les biplans ont eu leur heure de gloire aux environs de la guerre de 14-18, mais on en fabrique beaucoup jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, par exemple pour embarquer sur les porte-avions ou pour l’acrobatie.
Un modèle célèbre utilisé dans la voltige, seulement détrôné par les avions modernes : le Stampe SV4.
Le biplan le plus gros et le plus puissant du monde est l’Antonov An-2 c’est aussi le deuxième avion le plus produit de l’histoire : 18 000 exemplaires.
Bivouac(cf. Faisceaux)
Terme militaire qui désigne le fait d’établir un campement provisoire à l’extérieur, et, par extension, un repas ou une nuit passée dehors. Le terme tend à être utilisé davantage au début de la guerre, avant l’installation dans les tranchées, il s’applique ensuite lors des déplacements entre secteurs.
Bled(cf. No man’s land)
Mot arabe désignant la campagne, popularisé par les troupes venant d’Algérie, utilisé dans l’argot des combattants de 1914-1918 pour désigner le terrain libre, en particulier celui qui se situe entre les lignes de tranchées opposées.
Blessure(cf. Bonne, Fine)
Blessure du combattant suffisamment sérieuse pour lui permettre d’être évacué du front mais n’impliquant pas de séquelles trop importantes ; en ce sens, elle peut permettre un sort meilleur que la vie dans les tranchées.
Bleuet
Mme Malleterre
Le Symbole du bleuet tire ses origines des tranchées. Il est né en1916, à l’initiative de Mme Malleterre, fille du gouverneur des Invalides et de Mme Lenhardt, infirmière. Émues par les souffrances des grands blessés, elles décident de les aider en leur faisant confectionner des fleurs de bleuet en tissu. Outre le fait de leur permettre de réapprendre à vivre avec leur handicap, ces fleurs leur procurent des ressources. Le 15 septembre 1920, le président des Mutilés de France, Louis Fontenaille, propose au Comité Permanent Interallié un rapport visant à pérenniser l’existence de la fleur de tissu. Honorer les morts à travers un symbole reconnu, recueillir des fonds par la vente des fleurs et procurer un travail aux invalides de guerre, sont les objectifs avoués de cette proposition.
Le « Bleuet de France » sera choisi comme fleur emblème en souvenir des jeunes combattants qui, arrivant au combat, étaient surnommés les « bleuets » par les poilus, mais aussi parce que le bleu est la couleur nationale.
Bleuet, Bleu, Bleusaille (cf. Soldat.)
Bleu horizon
Nom donné à la couleur de l’uniforme français adopté après la bataille de la Marne en septembre 1914, pour rompre avec la visibilité désastreuse des pantalons rouges (garance) utilisés jusque-là. La distribution des nouveaux uniformes s’étale dans le temps jusqu’en 1915.
Blockhaus(cf. Abri, Banquette, Créneau)