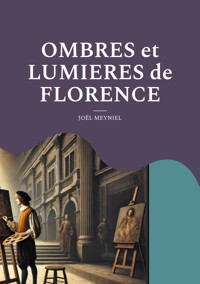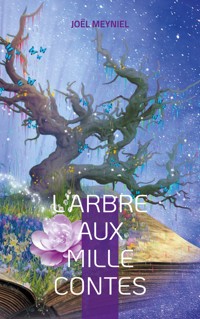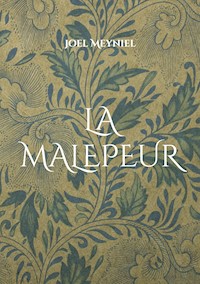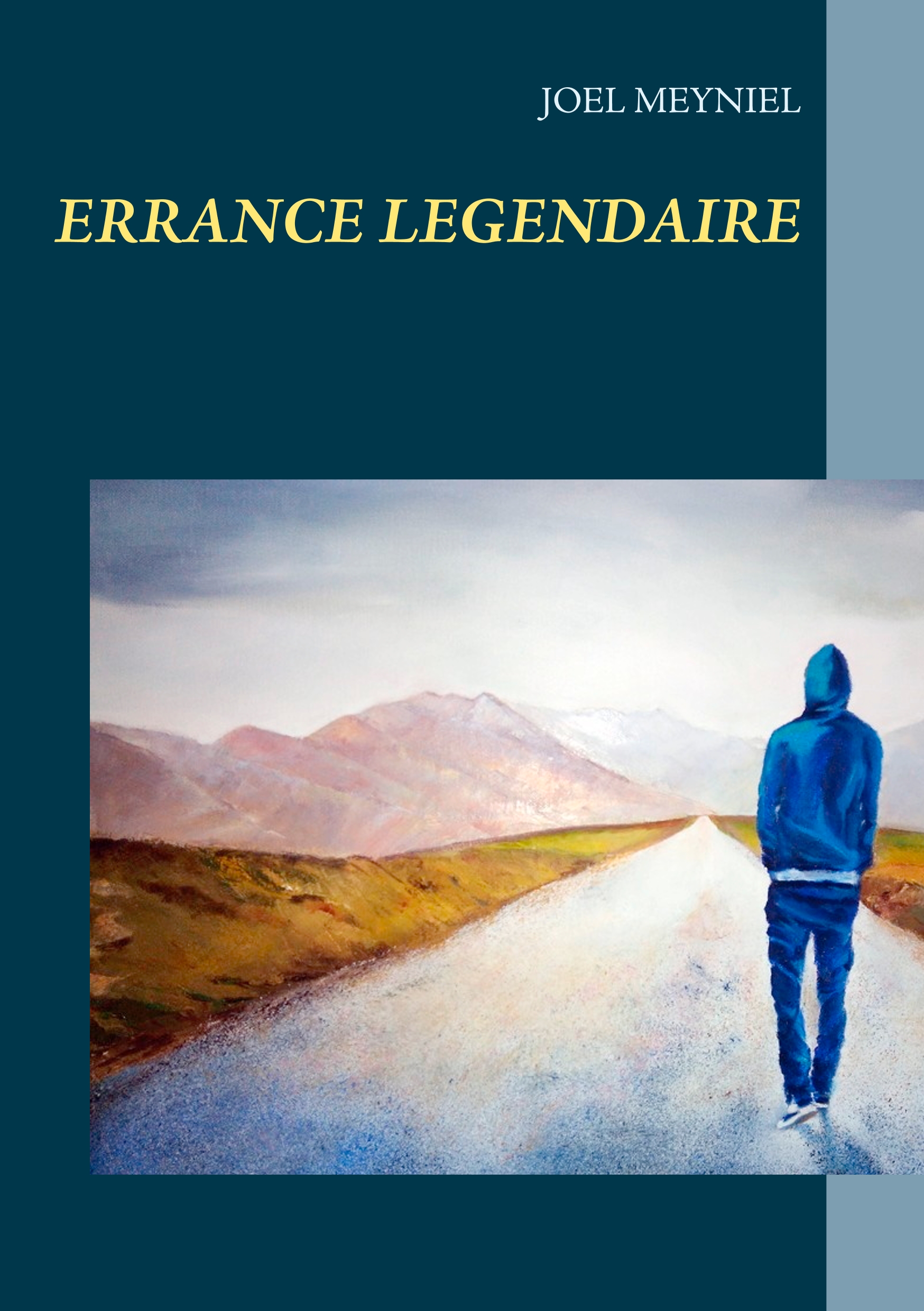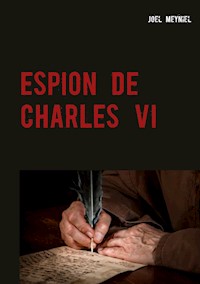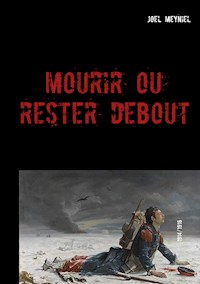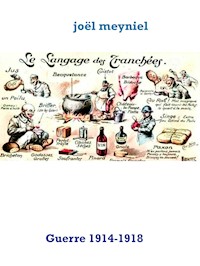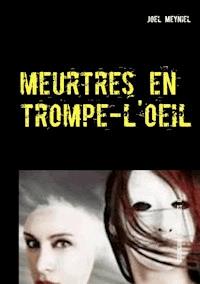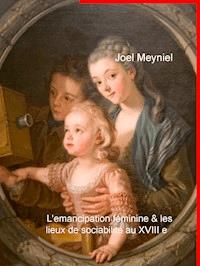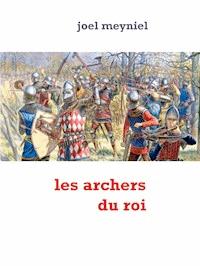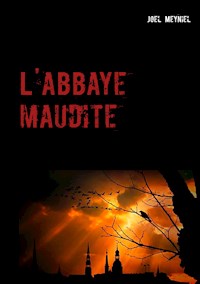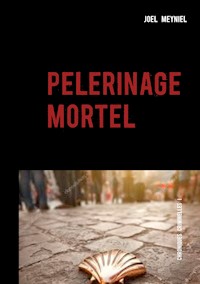
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: chroniques criminelles
- Sprache: Französisch
En 1367, cela va faire dix ans que la France est en conflit contre l'Angleterre. Toujours pas de paix conclue, seulement des trêves qui sont plus dévastatrices que les actions de guerre. Lors de l'une d'elles, les routes sont rendues au commerce et aux pèlerinages. Joaven , vinaigrier à Tours, profite de cette paix provisoire pour entreprendre un pèlerinage à Compostelle. Il n'ignore pas les dangers représentés par cette pérégrination, ce qu'il méconnaît, en revanche, c'est la machination dont il sera victime et qui lèvera le voile sur une déchirante vérité concernant son passé.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le mensonge a beau être prompt, la vérité l’attrape.
Recueil d’apophtegmes et axiomes (1855).
« Le mensonge est le fils du diable, la vérité est la fille de Dieu. »
Proverbes de la Bulgarie (1956).
LES PERSONNAGES
Famille Guibert :
Geoffroy, marchand de vinaigre à Orléans.
Johanna, femme de Geoffroy.
Joaven, leur fils marchand de vinaigre à Tours.
Famille Bajac :
Amaury, marchand de vinaigre à Orléans
Udeline, femme d’Amaury.
Aude, leur fille, promise de Joaven.
Le groupe de pèlerins au départ de Tours avec Joaven :
Jauffré De Barbezieux, troubadour.
Luciane De Barbezieux, sœur de Jauffré, chanteuse.
Anseau De Conty, dit « le vaillant », nobliau de province, originaire de Picardie.
Eudes Drouet, guide pèlerin professionnel.
Julienne Pelletier pèlerine, dite « la mirgesse », mère de Paulus.
Paulus Pelletier, fils de Julienne.
Adelaïs Petrote, pèlerine.
Pèlerins se joignant au groupe sur le chemin :
Peter De Grooningen, pèlerin hollandais.
Rodan Butler, pèlerin écossais.
Les marauds :
Anselme Saveuse, dit « le Borgniat » (le Borgne).
Guillaur Villibald dit « la Disette », compagnon du Borgniat
Les autres personnages :
Argange Bertille, cuisinière des Guibert.
Anthelme Peynel, comptable des Guibert, à Orléans.
Belmont Pierrette et Méric parents d’ Anceline, et de ses deux jeunes frères Jeannet et Odon.
Ercibal le Grincheux, un des agresseurs.
Hubert Politain, notaire royal à Tours.
Ignace de Saint-Hilaire, prévôt de la ville de Tours.
Johan Gratot, comptable de Joaven à Tours et son ami.
Menchauld Maigneray, cordonnier et ami de Joaven.
Ogier Briconnet, fils de marchand vinaigrier.
Père Bertrand Moinet, curé en titre à Tours.
Père Jérôme Plaget, curé adjoint à Tours.
Pierrick Barbeyrac, Maître de la confrérie des Enfants de Compostelle à Orléans
AVERTISSEMENT
Le vocabulaire
Un certain nombre de mots et expressions ont une graphie médiévale. C’est une orthographe intentionnelle.
Cette histoire est une fiction, mais les noms sont authentiques, ainsi que certains faits sociétaux.
NOTE DE L’AUTEUR
L’histoire de Joaven se situe dans la deuxième moitié du XIVe siècle.
La guerre dite de « Cent Ans », entre les Français et les Anglais, n’est pas terminée, mais provisoirement les deux pays sont en paix, suite au traité de Brétigny, signé en 1360 : le roi Jean II le Bon abandonne toute souveraineté au roi d’Angleterre sur une grande partie de l’ancien domaine continental des Plantagenêt. La France renonce à tous ses droits sur la Guyenne. Édouard III, la donne à son fils le Prince Noir, avec Bordeaux pour capitale.
En contrepartie, Édouard III renonce à sa prétention sur la couronne de France et rend la liberté au roi Jean II le Bon, fait prisonnier lors de la bataille de Poitiers en 1356, moyennant une rançon de trois millions d’écus d’or.
En 1364, c’est l’avènement de Charles V, surnommé le Sage, tant à cause de son savoir que de la prudence avec laquelle il gouverne. Son règne s’ouvre dans de mauvaises conditions, mais Charles V sait s’entourer d’hommes de valeur et arrive à surmonter toutes les difficultés résultant des règnes précédents.
Rarement le relèvement d’un pays est entrepris avec un tel courage, une telle intelligence, rarement réussite se révèle aussi éclatante. Le roi est aidé en cela par l’existence d’une idée nouvelle, le sentiment d’appartenir à une même nation, Charles V en prend conscience et en profite pour redresser le pays.
Or les Anglais occupent toujours notre territoire, souvent indûment, mais avant de pouvoir les chasser, il faut rétablir l’ordre public, fortifier les villes et les châteaux, restaurer les finances, reconstituer l’armée et la marine.
Il faut surtout lutter contre Charles le Mauvais, roi de Navarre et les « Grandes Compagnies ».
Pour venir à bout de ces problèmes, le roi porte son choix sur un homme, le breton Du Guesclin, son meilleur général.
Charles II de Navarre, dit le Mauvais (Évreux, 10 octobre 1332 — † Pampelune 1er janvier 1387) est roi de Navarre de 1349 à 1387 et comte d’Évreux de 1343 à 1378. Il est le fils de Philippe III de Navarre et de Jeanne II, fille du roi de France et de Navarre, Louis X le Hutin.
En 1328, Jeanne II, seule descendante directe du roi Louis X, se voit évincée de la succession de Brie et de Champagne, au profit de ses oncles Philippe V et Charles IV grâce à l’introduction d’une clause de masculinité dans l’héritage à la couronne de France. Charles de Navarre ne naît qu’en 1332 et Jeanne de Navarre ne peut donc toujours pas revendiquer la couronne qui est attribuée à Philippe VI de Valois, cousin de Louis X, descendant le plus direct par les mâles. Les premiers Valois sont confrontés à la crise économique, sociale et politique qui conduit à la guerre de Cent Ans, pendant laquelle la supériorité tactique anglaise est telle que les désastres se succèdent pour l'armée du roi de France. Le discrédit des Valois permet à Charles de Navarre, fils de Jeanne II, de contester leur légitimité et de réclamer le trône de France. Il n’a de cesse d'essayer de satisfaire son ambition et de profiter de la déstabilisation du royaume pour jouer sa carte : il change plusieurs fois d’alliance, s’accordant avec le dauphin Charles (le futur Charles V) puis avec les Anglais et Étienne Marcel, pour ensuite se retourner contre les Jacques quand la révolte parisienne tourne court.
En 1361, il n’obtient pas la succession du duché de Bourgogne, confié à Philippe le Hardi, le jeune fils de Jean le Bon. En représailles, il saisit l’occasion de la mort de Jean le Bon pour lever, en 1364, une puissante armée et tenter d’empêcher le sacre de Charles V, mais il est vaincu à Cocherel et doit retourner aux affaires espagnoles. Il tentera un retour sur la scène française en complotant avec les Anglais en 1378, mais il est découvert. Déconsidéré, il s’isole diplomatiquement et finit vaincu et neutralisé par Charles V.
En 1365, le traité de Saint-Denis met fin à la guerre entre la France et la Navarre. Charles “le Mauvais” renonce à ses prétentions au trône de France.
En non-belligérance avec la Navarre et les Anglais, les troupes démobilisées sans solde, désemparées, continuent les exactions pour leur propre compte et fondent de « Grandes Compagnies » qui infestent le pays. Ce sont des troupes d’aventuriers recrutées parmi des étrangers de toutes nationalités, financées par les princes en temps de guerre, qui vivent de pillage et de rançons en période de paix ou de trêve et désolent la France.
En réaction à leurs déprédations, les paysans les battent en plusieurs rencontres et les dispersent pour quelque temps. Mais ces actions sont insuffisantes.
Pour s’en débarrasser définitivement, permettre aux paysans de travailler en toute tranquillité et rétablir la sécurité des voies commerciales, Charles V charge Du Guesclin de conduire les « Grandes Compagnies » en Castille, où Henri de Transtamare est en révolte contre son frère, Pierre le Cruel, roi de Castille, qui a fait étrangler sa mère.
Du Guesclin fait couronner Henri de Transtamare à Burgos et Pierre le Cruel se réfugie à Bordeaux auprès du Prince Noir.
Le 3 avril 1367, Du Guesclin est fait prisonnier par le Prince Noir à la bataille qui eut lieu entre Nàjera et Navarette, ce qui pousse le roi de France à redoubler de précautions, car il prévoit que la paix avec l’Angleterre ne durera pas.
Le milieu du XIVe siècle présente une de ces ondulations économiques fréquentes en France, à une période de prospérité succède une récession suivie d’un redressement. En quelques années, deux fois écrasée par les Anglais, à bout de ressources pécuniaires, en proie à l’anarchie, à la guerre civile, dévastée par les ennemis du dedans et par ceux du dehors, la France reconquiert une grande partie de ce qu’elle a perdu. Elle redevient florissante et respectée et retrouve, avant d’être éprouvée par de plus longs malheurs, une existence qui n’est pas sans éclat. Marquée par l’essor du commerce et l’émergence d’un semblant de libre concurrence qui s’affirmera au fil du temps, cette époque verra la création des guildes et des hanses, lesquelles donnèrent naissance aux corporations.
La guerre a généré une crise monétaire : les mutations monétaires effectuées à maintes reprises par les belligérants ont entraîné des dévaluations. Charles V parvient à restaurer l'autorité royale en faisant accepter aux états généraux la permanence de l’impôt pour financer une armée permanente. Le Franc créé le 5 décembre 1360 permet à l’état de retrouver sa crédibilité en rétablissant la sécurité monétaire. La France restaure une relative prospérité. Les premiers établissements français s’installent sur les côtes de l’Afrique (Guinée et Sénégal).
Les routes sont rendues au commerce et aux pèlerinages. Le chemin de Santiago de Compostela, qui conduit aux confins du Nord-est de l’Espagne, là où selon la légende, reposent les restes de l’apôtre Jacques le Majeur, est la route la plus fréquentée d’Europe. Le chemin de Compostelle est surveillé de manière efficace par des ordres militaires religieux et ses chevaliers ont pour mission de le nettoyer des pillards et des malfaiteurs, bandits de grands chemins et filous de tout poil qui le hantent. À deux occasions l’excès zèle, de certains, conduit le Pape à mettre un frein à l’excessive ferveur des chevaliers. Outre les pèlerins, qui voyagent habituellement à pied et par groupes, de nombreux autres voyageurs en transit empruntent les chemins : montreurs, saltimbanques ambulants, bambocheurs, femmes de mœurs légères, arracheurs de dents, barbiers, drapiers, commerçants en vin, marchands de bois, vendeurs d’eau ou de reliques (toutes certainement fausses), toutes sortes de prêtres et de frères, les membres d’ordres mineurs tels celui des mendiants.
On y rencontre aussi de faux pèlerins, anciens routiers qui préfèrent la rapine facile des chemins plutôt que de suivre, avec leur compagnie, Du Guesclin en Espagne.
Quand la guerre reprendra, en 1369, les conditions ont été créées pour que l’affrontement soit favorable à la France. Charles V a même su nouer des alliances avec l’Écosse, la Castille et le Portugal. Quand en novembre 1387, Joaven décide de consigner par écrit ses souvenirs, Charles V est mort depuis sept ans. C’est son fils qui règne, sous le nom de Charles VI.
Sommaire
Prologue
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Épilogue
Prologue
Le malheur est arrivé le jour de la saint Pancrace avec la venue de Ben-Yahoud, le mercanti juin ambulant qui visitait ce village deux fois l’an1.
Sa venue était un événement, une distraction, mais aussi pour beaucoup l’occasion de cesser le travail pendant quelques instants. Comme à l’habitude, il y avait foule autour de lui sur le parvis de l’église. Même le seigneur et sa Dame étaient présents. Dame Ermonde, toujours à l’affût de nouvelles étoffes pour son trousseau, ne manquait pour rien au monde ce rendez-vous. Pourtant, l’atmosphère festive habituelle n’y était pas ce jour-là, quelque chose n’allait pas. Ben-Yahoud d’un naturel souriant et un brin ironique n’était pas dans son état normal. Il claquait des dents, son visage, sous sa barbe poivre et sel, était rouge et ses yeux terrifiés.
La foule impressionnée recula de plusieurs pas dans un silence glacial. La maladie vient toujours de façon sournoise, rarement annoncée par des signes quelconques. On n’est plus habitué à l’arrivée des fièvres2.
Il vomit des glaires vertes. Son corps semblait se vider de sa vie. De la bave souillait sa barbe.
Le mercanti tomba à genoux, s’appuya sur le rebord de son coffre ouvert. Il claquait de plus en plus des dents.
Les mains toujours crispées sur le rebord de son coffre, les yeux exorbités, il tenta de se relever, mais n’y parvint pas. Il tomba lourdement sur le sol dans un hurlement de douleur.
Personne n’approcha du mercanti qui resta là plusieurs heures. La foule s’était dispersée comme une volée de moineaux. Quand ses cris cessèrent, un serviteur du château constata sa mort. La première d’une longue liste dans le village. La camarde venait faire ses provisions
Les mains toujours crispées sur le rebord de son coffre, les yeux exorbités, il tenta de se relever, mais n’y parvint pas. Il tomba lourdement sur le sol dans un hurlement de douleur.
Personne n’approcha du mercanti qui resta là plusieurs heures. La foule s’était dispersée comme une volée de moineaux. Quand ses cris cessèrent, un serviteur du château constata sa mort. La première d’une longue liste dans le village. La camarde venait faire ses provisions.
Dès lors, tout changea. Les hommes se confinaient comme des bêtes. Seuls quelques chiens qui erraient d’habitude à la recherche d’un os ou d’un quignon de pain faisaient leur ordinaire de cadavres que les survivants se gardaient bien d’enterrer. On a eu beau recourir aux suppliques et aux prières, rien n’y fit. Chacun cherchait son remède à la maladie. Les uns reclus, dans leurs maisons, ne laissant personne leur parler, se refusaient à entendre toutes nouvelles de l’extérieur.
D’autres s’adonnaient farouchement à la boisson comme aux jouissances. Ils allaient jour et nuit de taverne en mastroquet buvant sans crainte, ni mesure, et folâtrant tant et plus. Pour certains, le meilleur remède était la fuite.
La peur est une instabilité humaine, qui pousse au départ, permettant de croire que le malheur aura moins de chance de vous rattraper si vous avancez. En fuyant, ils laissaient à l’abandon leurs biens comme leur maison. Aux Muids, la faucheuse fit sa provision d’humains comme une ribaude, le jour de cohue. Quelques jours après la mort du mercanti, la maladie avait éliminé une bonne partie du village.
Pierrette Belmont, avec la force qui lui restait, ordonna à sa fille de faire la seule chose qui pouvait les épargner, s’il n’était pas déjà trop tard : fuir. Elle finit, par s’écrouler inconsciente.
Après avoir réuni quelques affaires et un peu de nourriture, Anceline n’oublia pas de récupérer la bougette que son grand-père cachait derrière une pierre dans la cheminée et qui contenait les économies de la famille. Ses parents n’en avaient plus besoin à présent.
Après plusieurs jours de marche, ses frères, trop jeunes, moururent de fatigue et de faim. Anceline dut continuer seule son chemin. Elle n’avait pas le temps de s’apitoyer, il en allait de sa propre vie.
Un soir, alors qu’elle se trouvait à la lisière d’une gaudine, Anceline n’avait pas la force d’aller plus loin. Depuis son plus jeune âge, on lui avait appris que s’il n’y avait rien à craindre des arbres, il fallait seulement se méfier de la plupart des choses qui poussaient entre eux : les champignons, les bêtes sauvages et surtout de la merdaille qui s’y cachait. Épuisée, elle ne put résister et s’allongea dans la mousse douillette et humide du sous-bois, entre les plantes et les racines et s’endormit.
Son sommeil fut perturbé par les éclats de voix de deux rustres connus sous les noms de Le Borgniat et de La Disette.qui rejoignaient la cache de leur Compagnie au cœur de la forêt, après une nuit de beuverie, pour fêter la mise à sac d’un village décimé par la maladie et le butin avait été conséquent. Leur verbe était haut et leur démarche lourde.
Laudes venaient de sonner quand les deux rustauds se jetèrent sur Anceline pour l’esnuer et l’enforcer chacun leur tour.
Anceline subi ce matin-là, des outrages3 qui la marquèrent à tout jamais. La perte de sa famille et la double débriscure qu’elle avait subie l’avaient profondément marquée.
C’était comme si elle était morte, maintenant qu’elle était souillée, elle risquait de passer pour une drôlesse. Elle voulait mourir. Il suffisait de revenir sur ses pas et se laisser prendre par la maladie de Florence. Pourtant, en son for intérieur, elle sentait qu’elle devait continuer à vivre, ne serait ce que, pour ce petit être innocent que ses soudards lui avaient sûrement laissé.
1À la Saint-Pancrace, au mois de mai et à la Saint-Michel le 29. Septembre.
2 Au Moyen Âge, nombreuses sont les maladies que l’on nomme fièvre. L’origine des fièvres est mystérieuse et on les considère alors comme une maladie à part entière et non comme un symptôme ; chaque humeur a son type de fièvre, ce qui fait que l’on parle alors de fièvre bilieuse, de fièvre flegmatique ou encore de fièvre mélancolique.
3 Au Moyen-Âge, le viol est désigné par l’expression « efforcement de femme » ou « défloration » pour le viol d’une jeune fille. On fait la distinction entre certains types de viol (viol d’une jeune fille vierge, d’une femme mariée). Dans le premier cas, le coupable peut échapper à la peine s’il épouse sa victime (à condition qu’elle ne soit pas d’un rang social supérieur) ou s’il la dote.
Si le violeur ne peut fournir de réparation, il doit subir la peine réservée à ceux qui outragent les femmes mariées, c’est-à-dire la peine de la « course », la castration ou la peine de mort.
I
Tours. 1367
Les matines n’ont pas encore sonné. Dehors, le ciel pleure de mélancolie. Le ruissellement de ses larmes noie mon sommeil, il m’inonde et ranime en moi des souvenances lointaines.
Assis dans le noir sur ma couche, enveloppé dans ma couette, me reviennent en pensée, ces nuits sous la pluie sur les chemins vers Compostelle. Cela fait quelques lustres maintenant.
Depuis mon retour, beaucoup de mes proches s’en sont allés rejoindre l’Éternel. Je pense à celui qui était devenu mon ami, Pierrick, l’ancien Maître de la confrérie des enfants de Compostelle, à la tête de laquelle je suis à présent. Avec le recul des ans, je ressens le besoin de relater cette période de ma vie qui m’a profondément blessée. Je le dois à mes enfants, car c’est aussi un peu leur histoire. Mais j’ai aussi le devoir, en tant que guide de la confrérie, d’apporter les fruits de mon expérience de romier aux futurs pénitents.
Le temps est venu de m’y employer, sans bruit, pour ne pas réveiller ma tendre moitié, je descends dans mon cabinet de travail. Là, je prends ma plume et non pas une feuille de parchemin, mais, une feuille de ce nouveau support que l’on appelle papier4 et, commence à écrire… Tout commence en l’an de grâce 1367.
*
Aux dires de mes connaissances, il est bien loin, le petit garcelet chétif que j’étais à ma naissance. Physiquement, j’ai bien changé. À présent, je suis robuste et assez grand pour mon âge. Mon visage large, au menton carré et ferme est éclairé par des yeux noisette, au-dessus desquels trônent des sourcils épais bien arqués. Quand on me rencontre, le regard reste accroché à mon épaisse chevelure châtain clair où se reflète la lumière. Je dégage, dit-on, force et détermination. Réservé je suis parfois étrange ou déroutant. Indépendant en apparence, j’ai du mal à vivre seul, j’ai besoin de pouvoir compter sur quelqu’un. Je me sens parfois seul, incompris, par toujours convaincu d’être perçu par mon entourage, malgré ma gentillesse. Il se dit aussi que j’ai un sens inné de la justice et de l’équité.
Mes parents sont vinaigriers, tout naturellement, je le suis devenu moi aussi.
C’est au début du printemps 1366 qu’avec mes parents, Geoffroy et Johanna Guibert, j’ai quitté Orléans pour Tours. J’avais alors seize ans.
Tours est bien situé dans la partie la plus basse du bassin de Paris, au bord de la Loire, au point où le Cher se rapproche si près du fleuve que les deux vallées se confondent.
Au début du Xe siècle, le monastère de Saint-Martin fut entouré, ainsi qu’une partie de son bourg, d’une enceinte de près de huit arpents5. Un territoire propre, soustrait à l’autorité de la Cité fut aussi instauré, entre le castrum et la Loire. Pour plusieurs siècles, il y eut sur le terrain comme dans les esprits, deux villes : Tours, la vieille cité héritée de l’Antiquité, et Châteauneuf, la ville neuve médiévale. Entre les deux, le monastère de Saint-Julien, par son vaste foncier, instaurait un intervalle qui fut long à s’urbaniser. Jusqu’au XIe siècle, l’existence de ce « castrum de Saint-Martin » eut pour résultat la bipolarisation effective de la ville pour quelques siècles entre la Cité, qui était Tours aux yeux des contemporains, et une nouvelle agglomération appelée Châteauneuf. Cet effet fut accentué par la restauration du monastère de Saint-Julien, dont les terres s’inséraient entre la Cité et Châteauneuf. Un espace fonctionnel tripartite s’établit dès lors, sans qu’il répondît à un quelconque projet d’ensemble. Depuis le XIIe siècle plusieurs phénomènes sont liés à la croissance urbaine avec la poussée vers l’ouest de la Cité avec le bourg des Arcis, l’accroissement en tous sens de Châteauneuf, la pression sur la rive du fleuve, tout comme l’ascension sociale de la nouvelle classe des bourgeois. Malgré le maintien du monastère de Saint-Julien sur ses terres, une densification lente de l’habitat le long de la Grand-Rue est sensible. Elle commence à établir la liaison entre les deux pôles.
L’installation de quatre couvents des ordres mendiants dans l’espace intercalaire à proximité de la Cité et de Châteauneuf à partir du XIIIe siècle souligne le dynamisme local.
Chacune des deux composantes présente le caractère contrasté des villes de notre époque, où le changement économique se manifeste par des conflits d’intérêts entre tradition et nouveauté. Au XIVe siècle, la fusion des deux villes est devenue une nécessité lorsque la guerre de Cent Ans amena leurs habitants à s’enfermer derrière la construction d’une même enceinte qui englobait 500 arpents6 depuis la Cité jusqu’à la paroisse exclue de Notre-Dame La Riche. La guerre de Cent Ans fut l’occasion de la réunion des trois composantes en un tout.
Depuis, la ville de Tours est constituée de trois agglomérations : la première l’ancienne cité comtale et épiscopale autour de la cathédrale Saint-Gratien, la deuxième, le bourg du Châteauneuf au pied de la basilique Saint-Martin et de la tour Charlemagne, la troisième, plus dispersée, formée par les habitations entourant l’Abbaye Saint-Julien.
Tours est une ville très commerçante. Par l’inflexion nord-sud de son cours devenant est-ouest, la Loire joue un rôle essentiel dans nos échanges commerciaux. Des gabares chargées de sel breton de Guérande et de fret de vin d’Anjou et de Touraine remontent la Loire en passant par Tours.
Les vins, se conservant mal et souffrant de la chaleur, tournaient en « vin piqué », avant d’atteindre Orléans. Nos bateliers se débarrassaient de ce vin non vendable en vidant leurs tonneaux dans le fleuve. Des marchands ambulants réussissaient, plus ou moins, à en récupérer. Ils déambulaient, ensuite, dans les rues avec un tonneau sur une birouette, munis de tous leurs ustensiles en criant : « Vin aigre qui es bon, vin aigre. ». Des mercantis, plus astucieux et entreprenants, peut-être, las de sillonner les rues pour petites pécunes, mirent à profit ces convoyages des vins.
Qui, le premier, eut l’heureuse idée de racheter ce « vin piqué », de le faire décharger à Orléans à la satisfaction des bateliers et vignerons ? On l’ignore.
Il est maintenant très recherché. On l’emploie, comme condiment, mais aussi comme boisson et médicament. Il facilite la digestion et possède des propriétés désinfectantes. En cuisine, il est utilisé pour rehausser le goût des aliments, pas toujours très frais. Il aide à leur conservation. Son usage était connu depuis longtemps, les Grecs s’en servaient avec de l’huile pour assaisonner des viandes bouillies. Une fois étendu d’eau, il devenait une boisson, l’Orient appréciait ce breuvage dit hygiénique, tonique et rafraîchissant nommée « Posca », les légions de César s’en désaltéraient.
Très rapidement, la demande fut plus forte que l’offre. Elle ne suffisait plus à satisfaire les besoins de la clientèle. Pour faire face à l’augmentation de la chalandise, mes parents ont décidé d’ouvrir une seconde échoppe à Tours.
Mais fatigués, vieillissant, ils n’avaient plus l’énergie nécessaire pour tenir les deux négoces, ce métier étant devenu trop prenant, ils voulaient se retirer des essaines.
Après mes humanités et quatre ans d’apprentissage, j’étais prêt à prendre la succession, étant « sains es membres et nectz en habillemens », comme le veut le règlement de notre guilde7. Ma formation fut complétée par des cours de droit.
Mon père a tenu à me donner la meilleure instruction, celle-ci me permettrait, disait-il, d’étendre mon négoce au-delà de la Touraine. Pourquoi pas Paris, et même, jusqu’en Flandre ?
Ils me confièrent donc la charge de leur maison de commerce de Tours. L’affaire d’Orléans fut confiée à notre fidèle comptable Anthelme.
Johanna et Geoffroy en sont ravis.
C’est dans le bourg du Châteauneuf que notre négoce est installé, sur le carroi aux Chapeaux, rue de l’arbalète. Non loin de la Loire, où se trouvent nos entrepôts, ce qui est bien pratique.
Notre cité est aussi un sanctuaire important, un centre de pèlerinage majeur, sorte de capitale religieuse drainant les foules qui amplifient l’activité commerciale.
Cela fait des siècles, que saint Martin accompli des miracles. Il fut, très vite, l’objet d’une immense dévotion et attire de nombreux pèlerins. On dit qu’il a ressuscité trois morts et rendu la santé à quantité de malades incurables.
Saint Martin de Tours, aussi nommé Martin le Miséricordieux, né dans l’Empire romain, plus précisément à Savaria dans la province romaine de Pannonie8 en 3106 ou 317.
Sous la pression de son père officier dans la légion romaine, il entre dans l’armée de l’empereur à 15 ans, comme officier, il va servir en Gaule.
Selon la légende, un soir d’hiver, il partage son manteau avec un déshérité transi de froid, car il n’a déjà plus de solde après avoir généreusement distribué son argent. Il tranche son manteau, ou tout du moins la doublure de sa pelisse, et la nuit suivante le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de manteau. Il a alors 18 ans. Le reste de son manteau, appelé « cape » sera placé plus tard, à la vénération des fidèles, dans une pièce fut appelée chapelle.
Martin reste encore deux années dans l’armée, puis rejoint ensuite Hilaire à Poitiers et se convertit. Il ne peut être ordonné prêtre, car il a servi comme homme de guerre et devient simplement exorciste. Vivant en ascète, parcourant les campagnes, il est très populaire et s’oppose aux évêques de cour qui utilisent le pouvoir temporel à leur service. Parmi ses actes méritoires, il s’est élevé contre les évêques qui firent exécuter, par le bras séculier, l’évêque d’Avila, Priscillien, et ses disciples accusés d’hérésie. Ce furent les premiers condamnés à mort pour cette raison.
En 371 à Tours, Monseigneur Lidoire vient de mourir. Les habitants veulent choisir Martin mais celui-ci s’est choisi une autre voie et n’aspire pas à l’épiscopat. Les habitants l’enlèvent donc et le proclament évêque le 4 juillet de même année sans son consentement. Martin se soumet en pensant qu’il s’agit là sans aucun doute de la volonté divine
Il fut enterré à Tours le 11 novembre 397. La légende veut que les fleurs se soient mises à éclore ce mois-là9.
Depuis la mort du thaumaturge, trois bâtiments se sont succédé au-dessus de sa sépulture.
Notre cathédrale Saint-Martin, qui lui est consacrée fut commencée en 1003. C’est la première église d’un type nouveau conçu en fonction des besoins d’un lieu de pèlerinage. Elle possède de vastes dimensions et un plan à déambulatoire permettant à la foule de défiler autour des saintes reliques. La principale relique, celle de saint Martin, apôtre des Gaules, renvoie la lumière de centaines de cierges plantés comme une forêt couverte de neige autour de lui, sur le revêtement d’or, d’argent et de pierreries qui l’habille.
De plus Tours est devenu, à la fois, ville étape et ville départ vers Compostelle. Tous les jours, l’église est pleine à craquer. Chaque pèlerin attend patiemment son tour d’approcher le tombeau sacré par les déambulatoires qui entourent le chœur. Les religieux ont grand peine à canaliser la foule, chacun jouant des coudes et essayant de convaincre ceux qui sont arrivés au but, de laisser la place aux autres, ceux-là, estimant qu’ils ont fait la queue assez longtemps, pour avoir le droit de prier saint Martin le temps qu’il faut pour lui faire part de tous leurs malheurs.
Un dimanche, au début du mois de mars, au cours de l’office, le père Bertrand Moinet, du haut de sa chaire, fait une surprise à ses paroissiens :
— Devant l’affluence, toujours plus grande des pèlerins et des nécessiteux, je ne peux plus faire face, aussi, je vous annonce l’arrivée prochaine d’un jeune prêtre, le père Jérôme, qui sera mon assistant. Il nous vient de Chartres. Je compte sur vous tous pour le joiler parmi nous.
Le père Bertrand a de bonnes raisons de se faire seconder. Depuis des décennies, la basilique recueille et assiste les pauvres et les malades, comme l’avait fait saint Martin et accueille de plus en plus de pèlerins venus se recueillir sur le tombeau de Saint-Martin, auxquels s’ajoutent ceux de passage vers Compostelle.
Pour soutenir toutes ces actions, un prêtre de plus était le bienvenu. Cela ne suffisait pas pour autant. Comme d’autres paroissiens, après la messe j’ai pris l’habitude d’offrir un peu de mon temps pour aider les nécessiteux et les pèlerins qui viennent dans la basilique.
C’est là que je fis connaissance, du père Jérôme Plaget. Tout a commencé par une conversation sur le vin de messe premier symbole chrétien.
Marque d’urbanité, source de santé et de réconfort, objet de fête publique et privée, médicament, en un mot un produit béni de Dieu, le vin est la boisson par excellence.
Apprenant ma qualité de vinaigrier et peu versé dans l’art des vins, le père Jérôme me demande mon avis sur les plants de nos campagnes.
— Vous savez, père Jérôme, en deux siècles, la culture de la vigne a connu un essor considérable, grâce à des cépages appropriés, pour satisfaire une demande croissante.
— À ce point ? Je ne l’aurais pas cru. Cela ne me plaît guère, seul le vin pour la messe est digne d’être produit. Ne crois-tu pas ?
— Certes, mon père, mais nos vins offrent une grande diversité et il en faut pour tous les besoins. Selon nos mires, ils passent pour convenir aux ventrailles échauffées par une riche nourriture carnée et pour aiguiser et réjouir l’esprit.
— Ah, dans ce cas !
— Et puis il faut distinguer les vins, il a vin et vin.
— Voyez-vous cela !
— Bien sûr. Il y a plusieurs qualités qui se différencient par leur couleur, les blancs sont les plus abondants, car moins fragiles. On se délecte de ces vins clairs comme les clairets et les rosés. Nos savants et nos mires les considèrent, comme les plus « sains ». Frais et vivaces, ils sont appréciés des nobles et ce sont ceux que vous utilisez comme vin de messe.
Les vins rouges sont jugés plus « nourrissants », donnant de la force, plus appropriés aux ouvriers, à qui ils sont recommandés. Mais les goûts changent. De nos jours, un procédé permet d’obtenir des vins plus ou moins colorés, à partir des seuls raisins noirs. Les vins d’un rouge rubis profond dont la couleur entache les tables sont les plus recherchés.
— Nous ne savons toujours pas les conserver et ils doivent être consommés dans l’année, sinon, ils tournent aigre, c’est bien cela.
— C’est exact, père Jérôme, et c’est là que j’interviens avec mon négoce. Le vinaigre est l’un des plus cadeaux que Dieu ait fait aux hommes.
— Je suis bien de ton avis mon fils. Son usage est mentionné dans l’Ancien et le Nouveau Testament pour donner du goût aux aliments, ajouter du piquant aux boissons et même comme base de plusieurs médicaments.
« Après avoir travaillé fort à ramasser l’avoine dans les champs, Ruth fut invitée par Boaz à manger du pain et à le tramper dans le vinaigre. 10»
— Sans oublier, mon père, son utilisation par les soldats, une fois diluée comme cordial, ainsi que pour nettoyer et désinfecter les plaies.
— Tu as raison, mon fils. Même les alchimistes semblent apprécier ses vertus pour obtenir ce qu’ils nomment « sucre de plomb » lorsqu’ils en versent sur du saturne11.
— Du sucre de plomb, à quoi cela sert-il, mon père ?
— À adoucir et sucrer le cidre dur. Tout ceci est fort bien, mais le devoir m’appelle, veux-tu m’aider ?
— Volontiers, mon père que puis-je faire ?
*
Peu de temps après, alors que je m’occupe d’un groupe de pèlerins, en compagnie du père Jérôme, l’un d’eux, évoque le grand saint Jacques. Nous nous assoyons et l’écoutons.
— Il y a fort longtemps, après la mort de Jésus, ses apôtres s’étaient dispersés pour prêcher l’Évangile. Jacques était parti en Galice, au nord-ouest de l’Espagne, avant de retourner en Palestine, où il fut supplicié sur l’ordre du roi Hérode. Ses disciples parvinrent à ramener son corps en Galice où il fut enseveli. Pendant que les chrétiens combattaient les infidèles, un ermite attiré par une lumière surnaturelle dans un bois, au-dessus d’une clairière, découvrit le tombeau de l’apôtre. Ce lieu, le « Campus Stellae » devint célèbre. On y fit construire la première église dédiée à Jacques.
Depuis, je ne cesse de questionner le père Jérôme, au sujet de ce mystérieux Jacques.
— Dis-moi, après tout, pourquoi ne te mets-tu pas en route vers celui-ci ? C’est là une expérience unique, peut-être est-ce un message, une invitation à te joindre aux pèlerins et à les suivre jusqu’à Compostelle. Sais-tu où se trouve cette ville merveilleuse ?
— Ma foi, non.
— Compostelle est une ville d’Espagne située dans la province de La Corogne. Pour s’y rendre, rare sont les gens qui le savent, mais il existe en fait quatre voies sacrées qui valent une série de bénédictions et d’indulgences pour quiconque parcourt l’une d’elles.
— Comment en connaissez-vous l’existence ?
— Grâce à un ouvrage qui a pour nom Le Codex Calixtinu, attribué à un moine poitevin, un certain Aimery Picaud. Il y indique sommairement ces quatre routes, le chemin de Paris, dont le vrai départ est en réalité ici à Tours, celui de Vézelay, ceux du Puy et d’Arles. Les trois premiers fusionnent à Ostabat dans les Pyrénées, puis, les quatre, à Puente la Reina en Espagne, pour constituer le Camino francés.
Je suis littéralement médusé, accroupi auprès du père Jérôme, désirant toujours en savoir plus.
— Il est peut-être l’heure de rentrer chez toi à présent ?
— Oui, sûrement, lui répondis-je, l’esprit ailleurs, comme dans un rêve, je m’y voyais presque.
— Si tu te sens réellement décidé, alors mets-toi en route, mon fils, ne retiens pas ce qui est en toi, marche, si c’est vraiment ce que tu désires. Tu as une excellente occasion qui se présente à toi, puisqu’il y a un important départ prévu le lendemain de Pâques, le lundi. Réfléchis s’y, parles-en avec les tiens et, si tu pars, passe en famille les Pâques pour te souvenir des souffrances du Christ et de sa résurrection. C’est une bonne manière de commencer l’année nouvelle12.
— J’ai honte d’avouer que je n’avais jamais pris le temps d’y penser auparavant, trop occupé par mon négoce.
— N’aie crainte, il n’y a pas de regrets à avoir, puisque tu l’ignorais, et puis, il n’est jà trop tard pour bien faire. Tu peux aller l’esprit en paix, Joaven, il se fait une heure avancée, les tiens vont s’inquiéter.
Après avoir quitté le père Jérôme, je ne peux rentrer chez moi de suite, j’éprouve le besoin de marcher, me perdre dans la ville pour surmonter mon émotion et réfléchir. Partir est une décision difficile à prendre. D’autant plus difficile non pas que ma condition m’en empêche, mais malgré toute la liberté dont je jouis, je n’ai guère envie de quitter cette ville où je me sens bien.
Les rues et les ruelles de Tours sont comme toutes celles des autres villes, sinueuses, sales étroites, encombrées et bouillonnantes. Les auvents permanents ou relevables et les étaux occupent une partie de la rue, tandis que les enseignes, les galeries qui les enjambent restreignent l’arrivée de la lumière et du soleil. Le désordre, que je rencontre, témoigne d’une intense activité en cette fin de matinée. À cette foultitude de gargouillis du ventre de la ville s’ajoutent le cliquetis des crécelles des lépreux de passage, les clochettes des pèlerins.
Je croise un homme de bien, ce qui m’oblige à descendre dans le caniveau central pour lui céder le passage. Le « haut du pavé »13, la partie haute est réservée aux gens de sa condition. Je réussis à ne pas trop me salir en marchant dans les eaux usées déversées des maisons qui s’écoulent dans le mitan de la rue, se mêlant aux eaux de pluie. Le plus souvent, ces eaux stagnent, formant avec les ordures une boue nauséabonde qui offense l’odorat.
Perdu dans mes pensées, je reste étranger aux injures des gens que je bouscule, aux grognements des porcs qui errent en liberté à la recherche de déchets devant la porte des habitations.
Les cloches sonnent sans cesse et finissent, malgré l’habitude, par être assourdissantes. Elles rythment notre vie quotidienne, et les temps forts de la spiritualité. Avec des sons plus ou moins graves, elles indiquent les heures, la levée du couvre-feu, l’ouverture des volets des échoppes et des ouvroirs le matin. Elles indiquent les temps de travail, les temps de repos et le moment de poser les outils pour déjeuner à midi. Dans un registre moins gai, elles sonnent le glas et autre tocsin, l’effroi, et le couvre-feu. Je n’oublie pas les services religieux, depuis les matines et les laudes, tôt le matin, jusqu’aux complies à la fin de la journée.
Les colporteurs, les marchands d’eau, les rémouleurs, les mendiants qui battent le pavé en interpellant les passants de leurs voix puissantes, fausses, enrouées ou grêles accentuent l’assourdissant concert des cris de Tours. Les annonces d’un mariage, d’une prochaine foire, de la réunion du conseil des guildes, et même d’une exécution par le crieur public provoquent un attroupement.
Je réprime un jurement en évitant de justesse le contenu d’un orinal.
Assoiffé par ma course, je trouve une taverne, « Au vin d’ici-bas », sur la rive gauche de la Loire à quelques dizaines de mètres du fleuve, à proximité d’un gigantesque chantier. On démolit l’église Saint Saturnin pour la reconstruire plus grande.
— Quelle agitation, Maître Vin14 ?
— Ah ça messire, je ne vous le fais pas dire.
— Cela vous fait fuir la chalandise ?
— Oh ne vous bilez pas, j’ai les ouvriers du chantier. Et puis, c’est pour cela que depuis j’ai changé mon enseigne. « Au vin d’ici-bas » est plus approprié maintenant. Vous ne trouvez pas ?
— Si vous le dites. Mais je ne vois pas bien pourquoi.
— Réfléchissez donc un peu !
— Non désolé, je ne vois toujours pas.
— C’est ma foi assez simple. Étant situé en face de cette maison de Dieu, et vu son état, il vaut mieux venir boire mon vin, ici, que l’eau de là.
— ??
— Y voit toujours pas ? Eh bien, j’ai pensé que le vin d’ici valait mieux que l’eau de là…, l’au-delà, compris ?
Très fier de sa trouvaille, il part d’un rire communicatif qui arrive à me faire sourire. Malgré son humour un peu effronté, l’homme semble mener rondement ses affaires et ne pas manquer de clients. La salle, en dépit de ses murs grisâtres, à cause des fumées de la grande cheminée où brûle un feu ténu qui adoucit l’atmosphère, est propre et assez cossue. Une grande baie sur rue, en verre potassique, l’éclaire de la lumière du jour. Ce qui me confirme les bonnes affaires du Maître des lieux. La plupart des autres établissements utilisent pour assurer la lumière de leur salle de la toile passée à la cire blanche, à la résine ou à la térébenthine, du papier huilé ou de la vessie de porc traitée, car, l’emploi du verre n’est guère bon marché. Il en coûte à ce jour, deux sous le pied carré. Ce qui n’est pas à la portée de toutes les bourses.
Tout à mes observations, j’aperçois, par l’embrasure de la fenestre, des centaines d’hommes qui s’affairent pour démonter pierre après pierre l’édifice religieux, rendant cette partie de la ville comparable à un essaim. Il y a là des Maître maçons, pas des bousilleurs.
À longueur de journée, on charge pierres et matériaux dans les dépôts sur les berges de la Loire.
Le regard perdu, je fixe cette fourmilière humaine qui s’active.
Les chantiers en plein air ont toujours été bruyants et continuent de l’être. En sortant de la taverne, mes oreilles sont assaillies par le bruit du marteau du fèvre qui retombe sur l’enclume, le grincement des roues des chariots des charretiers, la scie des charpentiers et tous les bruits des autres métiers présents.
Ce sont les appels, les vociférations des ouvriers d’un échafaudage à un autre ou du sommet d’une échelle au pied du mur, les sons que rendent les outils sur la pierre, ceux de la scie ou de la hache sur le bois. Des plaisanteries fusent entre les jeunes gens et les adultes qui s’interpellent, se provoquent. Les ouvriers poussent la chansonnette avec leurs mélodies favorites.
Quelques pas plus loin, toujours perdu dans mes pensées, j’arrive rue des Échoppes. L’agitation y est extrême, une jeune fille au corsage rayé de jaune et de rouge présente un large plateau d’osier en annonçant : « Belles frezes, framboises… » Un boulanger15 s’invective au prétexte d’une concurrence déloyale contre un petit marchand ambulant qui vend moins cher ses oublies et ses gaufres. Un peu plus loin, c’est un valet à l’étal du boucher16 qui s’active contre les mouches qui grouillent sur ses morceaux de viande, en les houspillant. De nombreuses commères se bousculent devant l’étal du poissonnier. Ce dernier harangue les chalands pour leur vanter la fraîcheur de sa marchandise. Il jure la main sur le cœur que ses poissons, enveloppés dans des linges humides afin de les rafraîchir, n’ont pas plus de trois jours17 malgré une odeur lourde et peu engageante. Deux furies lui chantent pouilles et réclament leur bon argent. Attirés par le chahut, quatre sergents en armes se dirigent vers l’étal du scandale.
— Que se passe-t-il ici que l’on vous entend de l’autre bout du bourg ?
Les deux femmes parlent en même temps.
— Oh là !, les commères, on se calme, on n’y entend rien. Vous Dame Langet, parlez.
— Ce scélérat nous vend du poisson passé pour du frais.
— Oui, c’est honteux, faut qui nous rembourse, ajouta l’autre.
— Bon du calme, à présent. Voyons voir.
L’un des sergents soulève un des poissons et le hume. Une grimace de dégoût apparaît sur son visage.
— Dis-moi l’homme, d’puis quand l’a été pêché ton poisson ?
— Sur mon honneur, deux jours, sergent.
— Deux jours ? Et il pue déjà la pisse à dégorger ! Tu te moques de moi.
— Je n’oserais, sergent. Je l’ai reçu hier par coursier rapide.
— En plus, tu t’joues de moi !
— Que non pas. Peut-être qu’il devait, sans doute, être pêché de la veille, suggéra-t-il ?
— Quoi qu’il en soit, tu as fraudé. Tu dois payer une amende.
— Mais j’y suis pour rien sergent.
— Il suffit, ou tu paies l’amende de suite, ou tu paieras le double demain.
— C’est bon, je paie de suite.
La somme encaissée, l’un des sergents ordonna d’un ton sec :
— Galopin, fais ton travail.
Le sacripant renverse sur l’étal un seau de merde du putel voisin. L’odeur caractéristique et très reconnaissable se répand soudain au grand dam du poissonnier.
— Voilà, t’peux plus dire qu’il est frais ton poisson maintenant. À présent file de cet’ville et n’y r’viens onc, sinon t’goûteras à nouveau de not’putel.
Après avoir remboursé les deux commères, l’homme s’enfuit, sous les rires, sans demander son reste et les sergents se retirent sous les applaudissements.
Un peu plus loin des colporteurs proposent leurs rubans, passementeries, fils et aiguilles. Devant chez l’épicier, on respire une multitude de senteurs. Là aussi, il y a foule. Ces dames y viennent se fournir en cosmétiques, eaux de visage, de corps, de cheveux ou de bouche18.
Cette agitation m’a ramené à la réalité, d’autant qu’il faut être attentif afin d’éviter les petits vendeurs qui se contentent d’étaler une large touaille à même le sol afin d’y proposer leurs denrées : fromages de chèvre, gourmandises au miel et croûtes dorées, parfois même quelques légumes et fruits frais.
Une servante bien en chair, la mine belliqueuse s’en prend au saucissier sur la qualité de ses saucisses de sang qu’elle trouve bien trop claires.
— D’la saucisse de sang, ça ? Elles sont aussi pâlottes qu’tes pices tes saucisses. L’avait du sang au moins, ton cochon ?
— Pour sûr ma belle, c’était du sang de cochon de lait.
— Euh-là…mais qu’ec qui m’raconte c’lui là, arrête ton batelage, t’prends pour une baguenaude, maroufle. Ch’ui pas fille à m’faire larroner.
— Mais en vérité, j’vous jure sur…
— Sur qui donc corne bouc ? Fils de puterelle. J’en veux point d’tes coilles de cadavres, t’peux t’les mettre où qu’j’pense et qu’t’fasses profit.
— Doucement, la mégère, faudrait voir, à rester cortoise.
— Musèle ton clapet bast ou j’vas t’en emmancher une qu’tes braies vont rester s’place.
La saillie plaît aux femmes qui s’étaient attroupées autour de l’étal. Elles applaudissent avec ferveur l’audace de leur commère.
J’aime m’attarder dans cette billebaude de la rue, mais il se fait très tard, à présent, je me hâte de rentrer. De retour chez moi, toujours indécis, je décide d’aller, dès le lendemain, demander conseil à mon ami Ogier.
*
La ville se réveille à peine de sa nuit de débauche et autres vilenies quand je me saisis du heurtoir du logis des Briconnet. J’ignore si Ogier est levé, mais je ne pouvais attendre plus. C’est sa mère qui vient m’ouvrir.
— Joaven, que se passe-t-il ? Tu es tombé du lit ? Il n’est arrivé aucun malheur, j’espère ?
— Non, rassurez-vous, Dame Briconnet, je voudrais parler à Ogier.
— Entre, installe-toi, tu connais la maison, je vais le prévenir.
Dame Briconnet avait toujours refusé d’embaucher une servante sous prétexte qu’elle mettrait son nez partout.
Leur négoce de vinaigre ne marche pas fort depuis la mort, il y a une paire d’années, de Maître Briconnet. Son fils passe plus de temps dans les plaisirs qu’au travail.
D’un pas lourd, Ogier descend l’escalier qui conduit à la salle commune où je me suis posé. L’homme est grand. Son visage est austère, ses yeux noirs et profonds, ses cheveux foncés. Malgré son jeune âge, des rides de mauvaise vie ont creusé leurs sillons prêts à recevoir les graines de la vieillesse. Pour embellir son allure, il porte un anneau d’or à l’oreille gauche.
Il a gardé certains aspects de son caractère d’enfant. Rien ne provoque plus de plaisir chez lui que d’organiser des farces, des diableries qui ne sont pas du goût de ses victimes. Ce qui nuit à son négoce et à ses relations. Pour ne rien arranger, sa fréquentation est souvent malplaisante. Il discourt sur n’importe quoi, il sait tout, il est intarissable. Cela aurait pu être un atout majeur dans son commerce, mais il a une manière détestable de ramener continuellement tout à lui.
Mais, si on l’écoute avec attention, il peut vous donner de précieuses informations glanées dans le ventre nocturne de la ville.
Son teint sombre, ses yeux plus que plissés révèlent une nuit qui a été courte. Comme cela lui arrive souvent, il a dû courir les ribaudes et les tripots.
C’est malgré tout avec plaisir qu’il m’accueille.
— Le bon jour Joaven, te voilà bien matinal pour me rendre visite, un problème ?
— Le bon jour à toi aussi et je te remercie de me recevoir, car tu dois avoir plus envie de dormir que de me faire la causette. Rassure-toi, je serai bref.
Voilà, je souhaite partir en pèlerinage à Compostelle, mais, je ne sais rien du voyage et de ses dangers. Pourrais-tu m’aider à y voir plus clair ?
— Ainsi, tu veux partie pour Compostelle ? Voilà qui me surprend. J’ignorais que tu étais si bigot ?
— Il n’y a rien de bigot dans ce périple ? Le pèlerinage est entrepris par des gens de toutes sortes.
— Tu le sais ce n’est pas vraiment ma gagnerie, mais je connais des personnes qui ont fait ce pèlerinage. Ils se sont regroupés en une confrérie dont le siège est dans une chapelle, rue des Hôtelleries, à Orléans, pratiquement face à la rue Pierre-Percée, au bout du pont qui traverse la Loire. Eux sauront te guider, je pense, et répondre à tes questions.
Mais dis-moi, si tu pars, tu laisserais ton commerce et surtout Aude toute seule pendant des mois ? Voilà qui est intéressant.
— Pour ce qui est de mon commerce, mes parents s’en occuperont, quant à Aude, je suis sûr qu’elle saura m’attendre.
— Voyez-vous cela !
— Je ne te permets pas d’en douter, Ogier.
— Je serais toi, je ne me montrerais pas si assuré.
— Cette fois tu dépasses les bornes…
— Bon, bon, entendu, comme tu voudras. J’ignore toutefois, si Aude, épousera un bâtard ?
— C’est moi que tu traites de bâtard ?
— Je crois bien, il n’y a personne d’autre que toi, ici.
— Je crois que je n’ai plus rien à faire ici. Moi qui te croyais mon ami. Je ne te dérange pas plus longtemps. Je ne te salue pas.
*
Le lendemain matin, je me mets en route pour Orléans. Après deux journées passées à cheval, j’arrive avant la fermeture des portes. Il est trop tard pour me rendre à la fraternité. J’avise une auberge où je passe la nuit. Un peu avant tierce, je frappe à la porte de la confrérie des anciens de Compostelle. Un homme d’un certain âge vient m’ouvrir. Il est vêtu du costume de la communauté, qui n’a rien à voir avec la tenue du pèlerin ordinaire. Elle est composée d’un habit de velours rouge, d’un chapeau avec les insignes de saint Jacques, d’un collier de jais et à la main son bourdon, il m’accueille avec un large sourire :
— Que veux-tu, Damoiseau ?
— Pour me rendre à Compostelle, dites-moi ce qu’il faut faire ! Combien de temps cela prendra, ce que je dois emporter.
— Oh là, oh là, tout doux mon damelot, prends le temps de respirer. Tu veux savoir trop de choses à la fois.
En premier lieu, on salue, et ensuite, dis-moi qui tu es.
— Si fait, pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs.