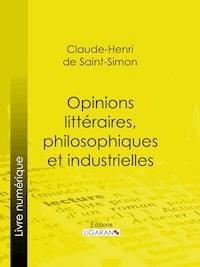
Opinions littéraires, philosophiques et industrielles E-Book
Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Tout le monde parle de la philosophie, chacun porte son jugement sur les travaux des philosophes, et cependant très peu de personnes conçoivent clairement les rapports existants entre les travaux philosophiques et les autres travaux intellectuels. Très peu de personnes se font une idée nette de la marche qui a été suivie, et de la manière dont se sont opérés les progrès de la philosophie."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’âge où nous vivons offre un singulier contraste dans la manière de penser et dans celle d’agir. Jamais il n’y eut une aussi grande masse d’idées nobles et généreuses répandues sur le monde intellectuel, et jamais la société ne s’est montrée sous des dehors aussi médiocres et aussi mesquins : jamais les belles actions n’ont eu de plus éloquents admirateurs, de louangeurs plus enthousiastes et plus habiles ; jamais aussi elles n’ont été plus rares. La source première du mal est sans contredit dans la direction fausse qu’imprime à la société la force chargée du soin d’en gérer les intérêts matériels et moraux. Mais la génération actuelle n’est pas, à nos yeux, pure de tout reproche : au lieu de chercher à s’organiser d’une façon conforme à ses inclinations et à ses besoins, elle semble ne vouloir que s’oublier ; elle perd, elle dissémine sur une foule d’objets sans importance, cette puissance de vie et de pensée qu’elle devrait concentrer sur un seul point ; c’est, en un mot, une masse, qui, possédant la faculté du mouvement, reste immobile, tandis qu’elle n’aurait besoin que d’un léger effort pour s’élancer dans la plus vaste sphère.
Mais, il faut l’avouer, les sociétés ont presque toujours été impuissantes à se faire mouvoir elles-mêmes : la force morale des nations a ses ministres, ses fonctionnaires, aussi bien que la force matérielle. Cette dernière sait diriger ses hommes ; et elle en est merveilleusement secondée : il y a, en un mot, unité et concorde dans toutes les parties de son action. Bien au contraire, les représentants de la force morale des sociétés ne s’entendent pas : au lieu de diriger vers un but commun les connaissances et les sentiments de l’homme, ils suivent tous des routes ou différentes ou opposées ; on les voit employer, d’une manière inutile au bien de la masse, par un défaut de combinaison, ou consacrer au service du pouvoir, par un défaut de noblesse et d’honneur, ce levier puissant, cet unique instrument que la force morale possède pour se développer, la littérature.
C’est, en effet, la littérature qui détermine l’action directe des sciences et des beaux-arts sur la multitude ; elle met en contact avec les masses le savant et ses découvertes, le philosophe et ses conceptions, l’artiste et les produits de son talent. La littérature du dix-huitième siècle a la première senti sa mission ; c’est du milieu d’elle, c’est de la bouche de Voltaire et de Rousseau, qui en furent les chefs, qu’est sorti ce premier cri, ce cri de marche, qui a mis en mouvement toute la puissance intellectuelle de la société, et qui a conduit l’esprit humain aux plus nobles et aux plus rapides conquêtes.
Pourquoi s’est-il arrêté dans sa marche ? pourquoi la force morale, après les victoires qu’elle a remportées, est-elle restée stationnaire ? C’est que la littérature du dix-huitième siècle ayant accompli sa tâche, qui était de critiquer et de détruire, a été continuée en pure perte après que tout était détruit. On n’a pas vu qu’il ne s’agissait plus que d’organiser, et qu’une littérature nouvelle était nécessaire pour s’opposer à la fois à l’action de la force matérielle qui voulait reconstruire, en prenant ses matériaux dans le passé, et pour diriger la force morale, qui ne voulait point renoncer à la tendance de désorganisation et de critique.
Les écrivains du siècle de Louis XIV ont eu raison de conserver le passé pour point de mire : le christianisme n’avait pas encore été compris ; l’état social n’avait réellement pas changé. Les écrivains philosophiques du siècle dernier sont venus, qui se sont encore tournés vers le passé, mais pour en rire, et pour le déconsidérer aux yeux des hommes : ils ont démontré qu’il ne valait plus rien pour le présent ; mais ils ne se sont pas occupés de l’avenir ; ils ne le pouvaient point, et ils ont fait assez : ils ont amené la révolution française qui a proclamé l’abolition de l’esclavage dans la nuit du 4 août, nuit décisive qui vit s’accomplir ce qu’avaient commencé Platon et Jésus-Christ, et qui, arrachant le dernier fondement du vieil édifice social, permit de poser les bases d’un édifice tout nouveau. Cette grande et vraiment sublime détermination a rendu possible l’exécution de l’Évangile ; elle a rendu les hommes égaux, et par conséquent capables, pour la première fois, de vivre en frères ; elle a permis à la politique, qui ne pouvait être jusque-là que l’art de tromper et d’opprimer, de devenir enfin une science, féconde, comme toutes les autres, en résultats salutaires ; elle a agrandi le domaine de la morale ; elle a renouvelé les arts dans leur essence ; elle a révélé au savant tout le parti qu’il pouvait tirer, pour le bien commun, de son pouvoir sur la nature ; en un mot, elle a ouvert au génie et au talent toutes les sources de pensées qui peuvent émouvoir le cœur de l’homme, éclairer son intelligence, charmer son imagination.
C’est donc du christianisme que doit dater une ère nouvelle en littérature. Nous ne voulons pas dire par là qu’il faille remplacer les souvenirs du culte païen par les inspirations du culte catholique ; nous voulons dire que le christianisme, parvenu à son entier accomplissement (l’abolition de l’esclavage parmi les hommes, opérée en France par la révolution), a ouvert une route nouvelle aux savants, en politique, en morale, comme en toute espèce de sciences ; aux artistes, et aux théologiens, qui ont reçu du ciel le plus noble don, celui de transmettre la vertu ; aux chefs des travaux industriels, qui ont sur le corps social puissance de vie et de mort ; en un mot, à la société tout entière, et par cela même à la littérature, qui est l’expression vivante des formes, des besoins de la société, et l’application continue de la pensée à tout ce qui peut contribuer à ses intérêts et à ses plaisirs.
La dernière partie de cette définition est principalement convenable à cette branche de la littérature, qui l’embrasse et la représente tout entière, le journalisme. Ce nouveau moyen de rapports, créé par les sociétés modernes, n’a jamais été plus nécessaire qu’aujourd’hui, et jamais ceux qui se chargent de faire agir ce puissant ressort n’ont eu à remplir une mission plus belle et plus importante.
Longtemps torturée par un régime contraire à son développement et à sa nature, la société, en France, grâce aux leçons de maîtres habiles, qui avaient su l’éclairer sur les imperfections de son état, avait enfin pris part à sa propre existence, et commençait à s’organiser elle-même, dans son indépendance et dans sa raison, quand tout à coup ce grand corps se trouva pris d’une violente maladie : il tomba dans une fièvre ardente. Tourmenté de sa force, qu’on voulait comprimer encore, il s’élança, brisa ses liens et se livra à des transports inexprimables : il fallait de l’action à son énergie, du fer à son bras plein de vigueur : on vit un peuple entier changer ses mœurs, son langage, mettre de la frénésie dans la vertu comme dans le crime : on vit une troupe de furieux en démence jouer au gouvernement, à la guerre, à la justice : on vit les enfants d’un même sol se poussant tour à tour sous la hache des proscriptions, et dansant au pied des échafauds, tandis que d’autres allaient mourir en face de l’ennemi, pour conserver libre ce cimetière qu’ils appelaient patrie. Survint un homme qui, comprenant le mal de tous ces hommes, voulut les guérir : il fit perdre tant de sang à cette société délirante, que sa fièvre tomba peu à peu avec ses forces ; il amusa sa convalescence par de beaux spectacles, par des conquêtes, de la gloire militaire, des cordons, des broderies, des titres. Tout à coup ce peuple se réveilla : il ne voulut plus de l’homme qui l’avait guéri ; il désira un régime convenable à son état de santé et à sa vigueur renaissante ; pendant sa fièvre, une grande révolution s’était opérée dans ce corps en travail ; la longue crise avait cessé : la nation jeta les yeux sur elle-même ; elle se trouva saine, bien portante, et elle était devenue majeure.
Nous en sommes là : nous sommes pleins de santé, pleins de force, pleins de raison, et cependant nous n’avons pas encore arrêté notre plan de vie : nous ne marchons pas, nous piétinons.
La société a grandi ; mais, après s’être longtemps fatiguée en vain, elle s’est assise ; elle attend, pour se lever, qu’un homme passionné pour le bien étende le bras, et lui dise : Voilà la route.
Une philosophie nouvelle, résultat de longues méditations sur l’organisation sociale, a compris : que jusqu’ici on s’était beaucoup trop occupé de changer les gouvernants, sans songer à placer l’action de gouverner au véritable rang que doivent lui assigner les progrès de la civilisation ;
Que toutes les forces du corps social, résidant dans les sciences, les arts et l’industrie, un ordre de choses en harmonie avec les besoins de la société, serait celui où les hommes qui excelleraient dans ces trois grandes capacités, se trouveraient exercer une action prépondérante, et emploieraient directement leurs facultés de la manière la plus convenable au bien de tous ;
Que le résultat nécessaire d’une pareille organisation serait de procurer à la partie la plus utile de la nation, celle qui produit, la plus grande somme possible d’instruction et de jouissances ;
Et enfin, que l’esclavage ayant été aboli par la révolution française, le temps était venu où l’on pouvait faire marcher de front les sciences morales et les sciences physiques, et donner aux premières ce caractère positif, ce degré de certitude et de perfection progressive, qui distingue si éminemment les secondes.
On sent combien ces principes, appliqués aux sciences et aux beaux-arts, peuvent être féconds en aperçus nouveaux, en observations grandes et utiles, et quel champ, vierge encore, ils ouvrent à la morale et à la critique littéraire. Les écrivains, en bien petit nombre de nos jours, qui exercent avec impartialité le journalisme, soit littéraire, soit politique, se traînent tous sur des routes battues, et se répètent sans se fatiguer jamais. Ils continuent, d’une part, l’école de Marmontel et de Laharpe ; de l’autre, celle de Voltaire et de Rousseau ; et ils ne diffèrent entre eux que par l’expression plus ou moins ingénieuse, plus ou moins piquante de vérités connues, devenues sans application et sans but. Chose étonnante ! l’objet de la critique a changé ; la critique est toujours la même. Quant à nous, qui avons l’avantage de partir d’un point fixe et de nous diriger vers un but certain, dans le cours de nos travaux littéraires nous porterons des jugements qui auront du moins le caractère de la nouveauté, en ce qu’ils ne seront pas dictés par la routine, mais par une conviction profonde, et par une invariable tendance vers un ordre de choses meilleur et plus élevé. Nous tâcherons d’indiquer aux savants et aux artistes comment ils doivent combiner leurs connaissances et leurs sentiments dans l’intérêt de l’utilité commune, de leur gloire particulière, et de leur propre dignité. Nous espérons enfin montrer à tous les amis de la vérité et du bien public ce que doivent être les littérateurs français au dix-neuvième siècle.
Jeunes gens, nous connaissons l’état d’anxiété qui vous pèse : on ne vous enseigne pas tout ce que vous désirez apprendre. Les évènements qui ont passé sur notre patrie, et qui ont agité la société dans ses plus profondes racines, ont laissé de grands besoins au fond des cœurs ; vous rêvez je ne sais quoi de juste et de beau que vous ne voyez nulle part. Ce n’est pas en vain que vous avez grandi au bruit des épées et du tambour, que vous vivez au milieu de soldats, devenus citoyens, qui se souviennent à peine d’avoir autrefois remué le monde, et que derrière vous s’agite encore un passé plein d’hommes et de choses. Non, de pareils souvenirs ne pouvaient être stériles : aussi êtes-vous riches de pensées avant le temps, et capables d’émotions et de désirs inconnus à vos pères. Travaillés du besoin d’une littérature actuelle, tous les livres qui ne sont pas de ce siècle sont muets pour vous : vous ne les comprenez plus, et ceux qui les ont faits ne vous comprendraient point vous-mêmes. Rien ne peut reposer votre esprit : les sciences ne sauraient le captiver tout entier, car l’étude de la nature ne fait que vous rendre plus avides d’une morale qui soit simple et positive comme elle. L’histoire, qu’on popularise pour vous, vous apprend bien à juger le passé, mais non pas à vous contenter du présent et à présager l’avenir ; les arts ont pris à vos yeux un caractère grave et touchant ; la plupart de ceux qui les cultivent ne vous paraissent point sentir leur mission ; vous demandez à la poésie autre chose que des vers, autre chose que des chants à la musique, et que des formes à la peinture. En un mot, vous n’avez plus qu’une pensée, pensée immense, à laquelle vous rattachez tout, et qui est devenue votre vie, celle d’un bonheur universel et d’une perfection indéfinissable. Jeunes gens, nous ne marchons pas sans boussole, et nous vous montrerons un but. Les principes de littérature et de morale dont nous voulons produire l’application pourront fournir à votre esprit un aliment solide, à votre cœur des jouissances assez élevées ; et ils sont de nature à donner une base à tous les sentiments généreux. Nous chercherons à inspirer à l’homme cette croyance en lui, sans laquelle il tombe dans l’apathie, et devient la proie de l’égoïsme, qui n’est au fond qu’une méfiance mutuelle de nos forces. Tandis que mille voix ne cesseront de s’écrier autour de vous, « L’Europe est vieille, » nous, nous dirons à chaque page : « Ne les croyez pas, elle est jeune ! » Loin de vous entretenir dans cette tristesse, à laquelle des esprits faibles et chagrins voudraient vouer notre âge, et qui n’appartient qu’à la décadence et à la maladie, nous vous ferons marcher tête levée, avec ce sourire de sécurité et d’espoir, qui sied si bien à la force et à la santé. Avec nous, en un mot, vous aurez beaucoup d’avenir, et vous sentirez votre âme s’élever, votre imagination s’agrandir et s’étendre avec les destinées de l’homme.
L’âge d’or, qu’une aveugle tradition a placé jusqu’ici dans le passé, est devant nous ; l’avenir se montre aux yeux des peuples non plus comme un écueil, mais comme un port. Jusqu’ici les hommes ont toujours légué à leurs descendants l’amour et l’admiration du passé ; tourmentés par un besoin de bonheur, dont ils n’entrevoyaient pas la possibilité sur cette terre, ils le cherchaient en arrière d’eux ou dans le ciel. En proie à des douleurs physiques positives, ou à de vagues souffrances morales, ils se consolaient par des chimères : ils disaient que l’homme est né pour souffrir, que les temps de félicité s’étaient enfuis pour toujours, qu’il n’y a de bonheur à espérer que lorsqu’on n’est plus. Ils rêvaient un âge d’or, où tous les hommes vivaient en frères, réunis par les plus doux nœuds sociaux ; où la guerre était inconnue ; où régnaient l’amour, l’innocence et la candeur ; où coulaient des ruisseaux de miel et de lait, emblème de l’abondance et de la santé. Ainsi l’homme attribuait à la faiblesse de l’enfance tous les privilèges de la virilité, et croyait trouver dans le passé le plus reculé ce qu’il n’osait promettre à sa postérité la plus lointaine. Étrange illusion ! Comme si le bien pouvait précéder le mal, la vérité se montrer avant l’erreur, et la force avant la débilité ! comme si une pareille idée n’était point contraire à la morale, à l’organisation de l’homme, et aux lois de la nature ! Mais que pouvaient faire les peuples, quand tout les entretenait dans cette erreur qu’ils avaient reçue de leurs pères ; quand tout ce qui est destiné à les instruire et à les charmer reprenait cette idée sous mille formes, la représentait sous mille couleurs, l’appuyait de toutes les ressources de la pensée, l’ornait de toutes les grâces de l’imagination ; quand les vices de leurs institutions, quoique successivement améliorées, leur faisaient déplorer le présent et désespérer de l’avenir ? Les moralistes, ces instituteurs du genre humain, n’avaient point compris leur tâche, et ils n’avaient pu la comprendre ; au lieu d’instruire, ils consolaient ; ils ne connaissaient qu’une science, celle de supporter la douleur ; ils regardaient le mal comme une nécessité ; ils se servaient de la morale, comme d’un remède à la vie, et ils unissaient leurs voix à la lyre des poètes, pour célébrer le bonheur des premiers âges, et promettre à l’homme une vie plus heureuse, loin de ce monde passager. Les artistes ne portaient jamais leurs yeux qu’en arrière ; ils ne puisaient leurs inspirations que dans le passé ; ils y cherchaient tout ce que pouvait reproduire avec avantage la palette ou le ciseau ; les divinités, auxquelles ils élevaient des temples, s’étaient toutes communiquées aux hommes dans les premiers jours du monde ; mais, irritées par leurs péchés, elles ne respiraient plus que colère contre le genre humain, et n’assuraient à la vertu qu’un chimérique asile, où l’on ne pouvait aller qu’en passant par le tombeau. Les poètes chantaient les grandes guerres des premiers siècles ; leur imagination se plaisait dans des scènes de destruction et de carnage ; ou, s’ils consacraient leur muse aux plaisirs, ils ne célébraient que les voluptés de l’opulence ; ils apprenaient à jouir d’une vie qui, selon eux, n’était bonne qu’à la bien perdre ; ils ne disaient rien pour le pauvre, rien pour l’affligé ; ils ne montraient point de but aux travaux de l’homme ; ils ne chantaient que pour le désœuvrement, qui a besoin de jouissances, et qui payait leurs vers comme une recherche du luxe. Ainsi grandissaient les nations, ne s’apercevant pas de leurs progrès, et perpétuant cette grande erreur, qu’elles s’éloignaient du bien à mesure qu’elles avançaient dans l’avenir. Les rois et les chefs des peuples, qui seuls alors avaient assez de richesses pour payer les travaux de la pensée et les productions des arts, n’avaient garde de combattre cette décourageante idée ; ils la faisaient au contraire soutenir et répandre ; ils sentaient combien de force elle ajoutait à leur empire, puisqu’elle éteignait tout espoir d’amélioration chez les hommes, et qu’elle les accablait sous le poids d’une irrévocable destinée. Mais en dépit de ses chefs, de ses moralistes, de ses artistes, de ses poètes, le corps social se fortifiait de jour en jour ; il se développait par une marche lente, mais continue ; il montra tout à coup à ses faux prophètes, il se révéla, pour ainsi dire, à lui-même que les siècles n’avaient pas été perdus pour lui, et qu’il avait à espérer de plus beaux jours que les temps de son enfance. Le christianisme, accompli enfin par la révolution française, a déchiré le rideau qui rendait notre vue si bornée ; le voile est tombé, des flots de lumière ont brillé soudain, et l’avenir nous est apparu, plein de magnificence et de bonheur.
Oui, nous le proclamons avec conviction, la société, depuis qu’elle existe, n’a jamais fait un pas en arrière ; on a pu ralentir son développement, mais il n’était pas au pouvoir de l’homme de l’empêcher. L’âge d’or, nous le répétons, est devant nous ; le paradis terrestre devient visible ; et ceux qui auront contribué à l’établir, auront seuls droit à une place dans le paradis céleste.
C’est à nous, Français, qui sommes à la tête de la civilisation européenne, parce que nous avons été retrempés par la secousse politique la plus violente, la plus profonde, et que nous avons un caractère de généralité qui n’est le partage d’aucun peuple ; c’est à nous de diriger la grande coalition des intelligences, et de la mettre, les premiers, en mouvement. Tout est pour nous, le pays, le temps et les hommes : nous avons une terre favorisée de la nature, qui satisfait à tous les besoins de la vie, comme à ceux des yeux et du cœur ; qui est couverte de champs fertiles, de beaux sites et d’une population éclairée, industrieuse, amie de l’ordre, parce qu’elle est amie du travail, et digne de son affranchissement, puisqu’elle sait se diriger elle-même. Nous avons des savants dont les veilles, riches de faits et d’expérience, augmentent journellement nos conquêtes sur la nature ; nous avons des écrivains qui ont du jugement, des lumières, et une facilité de diction que n’a jamais offerte aucune époque ; nous avons des poètes, des artistes, qui ont plus que de l’imagination et du talent, puisqu’eux aussi ils veulent servir l’humanité, et qu’ils demandent tous un but, une action ; nous avons du marbre et de la pierre, pour élever des statues aux bienfaiteurs de l’humanité, et des palais aux seuls objets qui en soient dignes, les sciences, la religion, et les beaux-arts. Unissons-nous donc ! Puisqu’aujourd’hui l’on peut s’occuper directement du bien de la masse, poètes, artistes, théologiens, littérateurs, hommes de l’industrie, hommes des sciences, notre route à tous est tracée ! Laissons enfin reposer le passé, auquel nous avons fait d’assez belles et d’assez longues funérailles ! Ne le dédaignons pas cependant, sachons l’apprécier, puisqu’il nous a conduits au présent, et qu’il nous ouvre un chemin facile vers le plus bel avenir ! N’ayons tous qu’un vœu, qu’une espérance ! Marchons comme un seul homme, suivant la belle expression d’un poète ancien ; et inscrivons sur nos pacifiques bannières : Le paradis terrestre est devant nous !
Pour l’exécution de notre entreprise, nous avons formé une société qui se compose de littérateurs, de légistes, de savants (parmi lesquels nous faisons jouer le principal rôle aux physiologistes), de moralistes occupés du perfectionnement de la philosophie religieuse, de personnes livrées à l’étude de l’économie politique, et d’artistes.
Il résulte nécessairement de la composition de notre société, que nous produirons des travaux sur la littérature, sur la législation, sur les sciences (particulièrement sur la science de l’homme), sur la philosophie religieuse, sur l’économie politique, et sur les beaux-arts.
Voilà quelle sera la division de notre ouvrage, sous le rapport spirituel ; quant à la division matérielle, nous nous astreindrons seulement à partager notre publication en deux parties. Nous traiterons dans la première les sujets d’une manière grave et systématique ; la seconde sera consacrée à des morceaux de littérature, qui se rapporteront, d’une façon plus ou moins directe, aux idées fondamentales. Des opinions philosophiques neuves, et qui correspondent à l’état présent de la civilisation, ont été adoptées par toutes les personnes qui concourent à l’exécution de cette entreprise ; elles seront le lien qui unira toutes les parties de l’ouvrage, et qui en formera un tout systématique.
Nous allons énoncer celles de ces opinions qui nous paraissent les plus importantes ; nous mettrons par ce moyen le lecteur en état de juger l’ouvrage sous son rapport le plus essentiel, avant même qu’il ait été entièrement produit ; car il ne contiendra que le développement et l’application de ces opinions fondamentales.
Sur la philosophie.
Tout le monde parle de la philosophie, chacun porte son jugement sur les travaux des philosophes, et cependant très peu de personnes conçoivent clairement les rapports existants entre les travaux philosophiques et les autres travaux intellectuels. Très peu de personnes se font une idée nette de la marche qui a été suivie par les philosophes, et de la manière dont se sont opérés les progrès de la philosophie.
La philosophie est la science des généralités. La principale occupation des philosophes consiste à concevoir le meilleur système d’organisation sociale, pour l’époque où ils se trouvent, à en déterminer l’admission par les gouvernés et par les gouvernants, à perfectionner ce système autant qu’il en est susceptible, à le renverser ensuite, quand il est parvenu aux extrêmes limites de son perfectionnement, pour en construire un nouveau avec les matériaux rassemblés dans toutes les directions particulières par les hommes livrés à des travaux intellectuels spéciaux.
Ce sont les philosophes du Moyen Âge (appartenant tous au clergé, parce qu’il était alors la seule classe possédant quelque instruction) qui ont conçu et établi le système théologique et féodal, après avoir renversé jusque dans leurs fondements les plus profonds, les systèmes sociaux produits et mis en pratique par les philosophes grecs et romains.
La supériorité des philosophes du Moyen Âge sur ceux de l’antiquité a été constatée par la supériorité de leurs travaux sur ceux des philosophes grecs et romains, c’est-à-dire par la supériorité du système d’organisation sociale théologique et féodal sur tous les systèmes politiques en vigueur chez les peuples de l’antiquité.
Sur l’état de la civilisation chez les peuples de l’antiquité, et sur ses progrès chez les peuples du Moyen Âge.
La supériorité du système d’organisation sociale théologique et féodal sur les régimes politiques qui avaient été adoptés par les peuples de l’antiquité est évidente, et cependant ce fait n’a point encore fixé l’attention des bons esprits, aucun philosophe ne l’a encore franchement proclamé ; l’école est encore dominée par les idées philosophiques et politiques qui ont été produites dans l’antiquité ; les professeurs de philosophie ne parlent qu’avec la plus grande exaltation et avec le plus saint respect des législateurs Minos, Lycurgue et Solon ; ils ne disent pas un seul mot de Charlemagne, d’Alfred ni de Grégoire VII. Les systèmes politiques des Lacédémoniens, des Athéniens, et des Romains, sont pour eux des objets d’admiration, et le système d’organisation sociale qui s’est formé dans le Moyen Âge et qui a uni, par des liens politiques, toute l’immense population européenne, ne leur paraît qu’une conception mesquine qui ne mérite pas la plus légère attention.
Nous allons expliquer en peu de mots la cause de cette erreur. Toutes les opérations de l’esprit humain se réduisent à des comparaisons : ainsi, dire qu’une chose est bonne ou qu’elle est mauvaise, c’est dire qu’elle est meilleure ou pire que telle autre à laquelle on la compare. Quand les philosophes modernes ont vu que le système théologique et féodal avait atteint les extrêmes limites de son perfectionnement ; qu’il ne pouvait plus subir les modifications nécessaires pour le mettre en rapport avec les progrès de la civilisation, et qu’il était devenu indispensable de le renverser, ils se sont mis à le critiquer : or, pour prouver qu’il était mauvais, ils avaient besoin d’un terme de comparaison ; ils n’avaient pas le moyen de concevoir un système supérieur, puisque ce système ne pouvait être conçu qu’après le renversement de celui qui existait alors : ils ont pris le parti de le comparer au système antérieur des Grecs et des Romains, et pour atteindre leur but, ils ont établi la comparaison entre ce que le système des peuples de l’antiquité avait eu de bon, et ce que le système théologique et féodal avait de pire.
Maintenant qu’on peut concevoir un système d’organisation sociale, supérieur au système théologique et féodal, on peut sans inconvénient établir la supériorité de ce dernier système sur celui des peuples de l’antiquité : c’est ce que nous allons faire.
Pour rendre clair et facile à juger ce que nous allons dire à ce sujet, nous commencerons par énoncer les principales conditions qui doivent être remplies par un système d’organisation sociale ; cela fait, il ne s’agira plus que de comparer les régimes politiques des peuples de l’antiquité avec celui qui s’est établi chez les Européens, à l’époque du Moyen Âge.
Nous ne ferons cette comparaison qu’entre le système politique suivi par les Grecs et les Romains, et le système d’organisation sociale qui s’est établi au Moyen Âge, par la raison que l’école accorde sans aucune hésitation la supériorité à ces deux peuples, dans tous les genres, et particulièrement en politique, sur toutes les peuplades qui leur ont été contemporaines.
Nous disons donc et nous ne craignons pas que cela nous soit contesté :
« La meilleure organisation sociale est celle qui rend la condition des hommes composant la majorité de la société, la plus heureuse possible, en lui procurant le plus de moyens et de facilités pour satisfaire ses premiers besoins.
C’est celle dans laquelle les hommes qui possèdent le plus de mérite, et dont la valeur intrinsèque est la plus grande, ont le plus de facilité à parvenir au premier rang, quelle que soit la position dans laquelle le hasard de la naissance les ait placés.
C’est encore celle qui réunit dans une même société la population la plus nombreuse et qui lui procure les plus grands moyens de résistance contre l’étranger.
Enfin, c’est celle qui donne pour résultat des travaux qu’elle protège, les découvertes les plus importantes et les plus grands progrès en civilisation et en lumières. »
Comparons maintenant sous ces quatre rapports différents les sociétés grecques et romaines avec celle qui s’est formée en Europe dans le Moyen Âge.
Première comparaison. Chez les Grecs et chez les Romains, l’esclave appartenait directement au maître, qui avait sur lui droit de vie et de mort.
Aucune loi, aucune institution, aucun principe de morale publique, aucune opinion religieuse ne protégeait l’esclave, et n’avait pour but de limiter le pouvoir arbitraire du maître à son égard.
Sous le régime théologique et féodal, l’esclave était attaché à la glèbe ; ce n’était plus que d’une manière indirecte qu’il appartenait au propriétaire du sol qui l’avait vu naître. La loi du rachat des crimes donnait une valeur à la vie d’un esclave, à chacun de ses membres, à toutes les parties de son corps : ses yeux, ses oreilles avaient un prix déterminé, de manière que le maître qui avait tué un de ses esclaves, ou qui l’avait mutilé, était obligé d’indemniser ses enfants dans la proportion fixée par le tarif.
La morale généralement admise, ainsi que la religion, protégeaient l’esclave contre l’abus du pouvoir arbitraire de son maître ; la morale chrétienne prescrivait à tous les hommes de se regarder comme frères ; elle recommandait à chacun de se conduire vis-à-vis de son prochain comme il désirerait voir son prochain se conduire à son égard ; et la religion chrétienne enseignait que tous les hommes, sans aucune exception, sont égaux aux yeux de Dieu.
Chez les Grecs et chez les Romains, les maîtres étaient toujours armés, journellement réunis sur la place publique ; ils habitaient presque en totalité l’enceinte des villes, qui étaient toutes fortifiées, tandis que le plus grand nombre des esclaves étaient répandus dans les campagnes, où ils exécutaient les travaux de la culture. Il s’ensuivait que les maîtres n’étaient point contenus par la crainte des insurrections, puisqu’elles étaient presque absolument impossibles. Sous le régime théologique et féodal, au contraire, c’étaient principalement les artisans qui habitaient les villes ; les maîtres avaient leur domicile à la campagne, de sorte qu’ils se trouvaient isolés au milieu de leurs esclaves, d’où il résultait qu’ils étaient jusqu’à un certain point contenus par la crainte d’une vengeance de leur part, vengeance dont l’exécution était possible, et qui avait lieu quelquefois quand les esclaves étaient exaspérés par de trop mauvais traitements.
Les jeunes Lacédémoniens allaient fréquemment à la chasse aux ilotes, et il ne résultait jamais pour eux aucun inconvénient des plaisirs barbares qu’ils se procuraient de cette manière. De pareils excès ne sont point arrivés sous le régime théologique et féodal.
Ainsi le sort des hommes composant la très grande majorité de la société a été beaucoup moins malheureux sous le régime théologique et féodal qu’il ne l’avait été sous le système d’organisation en vigueur chez les Grecs et chez les Romains.
Deuxième comparaison. Chez les Grecs et chez les Romains, ce sont les patriciens qui ont habituellement et presque exclusivement dirigé les affaires publiques ; ce sont eux qui ont occupé les emplois les plus importants du pouvoir spirituel ainsi que du pouvoir temporel. Les sénateurs étaient patriciens, les grands prêtres, les aruspices et les augures étaient également patriciens. Les magistratures occupées par les plébéiens n’étaient que d’un ordre inférieur, et ne les faisaient point participer à l’action directrice : elles leur procuraient seulement quelques moyens de s’opposer au pouvoir arbitraire qui était confié aux patriciens ; jamais les plébéiens n’ont obtenu le premier degré d’importance que par des insurrections, et jamais l’importance qu’ils ont obtenue par ces insurrections ne s’est consolidée.
Dans l’habitude de la vie, les plébéiens se trouvaient presque dans un état de domesticité à l’égard des patriciens : d’après les usages de ce temps-là, ils se constituaient les clients des patriciens les plus importants, et, en cette qualité, ils les suivaient dans les rues, et faisaient antichambre dans leurs maisons.
Les avantages les plus essentiels dont les plébéiens jouissaient à l’égard des esclaves, consistaient en ce que les premiers choisissaient à leur gré le maître auquel ils s’attachaient, que la loi les protégeait contre tout mauvais traitement physique, et qu’il leur était assez facile de se coaliser entre eux pour effectuer d’importantes insurrections.
En un mot, tout homme qui examinera sans préjugé les dispositions principales de l’organisation sociale des Grecs et des Romains, reconnaîtra qu’elles étaient toutes à l’avantage des patriciens, qui formaient une aristocratie héréditaire ; il reconnaîtra que le pouvoir de diriger les intérêts généraux de la société fut constamment la propriété des patriciens, et que cette hérédité pour eux des pouvoirs politiques était fortement cimentée par la disposition législative qui accordait droit de vie et de mort aux pères sur leurs enfants. Cette disposition empêchait les jeunes gens de se livrer aux idées généreuses ayant pour but l’établissement de l’égalité, puisqu’elle les mettait sous la dépendance absolue des vieillards, qui sont infiniment moins susceptibles que les jeunes gens de passions nobles et élevées.
Enfin, si on observe attentivement les obstacles qui s’opposaient à ce que les hommes de mérite parvinssent au premier rang, quand ils n’étaient pas patriciens, on sera forcé de convenir qu’en général l’organisation sociale des Grecs et des Romains condamnait à l’obscurité les hommes nés dans la classe la plus nombreuse de la nation, quelle que fût leur valeur intrinsèque relativement à celle des patriciens.
Le système théologique et féodal s’est fondé sur des principes très différents, et, sous certains rapports, tout à fait opposés à ceux qui avaient servi de base au système politique des Grecs et des Romains.
Chez les Grecs et chez les Romains, le pouvoir spirituel était subordonné au pouvoir temporel, auquel il servait humblement d’auxiliaire.
Chez les Européens du Moyen Âge, l’influence du pouvoir spirituel était prépondérante, le pouvoir spirituel était général, les pouvoirs temporels n’avaient qu’une autorité locale.
Chez les Grecs et chez les Romains, le pouvoir spirituel était exclusivement dirigé par les patriciens.
Chez les Européens du Moyen Âge, ce furent les plébéiens qui dirigèrent habituellement le pouvoir spirituel pendant tout le temps que le système théologique et féodal fut dans sa vigueur.
Ce furent en un mot les patriciens qui dirigèrent les intérêts des Grecs et des Romains tandis que ce furent les plébéiens qui se placèrent en tête de la société européenne, et qui lui servirent de guides, pendant toute la durée du Moyen Âge.
C’est au clergé, composé essentiellement de plébéiens, et qui a été constamment dirigé par eux-mêmes, dans le petit nombre de cas où les papes ont été pris dans les rangs des patriciens, que l’espèce humaine doit les progrès faits par la civilisation depuis Hildebrand jusqu’au seizième siècle : or, ces progrès ont été immenses, et ils ont placé l’esprit humain à une hauteur beaucoup plus grande que celle où il s’était élevé à l’époque la plus brillante des sociétés grecques et romaines.
C’est le clergé catholique qui a déterminé tous les défrichements qui se sont effectués dans les Gaules, dans la Germanie, et dans tout le nord de l’Europe, c’est lui qui a dirigé et personnellement exécuté les premières opérations de ce genre.
C’est le clergé qui a rendu les Européens susceptibles de faire des progrès en intelligence, par le soin qu’il a eu pendant tout le Moyen Âge d’entretenir dans toutes les parties de l’Europe des écoles où l’on enseignait à lire et à écrire.
C’est le clergé qui a conservé tous les monuments de science, de littérature et de beaux-arts qu’avaient produits les Grecs et les Romains, et qui avaient survécu aux ravages des barbares.
C’est encore le clergé qui a mis un frein à l’humeur guerroyante des chefs du pouvoir temporel, en établissant la trêve de Dieu.
C’est lui qui a commencé à faciliter les communications, en suscitant la construction des ponts et des chemins, par les indulgences qu’il accordait à ceux qui se livraient à ce genre de travaux.
C’est lui qui a introduit en législation les formes conservatrices des intérêts particuliers dans les procès civils et criminels.





























