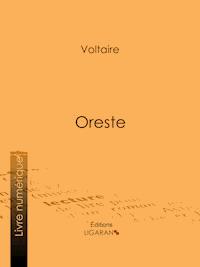
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "IPHISE. Est-il vrai, cher Pammène, et ce lieu solitaire, Ce palais exécrable où languit ma misère, Me verra-t-il goûter la funeste douceur De mêler mes regrets aux larmes de la sœur ? La malheureuse Electre, à mes douleurs si chère, Vient-elle avec Egisthe au tombeau de mon père ? Le sang d'Agamemnon paraisse à ces côtés ? Serons-nous les témoins de la pompe inhumaine Qui célèbre le crime, et que ce jour amène ? "
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335095555
©Ligaran 2015
Voltaire va continuer d’opposer pièce à pièce à Crébillon, qu’on ose mettre en parallèle avec lui. Crébillon avait fait représenter son Électre le 14 décembre 1708, tragédie qui aurait pu plus justement s’intituler Oreste. Électre avait eu dans sa nouveauté quatorze représentations consécutives. La quatorzième représentation fut donnée le 12 janvier 1709. Le théâtre fut fermé à cause du froid excessif, et ne se rouvrit que le 23 janvier. Électre depuis lors avait eu beaucoup de succès, et avait reparu sur la scène à diverses reprises.
Crébillon, quand il avait fait jouer Électre, avait trente-huit ans. Il en avait soixante-dix-huit lorsque son Catilina fut représenté, le 12 décembre 1748. Catilina fut accueilli avec enthousiasme, et eut vingt représentations consécutives.
Ce furent ces deux tragédies que Voltaire entreprit de surpasser à la fois, en composant pendant l’année 1749 son Oreste et sa Rome sauvée ou Catilina. C’est à cette dernière qu’il songe d’abord. Il en trace l’ébauche en huit jours. Mais à peine a-t-il achevé cette ébauche que l’autre œuvre est commencée. Il écrit à l’abbé de Voisenon : « Je ne sais si Mme du Châtelet m’imitera, si elle sera grosse encore ; mais pour moi, dès que j’ai été délivré de Catilina, j’ai eu une nouvelle grossesse, et j’ai fait sur-le-champ Électre (Oreste). Me voilà avec la charge de raccommodeur de moules dans la maison de Crébillon. »
C’est Oreste qu’il présente en premier lieu aux comédiens, et cela peut aisément s’expliquer. Voltaire en donne d’abord une raison plausible dans une lettre à la duchesse du Maine : « Madame, en arrivant à Paris, j’ai trouvé les comédiens assemblés prêts à répéter une comédie nouvelle, en cas que je ne leur donnasse pas Oreste ou Rome sauvée à jouer en huit jours. Ce serait damner Rome sauvée que de la faire jouer si vite par des gens qui ont besoin de travailler six semaines. J’ai pris mon parti, je leur ai donné Oreste, cela se peut jouer tout seul. Me voilà délivré d’un fardeau. J’aurai encore le temps de travailler à Rome, et de la donner ce carême. » Il y avait aussi un autre motif, c’est que la représentation du Catilina de Crébillon était toute récente, que cette pièce avait obtenu un grand succès, et qu’il y avait une certaine imprudence à demander au public de se déjuger aussi vite, tandis que l’Électre datait de près d’un demi-siècle.
La représentation eut lieu le 12 janvier. Voltaire avait fait imprimer sur les billets de parterre les lettres initiales de ce vers d’Horace :
« C’était sans doute, dit Collé, qui a inséré dans ses Mémoires le modèle de ces billets, c’était, sans doute, un petit coup de patte qu’il voulait donner à Crébillon sur sa versification qui, effectivement, n’est pas aussi correcte et aussi douce que la sienne, mais qui est plus mâle. Après la chute de la pièce, un plaisant du parterre trouva que ces lettres initiales voulaient dire : Oreste, tragédie pitoyable que monsieur Voltaire donne. »
Oreste fut, en effet, assez mal accueilli. La deuxième représentation dut être différée pour que l’auteur pût faire les corrections qui paraissaient nécessaires. Voltaire se mit à l’œuvre avec son ardeur ordinaire, ce qui faisait dire à Fontenelle : « M. de Voltaire est un homme bien singulier, il compose ses pièces pendant leur représentation. »
Il supprima un couplet de Mlle Gaussin (Iphise), qui avait semblé choquant ; il refit tout le cinquième acte.
Il écrit à Mlle Clairon (Électre) plusieurs lettres qu’on trouvera dans la correspondance, pour lui donner des conseils sur son jeu. Il se plaint vivement à la duchesse du Maine, qui s’est dispensée d’assister à la première représentation. Il la supplie de paraître à la deuxième, le lundi 19 janvier.
La deuxième représentation eut lieu, et le résultat en fut plus favorable. Jamais Voltaire ne déploya plus d’énergie, plus de passion pour faire réussir une de ses œuvres. Il dirigeait, dit-on, lui-même ses partisans, il animait le parterre, criant : « Battons des mains, mes chers amis ; applaudissons, mes chers Athéniens ! » Tantôt, dans le foyer, il jurait que c’était la tragédie de Sophocle et non la sienne à laquelle on refusait de justes louanges ; tantôt, dans l’amphithéâtre et plongeant sur le parterre, il s’écriait : « Ah ! les barbares, ils ne sentent pas la beauté de ceci ! »
C’est Collé, l’auteur de la Partie de chasse de Henri IV, qui nous le montre se démenant de la sorte, et Collé, il est vrai, est un adversaire décidé. Il ajoute que l’auteur d’Oreste renouvela ces efforts à toutes les représentations : « Enfin, un jour, dit-il, il a poussé la chose jusqu’à insulter un nommé Rousseau parce qu’il avait les mains dans son manchon, et qu’il n’applaudissait pas. Ce dernier lui répondit assez ferme, mais sagement, et point aussi vertement qu’il aurait pu. »
L’anecdote s’est trouvée confirmée d’autre part. « L’on ne raconte pas, dit M. G. Desnoiresterres, comment s’engagea la dispute, mais avec Voltaire les choses allaient bon train. “Qui êtes-vous ? criait le poète hors de lui. – Rousseau, répondait la partie adverse. – Rousseau ; quoi Rousseau… ? – Le petit Rousseau…” Voltaire ne réfléchissait pas qu’il empêchait le spectacle, et sans doute était-il loin d’avoir fini, lorsqu’une grande femme à l’air viril, se dressant de toute sa hauteur, lui dit d’une voix de stentor : “Si vous ne vous taisez pas, je vais vous donner un soufflet ;” ce qui le mit en fuite, et fit rire toute la salle. Cette virago, habituée dans son ménage à parler sur ce ton, était l’hommasse Mme Le Bas, la femme du célèbre graveur, qui, du reste, n’était point inconnue à notre poète. »
Il y a de l’exagération sans doute dans tout ce que raconte Collé de la conduite de Voltaire en cette circonstance, mais il y a aussi une part de vérité. La lutte était des plus vives. Voltaire l’avait dit à d’Argental : « Je sais bien que je fais la guerre, et je la veux faire ouvertement. Loin de me proposer des embuscades de nuit, armez-vous, je vous en prie, pour des batailles rangées, et faites-moi des troupes, enrôlez-moi des soldats, créez des officiers… »
Aucune autre pièce de Voltaire ne souleva, d’autre part, plus de railleries, d’épigrammes, de quolibets, de turlupinades. L’historiette de Polichinelle, que nous avons racontée à propos de Mérope, fut renouvelée avec aggravation. Oreste, dans sa nouveauté, eut neuf représentations, la dernière le 7 février 1750.
Remis au théâtre en 1762, Oreste obtint un succès complet, grâce surtout à la manière supérieure dont Mlle Clairon interpréta alors le rôle d’Électre. Cette tragédie disparut ensuite de la scène pendant plus de vingt ans. Mme Vestris, qui remplaça Mlle Clairon, fit de vains efforts pour obtenir qu’on reprît cette pièce. Brizard, qui avait un rôle brillant dans Palamède (d’Électre) et un médiocre dans Pammène (d’Oreste), écarta obstinément la reprise d’Oreste. Oreste toutefois fut joué pour quelques débuts, entre autres pour celui de Mlle Raucourt, et toujours avec succès. L’œuvre de Voltaire eut, comme la plupart de ses pièces, une sorte de renouveau après la Révolution. « L’effet du théâtre, dit Laharpe, a confirmé par degrés une justice d’abord refusée ; et, dans les dernières représentations d’Oreste, toutes les beautés en ont été vivement senties, et l’impression en a été beaucoup plus grande que n’est depuis longtemps celle d’Électre. »
Cette pièce est une imitation de Sophocle, aussi exacte que la différence des mœurs et les progrès de l’art ont pu le permettre. Elle fut jouée en 1750 avec beaucoup de succès. L’auteur fut seulement obligé d’en changer le dénouement.
Crébilion était censeur des pièces de théâtre : M. de Voltaire fut donc obligé de lui présenter sa tragédie. « Monsieur, lui dit Crébilion, en la lui rendant, j’ai été content du succès d’Électre ; je souhaite que le frère vous fasse autant d’honneur que la sœur m’en a fait. »
À la première représentation, on applaudit avec transport au morceau imité de Sophocle. M. de Voltaire s’élança sur le bord de sa loge : « Courage, Athéniens ! s’écria-t-il, c’est du Sophocle. »
On verra, en lisant les variantes, que l’auteur a retranché d’éloquentes déclamations pour mettre plus de mouvement dans les scènes ; qu’il s’est écarté du génie du théâtre grec pour ne plus suivre que le sien.
L’auteur des ouvrages qu’on trouvera dans ce volume se croit obligé d’avertir encore les gens de lettres, et tous ceux qui se forment des cabinets de livres, que de toutes les éditions faites jusqu’ici, en Hollande et ailleurs, de ses prétendues Œuvres, il n’y en a pas une seule qui mérite la moindre attention, et qu’elles sont toutes remplies de pièces supposées ou défigurées.
Il n’y a guère d’années qu’on ne débite sous son nom des ouvrages qu’il n’a jamais vus ; et il apprend qu’il n’y a guère de mois où l’on ne lui impute dans les Mercures quelque pièce fugitive qu’il ne connaît pas davantage. Il se flatte que les lecteurs judicieux ne feront pas plus de cas de ces imputations continuelles que des critiques passionnées dont il entend dire qu’on remplit les ouvrages périodiques.
Il ne fera plus qu’une seule réflexion sur ces critiques : c’est que, depuis les Observations de l’Académie sur le Cid, il n’y a pas eu une seule pièce de théâtre qui n’ait été critiquée, et qu’il n’y en a pas eu une seule qui l’ait bien été. Les Observations de l’Académie sont, depuis plus de cent ans, la seule critique raisonnable qui ait paru, et la seule qui puisse passer à la postérité. La raison en est qu’elle fut composée avec beaucoup de temps, et de soin par des hommes capables de juger, et qui jugeaient sans partialité.
À SON ALTESSE SÉRÉNISSIME MADAME LA DUCHESSE DU MAINE.
MADAME,





























