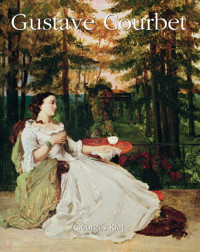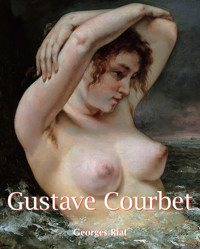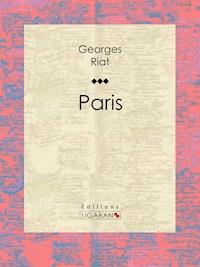
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"""Paris"", le livre captivant de Georges Riat, nous transporte au cœur de la Ville Lumière, nous dévoilant ses secrets les plus intimes et ses trésors cachés. À travers une plume envoûtante, l'auteur nous invite à une promenade littéraire à travers les rues pavées de Paris, nous faisant découvrir ses quartiers emblématiques, ses monuments majestueux et ses anecdotes historiques fascinantes.Riat nous offre une vision unique de Paris, en nous dévoilant les multiples facettes de cette ville mythique. Des Champs-Élysées à Montmartre, en passant par le Quartier Latin et le Marais, chaque quartier est décrit avec une précision et une passion qui nous transportent instantanément dans son atmosphère si particulière.Mais ""Paris"" ne se limite pas à une simple visite touristique. L'auteur nous plonge également dans l'âme de la ville, en nous faisant découvrir ses habitants, leurs histoires et leurs traditions. Des artistes bohèmes aux élégantes parisiennes, en passant par les bouquinistes des quais de Seine, Riat nous offre un véritable panorama de la vie parisienne, de ses joies et de ses peines.Au-delà de son aspect descriptif, ""Paris"" est également un hommage vibrant à la beauté intemporelle de la capitale française. Les mots de Riat se mêlent aux images qui se dessinent dans notre esprit, nous faisant ressentir l'effervescence des rues animées, le charme des cafés parisiens et la magie des couchers de soleil sur la Seine.En somme, ""Paris"" est bien plus qu'un simple guide touristique. C'est un véritable voyage littéraire qui nous transporte dans les méandres de la ville, nous faisant découvrir ses trésors cachés et nous invitant à tomber amoureux de Paris, encore et toujours. Un livre incontournable pour tous les amoureux de la Ville Lumière et ceux qui rêvent de la découvrir.
Extrait : ""La Seine divise Paris en deux parties assez distinctes, puisque pour certains Parisiens, « passer l'eau », aller de la rive gauche à la rire droite, est presque une excursion dans une autre ville ; elle forme elle-même une troisième région, la région du bord de l'eau, qui n'est ni la moins intéressante, ni la moins belle."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016635
©Ligaran 2015
Le lecteur trouvera dans ce volume, non point un livre d’érudition originale, mais une vulgarisation des travaux d’érudition consacrés à la ville de Paris, mise à jour et corroborée par des études et des observations personnelles. J’ai profité, pour ce faire, des descriptions anciennes de Sauval, Lebeuf, Piganiol, Béguillet, Thierry, Dulaure, comme des livres modernes de M. de Guilliermy et de M. de Champeaux, enfin des cours de Quicherat et de M. de Lasteyrie à l’École des Chartes. J’ai plaisir aussi à témoigner combien les conseils si avertis de mon collègue et ami M. Paul Vitry, attaché au Musée du Louvre, m’ont été utiles non seulement pour la première, mais encore pour cette deuxième édition.
La nature du sujet, la matière considérable à étudier, les limites matérielles mêmes de ce volume, mont imposé une façon de le concevoir, dont je voudrais dire un mot. Il n’était pas possible, quelque séduisante que fût l’idée, de présenter un tableau d’ensemble, artistique, historique, littéraire, et pittoresque de Paris, sans sacrifier chacune de ces parties. D’autre part, il n’y a pas eu à Paris d’école parisienne proprement dite, se développant particulièrement, comme l’école vénitienne, par exemple ; les éléments de ce développement n’ont été qu’en minorité indigènes, pour la majorité provinciaux et même cosmopolites, comme l’histoire de Paris ne peut se différencier de l’histoire générale de la France. D’où la nécessité de restriendre le domaine du sujet pour le mieux embrasser, et de n’exposer de l’ensemble que ce qui est nécessaire pour l’intelligence de la partie. C’est pourquoi nous avons cherché à tracer surtout, avec le plus de précision et de netteté possibleune Histoire monumentale de Paris, éclairée de quelques brèves indications historiques, et dont chaque chapitre est précédé d’un examen rapide, qui en présente comme la philosophie ; nous y avons ajouté un exposé sommaire de l’évolution de la peinture et de la sculpture françaises d’après les œuvres conservées au Louvre et au Luxembourg. Cette histoire peint les monuments ; quant au pittoresque des quartiers, nous l’avons esquissé à traits rapides dans l’Introduction ; et, pour le surplus, l’illustration y suppléera.
Paris, 5 mai 1904.
La Seine divise Paris en deux parties assez distinctes, puisque pour certains Parisiens, « passer l’eau », aller de la rive gauche à la rive droite, est presque une excursion dans une autre ville ; elle forme elle-même une troisième région, la région du bord de l’eau, qui n’est ni la moins intéressante, ni la moins belle. Son cours est sillonné par un va-et-vient continuel de bateaux-omnibus, qui transportent une foule de voyageurs, de remorqueurs qui traînent des radeaux pesamment chargés, de barques, de canots d’utilité ou même de plaisance. Le trafic, qui en résulte est énorme, puisqu’il est supérieur à celui de tous les autres ports français, et le rêve de « Paris port de mer » n’est certes pas une utopie.
Par une heureuse coïncidence, le fleuve commercial est aussi très esthétique, déterminant sur tout son parcours, avec les monuments riverains, les plus divers et gracieux paysages. On serait bien embarrassé de dire sa couleur ; il les a toutes, selon le moment de la journée, l’inclinaison du soleil ou de la lune, la pureté azurée du ciel ou les brouillards tout proches et ternes, le débit plus fort en hiver et l’étiage. Par un temps clair, il est blanc, gris, avec des moirures vertes, bleues et émeraudes, ou bleu de Prusse avec des vagues grises ; à l’aurore, il se teinte de rose, et au crépuscule, il devient violet, pourpre, sanglant. Quand le ciel est bas, chargé de vapeurs, il prend une teinte olive, vert de chrome ; et il est d’un jaune blond après la pluie ou la fonte des neiges. Des peintres vont chercher fort loin, en Afrique, dans l’Extrême-Orient, des effets fugitifs de lumière, ne se doutant pas du nombre et de la qualité des colorations, qui se nuancent si près d’eux, et pour l’analyse desquelles il n’est besoin d’aucun long et dispendieux voyage. La difficulté ne fait pas toujours la rareté, et l’atmosphère parisienne, si délicate, si tendre, si exquise, mérite qu’on l’analyse avec amour.
La Seine entre à Paris non loin de Charenton et du bois de Vincennes, accrue en de notables proportions, par l’apport de la Marne. Les premiers quais de ce côté : La Rapée, Bercy, Austerlitz, sont assez monotones, encombrés de gares, et de marchandises. À partir du pont Sully, commence le vieux Paris si intéressant, malgré les restaurations sans nombre qu’on lui fait subir. Voici l’île Saint-Louis avec ses hôtels de bourgeois cossus : puis la vénérable île de la Cité, berceau de la capitale et de la France. La vieille cathédrale s’estompe là en une masse sombre, d’où émergent la flèche et les deux tours, au-dessus des arbres du square de l’archevêché ; le Palais de justice, l’Hôtel-Dieu, la Préfecture de police l’entourent ; et, sur les quais, les pavillons de l’Hôtel de Ville, l’église Saint-Gervais, les deux théâtres municipaux, Saint-Julien le Pauvre et Saint-Séverin, le Pont-Neuf avec la statue de Henri IV, l’écluse, la Monnaie, complètent un ensemble qui ne laisse pas d’être émouvant.
Puis, c’est la ligne magnifique des palais du Louvre et des Tuileries, mirant dans le fleuve tour à tour la noblesse et la grâce des temps passés, les beaux ombrages séculaires des Tuileries, sous lesquels la promenade est si charmante, la place de la Concorde ; à gauche, le palais de l’Institut, les quais où bouquinistes et bouquineurs s’occupent à ne rien faire, le Palais Bourbon ou Chambre des députés, le ministère des Affaires étrangères ; et, ici et là, les beaux ponts des Arts, du Carrousel, Royal, de Solférino, de la Concorde.
À partir du pont Alexandre III, ce sont les Palais de l’Exposition, qui avoisinent les rives, entre l’Hôtel des Invalides, l’École Militaire d’une part et les Champs-Élysées de l’autre : palais âgés déjà, comme le Trocadéro, qui arrondit là-bas sa colonnade, palais tout neufs, comme le Grand et le Petit Palais, palais créés en quelques mois, éphémères et brillants, tôt construits, tôt abattus souvent, tandis que, tout près, les monuments des anciens âges continuent depuis des siècles, si différents de nous, à nous servir, à vivre après nous. Du Champ-de-Mars à la sortie de Paris, près de Billancourt, les quais n’offrent plus grand intérêt.
Revenons sur nos pas pour décrire chacune des deux parties de la ville, à son tour. D’une façon générale, et autant qu’il est possible de généraliser en si vaste et changeante matière, la Rive gauche (entre la Seine et la ceinture périphérique formée des quartiers excentriques de Grenelle, Vaugirard, Petit-Montrouge, Maison-Blanche est le pays des étudiants, des juges, des prêtres, des petits commerçants, des grands services publics. La vie, malgré les étudiants, y est calme, tranquille, un peu dévote, une vie de bourgeois modestes, vivant leur petit trantran, avec un parc très aimé, le Luxembourg, de vieux théâtres un peu désuets, de vénérables églises du Moyen Âge, des rues parfois étroites, que les grands travaux d’assainissement n’aèrent encore que par exception.
L’habitant de la rive gauche a de quoi se plaire et se distraire d’ailleurs dans sa petite patrie.
Outre le Luxembourg pour les jours ensoleillés, il y a l’hôtel de Cluny, pour les après-midi pluvieux, les cours du Collège de France et de la Sorbonne. S’il est religieux, il dispose de Notre-Dame, Saint-Séverin, Saint-Étienne du Mont, Saint-Germain des Prés. Saint-Nicolas du Chardonnet, et, enfin, de Saint-Sulpice, qui est le centre du commerce d’imagerie et de sculpture religieuses, tout environné de séminaires, chapelles et couvents, d’une population pieuse. La politique s’agite en ce quartier, au Palais Bourbon et au Luxembourg. Les grandes écoles y ont élu domicile : le Collège de France, la Sorbonne, l’École des Chartes, l’École pratique des Hautes-Études, l’École spéciale des langues orientales, l’École coloniale, l’École polytechnique, l’École de médecine, l’École de droit, groupées autour du Panthéon, qui consacre la gloire. Une foule d’hôpitaux : Salpêtrière, Cochin, Laënnec, Val-de-Grâce, Necker, la Pitié, Ricord, fournissent asile et assistance aux malades et aux malheureux. Il y a là aussi, à l’Hôtel des Invalides, le siège du gouvernement militaire de Paris, et, non loin, l’École militaire.
La Rive droite est plus joyeuse, plus active, plus commerçante, plus avide de plaisirs, d’émotions fortes et d’argent. On y brasse les affaires ; le temple de l’Argent, la Bourse, se trouve dans ces parages. Tous les soirs, les grands boulevards : Saint-Martin, Saint-Denis, Bonne-Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, Capucines, de la Madeleine drainent les espèces sonnantes vers les magasins et cafés illuminés. Ce qui en reste court aux théâtres : Opéra, Opéra-Comique, Comédie-Française, Vaudeville, Variétés, Gymnase, Renaissance, ou aux music-halls. Par-dessus, la colline Montmartre abrite la cohue des artistes, bruyante et gaie.
La rive droite a été assainie, embellie par de considérables entreprises d’édilité ; sans parler des boulevards centraux et extérieurs, plantés d’arbres en nombre incalculable, elle s’enorgueillit des Champs-Élysées, qui conduisent au Bois de Boulogne, des Tuileries, du Louvre, de l’Opéra, et, en dehors, des Buttes-Chaumont, et du cimetière du Père-Lachaise, qui est presque un jardin, d’une foule de squares, promenades, jardins verdoyants, qui, paraît-il, donnent à Paris, quand on le voit d’un ballon, l’aspect d’une véritable forêt. La rive droite se développe sans cesse du côté de la Muette, des Batignolles, de Montmartre, de la Chapelle, de la Villette, de Belleville, menaçant même de renverser la ceinture des fortifications, et d’agglomérer, au-delà, les plaines de Neuilly, Levallois-Perret, Clichy, même Puteaux et Courbevoie, en vertu de cette marche vers l’Ouest, constatée dans toutes les capitales.
Tout cet ensemble : traversée de la Seine, rive gauche, rive droite, compose cette merveilleuse ville de Paris, si intelligente, laborieuse, accueillante, saine, embellie par l’effort des artistes et de ses administrateurs, et qui, digne de toute sympathie et affection, malgré ses tares, inséparables d’une telle masse d’hommes et de choses, mérite cette appellation de Ville Lumière, dont l’admiration universelle la salue. Elle est la résultante d’un travail plus de vingt fois séculaire, dont nous allons marquer les étapes glorieuses à travers les âges.
Paris, l’ancienne Lutetia Parisiorum, remonte à une haute antiquité. César y réunit en 52 le Concilium Galliarum ; devenue ville romaine, elle fit partie de la province lyonnaise. Les empereurs y résidèrent volontiers, entre autres Julien l’Apostat, qui l’appelait sa « chère Lutèce », Valentinien Ier, qui y passa l’hiver de 365, et Gratien, en 379.
Il subsiste encore plusieurs vestiges de la civilisation parisienne en ces temps lointains. Le 16 mars 1711, des maçons, creusant sous le chœur de Notre-Dame, découvrirent neuf pierres sculptées, revêtues d’inscriptions, et du plus haut intérêt. Deux forment un cippe ; trois autres composent l’entablement d’un autel. On y voit sculptées, en bas-reliefs, des divinités romaines, comme Vulcain, Jupiter, Castor et Pollux, et gauloises, comme Esus, Cernunnos avec deux cornes de cerf décorées d’anneaux, et le taureau triganarus qui porte trois grues sur sa croupe. Une inscription permet de dater ces précieux monuments ; sur l’un d’eux, en effet, sont inscrits ces mots :
TIB. CAESARE
AVG. JOVI OPTVMO
MAXSVMO [ ARA ] M
NAVTAE PARISIACI
PVBLICE POSIERVNT
Cet autel avait été consacré par une confrérie de Nautes ou marchands d’eau parisiens sous le règne de Tibère (14-37).
On peut le voir au musée de Cluny, où il est conservé. Ce musée est installé en partie dans l’ancien palais des Thermes de Julien, qui est peut-être dû, d’ailleurs, à Constance-Chlore. Mais on y proclama Julien empereur, en 360. Plusieurs passages du Misopogon, écrit par ce même prince, et des poésies élégantes de Venantius Fortunatus, évêque de Poitiers, et ami de sainte Radegonde, attestent la magnificence de ce palais qu’il est loisible d’admirer par soi-même en visitant ses ruines nombreuses et bien conservées. D’une charte, datée de 1218, il appert que Philippe-Auguste le donna, ainsi qu’un pressoir voisin, à son chambellan Henri. Il passa, en 1360, aux mains de Pierre de Chaslus, abbé de Cluny, qui y construisit un hôtel où résidèrent les abbés successifs de son ordre. Et c’est en 1820, que des travaux, conduits avec beaucoup d’intelligence, approprièrent en musée les bâtiments et les jardins.
Des Thermes de Julien il subsiste encore des vestiges considérables. C’est d’abord la salle des bains chauds ou tepidarium, bordée de niches en hémicycles, avec des escaliers et des réservoirs. C’est surtout la grande salle des bains froids, ou frigidarium, qui a 18 mètres de haut, et qui est large de 12 mètres et longue de 20, construite en petit appareil, si commun chez les Romains, avec des insertions de briques en longues bandes horizontales. Elle est entourée d’une piscine, de niches où aboutissaient les eaux, et d’arcades cintrées pour les communications avec les autres parties de l’édifice. Voici la description qu’en donne Guilhermy, dans son si précieux Itinéraire archéologique de Paris, qui nous a été d’un tout particulier secours : « De semblables monuments se mesurent plutôt qu’ils ne se décrivent ; ils tirent toute leur beauté du grandiose des proportions, de la régularité de l’appareil, et de l’importance de leurs dimensions. Quelque nue et dépouillée qu’elle puisse être, la salle des Thermes, sur laquelle ont déjà passé quinze siècles, commande l’admiration et le respect. On contemple avec étonnement les hautes voûtes et les voussures hardiment projetées dont les retombées ont pour consoles des poupes de navires. L’œil suit avec curiosité les archivoltes des arcades, et des niches, dont la brique et la pierre, découpées en claveaux d’une finesse charmante, composent alternativement le pourtour. Nous avions peine à croire, au premier abord, que, sous un climat humide et froid, comme le nôtre l’est une grande partie de l’année, les Romains n’eussent pas senti la nécessité de réduire les dimensions qu’ils étaient dans l’usage de donner à leurs constructions thermales de l’Italie ou de l’Orient, et que cette immense salle du palais de Paris n’eût réellement jamais eu d’autre destination. Mais la comparaison de nos thermes avec des établissements semblables, bien étudies, à Rome et ailleurs, ne laisse pas même le droit d’émettre un doute. » Les saisons, à ce moment-là, étaient peut-être plus douces, si nous en croyons un passage du Misopogon, et ce fait seul justifierait déjà la construction de thermes aussi considérables : « On appelle Lutèce [την φιλην Λευϰετιαν] la petite capitale des Parisii : elle occupe un îlot entouré de murs, dont le fleuve baigne le pied. On y entre de deux côtés par des ponts de bois… L’hiver n’y est pas rigoureux… On y a de bons vignobles et même des figuiers, moyennant le soin que l’on prend de les couvrir de paille en hiver et de les garantir de l’air. »
On a ajouté une toiture à la grande salle pour la préserver des intempéries ; l’autre est restée découverte. Une foule de monuments, découverts un peu partout dans le sol de la vieille ville, sont venus reposer au pied de ces ruines vénérables ; et un lierre très fourni, qui rampe sur les murailles, frôle les colonnes, ourle les arcatures, ajoute un charme poétique à cet ensemble si intéressant.
De l’époque gallo-romaine datent aussi les ruines d’un palais découvertes dans la cour de la Sainte-Chapelle ; d’une basilique élevée par Childebert à l’emplacement de Notre-Dame ; la magnifique tête de Vesta, en bronze, crénelée, aujourd’hui au cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale, qui fut trouvée près de Saint-Eustache ; les Arènes de la rue Monge, non loin du Jardin des Plantes, où l’on peut voir encore des sièges, des traces de vomitoires et de gradins. On sait enfin qu’il existait des cimetières près de Saint-Germain l’Auxerrois, de Saint-Germain des Prés, du faubourg Saint-Jacques, et près de l’église Saint-Pierre de Montmartre. Ce dernier monument avait été édifié au IIIe siècle sur la butte, à l’endroit où auraient été martyrisés les premiers apôtres de Paris : saint Denis, le prêtre Rustique et le diacre Eleuthère. Détruite par les Normands, il en reste quelques colonnes antiques, employées dans le nouvel édifice, reconstruit à différentes reprises en 1137, au XVIe siècle, et après la Révolution, et qui va être incessamment l’objet d’une complète restauration. On peut voir encore au porche des chapiteaux mérovingiens en marbre noir et blanc d’Aquitaine.
Après les Thermes de Julien, le monument le plus vénérable de Paris est l’église Saint-Germain des Prés. Elle s’appela d’abord Sainte-Croix et Saint-Vincent, et fut édifiée par Childebert 1er, roi de 511 à 558, au retour d’une expédition en Espagne contre le roi des Wisigoths, Amalaric (542), durant laquelle il s’était emparé de reliques à Tolède. Elles prirent place dans la nouvelle église, décorée de peintures, de lambris dorés, et de colonnes de marbre, enlevées sans doute à quelque palais antique. Saint Germain, évêque de Paris, qui avait été l’instigateur de cette œuvre, y fut inhumé en 676, et ses miracles contribuèrent à faire changer, en faveur de sa mémoire, le vocable du monument, lequel s’appela désormais Saint-Germain des Prés, parce qu’il fut construit en dehors des remparts, au milieu d’une prairie bordant la Seine. Peu de temps après, les religieux du monastère, voués d’abord à saint Antoine et saint Basile, embrassèrent la règle bénédictine.
L’abbaye jouissait d’une grande réputation ; les rois mérovingiens tenaient à honneur de s’y faire enterrer, comme plus tard leurs successeurs dans la basilique de Saint-Denis. Même le fondateur de la dynastie capétienne, Hugues Capet, en fut abbé. Mais, à cause de sa position extérieure à la ville, et malgré qu’il fût fortifié comme un château, le couvent fut la proie facile des Normands, qui le pillèrent ou l’incendièrent plusieurs fois ; et l’abbé Morard, qui tint la crosse abbatiale de 990 à 1014, eut fort à faire pour réparer tous ces désastres. Il subsiste de cette reconstruction des témoignages importants : ce sont douze magnifiques chapiteaux du XIe siècle, conservés au musée de Cluny, et qui figurent le Christ dans sa gloire, des saints, des anges, l’agneau pascal, Daniel et Samson ; peut-être même certains chapiteaux des collatéraux sont-ils aussi de ce temps ; on y voit des poissons, des sirènes, des serpents, des hippopotames, toute une ménagerie naïve et grossière, encadrée dans une flore approximative.
Sans doute, par suite du développement pris par le monastère, le chœur, au siècle suivant, devint insuffisant ; le nombre des moines s’étant accru, il fallut en augmenter les proportions : mais la nef de l’abbé Morard resta à peu près intacte. On la fit précéder d’une tour quadrangulaire, qui a été bien des fois remaniée : du XIIe siècle sont encore l’immense salle du premier étage, qui pouvait abriter les gens du couvent en cas d’alerte, et les huit baies cintrées du sommet dans leurs arcatures géminées. Le 21 avril 1163, le pape Alexandre III, sur la prière de l’abbé Hugues de Monceaux, avec l’assistance de douze cardinaux, dédia la nouvelle église : Hubald, évêque d’Ostie, et plusieurs autres évêques consacrèrent les neuf chapelles absidales.
Au XIIIe siècle surtout, de grands travaux signalèrent la prospérité de l’abbaye ; en 1227, l’abbé Eudes fait bâtir le cloître ; l’abbé Simon confie à l’architecte de la Sainte-Chapelle, Pierre de Montereau, la construction d’un magnifique réfectoire, qui était comparable pour la hardiesse et l’élégance à celui de Saint-Martin des Champs (1239-1244) ; les abbés Hugues d’Issy, et Thomas de Mauléon (1244-1255), le chargèrent aussi d’édifier la chapelle de la Vierge, derrière le maître autel. C’est en reconnaissance de ces services, que l’abbé Gérard de Moret accorda aux restes du grand imagier, en 1266, une sépulture d’élite, au chœur de cette même chapelle. En 1273 enfin, cet abbé grand constructeur, paracheva son œuvre en élevant le dortoir et la salle capitulaire.
Au XVIe siècle, le cardinal de Bourbon ajouta le palais abbatial en style de la Renaissance, avec pilastres, refends et frontons. On couvrit, plus tard, la voûte de la nef en pierres, on réédifia le transept, et on ouvrit çà et là de nombreuses et hautes fenêtres. Le porche de l’entrée principale est de la même époque, ainsi qu’une porte latérale, les croisillons et la chapelle Saint-Symphorien, que bénit saint François de Sales, en 1619. La bibliothèque, « ce sanctuaire de la science, où venaient étudier les Mabillon, les Montfaucon, les Martène, les Ruinard, les Félibien », fut détruite au commencement de la Révolution. En notre siècle, on a supprimé pour ne pas les restaurer, les deux clochers, qui accostaient le transept, rebâti la chapelle terminale, refait toutes les fondations, restauré une foule de parties de l’édifice ; et Hippolyte Flandrin a déroulé sur ses murs, en des fresques d’une haute inspiration et d’un sentiment religieux profond, les scènes de l’ancien et du nouveau testament.
Telle qu’elle existe aujourd’hui, la vieille église, où tous les âges se sont ingéniés à imprimer la marque de leur art, est plus vénérable par les souvenirs qu’elle rappelle, que par l’antiquité réelle de ses parties. Son plan est une longue croix latine avec des bras fort peu saillants ; la nef a 65 mètres de long, la voûte une hauteur de 19. Il y a des fenêtres d’un seul côté, l’autre étant bloqué par les constructions abbatiales. Plusieurs tombeaux sont remarquables, entre autres celui du roi de Pologne, Jean-Casimir Sobiezki, qui mourut, en 1672, abbé de Saint-Germain des Prés ; l’Académie française, en 1819, y a consacré des épitaphes à Boileau, Descartes, Mabillon et Montfaucon, dont les restes furent déposés dans l’église, après la suppression du musée des Petits-Augustins. L’ensemble du monument ne laisse pas de sembler disparate ; mais l’antique abbatiale reprend sa splendeur d’autrefois, quand le soleil inonde la polychromie de sa décoration, ou quand le crépuscule, à peine percé par de rares lumières, l’enténèbre de mystère et de poésie.
L’église de l’ancien prieuré de Saint-Julien le Pauvre n’est pas moins vénérable ; elle est citée par Grégoire de Tours, et, comme Saint-Germain, elle fut dévastée par les Normands. Les religieux de Sainte-Marie de Longpont la reconstruisirent dans les premières années du XIIe siècle sur un plan grandiose, puisque, pendant plus de trois cents ans, l’université y tint ses assemblées plénières, et y élut son recteur. En 1635, des vandales détruisirent une partie de sa nef, supprimèrent le portail gothique, et lui substituèrent une façade pseudo-classique du plus piteux effet. Il subsiste de l’ancien un bas-relief au-dessus d’une porte, dans la rue Galande, et qui représente saint Julien l’Hospitalier et sa femme transportant Jésus, sous la forme d’un lépreux, sur leur barque. Car saint Julien l’Hospitalier partagea la gloire du vocable de l’église avec saint Julien le Confesseur, et saint Julien le Martyr. Devenu chapelle de l’Hôtel-Dieu, le monument fut concédé, en 1889, au culte grec par l’autorité archiépiscopale.
Quand, après des détours et des chemins pénibles, on a pu pénétrer à Saint-Julien, on est frappé par l’aspect noble et austère de l’architecture. L’église est trapue, pesante, massive ; il y a trois nefs et trois absides, dirigées, comme l’a remarqué Sauvai, vers le levant d’hiver : des anciennes travées, quatre seulement ont subsisté. Les piliers sont énormes, supportant des arcades puissantes, sans aucune ornementation. Beaucoup de chapiteaux offrent à l’observateur mille remarques intéressantes : « Le plus curieux, dit Guilhermy, est placé sur le côté méridional du chœur. Des feuillages perlés l’enveloppent ; à ses angles se dressent sur les volutes quatre figures à tête de femmes, corps emplumés, ailes étendues, pattes armées de griffes. Un chapiteau presque semblable existe dans l’église de Notre-Dame, et, comme à Saint-Julien, il surmonte une colonne dans la partie méridionale du rondpoint. » Ce chapiteau est un des chefs-d’œuvre de la sculpture du Moyen Âge ; la sculpture des acanthes est très fine, l’expression des figures est calme et grave : et les ailes s’éploient à la place des volutes pour supporter le tailloir. Le maître imagier a trouvé ainsi la forme rationnelle d’un chapiteau original.
Vers la fin du XIIe siècle, la foi d’un évêque et d’un peuple tout entier fit jaillir sur le sol de la cité, à l’endroit où se dressait une basilique élevée par Childebert, Notre-Dame de Paris. L’honneur de cette idée grandiose revient à Maurice de Sully, qui administra le diocèse de 1160 à 1196. Des deux églises Saint-Étienne et Sainte-Marie, qui si longtemps avaient suffi au culte, la seconde avait été incendiée par les Normands en 857, puis rebâtie : on l’appelait nova ecclesia, et elle était préférée à sa voisine ; quand il s’agit de les réunir en une seule cathédrale, c’est elle qui donna son vocable au monument nouveau.
La première pierre fut posée en 1163 par le pape Alexandre III, comme l’atteste le récit du moine d’Auxerre ; Henri, légat, consacra en 1182 le maître-autel, peu de jours après la Pentecôte. On sait, en outre, que le patriarche de Jérusalem, Héraclius, officia pontificalement dans le chœur en 1185. Quand mourut Maurice de Sully, en 1196, l’abside était achevée et la nef très avancée.