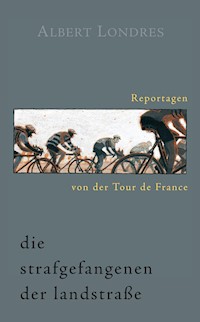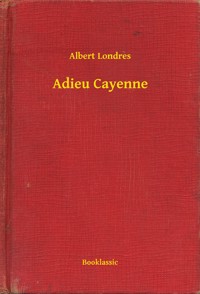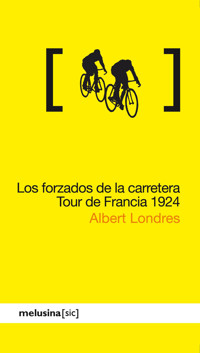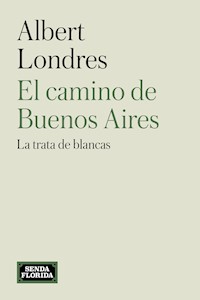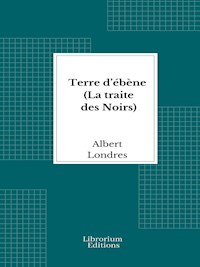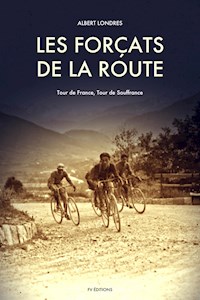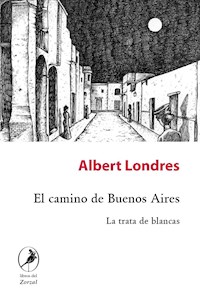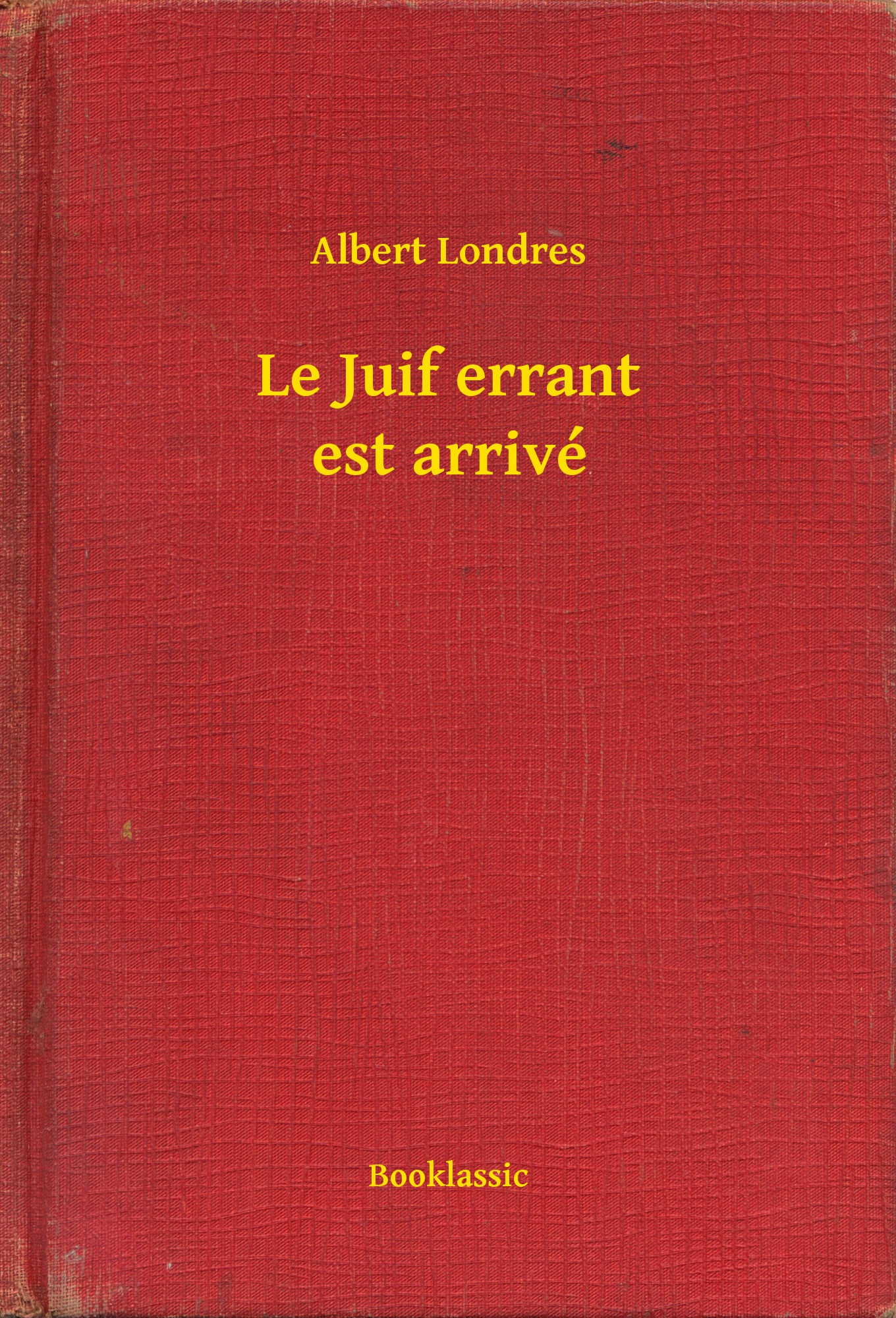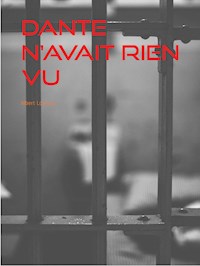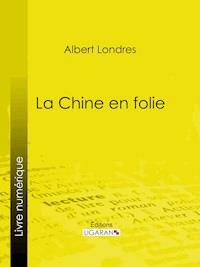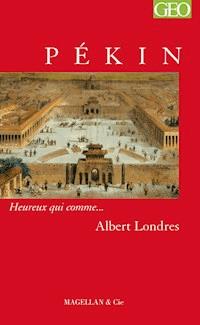
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Heureux qui comme…
- Sprache: Französisch
Partager les émotions des premiers écrivains-voyageurs et retrouver les racines d’un monde intemporel.
Dans un empire chinois livré aux guerriers, pirates et autres trafiquants, Albert Londres (1884-1932) affiche une humeur désinvolte : l’allure rapide, la réplique amusante, tout laisse entendre qu’une belle comédie se joue à Pékin, pourtant menacée par les seigneurs de la guerre.
Loin du ton mélodramatique qui prédomine dans le reportage de guerre contemporain, cette voix décalée, restée étonnamment moderne, renouvelle notre regard sur le monde.
Texte extrait de La Chine en folie, reportage publié dans l’Exelsior en 1922. (Deuxième édition)
EXTRAIT
Qui veut acheter le Palais d’Été ? Qui rêve de démolir vingt mètres de la muraille pour se construire une bicoque avec ces pierres sacrées ?
C’est à vendre.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
« Loin du ton mélodramatique, en Chine, Albert Londres n’y va pas par quatre chemins. » (Bibliomonde)
A PROPOS DE L’AUTEUR
Albert Londres nait à Vichy en 1884. Il passe son enfance à la Villa Italienne, pension de famille tenue par ses parents. Il dévore les œuvres d’Hugo et Baudelaire. Il entre au Matin. Le 1er août 1914, la guerre est déclarée. Il devient correspondant de guerre. Ses papiers font sensations, son style détonne : plutôt que de se réfugier derrière l’objectivité, il écrit à la première personne. Il raconte ce qu’il voit, ce qu’il ressent et ce qu’il sait.
Il parcourt l’Espagne, puis l’Italie, et met en évidence les bouleversements apportés par le bolchevisme et le nationalisme qui agitent les esprits en Europe. Au Proche-Orient, au Liban, en Syrie, en Égypte, il traite du problème de la domination franco-britannique. Il réussit à entrer dans la toute jeune U.R.S.S. Il enquête sans complaisance, décrit le régime naissant et raconte les souffrances du peuple. En Inde, il se fait l’écho du vent de rébellion qui souffle sur ce vaste pays encore sous domination britannique; et en Chine, il dépeint un invraisemblable chaos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PÉKIN, 1922 : DRAME OU COMÉDIE ?
Présenté par Émilie Cappella
Au début du XXe siècle, alors que la presse est le seul média de masse, apparaît un mélange d’écrivain et d’aventurier qui fournit au public des opinions variées, des sensations fortes et de l’information sérieuse : le reporter. Parmi eux, Albert Londres (1884-1932), globe-trotter emblématique, a passionné ses lecteurs entre 1914 et 1932 avec des reportages aux quatre coins du monde. Mais Albert Londres n’a pas seulement arpenté l’Inde, l’Indochine, la Palestine, les Balkans et la Chine, dénoncé les méfaits de la colonisation en Afrique, enquêté sur le bagne de Cayenne et la traite des blanches en Argentine, il a également laissé à la postérité des ouvrages devenus des modèles du genre. Référence absolue des reporters français, il a donné son nom à un prix décerné depuis sa mort aux plus grands journalistes français.
Selon la belle expression de Francis Lacassin, grand spécialiste d’Albert Londres, cet inlassable voyageur est « un observateur engagé, un poète et un redresseur de torts ». Devenu reporter à trente ans, l’ancien poète ne se réfugie jamais derrière une quelconque objectivité. Londres prend des libertés avec les règles du métier que l’on connaît aujourd’hui : il écrit à la première personne, raconte ce qu’il ressent et, passionné de théâtre, a constamment recours à des dialogues finement mis en scène. Ses reportages sont aussi maîtrisés, du point de vue des techniques narratives et du style, que des récits littéraires. C’est sans doute pourquoi ils semblent si près de la vérité.
La Chine en folie, publié en 1925, rassemble des reportages donnés à l’Excelsior en 1922. Albert Londres y dépeint un invraisemblable chaos qu’il ne surplombe jamais. C’est à peine s’il interprète ce qu’il voit, se contentant de faire jaillir le sens d’une mise en scène des situations, jouant de l’effet de surprise, du contraste et du paradoxe.
Au diapason des situations rencontrées, il adopte un ton proche des récits d’Hugo Pratt, le créateur de Corto Maltese. Dans un Empire chinois livré aux guerriers, pirates et autres trafiquants, le reporter affiche ainsi une humeur désinvolte : l’allure rapide, la réplique amusante, tout laisse entendre qu’une belle comédie se joue à Pékin, alors enjeu des seigneurs de la guerre. Ce portrait d’un personnage, par exemple, d’une légèreté enjouée : « Gaute est un caporal suédois qui est général chinois. Il vint de sa Scandinavie, voilà peu d’années, dans le bon empire du Milieu, comme vendeur de poils de cochons surfins. Il avait pensé qu’une aussi délicate marchandise serait recherchée des mandarins pour des usages que lui-même n’entrevoyait pas encore très bien. N’ayant pas fait fortune, il se fit général. Depuis, ça va. »
Quand ses collègues de Pékin l’invitent à dîner, Albert Londres prononce malgré lui un éloge de l’anarchie. Aux « malheurs » qu’il évoque, tous applaudissent et lui démontrent qu’ils n’entament en rien la prospérité du peuple chinois. Alors qu’il interroge plus tard le directeur d’un journal pékinois sur l’état du gouvernement chinois, celui-ci lui répond : « La Chine, c’est Charlot ! C’est le Charlie Chaplin du vaste écran politique. Rions, vieux compatriote ! La Russie, c’est le drame ; la Chine, c’est la farce ! » Rien ne semble donc sérieux, mais s’agit-il vraiment d’une comédie ?
Albert Londres voit les événements du côté du peuple, il décrit l’histoire telle qu’elle est vécue au quotidien. Or, pour le peuple, la menace qui pèse sur Pékin relève du tragique. Le contraste entre les Chinois et les Occidentaux apparaît clairement lors d’une fête organisée par les Européens tandis que les troupes rivales marchent sur Pékin. L’issue de leur combat décidera du sort de la capitale, mais les Européens, protégés dans leurs légations, ne craignent rien, et donnent un bal costumé pendant que la terreur accable les malheureux citoyens chinois prochainement exposés aux pilleurs assassins.
Pourtant, parce que Pékin, en 1922, est le lieu de tous les possibles, Albert Londres opte pour la comédie. Il émerveille son lecteur par son inlassable confiance en l’être humain et la présence d’esprit dont il fait preuve au beau milieu d’un champ de bataille. Rien n’est tragique encore, à moins de vouloir qu’un sort funeste s’abatte sur la ville…
Comique et tragique alternent donc dans ce récit échevelé fidèle à la tradition de « l’œil rond ». Remis à la mode par Montaigne dans ses Essais, « l’œil rond » est le regard faussement naïf d’un voyageur philosophe. Destiné à déranger nos idées reçues et nos habitudes en feignant de les ignorer, il rend les évidences étonnantes. Les reportages d’Albert Londres en Chine sont empreints de ce procédé aussi divertissant que salutaire pour l’esprit. Ainsi des quelques pages consacrées à Shanghai dans un aller-retour express pendant le séjour à Pékin. Le reporter use alors d’un humour féroce pour dénoncer le capitalisme abusif de la ville.
Loin du ton mélodramatique qui prédomine aujourd’hui dans le reportage de guerre, cette voix décalée renouvelle sans cesse notre regard sur le monde.
Extrait de La Chine en folie, publié en 1922.
PÉKIN
UNE JOURNÉE ASSEZ CURIEUSE À PÉKIN
Ma joie est sans mélange. J’ai trouvé mon Eldorado. Il est des hommes cupides qui s’en vont par le monde pour épouser des mines d’or ; d’autres, aimant la lumière, pourchassent les puits de pétrole ; des troisièmes, une lanterne entre les deux yeux, attendent vibrants, des nuits entières aux lisières émouvantes des jungles, un rendez-vous secret avec le tigre noctambule. Moi, votre petit serviteur, je cherchais le pays sans maître, la ville chimérique de l’anarchie totale. Dieu m’a comblé. Je la tiens. C’est Pékin !
Qui veut s’offrir le Temple du Ciel dont les tuiles sont si bleues que les anges s’y trompent et, croyant regagner leur demeure, passent la nuit sur ses toits ? Qui veut acheter le palais d’Été ? Qui rêve de démolir vingt mètres de la muraille pour se construire une bicoque avec ces pierres sacrées ? C’est à vendre. La plus échevelée foire d’empoigne des temps anciens et modernes est ouverte. Amateurs d’antiquités, d’enclos nationaux, de manuscrits catalogués, Rockefeller et tous les autres « rocs » du Pactole, accourez ! Voulez-vous les tombeaux des empereurs Ming ? Je vous les vends. Je vous signe même sur facture la permission de les débarquer, vingt jours après, à San Francisco. À Rothschild, j’offre le Temple des Lamas. C’est tout le Tibet. Je lui fais même un lot, je lui vends les lamas du même coup. C’est une affaire. Ces bonzes mangent peu. Que M. le baron me télégraphie si cela lui chante. Dans quarante-six jours, il a le monument, les prêtres, la crasse et les statues impudiques, franco Marseille.
Qui désire l’autel du sacrifice en marbre blanc, où les empereurs vêtus de bleu, à trois heures du matin, la seconde nuit de pleine lune, face au ciel, venaient, de leurs mains transparentes, égorger la bêlante victime ? C’est un beau morceau. Il doit peser lourd, mais on s’arrangera. Les Messageries maritimes feront trente pour cent de réduction pour le transport, je le prends sur moi. L’autel pourrait servir, par exemple, à exhiber deux mille danseuses internationales. Je propose cet achat à M. Volterra. Je suis rond en affaire : un million de dollars (le port en sus), c’est pour rien. Enlevez le colis !…
***
Entre les murailles de Pékin, l’anarchie déferle. Mais c’est une bonne fille d’anarchie. De petits coups de sabre de temps en temps, pas de terreur. Des sourires, voire des éclats de rire ! Je n’ai jamais tant ri que depuis que je suis Pékinois. Je me réveille pour rire ; à table je m’étrangle parce que je ris et, le soir, on a une peine inouïe à s’endormir tant on rit toujours ! Il y a du haschich dans l’air.
Tenez, nous allons vivre ensemble cette journée.
Huit heures du matin, le boy pénètre dans ma chambre. Je préférerais évidemment que ce fût le premier prix de beauté du concours du Journal ; mais c’est le boy ! Immédiatement, il me crie : « Tout va bien ! » Cela signifie que ni Tsang Tso-lin, mon vieux copain, ni Wou Pé Fou, ni aucun autre des vingt pirates armés n’est entré de nuit dans la capitale du Nord ; en un mot, que l’ordre règne.
– Bon ! lui dis-je, continue de ne pas t’en faire et passe-moi le Journal de Pékin.
Et je lis : « Hier après-midi, les professeurs des universités, écœurés de ne plus être payés depuis sept mois, ont gagné le ministère de l’Instruction publique et se sont emparés de la grande antichambre. Ils y ont passé la nuit, déclarant qu’ils ne partiraient que dollars en poche. Les professeurs dames avaient imité leur exemple, elles ont emporté d’assaut le propre salon du ministre par intérim où elles ont également passé la nuit. Les professeurs refusant de se retirer, le ministre a décidé de les nourrir. Des cuisiniers supplémentaires furent engagés et cinquante tables dressées, vingt-cinq pour les hommes, vingt-cinq pour les femmes. »
– Boy ! mes souliers, mon chapeau, ma canne, je vais aller voir ce ministre.
Je saute dans un rickshaw, j’arrive. Il sortait.
– Dommage ! fis-je.
– Montez avec moi.
Il allait à la présidence du Conseil remettre sa démission.
– Mais, dis-je, le président du Conseil n’est pas là. Il est en congé depuis quatre-vingt-trois jours, à Tientsin.
– Je trouverai peut-être quelqu’un, fait-il. On ne sait jamais.
Nous arrivons. Une frise de dragons arrogants rehaussait la demeure du « Premier » à la hauteur du rez-de-chaussée et, deux lions chinois de joviale humeur, assis chacun sur une fesse, grimaçant et en bronze, faisaient les honneurs de la porte. Le ministre par intérim demande le remplaçant du président. On ne l’a jamais vu. Il demande l’intermédiaire du remplaçant. On ne l’a pas vu davantage. Alors, dans un moment de décision, il remet sa démission au portier.
Il y eut alors grande palabre entre le ministre et le portier.
– Que vous disait-il ?
– Lui ? Il me conseillait de conserver le pouvoir.
Que l’on me tranche la main, les quatre doigts et le pouce, si ce que j’écris n’est pas authentique.
Dix heures. Repassons par l’hôtel. Dans le hall, je me heurte à une délégation. Ce sont des fonctionnaires du ministère des Finances. Ce ministère possédant dans une banque un dépôt de garantie de quarante mille dollars, les fonctionnaires pensèrent qu’un dépôt de garantie ne pouvait être mieux employé qu’à les garantir de la faim. Légalement, ils établirent un chèque que le gérant des deniers publics, lui-même à la dernière extrémité, contresigna sur-le-champ.
Hélas ! le chèque était bon mais la banque n’avait plus le sou ! Alors, ces messieurs venaient à l’hôtel où logeait l’un des pontes de l’établissement défaillant. Ils venaient lui faire de la musique.
Mais le ponte avait I’oreille fine. Aux premières mesures, filant par la boutique du coiffeur, il bondit dans un rickshaw.
Les affamés veillaient. Ils virent s’enfuir le banquier ; alors, chèque haut, bondissant eux aussi dans des rickshaws, criant comme des putois à qui l’on prend leur peau pour en faire une fourrure, ils lui donnèrent la chasse. Malheureusement, le vent jaune qui soufflait enveloppa bientôt l’équipe. Et le reste de l’histoire se perdit dans la poussière.
Sortons. Contre la muraille à meurtrières qui cuirasse le quartier des légations, deux personnes rient. Depuis que je suis à Pékin, je ne veux plus que l’on rie sans moi. Ils lisent une affiche imprimée en français, en anglais, en chinois :
« AVIS (je transcris textuellement). – Le ministre des Communications annonce à tous que les biens des Chemins de fer, tels que : bâtiments, rails, wagons, bateaux et matériaux divers, y compris les bons du Trésor, constituent, si peu qu’il en reste, la propriété de l’État. Après avoir ordonné, aux diverses administrations des Chemins de fer, de ne plus les vendre ni de s’en servir comme garantie pour des emprunts personnels, le ministre se fait un devoir de déclarer par le présent avis que si une administration chinoise, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, vend les biens sus-mentionnés, l’opération ne sera pas reconnue par ce dernier qui se réserve d’agir en des temps meilleurs. »
Maintenant, prenons un rickshaw et dirigeons-nous vers Chienmen, la porte de Devant. Un ancien ministre exilé, mais qui s’est administré lui-même l’amnistie, veut me faire déjeuner. Je suppose qu’il doit se cacher. En sa compagnie, voilà six mois, j’ai fait la traversée. Il me disait alors n’être pas excessivement fier de sa décision.
– Je serai forcé de prendre des précautions, répétait-il.
Nous y voici. C’est bien lui. Il ressemble un peu plus à un petit bonhomme d’ivoire. Ayant retrouvé de la bonne vieille drogue de derrière les fagots, il doit fumer quelques pipes de trop. Mais ce n’est pas mon affaire.