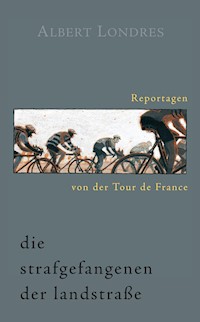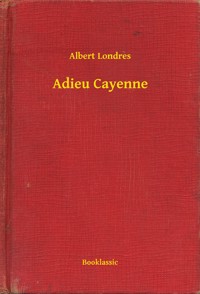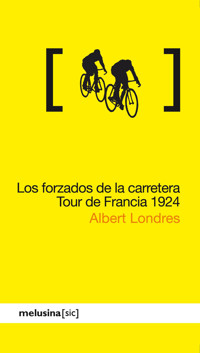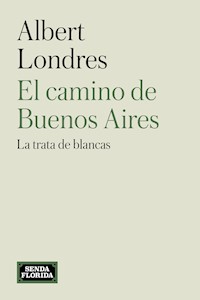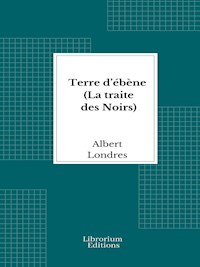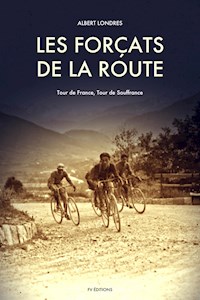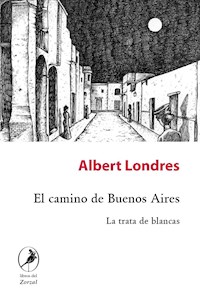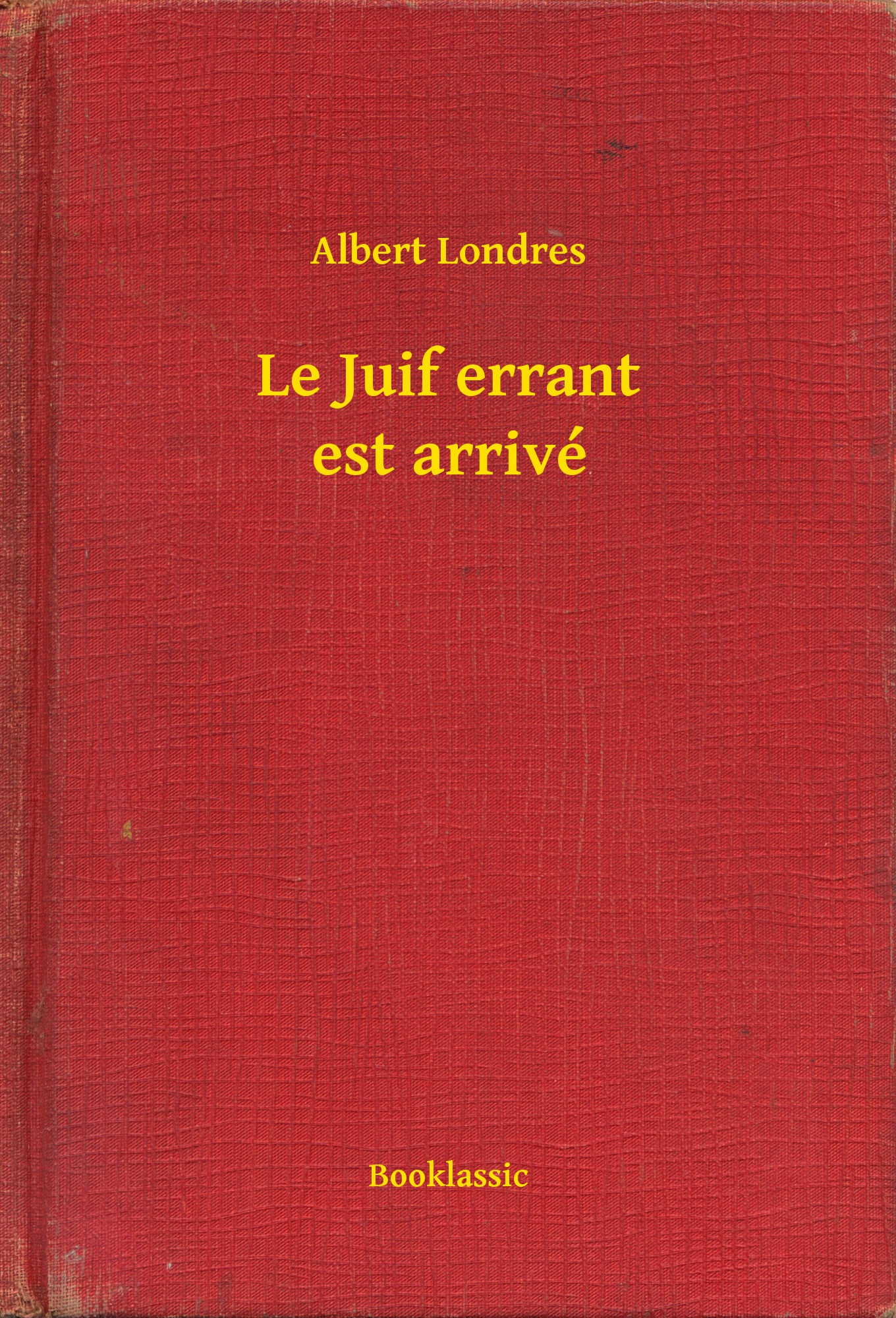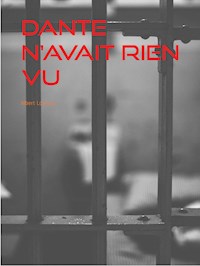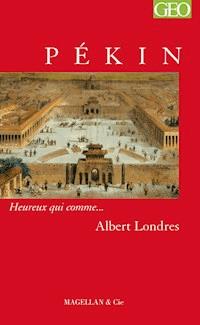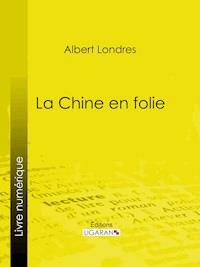
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
"La Chine en folie de Londres, écrit par Albert Londres, est un livre captivant qui nous plonge au cœur de la Chine du début du XXe siècle. À travers ses pages, l'auteur nous offre un regard unique sur ce pays fascinant, en proie à de profonds bouleversements politiques, sociaux et culturels.Albert Londres, célèbre journaliste français, nous emmène dans un voyage extraordinaire à travers les rues animées de Shanghai, les temples majestueux de Pékin et les paysages enchanteurs de la campagne chinoise. Avec une plume incisive et un sens aigu de l'observation, il nous dépeint la vie quotidienne des Chinois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs luttes pour la liberté.Mais La Chine en folie de Londres ne se contente pas de nous offrir un simple récit de voyage. L'auteur va plus loin en nous dévoilant les dessous de la politique chinoise de l'époque, les rivalités entre les différentes factions et les conséquences de l'impérialisme étranger sur le pays. Il nous livre également des témoignages poignants sur la condition des femmes chinoises, la pauvreté endémique et les injustices sociales.Ce livre, publié pour la première fois en 1922, reste d'une actualité saisissante. Albert Londres, avec son style percutant et sa vision lucide, nous offre une analyse profonde de la Chine de l'époque, mais également des clés de compréhension pour appréhender les enjeux actuels de ce pays en pleine expansion.La Chine en folie de Londres est un ouvrage incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la géopolitique et à la culture chinoise. À travers ses pages, nous découvrons un pays complexe et fascinant, à la fois traditionnel et moderne, en proie à des transformations profondes. Un livre qui nous invite à réfléchir sur les défis auxquels la Chine est confrontée aujourd'hui et sur son rôle dans le monde de demain.
Extrait : ""Le voyageur de grand chemin prend rapidement l'habitude de circuler tout à son aise parmi des millions d'individus qui lui resteront parfaitement inconnus. Il va parmi ces foules, sans plus s'occuper d'elles que le poisson de l'immensité de la mer. Quel étonnement, en revoyant sa Patrie, d'entendre les passants parler tous votre langue! Ce sont vos frères, vos sœurs. On se promène en famille!..."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
qui me mit en main le bâton de chemineau.
A.L.
… puis il y a celui qui voyage comme l’oiseau vole, parce que Dieu, à l’un donna des ailes, à l’autre l’inquiétude.
Jean-Pierre d’Aigues-Mortes n’avait pas de profession : il était envoyé spécial de journaux. Depuis des années il arpentait la terre d’un point cardinal à un autre. Aussi, pouvait-il jurer que la géographie se trompe en n’avouant que quatre points cardinaux. Certainement il y en a davantage…
Jean-Pierre était devenu ce qu’il était sans préméditation. Un jour on l’avait fait appeler dans un bureau. Là, un monsieur portant généralement le titre de rédacteur en chef et la rosette d’officier de la Légion d’honneur, et qui avait obtenu de l’administration quelque maigre crédit, pour donner « un peu plus de vie au journal », lui avait dit : « Bonjour ! Avez-vous une valise ? Oui ? Allez donc voir à Constantinople ce qui se passe. » Il partit. Il tourna trois mois dans les Balkans, puis il revint.
Le rédacteur en chef, qui avait été félicité pour l’idée, regarda le voyageur avec des yeux étonnés et lui dit : « Que faites-vous là ? Il faut repartir. » Il repartit.
Quand il eut couché dans toutes les capitales d’Europe, interviewé quatre monarques, prédit d’imminentes complications internationales, comme il ne lui restait plus une bank-note et que, d’autre part, son journal avait à fouetter d’autres chats que de répondre à ses télégrammes désespérés, Jean-Pierre retraversa l’Occident en wagon de troisième classe et reparut visiblement affamé.
– Encore vous ? lui dit le rédacteur en chef. Vous n’aviez plus d’argent ? Ce n’est pas ce que dit l’administrateur.
– Qu’est-ce qu’il dit ?
– Que vous avez déjà dû acheter une maison de campagne.
– Deux !
Il repartit. Les divers Orients virent son ombre se profiler sur leur sol. Il fut prisonnier dans Fez et toute une nuit le you-you-you des Marocaines chanta à ses oreilles la mélopée de sa mort probable.
Sur la mer Noire, alors qu’il essayait de comprendre pourquoi les Turcs qui ne valent pas cher, saignaient périodiquement les Arméniens qui ne valent pas mieux, Jean-Pierre attrapa un gracieux typhus – pour le punir de se mêler de ce qui ne le regardait pas.
« Allez donc voir à Damas ce que fait l’émir Fayçal. » Il alla à Damas alors qu’on n’y allait pas. Trois longues nuits, le club arabe discuta pour savoir ce qui, politiquement, vaudrait le mieux, ou laisser ressortir le correspondant, ou, le lendemain, plaindre à grands cris l’infidèle qui s’était allé jeter de lui-même sur le poignard d’un fanatique.
Une crapule nommée Hussein venait d’être bombardée roi du Hedjaz et cela pour le seul plaisir de la généreuse Angleterre, Jean-Pierre partit à Djeddah, afin de contempler ce roi de la Mecque.
Mais les Anglais sentirent Jean-Pierre sur la mer Rouge. Et, si tout le monde ne le sait pas déjà, que chacun l’apprenne ici : il est bien préférable pour un correspondant en voyage de curiosité de rencontrer sur son chemin une tribu de scorpions que deux gentlemen de la police anglaise.
À quelque temps de là, alors que sous le prétexte d’étudier le problème égyptien, Jean-Pierre était au Caire, se chauffant dignement les côtes au soleil de février, l’Eastern Telegraph C°, qui lui en avait fait quelques autres, lui apporta un câble réfrigérant : « Allez Moscou. »
Il alla.
À découcher dans ces proportions, une étonnante maladie avait atteint Aigues-Mortes : il ne pouvait plus contempler deux jours de suite sa figure dans la glace de la même armoire. Repassant une fois par Paris, la seule vue de son appartement le plongea dans une inguérissable mélancolie. Il vendit ses meubles qui jusqu’ici lui avaient été si fidèles. Il donna congé et, pour tromper l’attente, il élut domicile à Terminus Saint-Lazare, d’où il pouvait, de sa fenêtre, voir des taxis chargés de bagages, tandis que, par la lucarne de son cabinet de toilette, entraient les chers appels des sifflets de locomotives.
Ce fut plus tard, six mois après, qu’il reçut la révélation de la détresse des retours. En général, les gens pleurent et s’effondrent aux départs. Ce sont de faux voyageurs. Ils font partie de cette catégorie de malheureux qui mettent une semaine à boucler une malle ! C’est quand on rentre que la lèvre est amère et le cœur dans le brouillard !
Jean-Pierre revenait d’une terre méchante de l’Amérique du Sud.
Le voyageur de grand chemin prend rapidement l’habitude de circuler tout à son aise parmi des millions d’individus qui lui resteront parfaitement inconnus. Il va parmi ces foules, sans plus s’occuper d’elles que le poisson de l’immensité de la mer. Quel étonnement, en revoyant sa Patrie, d’entendre les passants parler tous votre langue ! Ce sont vos frères, vos sœurs. On se promène en famille ! Mais l’horizon se rétrécit bientôt. On dirait que les frontières bornent votre vue. Votre jugement, si libre sur les routes du monde, revêt comme un uniforme national. On a la sensation que, derrière vous, une main vous a doucement replié les ailes.
Ce soir, dans Paris retrouvé, Jean-Pierre marchait sur les boulevards extérieurs. En passant près de la bouche du métro Pigalle, il entendit crier près de lui : « l’Intran ! la Presse ! Paris-Soir ! » Il connaissait cette voix, elle parlait à ses souvenirs. Il se retourna. Il vit la même petite marchande de journaux, avec les mêmes cheveux roux, qui, à la même place, lançait les mêmes mots !
Ainsi, pendant dix-sept mois, il avait traîné son incertaine carcasse de Suez à Panama et de la polaire à la croix du sud, pourquoi ? Pour se heurter ce soir à cette créature qui, elle, n’avait pas bougé !
Jean-Pierre poursuivit son chemin. La main invisible qui conduit les hommes le mena dans une taverne que d’abord il n’avait pas reconnue.
– Eh ! bonsoir ! Aigues-Mortes ! lui dit-on, que faites-vous par ici ? Vous n’êtes donc plus en voyage ?
« Voilà la phrase, se dit Aigues-Mortes. Je la connais ! On me la répète depuis dix ans. Je n’ai plus le droit de marcher sur le sol de mon pays sans que cela paraisse louche ! »
– Quand repartez-vous ? demanda l’ami.
Le garçon apparut. C’était toujours le même garçon. Un client l’appela. Ce garçon n’avait même pas changé de nom !
– Tiens ! fit le garçon, monsieur d’Aigues-Mortes ! Quand repartez-vous ?
– Adieu ! fit l’homme errant.
Il ralliait la gare Saint-Lazare quand, à l’angle de la rue Saint-Georges et de la rue de Châteaudun, une femme l’arrêta. Il la reconnut. Celle-là non plus n’avait pas quitté son poste. Dix-sept mois auparavant, au même coin de rue, elle le saisissait ainsi par le bras.
– Quoi ? lui dit-il, tu n’es pas morte, toi non plus ?
– T’es piqué ! lui renvoya l’enfant.
Jean-Pierre gagna son Terminus. Une fois dans sa chambre, il jeta violemment son chapeau sur sa valise.
– Ah ! le Carnaval ! s’écria-t-il, quelle grande idée philanthropique ! Convier ses contemporains à changer de gueule du jour des Rois au mercredi des Cendres, voilà ce que les Italiens, à mon avis, ont fait de mieux dans l’histoire !
Le lendemain après-midi, on pouvait voir Jean-Pierre d’Aigues-Mortes, absorbé, sur l’un des trottoirs de la rue Vignon. Il regardait dans la vitrine des Messageries Maritimes la carte d’Extrême-Orient. Il parlait tout seul :
– Port-Saïd, Suez, Djibouti, Colombo. Bon ! disait-il. Penang, Singapour, Saigon. Parfait ! Haiphong, Hong Kong, Shanghai, Yokohama, voilà mon affaire !
Il avait passé sa nuit à chercher vers quelles terres il pourrait s’en aller. C’était urgent puisque sa présence en France tournait au scandale ! Les Balkans ? On compterait par kilomètres les lignes de copie qu’il écrivit sur cette question. Le bluff bolchevik ? Il l’avait déjà dénoncé. La Nouvelle Turquie ? Oui et non. L’Espagne ? Il faudrait l’assassinat d’Alphonse XIII pour redonner de l’actualité au pays.
Il envoya promener l’Europe.
Le Mexique ? La guerre des pétroliers ? Trop brûlant pour des journaux à gros tirage. La Palestine ? Le sionisme ? Que de Juifs puissants pendus au téléphone de la rédaction quand paraîtraient les articles ! La fraude de l’alcool aux États-Unis ? L’Allée du Rhum ? On le lui avait déjà refusé.
Quoi ?
Et de l’autre côté du canal ? se dit-il. L’Inde en flammes, Gandhi ? Pas mauvais ! La Chine ? La Chine et son anarchie ? La Chine, enjeu de la partie de canons qui se prépare entre le Japon et l’Amérique ? Va pour la Chine !
Et, donnant un grand coup de pied dans sa chère valise en peau de cochon :
– Réjouis-toi, ma vieille, nous allons repartir sur les grands chemins.
Donc ce lendemain après-midi, ayant tenu son petit monologue rue Vignon, Jean-Pierre pénétra dans le Hall des Messageries.
Seuls les vrais chrétiens, ceux qui tressaillent sous le porche d’une église, sont capables de comprendre l’émotion qui secoue Aigues-Mortes chaque fois qu’il franchit le seuil de Thomas Cook ou d’une compagnie quelconque de navigation.
– Quelle est la date du prochain départ pour Shanghai et Yokohama ?
– Plus de place avant cinq mois ! Tout loué !
Jean-Pierre sourit. S’il ignore beaucoup de choses, il sait qu’un correspondant trouve toujours une cabine à bord. Il sait qu’il n’est jamais resté sur un quai. Il sait, la foudre tomberait-elle tous les cinq mètres devant sa personne, un jour d’embarquement, qu’il arriverait quand même à temps et tout entier, pour gravir la coupée, ou profiter de l’échelle de corde.
Il demanda de nouveau :
– Quel jour le prochain départ ?
– Samedi.
– Salut !
On était jeudi.
Il sauta dans un taxi : « Au Grand Journal ! »
– Quand on vous revoit, monsieur d’Aigues-Mortes, lui dit le garçon de l’ascenseur, c’est que vous allez repartir.
Il entra chez le rédacteur en chef.
– J’ai une idée. Cela ne vous coûtera pas cher. Je m’arrangerai.
– Où ?
– Indes, Japon, Chine.
– Vous vous arrangerez ?
– Il paraît que là-bas les journaux du pays payent assez correctement la copie. Avancez-moi quelques billets. Vous ne ferez pas une mauvaise affaire.
– Vous partez demain ?
– Après-demain.
– Voilà un bon. Au revoir !
– À l’année prochaine !
Jean-Pierre était déjà sorti.
– Dites donc, passez chez l’administrateur. Je crois que votre assurance sur la vie ne vaut plus rien.
– Pas le temps ! Au revoir !
– Passez chez l’administrateur, vous dis-je. Ce serait le journal, ensuite, qui serait forcé de casquer. C’est déjà suffisant de vous donner de l’argent tant que vous êtes en vie !
Marseille. Jean-Pierre gagna le cap Pinède. Il monta sur le bateau. Il avait trouvé une cabine, évidemment !
– Parfait, dit-il, après avoir serré la main du barman, ami d’autres traversées, on va toujours vivre quarante-cinq jours là-dessus qui ne devront rien à personne.
Et Jean-Pierre huma le large, passionnément.
S’il voyageait, c’était comme d’autres fument l’opium ou prisent la coco. C’était son vice, à lui. Il était l’intoxiqué des sleepings et des paquebots. Et, après des années de courses inutiles à travers le monde, il pouvait affirmer que, ni le regard d’une femme intelligente, et malgré cela proprement faite, ni l’attrait d’un coffre-fort, n’avaient pour lui le charme diabolique d’un simple et rectangulaire petit billet de chemin de fer.
« Rois, ministres, officiers, gens du peuple, à bas de vos chevaux. »
À Pékin, dans l’enceinte du Palais d’hiver, face à la montagne de charbon aux cinq pics et cinq pagodons, sur une stèle millénaire, en cinq langages : mongol, mandchou, chinois, turc et tibétain, ainsi, la vieille Chine, orgueilleusement, apostrophait le passant. À vous tous qui désirez me suivre par les trouées obscures du Céleste Empire en déliquescence, hommes de peu ou de bien, traîneurs de mélancoliques savates ou abonnés de rubriques mondaines, moi, diable blanc et barbare d’Occident, du haut rickshaw qui me roule présentement sur le sol immonde et vénéré de la Chine, je crie :
– Gens du peuple, officiers, ministres, rois, bottez-vous jusqu’au-dessus du genou, armez-vous de pincettes pour prévenir le contact de toutes choses et en avant ! »
Chine : chaos, éclat de rire devant le droit de l’homme, mises à sac, rançons, viols. Un mobile : l’argent. Un but : l’or. Une adoration : la richesse.
Du bandit de deuxième classe aux plus authentiques tyrans une unique idée : diriger vers sa demeure des brouettes de sous de bronze ou des wagons craquant sous l’or. Le peuple est une punaise que les hommes en armes écrasent dès qu’il ose sortir des plinthes.
Si vous désirez rajeunir, soyez satisfaits : nous retournons sept siècles en arrière. Le territoire est livré aux grandes compagnies. Nous sommes revenus à l’époque de Du Guesclin, mais Du Guesclin n’apparaît pas !
Vingt-et-une provinces, vingt-et-un tyrans. L’un vend sa part de Chine au Japon, l’autre aux Américains. Tout est mis à l’encan : fleuves, chemins de fer, mines, temples, palais, bateaux. Pour chacun le pays est un butin. Il ne s’agit que de faire main basse dessus, alors on ouvre les enchères. Qui veut des locomotives ? Qui dit tant de dollars ? Vous ? Tokyo ? Bon ! Adjugé ! À qui les trésors des empereurs Ming, avec le marché du pétrole par-dessus le compte ? À l’Amérique ? Adjugé !
Gabelle, taxes, impôts, toutes les ressources sont pour les généraux. Si l’on en prenait un au retour d’une de ses tournées, alors que ses poches débordent et qu’on l’incinérât, ce ne serait pas de la cendre que rendrait le four mais du métal en fusion. On fondrait une cloche avec ses restes.
– Il faut bien qu’ils paient leurs soldats, ces généraux-là, direz-vous.
– Oui-da ! bon peuple de chez nous, ils paient leurs soldats par un jour de pillage, chaque mois. Quand les Chinois, par bonheur, en connaissent la date, ils se précipitent chez le toukiun (ces tyrans s’appellent toukiuns).
– Ne nous écartèle pas, nous réglerons les dépenses. Combien veux-tu ?
Les villages moins malins sont ravagés. Les dames qui ont horreur de l’imprévu dans le plaisir se jettent dans les puits pour échapper au rut déchaîné. (Que les puits sont étroits ! Qu’elles doivent avoir de petits corps !)
Dans le Maomingan, à huit cents kilomètres de Pékin, au centre de la boucle du fleuve Jaune, sur la ville d’Honrato, naguère les bandits s’abattent. Ils enlèvent des femmes. C’est généralement une marchandise de bonne rançon. Ils les soupèsent. À leurs yeux, l’une vaut cent dollars. Ce n’est pas qu’elle possède une jolie petite bouche en forme de cerise, mais le mari est riche. Hélas ! le mari n’est pas seulement riche, il est mufle aussi. Je veux dire qu’il aime autant son coffre que sa femme. Il vient trouver le chef :
– Je suis pauvre, dit-il, voilà ce que je puis faire : cinquante dollars.
– Bien ! dit le chef qui empoche, moi je suis pour la justice, avance.
Il ouvre une porte, les otages sont alignés.
– Où est ta femme ? Celle-ci ? Parfait.
De son sabre, il la coupe en deux.
– Voici ta part, quand tu rapporteras cinquante dollars, tu auras l’autre moitié.
Ailleurs, par un jour de haute débauche militaire, les notables de la ville promise au sac n’avaient rien voulu savoir. Chacun avait enterré son magot. Il fallait pourtant que la horde se payât. Le toukiun, par un ordre du jour, lui avait donné vingt-quatre heures franches de liberté pour cela. Les ravageurs envahirent les maisons, se saisirent des enfants et, par les fenêtres, les repassèrent aux copains, en bas, dans la rue, qui les recevaient sur la pointe de la baïonnette. Ainsi sortit la galette.
Ce n’est pas de la chronique du temps de Marco Polo, c’est de l’histoire contemporaine.
La Chine a perdu la tête. Par compensation, elle a deux cerveaux : Pékin au nord, Canton au sud.
Dans le Sud, un homme qui s’appelait Sut-Yat-Sen s’est assis carrément, un jour, dans un fauteuil de bois noir, au-dessus de quoi était écrit : « Présidence de la République ». Il était président de la République du Sud comme moi je suis en ce moment propriétaire de l’Hôtel de Pékin, parce que j’y occupe la chambre 518.
Sur cinq provinces, trois ne lui obéissaient pas et dans Canton, sa capitale, le tiers des forces était hors sa main.
Les trois provinces réfractaires ont pour roi un M. Tchaen-Kiong-Ning, qui crache délicatement, sur le sol, en signe de démenti, chaque fois qu’on lui dit que Sut-Yat-Sen fut son président. Il n’a pas tort. Et je le démontre.
L’ensemble des sans métiers, des chenapans, des traîne-loques et autres pouilleux formant les armées du Sud fait un total de 350 000 fusils. Sur ces 350 000 fantassins de la dèche, l’homme cracheur, Tchaen-Kiong-Ning, en possède 100 000, et l’homme qui était président de la République comme moi je suis propriétaire de l’Hôtel de Pékin, 30 000. Les 220 000 qui restent, c’est la pagaille, mercenaires de simples toukiuns, ayant plus de fusils que de cartouches, usant celles qu’ils touchent à se tirer dans les jambes, n’obéissant que pour piller, se neutralisant d’eux-mêmes, courant l’hiver après les moutons pour leur voler leur peau, et crânant l’été, les fesses à l’air. C’est le Sud.
Le Nord a pour capitale Pékin.
Au point de vue politique, Pékin est une ville dans le genre de Saint-Denis et de Sceaux : elle est supprimée.
Il est bien à Pékin un président de République qui habite un palais céleste et impérial, de l’autre côté des lacs de nénuphars, dans la ville interdite, mais je crois que c’est lui qui est interdit ! Il n’est président de la République que pour les jocrisses de mon acabit et les ministres plénipotentiaires du quartier des légations. Le seul être lui obéissant est tibétain et ce n’est pas un homme, c’est un chien !
Deux tyrans, deux super-toukiuns : Tsang-Tso-lin et Wou-Pé-Fou règnent en Chine du Nord.
Ce sont les deux Bouddhas de la guerre. Tsang-Tso-lin est au Nord, capitale Moukden. Il a 300 000 hommes et, près de lui, derrière un paravent, le Japon.
Wou-Pé-Fou est au centre, 300 000 hommes aussi. À son côté, blottie à l’ombre d’un grand dollar, se tient l’Amérique.
Le lundi, Tsang-Tso-lin, perché sur l’extrême pointe de la grande muraille, là où solennellement elle s’enfonce dans la mer, crie à Pékin, les lèvres au porte-voix :
– Chassez-moi ce ministère. Le président du Conseil me dégoûte. J’ai dit. Rompez.
Alors, le président du Conseil saute brusquement sur ses pieds, attrape un train en marche et se réfugie à Tientsin sur la concession française dont trois jours auparavant, au cours d’un magnifique mouvement oratoire, il demandait la suppression.
Le mardi, Wou-Pé-Fou, campé au milieu du grand pont du fleuve Jaune, lance tonitruant :
– Tsang-Tso-lin n’est qu’un âne, le président du Conseil restera à Pékin. J’ordonne.
Et le brillant président du Conseil, à pas de loup, rejoint, de nuit, son ministère.
Alors, Tsang-Tso-lin, de son trône, regarde Wou-Pé-Fou sur le sien :
– Prends garde, fils de chienne, dit-il, j’astique mon escopette.
Et il chantonne :
– Que les mânes de tes ancêtres rôdent insatisfaits hors de leur cercueil, lui renvoie Wou-Pé-Fou.
Et il murmure :
Tel est le pays fol où je vous emmène, compagnons d’aventures !