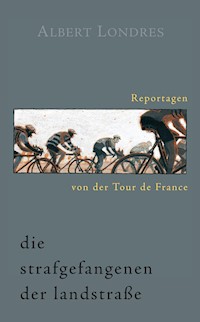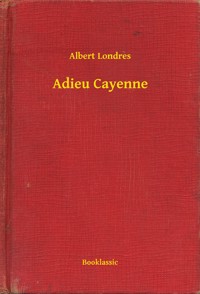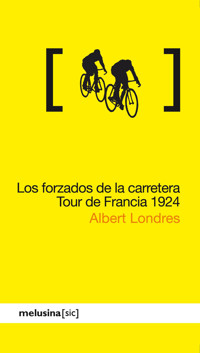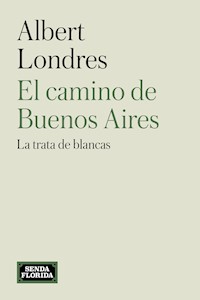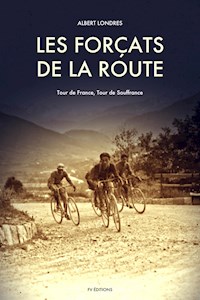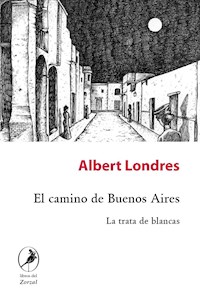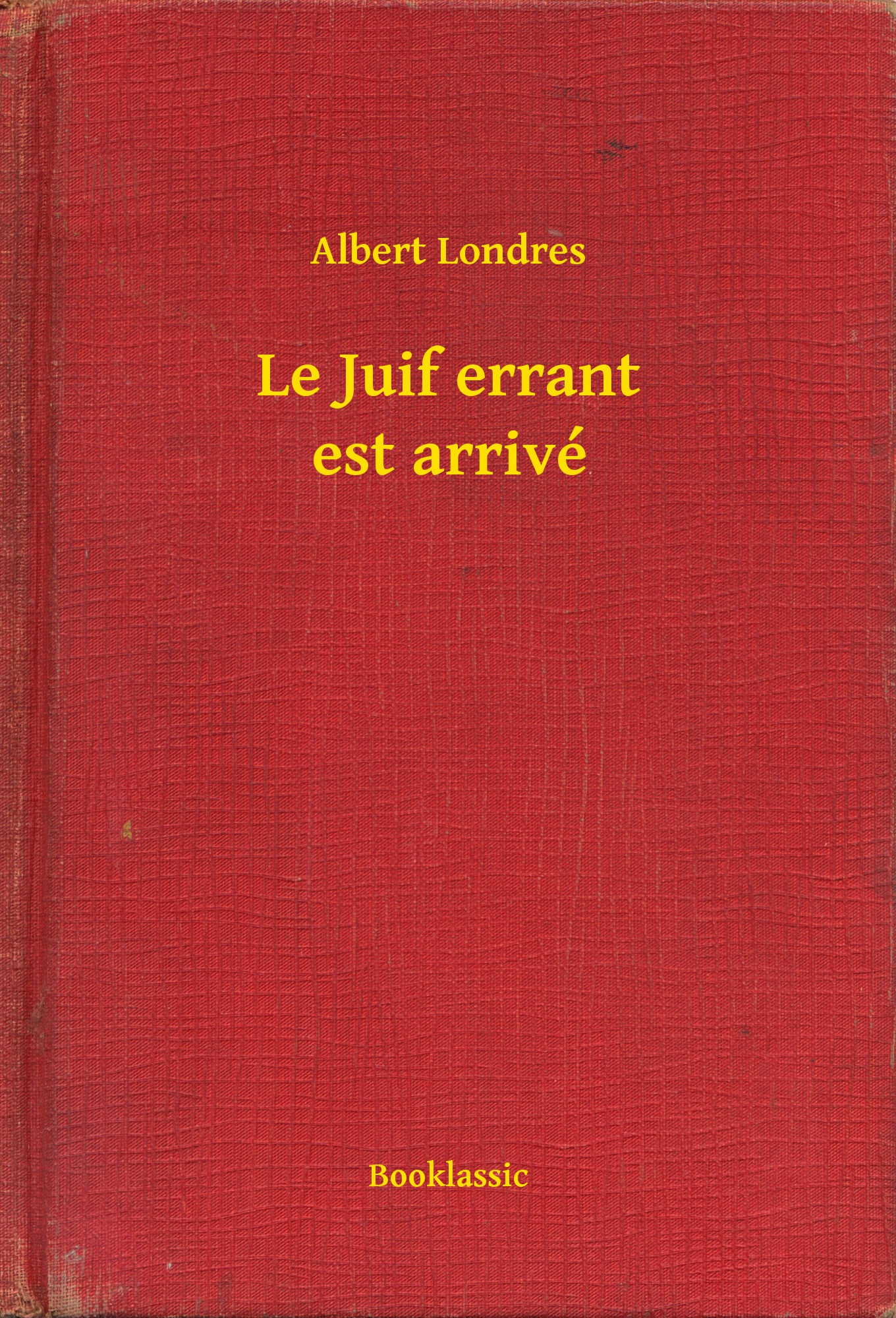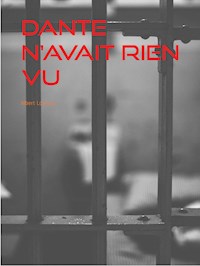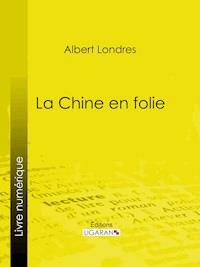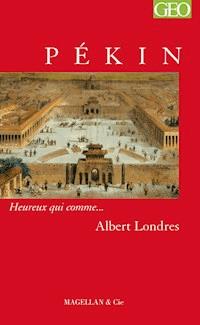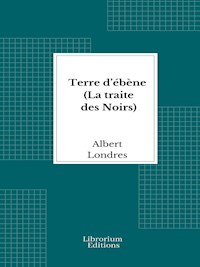
0,85 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
C’était Dakar !
Ce bloc de pierres blanches : le palais du gouverneur général.
À notre droite : Gorée, l’île où les derniers négriers embarquaient les derniers esclaves sur un bateau qui s’appelait le Rendu.
Le Rendu qui ne rendait jamais rien !
Les passagers de notre paquebot étaient déjà casqués et en blanc. Depuis le matin, chacun prenait de la quinine. On avait dit adieu aux plaisirs de bien boire, de bien manger, de respirer librement et surtout d’avoir les poils secs. Pour mon compte, j’étudiais le moyen de remplacer le mouchoir par une serviette-éponge. On aurait dit que l’on avait mis le ciel et la mer sous mica. La nature était congestionnée. C’était l’Afrique, la vraie, la maudite : l’Afrique noire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ALBERT LONDRES
TERRED’ÉBÈNE
(LA TRAITE DES NOIRS)
1929
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383834670
Voici donc un livre qui est une mauvaise action. Je n’ai plus le droit de l’ignorer. On me l’a dit. Même on me l’a redit.
On m’a également appris, à l’occasion de ce voyage en Afrique Noire, différentes autres choses : que j’étais un métis, un juif, un menteur, un saltimbanque, un bonhomme pas plus haut qu’une pomme, une canaille, un contempteur de l’œuvre française, un grippe-sous, un ramasseur de mégots, un petit persifleur, un voyou, un douteux agent d’affaires, un dingo, un ingrat, un vil feuilletoniste. Et quant au seul homme qui m’ait appelé maître, il désirait m’annoncer que j’étais plutôt chanteur qu’écrivain.
Tout ce qui porte un flambeau dans les journaux coloniaux est venu me chauffer la plante des pieds. On a lancé contre ma fugitive personne de définitives éditions spéciales. Les grands coloniaux du boulevard m’ont pourfendu de haut enbas, au nom de l’histoire, de la médecine, du politique, de l’économique, de la société, du colon, de l’or, du Niger, de la Seine et du Congo. Sous le titre : « Ceux qui ne répondront pas à Albert Londres », de rigoureux logiciens ont fait défiler dans un cadre endeuillé le nom des colons, des fonctionnaires, des commerçants morts l’année 1928 sur le territoire de l’Afrique Occidentale Française, cela afin de prouver irréfutablement au pays que j’avais le nez au milieu du front, le cœur dans un bocal de vitriol, la langue chargée de mauvaise foi et que tout allait bien là-bas ! Des lettres apportées par les derniers courriers m’annoncent la formation, en Haute-Volta, d’une nouvelle croisade. Des hommes se lèvent de toutes parts au cri de : La routine le veut ! et s’apprêtent à marcher, non plus contre les musulmans, mais contre l’Iroquois, chacun se disputant l’honneur d’être le premier à lui casser congrument la figure. En attendant et pour me faire prendre patience, on traîne mes quatre-vingt-deux kilogrammes devant les tribunaux.
Cela n’est rien.
Rien.
Les journaux coloniaux n’inondent pas le pays, ils imbibent seulement leurs abonnés. Était-ce suffisant pour créer un irrésistible courant ? Pas toutà fait. Or les chevaliers attitrés de la colonisation ont besoin de promener un cadavre sous les yeux du peuple de France, un cadavre qui appellera les justes imprécations de l’initié et les pierres vengeresses du populaire. Ce cadavre est choisi. Horreur ! c’est le mien !
Je m’en irai, ainsi, au gré du flot berceur, mon pauvre cher petit corps ligoté sur une planche de liège, la main droite coupée, coupable d’avoir écrit, les pieds carbonisés et mon dernier chapitre (auparavant, sous la menace, j’aurai dévoré tous les autres), fleurissant entre mes dents comme une fleur vénéneuse.
Le gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française a décidé la chose.
Il vient d’inviter douze journalistes et douze parlementaires, dans l’espoir que ces vingt-quatre personnes constateront que ceux qui, jusqu’ici, m’avaient pris pour un homme et non pour un âne, feraient bien de se rendre compte qu’ils n’ont aucune capacité quand il s’agit de distinguer la race humaine de la faune domestique.
À l’heure qu’il est, heure fatale, ces missionnaires débarquent à Dakar.
M. le ministre des Colonies y arrive aussi.
Que la terre d’ébène soit clémente à eux tous.
Pour moi, je n’ai plus que peu de choses à dire,et c’est ceci : je ne retranche rien au récit qui me valut tant de noms de baptême ; au contraire, la conscience bien au calme, j’y ajoute. Ce livre en fera foi.
D’autre part, je demeure convaincu qu’un journaliste n’est pas un enfant de chœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de roses.
Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie.
En Afrique noire Française il existe une plaie. Cette plaie, donnons-lui son nom, c’est : l’indifférence devant les problèmes à résoudre. Et cela conduit à des catastrophes. À qui la faute ? La faute en est moins à la colonie qu’à la métropole.
Quand votre ampoule électrique s’éteint dans votre chambre, vous ne vous en prenez pas à l’ampoule, mais au secteur.
Le secteur des colonies françaises, c’est la France.
Eh bien ! si le courant n’est pas très fort entre la France et Dakar, il est coupé entre cette même France et Brazzaville.
Ce n’est pas les hommes que je dénonce, mais la méthode. Nous travaillons dans un tunnel.Ni argent, ni plan général, ni idée claire. Nous faisons de la civilisation à tâtons.
Aussi, des nègres s’exilent, d’autres meurent. La révolte se lève dans l’Oubangui-Chari. Pendant qu’on l’étouffe, le ministère des Colonies fait dire qu’il est optimiste et qu’il ne croit pas à ces choses.
Et la France est heureuse d’être trompée.
Que pouvait-on jeter sur un tel tableau ?
Un voile ou un peu de lumière.
À d’autres le voile !
Albert Londres.
IC’ÉTAIT DAKAR
C’était Dakar !
Ce bloc de pierres blanches : le palais du gouverneur général.
À notre droite : Gorée, l’île où les derniers négriers embarquaient les derniers esclaves sur un bateau qui s’appelait le Rendu.
Le Rendu qui ne rendait jamais rien !
Les passagers de notre paquebot étaient déjà casqués et en blanc. Depuis le matin, chacun prenait de la quinine. On avait dit adieu aux plaisirs de bien boire, de bien manger, de respirer librement et surtout d’avoir les poils secs. Pour mon compte, j’étudiais le moyen de remplacer le mouchoir par une serviette-éponge. On aurait dit que l’on avait mis le ciel et la mer sous mica. La nature était congestionnée. C’était l’Afrique, la vraie, la maudite : l’Afrique noire.
Le quai des Chargeurs-Réunis nous attendait. Le Belle-Île accosta.
— Restez avec nous, fit le commandant. Là c’est le pays du Diable !
J’avais touché Dakar dans le temps. Je me rappelais, c’était la nuit, pendant le dur mois de septembre. La chaleur montait du sol, sortait des murs, tombait du ciel. Le voyageur connaissait les sensations du pain que l’on enfourne. La ville était comme imbibée d’une oppressante tristesse. J’allais alors au hasard, sans espérer m’égarer, sentant bien que ce n’était pas grand. Dakar, porte de notre empire noir ! Qu’y avait-il derrière ? De ce premier contact, deux souvenirs : les airs de phonographe qui rôdaient dans les rues du quartier administratif, airs européens traînant comme des exilés dans un pays où ils se sentaient perdus ; et, plus bas, dans la salle à manger d’un hôtel dit Métropole, une centaine de blancs plus jeunes que vieux, sans veste, sans gilet, chemise ouverte sur poitrine nue et soulevant d’une fourchette lourde un morceau de bidoche qui ne les tentait guère. Les colons !
Deux autres fois je n’avais pu toucher Dakar. C’était défendu. Dakar était pestiférée. Les bateaux la fuyaient à toute machine, filant de Madère ou des Canaries directement sur Pernambouc ou Rio de Janeiro. C’était au temps de la fièvre jaune.
Joli temps ! Belle fièvre !
Cela n’empêcha pas la France de dormir. Qui l’a su ? Cependant…
« Venez donc, me disait une lettre trouvée au retour d’un voyage, venez voir un peu ce qui se passe à Dakar. Nous en sommes au cent vingt-huitième mort (des blancs). Pourvu qu’on ne dise rien, on peut trépasser. Nous vous réservons une cage dans notre maison… Venez. »
Le cauchemar dura cinq mois. Un mort et demi par jour ! Les femmes, les enfants étaient partis. Il ne restait que les hommes, ce qui était bien juste ! Le prêtre qui enterrait le matin était enterré le lendemain — civilement ! Au cent cinquantième cadavre, d’éminents médecins débarquèrent de Paris, un appareil antimoustique en bandoulière. Il faut savoir que la fièvre jaune provient d’un moustique appelé stegomia. On ne pouvait demander au moustique qui vous piquait s’il était un stegomia. Ça ne parle pas, ces animaux-là ! Voyez la tête du colon chaque fois qu’il se grattait, c’est-à-dire tout le jour et toute la nuit !
On édicta des mesures. Portes et fenêtres seraient grillagées. On ne mangerait, on ne dormirait plus que dans une cage. À partir de six heures, tout le monde serait chez soi, ou bien l’on sortirait botté, crispins aux gants et coiffé d’une cagoule.
On vit cela.
Dakar fut hantée de fantômes, gantés et cagoulés. En n’oubliant pas qu’il faisait tout de suite, la nuit venue, un peu plus chaud que dans la journée, vous aurez une idée de la satisfaction que les promeneurs éprouvaient à goûter, ainsi vêtus, la fraîcheur du soir.
Cent quatre-vingt-dix-sept morts, dit l’administration.
— Plus de trois cents, renvoient les colons.
La vérité est sous terre.
Six heures ! on accroche la passerelle au bateau. Les fonctionnaires coloniaux sentent une angoisse les pincer au cœur. Ils ne savent où ils vont, en effet, ces gens-là. Sont-ils pour le Dahomey, la Guinée, le Soudan, la Côte d’Ivoire, le Togo, la Haute-Volta, le Niger ? Leur voyage est-il achevé ? En ont-ils encore pour dix, vingt ou trente jours, en auto, en chaland, en tipoye ? On va venir afficher leur sort dans le couloir.
On l’affiche. Les voici rassemblés autour de la feuille de papier signée : « Carde, gouverneur général. » Exclamations ! Protestations ! Nez ! On entend des mots mal élevés. Une femme jure qu’elle n’accompagnera pas son mari à Zinder. Ce lieutenant qui avait demandé Tombouctou et nous avait montré son équipement de méhariste, on l’envoie sur la Côte ! Celui qui comptait rester sur la Côte ira au Sahara. Ce couple qui a fait dix ans dans les pays humides, autour des lagunes d’Abidjan, est expédié dans un pays sec, à Ouagadougou !
— J’en mourrai, déclare le mari, mon épouse aussi. Carde veut notre peau, qu’il la prenne tout de suite ! La voilà, dit-il au représentant du proconsul, apportez-la-lui dès ce soir. Il en fera des souliers pour sa femme.
L’épouse ne veut pas donner sa peau pour faire des souliers à Mme Carde.
— Prenez ! prenez-les donc ! continue de crier l’homme qui n’aime pas les pays secs ; après il y aura nos os, ce sera pour son cabot !
Cela, c’est la faute de la plaque tournante.
La plaque tournante fut inventée par M. Carde.
Jadis les fonctionnaires coloniaux faisaient leur temps dans la même colonie. Aujourd’hui, le maître les force à valser. Ils n’aiment pas cette danse. Qui dit fonctionnaire colonial ne veut plus dire esprit aventureux. La carrière s’est dangereusement embourgeoisée. Finis les enthousiasmes du début, la colonisation romantique, les risques recherchés, la case dans la brousse, la conquête de l’âme nègre, la petite mousso ! On s’embarque maintenant avec sa femme, ses enfants et sa belle-mère. C’est la colonie en bigoudis !
Débarquons.
— Hep ! Hep ! Un porteur !
— Un porteur ? me répond un compagnon, vous avez la folie de l’aristocratie. Les nègres ne portent pas au Sénégal, monsieur, ils votent.
Descendant l’échelle, il murmurait :
— Ils votent ! Ils votent ! et bientôt ils danseront la gavotte !
Adieu, Belle-Île ! Va à Buenos-Aires charger tes viandes frigorifiées. Adieu, commandant Rousselet, cher vieux loup, si c’est ici le pays du Diable, on le verra bien ! Et me voici près de la passerelle. Je m’arrête. On ne peut la franchir. Un blanc et un noir y jouent de la savate.
— Ti frappes ? dit le noir. Ah ! ti frappes ? Ici c’est pas France, c’est Sénégal, toi comprendre ? Sénégal, mon patrie, ici, chez moi, toi comprendre ?
Le nègre avait été surpris examinant d’un peu près l’intérieur d’une cabine. Le garçon l’avait reconduit plutôt avec ses pieds qu’avec ses mains.
— Ici, répond le garçon, c’est la France, et si tu remontes…, et il lui indique sa chaussure.
— Toi, si ti descends, moi conduire toi chez commissaire, toi comprendre ? Ici Sénégal, hein ? pas France !
Et il crache comme pour noyer d’un même coup le garçon, le bateau, tous les blancs et leur saint-frusquin dans une immensité de mépris.
Il fait toujours noir quand je débarque dans ce pays nègre. C’est encore la nuit cette fois-ci. Appuyée à la grille du port, une vieille Ouolof fume sa pipe.
— Bonsoir ! lui dis-je.
— Him ! Him ! répond-elle.
Ce fut le seul salut de la terre d’ébène.
Et j’allai dans la ville.
Tiens ! la nouvelle poste est achevée. Ce n’est pas dommage ! L’autre était si dégoûtante que l’on n’osait lécher les timbres qu’elle vendait. Mais que tout est lugubre ! Quoi ? plus de terrasses devant les cafés, ces bonnes vieilles terrasses, images de la Patrie, et que la France exporte précieusement dans toutes ses colonies ? Que se passe-t-il ? Il y a que les mesures contre la fièvre jaune ne sont pas encore levées. Le stegomia se porterait-il toujours gaillardement ? Où est ma pompe contre les moustiques ? Je devrais l’avoir dans les mains et me faire précéder d’un nuage protecteur. La pompe est restée chez le marchand. Si ma mère savait cela ! Il est vrai que ces bestioles aiment surtout le sang pur et frais. Or…
Dakar n’est plus qu’une immense cage. Les restaurants sont derrière des toiles métalliques. Les personnes aux fenêtres, s’imaginant prendre l’air, sont, elles aussi, derrière des toiles métalliques. Ces deux colons buvant l’apéritif se prélassent au centre d’un vaste garde-manger planté dans un jardin. Une ménagère prévoyante a dû les mettre à l’abri des chats et des mouches, pour les faire cuire demain matin ! Ahuri, je les regarde ; alors ils font :
— Eh bien ! tu débarques ?
Je reprends mon chemin.
Sur le sol, j’entends mes pas qui frappent… qui frappent à la porte de l’Afrique.
II« MON PIED LA ROUTE »
Le train du Soudan part tous les mardis. Alors les bateaux s’arrangent pour arriver le mercredi !
C’est bien. Cela vous met tout de suite au pas.
Il n’est pas recommandé, en effet, de débarquer en Afrique crachant le feu, le diable au corps et des fourmis dans les jambes.
Ce pays n’aime pas que chez lui on fasse le malin. Autrement il vous envoie tout de suite son gendarme. C’est le soleil.
Le soleil paraît. Il frappe sur votre nuque et vous dit : « Veux-tu rentrer chez toi et marcher plus lentement. »
Vous pouvez lui désobéir une première fois ; peut-être ne dira-t-il rien, étant bien au-dessus de nous !
Mais si vous êtes incorrigible, que vous le dérangiez trop souvent, il viendra avec son bâton, un gros bambou, et vous en assénera un coup retentissant sur le crâne. Vous serez bien avancé !
Six jours avaient passé. Le voyage noir commençait. J’allais prendre mon pied la route, comme disent les nègres, ce qui signifie partir. Ce serait le Sénégal, la Guinée, le Soudan, la Haute-Volta, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Dahomey, le Gabon, le Congo. Après Dakar, Tombouctou ! Je cherche à vous lancer des noms connus : Ouagadougou ! La brousse ! la forêt, les coupeurs de bois, les chercheurs d’or, les poseurs de rails. Ah ! les poseurs de rails ! Les grands fleuves que l’on ne finit plus de remonter, les maisons de boue qui sont bien les plus vastes fabriques de chaleur en conserve signalées jusqu’à cette date. Ce serait de l’auto, du chaland, du chemin de fer, du cheval, du chameau, de la pirogue, du Decauville, du tipoye. L’empire noir de la République. Ses sujets, ses maîtres. Le pays inconnu des habillés de blanc et des humains tout nus. Ce serait…
Soudain quelqu’un me demanda :
— Avez-vous de la vaisselle ? du mobilier ? Combien de caisses ?
J’étais sur le quai de la gare, à Dakar.
— Combien de caisses ? Dix ? Vingt ? Trente ? Quarante ? Je dois le savoir pour le nombre de fourgons.
— Moi, dis-je, j’ai une valise.
— Une valise ? Où allez-vous ?
— Partout !
L’employé blanc du trafic tourna le dos, haussant les épaules.
Il est donc des gens qui voyagent avec quarante caisses ? S’il en est et qu’ils ne soient pas décorés de l’ordre de la voie ferrée, le ministre des Travaux Publics est un grand négligent !
L’employé avait dit vrai.
Les voyageurs arrivaient avec tant de colis que tous avaient l’air d’épiciers en gros qui déménageaient !
Viandes, légumes, poissons, fruits, tout ce que l’industrie moderne a su mettre en boîte. Lingerie, literie, bois de lit, cela suivait depuis la France pour aller se faire manger dans un poste de brousse, les victuailles par les broussards, le mobilier par les termites.
Un beau noir me précédait au guichet. Un électeur de Blaise. Ainsi ses frères appellent-ils M. Diagne. L’électeur était coiffé d’un chapeau dit melon et qui avait dû servir une quinzaine d’années, comme objet d’expérience, à ces camelots de rues barrées, vendeurs de savons qui détachent !
— Donne-moi un billet, dit-il au guichetier.
— Pour où ?
— Tiens ! donne-m’en pour cinquante francs.
La traite des arachides terminée, les Sénégalais ont un peu d’argent ; alors ils vont se promener.
Ils ne vont ni à Thiès, ni à Saint-Louis, ni à Kayes. Ils vont jusqu’à cinquante, quatre-vingts, cent francs, suivant leur fortune. Aux arrêts on les voit à la portière criant : « Bonjou Mamadou ! Bonjou, Galandou ! Bonjou, Bakari ! Bonjou, Gamba ! » Ils se montrent à leur connaissance dans la noble situation de voyageur. Ils sont fiers. Après, ils reviennent — à pied !
Le train démarra. Il allait courir sur douze cents kilomètres de voie. Il joint l’Atlantique au Niger. Puis il s’arrête. Les routes ou le fleuve feront le reste. Douze cents kilomètres ! Le plus grand des travaux que nous ayons accomplis en Afrique noire. Pour celui qui tiendrait à ne pas être ingrat, saluer ce chemin ne serait pas un geste suffisant, il faudrait emporter une caisse d’immortelles avec soi (quand on a quarante caisses !…) et semer sur le parcours ces fleurs séchées. On serait sûr, de la sorte, d’honorer, à chaque traverse, la mémoire d’un nègre tombé pour la civilisation.
On ne peut dire que le Sénégal ressemble à un jardin botanique : il n’a qu’un arbre. C’est le baobab. Le baobab est un géant désespéré. Il est manchot et tortu. Il tend ses moignons face au ciel, comme pour en appeler au Créateur de la méchanceté des bourreaux qui l’ont crucifié. On sent qu’il pousserait des cris déchirants s’il avait la parole et qu’il ferait des gestes de détresse si la nature lui avait donné le don du mouvement. Il se plaindrait d’avoir une telle dégaine et des bras comme les culs-de-jatte ont des jambes !
— Oui ! oui ! regardez bien ! C’est tout ce que nous avons comme ombrage. Vous en restez bouche ouverte. Il faudra la fermer. Ce paysage ne changera pas pendant six cents kilomètres. Votre mâchoire se fatiguerait à la longue. Dans un pays où nous aurions besoin d’ombre, voilà ce qu’on nous donne ! Mais je me présente : Jean Miette, conducteur de travaux publics, seize ans de colonie, plus un cheveu sur la tête, pas une seule saison à Vichy. J’étais le plus beau foie de la Côte d’Ivoire. Ça ne va pas durer. Carde veut mon foie : il m’affecte au Soudan, où l’on ne sue jamais. Il a décidé la chose un matin, dans son palais en pâtisserie. Il a dit : « Miette ne suera plus ! » Je suis discipliné. Je ne suerai plus, voilà tout !
Il ne cessait de s’éponger.
— Et mon foie, deviendra comme un caillou, ce qui fera deux cailloux avec celui que j’ai sous mon casque. N’avez-vous pas soif ?
On avait dépassé Rufisque, Thiès, Bambey, Diourbel. Aux stations, les indigènes vociféraient à la portière de leurs compartiments spéciaux. Ils connaissaient tout le monde, ils appelaient chacun.
— Bonjou, Molobali !
— Bonjou, Suliman !
— Bonjou, Koukouli !
— Bonjou, Poincaré !
Il y a beaucoup de Poincaré. Il y a des Herriot, des Kodak, des Citroën, des Painlevé, des Urodonal, noms que l’on voit écrits en grosses lettres sur les journaux de France !
— Bonjou, Samaritaine !
Les dioulas (colporteurs) leur vendent des noix de kola. Le noir mange des noix de kola comme nous du pain. Il s’en nourrit. Cela lui détraque le cœur. Il en meurt. Voilà vingt Sénégalais qui s’apprêtent à participer au grand mystère de la traction à vapeur : qui vont prendre le train. Ils montent à l’assaut du wagon. C’est une charge irrésistible. Ceux qui détiennent les places les reçoivent, arc-boutés, et les renvoient sur le quai les quatre fers en l’air. En proie à la colère, les vaincus lancent leurs baluchons dans le compartiment. Les voyageurs qui sont assommés ne bougent plus. Les autres jurent par tous les sorciers. Un sombre pugilat sort de là. Un blanc arrive et tape dans le tas. Tout va bien si celui qui reçoit les coups n’est pas un électeur. Autrement, la grande scène du défi commence :
— Ti m’as frappé ? Ti m’as ansourté (insulté) ?
— Ton gueule !
— Mon gueule vaut ton gueule ! Moi Français comme toi !
Et l’électeur cherche des témoins.
— Ti paieras vingt-cinq francs ! qu’il crie au blanc. Vingt-cinq francs !
— Approche-toi, renvoie le blanc, que j’en prenne pour cinquante francs.
Un blanc qui frappe un noir a vingt-cinq francs d’amende, mais il faut des témoins.
Le train repart. Le noir s’accroche à la rampe du marchepied.
— Ji reviendrai ! Ti seras condamné ! À rivoir (Au revoir) ! Ah ! ah ! À rivoir !
Il y a dans ce train un jeune homme qui débute dans la carrière coloniale. Il ne se sent pas d’aplomb sur la terre d’Afrique. Sa ville natale ferait beaucoup mieux son affaire. La vocation lui manque. Il montre la photographie de sa femme à tout le monde.
— Voilà maintenant comment on nous les envoie, fait M. Miette. Ou ça traîne toute sa famille derrière soi ou ça pleure sur une photographie ! Rentrez votre bout de carton, mon petit gars ! C’est un mauvais fétiche pour débuter. Il faut être sevré quand on choisit cette carrière. Vous ne pourrez prendre le métro pour aller dîner chez maman ce soir ni acheter la troisième édition de l’Intran, c’est entendu, mais ce sera autant d’économie !
Il y a le père Levreau, un vieux broussard. Vingt et un ans de Soudan. Il revient de France pour la deuxième fois seulement. Il n’aime que Kayes.
— D’ailleurs, explique-t-il, Kayes est l’une des trois villes les plus chaudes du monde. Podor, Djibouti et Kayes, c’est bien connu, il ne faut pas sortir de là. Partout où j’irais je déchoirais.
Le lendemain, à midi — dans la ville la plus chaude du monde, le train arrive à midi ! — le père Levreau débarqua à Kayes.
Ses six femmes l’attendaient sur le quai, six femmes noires dont deux Mauresques aux grands yeux de chamelle.
— Bonjour, mes chéries ! disait-il. Bonjour ! Bonjour !
Elles se précipitaient dans ses bras.
— Bonjou, papa ! répondaient-elles ! Ah ! papa ! Bonjou !
Serviteurs et servantes, derrière eux, battaient des mains. Il était fringant, piaffant.
À l’intérieur de la gare, le thermomètre marquait quarante-six !
IIILES TOUT NUS
Vingt millions de noirs, sujets français.
Deux empires.
L’Afrique Occidentale Française : A. O. F.
L’Afrique Équatoriale Française : A. E. F.
L’Aof ! et l’Aef !
Treize millions de sujets en Aof. Quatre millions en Aef.
Togo et Cameroun font le reste.
Les Allemands ont perdu ces deux terres pendant la guerre. Par hasard, plutôt que par pudeur, les Anglais ne les ont pas raflées.
Alors elles nous sont revenues.
Huit colonies en Aof : Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Soudan, Niger.
Quatre en Aef : Gabon, Moyen Congo, Oubangui-Chari, Tchad.
L’Aof va de l’Atlantique au lac Tchad pour la largeur, et du Sahara au golfe de Guinée pour la hauteur. C’est un territoire de cinq millions de kilomètres carrés.
L’Aef commence à l’équateur et se termine au diable noir, mangeant le cœur de l’Afrique.
Il y a de quoi se promener !
Les historiens disent du pays qu’il se présente en forme d’auge. Le mot chaudron lui irait mieux.
On y mijote. On y est sur le gaz comme un morceau de gîte à la noix dans son pot-au-feu. Le diable peut venir vous tâter du bout de sa fourche, on n’est jamais assez cuit ! On cuit le jour, on cuit la nuit. En sortant de là, on pourra toujours se mettre dans une presse à viande, ce n’est pas le sang que l’on rendra qui fortifiera les anémiques !
De quoi se plaint-on ? L’Afrique ne prend personne de force. Aucune sirène, sur ses côtes, ne vous appelle. Pas de ports naturels et la barre vous repousse. Les piroguiers ont beau chanter :
C’est nous les forts garçonsLes maîtres de la barre,Avançons, avançons…
La pirogue recule.
Faisons aller nos brasOn l’aura, on l’aura,À l’aide nos fétiches !
Ah ! la barre s’en fiche ! Elle chasse les hommes qui veulent aborder. S’ils insistent, elle les renverse. Ainsi se tient l’Afrique sur le seuil de sa porte pour recevoir ses visiteurs.
Nous avons laissé le Sénégal, colonie aux urnes, royaume de Blaise, les dix mille citoyens des quatre communes de plein exercice, exercice de prestidigitation, de boxe et de savate ! Voici les noirs, les vrais, les purs, non les enfants du suffrage universel, mais ceux du vieux Cham. Comme ils sont gentils ! Ils accourent de leur brousse pour vous dire Bonjou ! Ils agitent leurs bras avec tant de sincérité, un sourire vernit si bien leur visage que c’est à croire que nous leur faisons plaisir à voir. Ils vous regardent comme si dans le temps ils avaient été des chiens à qui vous auriez donné du sucre. Parmi eux, on se sent une espèce de bon Dieu en balade.
Leurs villages ne sont pas les uns sur les autres. Ils apparaissent clairsemés dans le grand continent. De petits tas par-ci et par-là, avec des centaines de kilomètres entre le ci et le là ! Le noir est un peuple qui ne pousse plus.
Hommes et femmes se tiennent tout nus avec infiniment de pudeur. Des femmes, parfois, croisent leurs bras sur leur poitrine quand vous les rencontrez, mais ce sont les vieilles !
Ils vont leur « pied la route ». Où vont-ils toujours en marche ? Loin. Très loin. Un voyage d’une semaine n’est pour eux qu’une affaire très ordinaire.
Ils marchent comme nous respirons.
Les hommes marchent, les femmes marchent, les enfants marchent, d’une jambe courageuse, d’un cœur sans détour. Toute l’Afrique marche au lever du jour : Dioulas (colporteurs) qui descendent du sel de Tombouctou et qui remontent des noix de kola de la Gold Coast. Naïfs qui traversent le Soudan de bout en bout pour une affaire d’héritage, une affaire de femme, mais surtout une affaire de rien du tout. Village qui s’en va sur les pieds de ses mâles, de leurs épouses et progénitures, porter le coton au commandant. En mouvement depuis deux jours, le village s’arrêtera demain matin. Ceux dont le coton ne sera pas bien trié iront à la boîte. Tous marchent, leur sac de trente kilos sur la tête, sans grogner jamais, ni penser à mal.
Voici sept prisonniers, en file indienne, liés par une corde qui leur tient au cou. Ces sept têtes semblent sept gros nœuds faits à cette corde. Je saurai plus tard qu’un tirailleur les accompagne, bien plus tard, le tirailleur étant cinq kilomètres en avant ! Ils suivent !