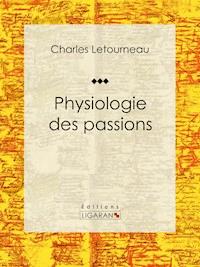
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il faudrait, disait le grand Linné, définir la vie avant de raisonner sur l'âme ; mais c'est ce que j'estime impossible. Les frontières de l'impossible n'ont jamais été fixées ; et qui oserait aujourd'hui jeter à la science le veto par lequel Jéhovah enchaîne les flots, de "Tu n'iras pas plus loin" de la Bible?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335033212
©Ligaran 2015
Une idée générale ressort de ce livre : c’est la grande idée moderne, celle que Lamarck, Darwin et leurs émules ont lancée dans le monde scientifique, l’idée de l’évolution, de l’évolution progressive. En décrivant les passions, nous avons essayé d’indiquer à grands traits, de jalonner la route que suivent l’individu et les sociétés pour s’élever de l’état bestial à l’état vraiment humain. À ce propos, quelques réserves sont à faire, et elles n’ont pu être exposées dans le cours de notre ouvrage, forcément limité.
Il est une manière aussi fausse que dangereuse de concevoir la loi du progrès, c’est d’attribuer à cette loi, partout et toujours, une force irrésistible, fatale. C’est à cette interprétation que se rallient volontiers la paresse, l’apathie, l’égoïsme. En effet, si le progrès est la loi du monde, s’il s’effectue envers et contre tous les obstacles, par la seule force des choses, à quoi bon se fatiguer, s’exténuer à sa poursuite ? « Claquemurons-nous dans notre pays, dans notre province, dans notre maison ; courbons le dos et ne pensons qu’à nous garer, nous et notre progéniture, des coups et des heurts. Laissons faire le temps, la science, dont nous n’avons souci, la vapeur, l’électricité, etc. »
Sans doute, le progrès a quelque chose de nécessaire, d’inéluctable, mais à condition qu’on l’envisage dans l’humanité tout entière. Dans le détail, et si l’on considère seulement un groupe ethnique, il en va tout autrement. Une nation ne saurait progresser et durer qu’à une condition : d’en être digne, c’est-à-dire d’être bien douée et de faire un constant effort ; car elle n’est point seule dans le monde. Cela résulte de la raison même du progrès, de la sélection, qui, à la longue, assure la victoire au meilleur, dans la lutte pour l’existence. Mais la sélection est impartiale, nullement sentimentale. Son effet se borne, un milieu quelconque étant donné, à assurer la survivance du plus apte à vivre dans ce milieu. En dehors de l’humanité, dans le monde végétal et animal, le résultat général de la loi de sélection est incontestablement le triomphe du mieux doué. Mais, là même, il y a parfois exception, sélection régressive. Ainsi, toutes choses égales d’ailleurs, l’insecte ailé est supérieur à l’insecte sans ailes ; pourtant, si l’un et l’autre habitent une île au milieu de l’Océan, l’abeille et le papillon, exposés à être entraînés au large par toute brise un peu forte, auront bien moins de chances de vivre que le carabe, cloué au sol par son organisation même.
C’est aussi la sélection qui règle et décide le succès ou la défaite de tel ou tel groupe humain dans la rivalité ethnique. Mais ici l’influence aveugle des agents naturels n’est plus seule à agir, et le résultat de la compétition est bien autrement varié ; car il dépend en grande partie des idées et des sentiments, des désirs et des caprices de l’homme, toutes choses muables et variables à l’infini.
Sûrement, depuis l’âge de pierre jusqu’à nos jours, le résultat général de la vie de l’humanité a été le développement progressif. Mais ce sont précisément des luttes, des rivalités, des efforts sans trêve qui ont été les facteurs de cette évolution. Partout et à la longue les nations ont succombé ou survécu, suivant qu’elles étaient mal ou bien douées, suivant qu’elles prenaient la mauvaise route ou la bonne. De tout temps et en tout lieu les peuples qui se sont engourdis, endormis dans l’inertie, la mollesse et les plaisirs niais ont disparu de la scène du monde. Le terrain de l’histoire est tout jonché de leurs débris.
Sans doute, la sociologie est loin encore de mériter le nom de science ; sans doute, les procédés propres à accélérer le développement, l’élevage de l’homme sont imparfaits et mal connus. Pourtant la voie est déjà tracée et frayée dans son ensemble ; dès aujourd’hui on peut, ou la suivre approximativement, ou lui tourner le dos. Nous savons que, pour durer et progresser, un peuple doit se composer en majorité d’individus physiquement robustes, moralement bons, dévoués et énergiques, intellectuellement sagaces et instruits. Nous savons aussi, au moins en gros, comment il faut s’y prendre pour développer l’homme de cette triple manière. Nous n’ignorons pas non plus que, si par malheur un peuple prenait le contre-pied de cette loi générale, il marcherait forcément à sa perte.
Supposons, par impossible, qu’il puisse y avoir au monde une nation assez infortunée et assez peu éclairée pour remettre le soin de ses destinées à des guides intellectuellement aveugles, sevrés de toute lumière scientifique, imbus de préjugés homicides et travaillant de toutes leurs forces à entraver le développement de leur pays. Alors, si le malheureux pays que nous supposons était docile et malléable jusqu’au bout, tout y serait bientôt organisé à rebours du sens commun, ou plutôt du sens scientifique. Ce qui devrait être honoré y serait honni ; ce qui mériterait d’être honni y serait honoré. Dès la première enfance, on inculquerait à l’homme des idées fausses sur la nature, sur la condition humaine, sur les sociétés, sur ses devoirs envers ses semblables. Plus tard on s’attacherait à ne lui donner qu’une instruction de mots. On le dresserait non pas à penser, à examiner par lui-même, à faire œuvre de virile initiative, mais à répéter des phrases banales et ronflantes, à se payer de lieux communs usés au lieu des larges données scientifiques, déjà dégagées de l’inconnu au prix d’efforts séculaires ; on lui farcirait le cerveau de soties et creuses abstractions, décorées du beau nom de philosophie. En même temps, maltraitant le corps du jeune homme comme on aurait géhenné son esprit, on l’étiolerait physiquement en le claustrant pendant des années dans un établissement plus ou moins monastique, où l’air, la lumière, le mouvement lui seraient parcimonieusement mesurés. À l’âge viril, on le lancerait dans la vie aussi mal préparé que possible, ne connaissant rien ou presque rien de la réalité des choses, ignorant de ses vrais devoirs sociaux, tout plein de préjugés d’un autre âge, souvent même ayant pris la vérité en horreur. Supposons que plusieurs générations aient pu être modelées de cette manière ; alors notre jeune homme, déjà étiolé de corps, de cœur et d’esprit, entrerait dans une société où l’énergie, la force de caractère, surtout l’amour passionné de la vérité et de la justice, non seulement ne seraient pas prisés, mais même seraient des causes de défaveur. Dans ce triste milieu social, force serait, à l’entrée de chaque carrière, de s’humilier, de capter la faveur de tel ou tel souvent par l’hypocrisie et le mensonge ; en résumé, il faudrait subir d’abord l’initiation de la honte. On se figure sans peine quelles seraient les mœurs dominantes dans un tel pays : la masse des classes dirigeantes n’aurait pour idéal que des plaisirs grossiers ou ineptes ; on n’aspirerait qu’aux jouissances sensuelles ou vaniteuses, à l’argent, aux sinécures, aux titres honorifiques, etc. ; le dévouement désintéressé y serait bafoué comme une sottise ; on n’aurait nul horizon sur le passé et sur l’avenir. En résumé, dans un tel pays, on pratiquerait sur une large échelle et avec persistance la sélection du moins digne. Naturellement le plus digne finirait par devenir rare, puis par disparaître et s’éteindre dans l’oubli et la misère. L’hérédité aidant et accélérant la décadence, le groupe ethnique déclinerait, avec une vitesse progressive, en dignité, en force physique et morale, en intelligence.
Mais la malheureuse nation que nous supposons ne serait pas seule dans le monde. À côté d’elle, autour d’elle, des rivaux plus avisés seraient restés plus sains et plus forts, et ils l’emporteraient fatalement dans la concurrence ethnique ; car ils auraient conservé et développé leurs énergies physiques, morales, intellectuelles. Par conséquent, pacifiquement ou non, ils supplanteraient forcément, en vertu de la loi même du progrès, le groupe dévoyé, qui, tôt ou tard, serait rayé de la liste des nations.
Concluons donc que, tout en étant la loi du monde, le progrès ne saurait s’effectuer qu’au prix d’efforts incessants et bien dirigés, de luttes constantes dans lesquelles il ne faut jamais faiblir.
En outre, plaignons les peuples moribonds dont nous avons plus haut tracé le portrait idéal, et que, dans la mesure de ses forces, chacun de nous travaille à éloigner de sa patrie une si lamentable fin.
CH. LETOURNEAU.
Florence, 4 octobre 1877.
« L’époque n’est pas éloignée, je l’espère, où l’on verra substituer aux causes occultes et mystiques, à l’aide desquelles on explique les phénomènes vitaux, l’exposition des lois physiques auxquelles ils sont dus. »
(DUTROCHET.)
« Il faudrait, disait le grand Linné, définir la vie avant de raisonner sur l’âme ; mais c’est ce que j’estime impossible. » Les frontières de l’impossible n’ont jamais été fixées ; et qui oserait aujourd’hui jeter à la science le veto par lequel Jéhovah enchaîne les flots, le « Tu n’iras pas plus loin » de la Bible ?
Nous savons maintenant qu’il n’y a nulle différence essentielle de composition entre ce qui vit et ce qui ne vit plus ou ne vit pas encore. Toute substance étendue, et nous n’en voyons et n’en concevons pas d’autres, est un simple agrégat d’atomes éternels, indestructibles, constamment actifs, s’attirant ou se repoussant mutuellement.
De là résultent des associations atomiques, infiniment variées, des groupes d’atomes appelés molécules, et ces molécules, en se juxtaposant, forment tous les corps vivants ou non vivants, qui impressionnent si diversement nos sens.
Quand ces molécules sont très riches en atomes, très complexes, très carbonées, elles forment des substances organiques peu ou point cristallisables, parfois et fort justement dénommées protéiques, à cause de leur grande instabilité.
Ces substances organiques constituent la trame de tous les êtres vivants ; mais, dans l’état de vie, elles se sont incorporé une grande quantité d’eau. Ce sont alors des corps semi-liquides. Aussi les a-t-on, pour cette raison, appelées colloïdes, par opposition aux substances minérales ou cristalloïdes.
Ces colloïdes vivants, toujours plus ou moins imprégnés de cristalloïdes, sont tantôt amorphes et sans structure, comme le sang et diverses humeurs de l’économie, tantôt modelés en éléments anatomiques, cellules ou fibres. Dans les deux cas, les colloïdes vivants sont le siège d’un perpétuel tourbillon d’atomes empruntés et rendus au monde extérieur. Incessamment les atomes du milieu externe se vitalisent en pénétrant dans la substance des êtres vivants, puis se minéralisent alors qu’ils en sont expulsés. Ce double mouvement s’effectue aussi bien dans les liquides vivants ou plasmas, comme le sang et la lymphe, qu’au sein des éléments figurés, cellules ou fibres. C’est l’essence même de la vie.
Disons donc, en dépit de la prophétie linnéenne, que « la vie est un double mouvement de composition et de décomposition continuelles et simultanées au sein de substances plasmatiques ou d’éléments anatomiques figurés, qui, sous l’influence de ce mouvement atomique, fonctionnent conformément à leur structure. »
Si l’on n’envisage la vie que dans un élément isolé ou dans un être organisé unicellulaire, les conditions principales de ce double mouvement d’assimilation et de désassimilation sont presque uniquement régies par les lois de l’endosmose et de l’exosmose.
Au lieu d’une cellule simple, isolée, supposons un groupe de cellules semblables entre elles et juxtaposées, nous aurons un de ces êtres polycellulaires et rudimentaires, qui occupent les plus humbles échelons des règnes organisés. Telles sont les paramécies ; telles sont encore les opalines des intestins de la grenouille, qui sont constituées par un groupe de cellules toutes semblables entre elles, renfermées dans une membrane munie de cils vibratiles, à l’aide desquels se meut l’animal. Ici le lien fédératif est encore très faible. Chaque cellule emprunte au milieu ambiant les matériaux qui lui conviennent, et restitue à ce même milieu ce qui lui est devenu inutile ou nuisible. Tout au plus y a-t-il un liquide intercellulaire tenant momentanément en dissolution les matériaux alimentaires ou excrémentaires des cellules.
C’est une pure affaire d’endosmose et d’exosmose, un double courant d’échanges matériels à travers la paroi cellulaire, courant soumis, exactement comme dans un appareil de physique, aux conséquences de la variation des densités.
Rien donc de mystérieux dans ce mouvement nutritif, qui est l’acte vital par excellence. Dutrochet et Graham ont provoqué et étudié cent fois, dans leurs appareils de physique, des faits analogues ; et la seule grande différence entre les phénomènes endosmotiques, qu’étudie la physique, et les actes nutritifs intimes se réduit à des modifications dans la composition chimique des corps en présence.
Le liquide expulsé par la cellule ou la fibre élémentaire diffère chimiquement de celui qu’elle absorbe : ainsi les éléments des tissus propres aux êtres organisés complexes, et dont nous dirons plus loin quelques mots, par exemple la fibre musculaire, organe du mouvement, la cellule cérébrale, organe de la pensée, transforment les matériaux nutritifs, fibrine, albumine ou plasmine, que leur apporte le torrent sanguin, en d’autres produits albuminoïdes, dénommés créatine, créatinine, etc., dus à une oxydation, à une combustion imparfaites.
Quelle simplicité au fond de ce que l’on a si longtemps appelé l’insondable mystère de la vie ! C’est un double mouvement d’assimilation et de désassimilation, soit dans un liquide, soit au sein d’un élément anatomique microscopique, que cet élément soit un globule sans paroi apparente, comme il arrive souvent chez les animaux complexés, ou une simple cavité close, fibre ou cellule, ce qui est presque la règle chez les végétaux.
Le mystérieux n’est que l’inconnu du présent, destiné le plus souvent à être connu dans l’avenir. Mais arrivons à l’examen rapide de la vie chez les êtres supérieurs.
Chez l’être complexe, surtout chez l’animal supérieur et chez l’homme, dont nous devons seulement nous occuper, les phénomènes intimes de la vie sont identiquement les mêmes ; mais ils ont besoin pour s’effectuer d’appareils organiques spéciaux ; la fédération est plus étroite ; il y a même des tendances monarchiques, et les éléments, doués de formes variées, se groupent pour constituer des tissus, des appareils, des organes, qui tous dépendent les uns des autres, qui tous possèdent les grandes propriétés vitales, sans lesquelles la vie ne peut exister, mais en outre sont spécialement chargés de telle ou telle fonction particulière, utile à la communauté.
Ainsi, pour que chacun des éléments nombreux, dont l’ensemble constitue l’animal supérieur ou l’homme, soit en rapport assez intime avec le monde extérieur, où il doit puiser les matériaux indispensables à son existence, le liquide intercellulaire ne suffit plus, et il est besoin d’un système compliqué de canaux, de vaisseaux ramifiés, reliant ensemble toutes les parties de l’animal, et dont le rôle est de contenir et de faire rapidement circuler un liquide énergiquement appelé par Bordeu de la chair coulante, le sang.
Ce précieux liquide est, selon l’heureuse idée de Cl. Bernard, un vrai milieu, un milieu physiologique pour les éléments anatomiques. Il est pour eux ce qu’est pour certains êtres organisés rudimentaires l’eau, dans laquelle ils naissent, vivent et meurent. Sa fonction est d’apporter, soit aux éléments eux-mêmes, soit à leur liquide intercellulaire, les matériaux de la vie, et de reprendre en même temps les résidus inutiles ou nuisibles, que des organes glandulaires spéciaux se chargent d’éliminer hors des frontières de la république.
Deux autres grands systèmes organiques sont les serviteurs de la circulation : ce sont le système digestif, qui, après avoir élaboré les futurs matériaux de l’absorption, les aliments, les livre au système circulatoire véhiculaire, et le système respiratoire, dont la fonction est de favoriser l’entrée de l’oxygène vivifiant dans le sang, où les globules le boivent, l’emmagasinent et le charrient jusqu’aux tissus. En même temps, et par un mécanisme analogue, ce système sert d’émonctoire gazeux, et il élimine les gaz impropres à la nutrition.
On sait que la peau agit aussi à la manière de la muqueuse pulmonaire, qui n’en est, à vrai dire, qu’un diverticule.
Dans tout cela il n’y a encore que des actes physiques ou chimiques, et rien pour la vie de conscience. Mais, pour former ces grands appareils, la cellule élémentaire a subi bien des métamorphoses ; elle s’est modifiée en tissus multiples, musculaires, fibreux, glandulaires etc., dont les éléments conservent bien encore une vie individuelle, mais entre lesquels il y a aussi une intime solidarité. Car, outre les grands systèmes dont j’ai parlé, il en est un autre exerçant spécialement un pouvoir uniteur, modérateur et régulateur des actes nombreux de la vie : c’est le système nerveux, constitué par un tissu spécial, le tissu nerveux. Ici il n’y a plus seulement, comme dans les systèmes circulatoire, digestif et respiratoire, de grossiers échanges, de purs transports de matériaux ; la fonction du système nerveux est surtout dynamique et gouvernementale. Ce système est, en outre, le théâtre et l’organe de la vie psychologique ; c’est à lui seul que la méthode scientifique nous oblige à rapporter tout ce que les psychologues et les métaphysiciens ont attribué à une entité abstraite, l’âme.
Les principales propriétés du tissu nerveux sont, en dehors de son influence indirecte sur la vie nutritive, la motilité, ou propriété de transmettre aux muscles des excitations, puis la sensibilité, l’impressionnabilité et la pensée, dont nous aurons spécialement à nous occuper.
Avec un système nerveux complet, l’être organisé est pourvu de la vie de conscience. Il sent dans une certaine mesure les actes organiques qui s’accomplissent en lui, et il peut intervenir volontairement, soit pour gêner, soit pour favoriser certains d’entre eux.
Sans le système nerveux, l’être organisé n’a que des fonctions s’exerçant fatalement et insciemment sous l’influence des grandes lois de la matière ; avec un système nerveux complet, il a des besoins, c’est-à-dire la conscience de certaines tendances organiques nécessaires ; il entend le cri des organes demandant à vivre, et voici la définition du besoin : C’est une tendance organique sentie, qui, psychiquement, cérébralement, chez l’homme, se formule en d’inéluctables impulsions, en désirs, dont la conséquence est une impression de plaisir ou une impression de douleur, suivant que l’évolution organique nécessaire à la vie est facilitée ou entravée.
De cette définition résulte, que le dénombrement des besoins doit être calqué sur celui des fonctions ; mais comme pour nous le besoin se compose de deux éléments, la tendance organique et son écho dans les centres nerveux sous forme de désir, il y aura besoin là seulement où la conscience et la volonté pourront intervenir.
Si nous avions conscience de tous les aptes vitaux, qui s’accomplissent dans notre organisme, si nous pouvions à volonté en modifier le cours, il y aurait autant de besoins que d’organes, que de tissus, que d’éléments, puisque le mouvement, l’action incessante, sont les conditions d’existence de la matière organisée ; mais un grand nombre de ces actes sont en dehors de la vie de conscience, et nous ignorons les actes vitaux les plus intimes. De même qu’avant l’apparition des centres nerveux, les actes vitaux primitifs, cellulaires, s’accomplissent insciemment : ainsi chez l’être complet, muni de l’arbre nerveux, ces phénomènes essentiels, quoiqu’ils soient la base de l’être, ont lieu sans éveiller de perception centrale. Les éléments anatomiques absorbent, sécrètent, se multiplient, vieillissent et meurent ; les hémisphères cérébraux n’en savent rien, et incessamment des milliers d’actes vitaux de valeur primordiale échappent à leur contrôle. Bien-être, mal être, force, faiblesse, voilà les seuls contrecoups cérébraux des actes intimes de la nutrition.
Mais le jeu des appareils spéciaux secondaires, existant chez l’homme et l’animal complet, est en rapport beaucoup plus étroit avec les centres nerveux, et il y a autant de besoins et quelquefois de groupes de besoins que de grandes fonctions physiologiques. De plus, chaque organe, chaque tissu spécial devant nécessairement vivre conformément à son organisation, il en résulte une série de besoins secondaires bien distincts, mais moins tyranniques que les besoins liés à la nutrition. On peut donc diviser les besoins en trois classes :
Tout être organisé, qu’il soit au bas ou au sommet de la hiérarchie des êtres vivants, qu’il soit constitué par un seul élément anatomique, par une cellule plus ou moins bien modelée, comme la monade, l’amibe, etc., ou qu’il soit composé de myriades de cellules et de fibres groupées en tissus et en appareils, comme l’homme ; tout être organisé, disons-nous, est le siège de l’incessant mouvement de composition et de décomposition, que nous avons décrit dans le chapitre précédent. Sous l’apparente fixité de la forme générale, se cache et s’opère une rénovation continue de la substance vivante, qui se rajeunit, sans trêve, molécule à molécule. C’est un vrai courant matériel, filtrant à travers la trame organique, qui l’accueille, l’absorbe, le modifie, puis l’expulse, quand il est devenu impropre à faire sa partie dans le concert physiologique. C’est l’arbre dit à feuilles persistantes, gardant toujours le même aspect, le même port, tandis que chacune de ses feuilles bourgeonne, s’épanouit, se dessèche et tombe à son tour ; c’est le cours d’eau invariable pour nos yeux, coulant toujours de la même manière entre les mêmes rives, mais ne roulant jamais deux fois à la même place le même flot.
Ce travail continu d’assimilation et de désassimilation que nous venons de peindre avec force mélataphores, est le fait fondamental de la nutrition, de la vie ; il est la condition de tout fonctionnement organique, depuis la contractilité de l’actinie jusqu’à la méditation du penseur ; il est surtout, aussi directement que possible la raison, la condition des besoins. En effet, que ce mouvement nutritif intime vienne à être troublé, soit que l’apport des matériaux fasse défaut ou excès, soit que l’élimination du déchet organique soit entravée, soit qu’il survienne des altérations dans la qualité des tissus ou dans celle des matériaux qui les traversent, et aussitôt la bonne harmonie physiologique entre les diverses parties de l’organisme en souffre et, si cet organisme est quelque peu aristocratique, s’il est composé de tissus multiples, d’appareils spécialisés, reliés par un système nerveux centralisé, il en résulte des faits de conscience, que nous appelons besoins. L’organe ou le système d’organes, dont la paix physiologique est altérée, en donne avis aux centres nerveux par l’intermédiaire des nerfs. Il en résulte d’abord une impression modérément énergique, agréable parfois, mais dégénérant vite en malaise, en douleur, en torture et engendrant des désirs de plus en plus impérieux, irrésistibles. De là, pour le pouvoir nerveux central, l’obligation inéluctable de s’élever, de s’ingénier activement à porter secours à la province qui souffre dans la fédération organique. C’est à cet accouplement de malaise et d’appétence, que nous donnons le nom de besoin. Le besoin se peut donc définir un trouble organique formulé dans les centres nerveux par une impression spéciale et un désir spécial aussi.
La perception cérébrale du besoin provoque aussitôt le désir de le satisfaire. Ce désir, que nous étudierons plus au long, est l’impulsion irraisonnée, indomptable dans son essence, d’accomplir un acte ; nous disons indomptable, car, si l’on peut et si l’on doit souvent résister plus ou moins victorieusement au désir, on ne peut ni l’empêcher de naître, ni l’étouffer, quand il a grandi.
Besoins, c’est-à-dire tendance organique éveillant le désir de se satisfaire ; ce sont là les premiers phénomènes de la vie cérébrale consciente chez l’enfant, ce sont aussi les assises, sur lesquelles reposeront les faits cérébraux plus nobles. Après le besoin et sa formule cérébrale, le désir, le fait psychique le plus fondamental, intimement lié d’ailleurs au besoin, c’est l’impression, mode d’une importante propriété cérébrale, l’impressionnabilité, que nous décrirons ultérieurement.
En effet, quand, obéissant à nos tendances organiques, nous satisfaisons un besoin, un besoin nutritif, par exemple, nous en sommes récompensés par une impression de plaisir et inversement la non-satisfaction du besoin suscite une impression de douleur. La conséquence naturelle est celle-ci : toutes les fois que se fait sentir l’aiguillon du besoin, la trace des impressions que son assouvissement a données à l’être se ranime ; les cellules cérébrales vibrent, si l’on veut, de la même façon, et, si les facultés intellectuelles sont nées, il en résulte une image anticipée, quoiqu’affaiblie, de l’impression qui nous attend, d’où une exagération du désir. C’est la première idée, c’est le premier raisonnement de l’enfant ; il veut faire cesser une impression pénible ; il sait qu’une impression agréable l’attend. Ce fond si simple, nous le retrouverons dans toutes les passions ; il en est la pierre angulaire.
La division des besoins que nous avons donnée ci-dessus, leur classification par groupes bien tranchés, à vives arêtes, est bien dans nos habitudes de raisonnement, mais non dans la nature. De même que, dans le spectre solaire, les couleurs fondamentales passent de rune à l’autre par nuances tellement insensibles, qu’il est impossible de tracer exactement la ligne de démarcation entre le rouge et l’orangé, l’orangé et le jaune, le jaune et le vert, etc., ainsi, dans le monde, même dans le monde des êtres concrets, complets, chaque fait se rapproche du fait voisin, qui cependant en diffère. D’où la difficulté des classifications, même en histoire naturelle et à plus forte raison, quand il s’agit de classer des faits, des actes aussi peu tranchés que les faits cérébraux. Forcément alors nos grossières divisions font abstraction des nuances, qui seules cependant reflètent la vérité.
Ainsi nous avons défini le besoin, une tendance organique sentie, un cri physiologique, dont on a conscience ; mais, si nous cherchons ces deux éléments dans chacun des besoins énumérés dans notre classification, nous ne les y trouverons pas toujours avec une égale évidence, ce qui tient en partie au vague de certains faits cérébraux, en partie à l’imperfection de nos connaissances physiologiques. Sans doute, ces centres nerveux étant l’unique théâtre de toute vie consciente, on peut dire que tout besoin y a son siège psychique, quelle qu’en puisse être l’origine organique. Néanmoins les besoins sont souvent rapportés par le centre nerveux, qui les perçoit, à l’organe chargé de les satisfaire ; ils sont localisés, mais avec plus ou moins de précision.
Le groupe des besoins nutritifs, dont nous avons d’abord à nous occuper, a pour double caractère une spécialisation plus ou moins imparfaite et une excessive énergie. Ces besoins sont mal spécialisés, à cause du rôle très général rempli par les fonctions qui les provoquent ; ils sont tyranniques, à cause de l’extrême importance de ces fonctions. Leur formule cérébrale est d’autant plus vague que leur base organique est plus, large.
Le système circulatoire étant, de tous les grands appareils organiques, le plus mal centralisé, le plus immédiatement utile à tous les éléments organiques, qu’il alimente incessamment, c’est lui qui détermine le besoin le plus mal formulé dans le cerveau. C’est lui aussi qui est le moins soumis à la volonté. Depuis les premiers temps de la vie embryonnaire jusqu’à la désagrégation finale, le cœur bat incessamment, sans se lasser, mais le cerveau, dont il est l’indispensable pourvoyeur, n’a sur lui que fort peu d’empire. On serait tenté de croire qu’il n’en a aucun, si l’on ne voyait souvent les troubles fonctionnels, même fugitifs, des centres nerveux, par exemple, les émotions fortes, perturber immédiatement le rythme des battements cardiaques. En dehors de toute émotion, quelques hommes peuvent à volonté suspendre les palpitations de leur cœur. Un certain colonel Townshend sera, pour ce fait, immortalisé par les traités de physiologie. Il est bien démontré aujourd’hui que cet arrêt volontaire des battements cardiaques ne s’obtient qu’indirectement en arrêtant d’abord les mouvements respiratoires, mais il ne s’en obtient pas moins. Inutile de dire que l’expérience dont nous parlons, ne saurait être de longue durée. Dès que le cœur est immobilisé, le cerveau ne reçoit plus le flot sanguin, oxygéné, nécessaire à son fonctionnement normal, d’où une impression d’insupportable angoisse, bientôt suivie de l’abolition complète de toute sensibilité et de toute pensée. Nous verrons plus loin que tout acte intellectuel a pour contrecoup une contraction des capillaires généraux du corps, tandis qu’au contraire les vaisseaux capillaires du cerveau se dilatent et se congestionnent.
Quoique le tissu du cœur soit constitué par des fibres musculaires striées, des fibres dites de la vie animale, et que son innervation ne soit que partiellement due au système nerveux nutritif, au grand sympathique, pourtant la circulation fait presque entièrement partie de la vie nutritive. Au contraire la respiration, fonction végétative aussi, pour la plus large part, se relie plus manifestement à la vie de relation et de conscience. Sans doute les échanges gazeux, qui sont les phénomènes respiratoires essentiels, s’effectuent fatalement et insciemment dans les tissus, dans le sang et à travers la muqueuse bronchique ; mais les actes mécaniques, qui, chez les vertébrés supérieurs, sont la condition des actes respiratoires plus intimes, jouissent déjà d’une demi-liberté. Ici la vie nutritive et la vie consciente se soudent étroitement. Chez l’homme, les mouvements respiratoires du thorax sont, dans une certaine mesure, indépendants du cerveau, puisqu’ils se produisent au moment de la naissance, quand les hémisphères cérébraux n’ont pas encore secoué le sommeil fatal, puisqu’on les voit même s’exercer dans certains cas tératologiques, chez des nouveau-nés rivés d’hémisphères cérébraux, puisque, chez l’adulte, le sommeil ne suspend pas leur va-et-vient rythmique. D’autres faits pourtant attestent qu’un lien de vasselage les relie au cerveau. Sans doute l’ascète, l’amant passionné, le philosophe peuvent tout oublier pour songer, le premier aux béatitudes d’un paradis-imaginaire ; le second, aux perfections nécessairement absolues de sa maîtresse ; le dernier, à la pensée féconde ou creuse qu’il poursuit. Chez tous trois, pendant ce temps, côtes et diaphragme s’élèvent et s’abaissent insciemment et mécaniquement. Grâce à ces mouvements, un sang incessamment ventilé charrie, entre les cellules cérébrales conscientes, les globules sanguins imprégnés d’oxygène, sans l’aide desquels nos rêveurs ne pourraient pourchasser un instant la chimère ou la vérité qui les captive. Pourtant, durant ce travail de la pensée, qu’il y ait préoccupation simple, passion ou extase, les mouvements respiratoires du thorax se ralentissent, d’où la nécessité de respirer profondément, de soupirer.
Il est bien autrement notoire que tous les hommes peuvent à volonté suspendre complètement les mouvements respiratoires du thorax et du diaphragme, ce qui a pour conséquence cérébrale une impression d’inexprimable anxiété, un irrésistible besoin de respirer promptement suivi de l’abolition de toute vie consciente, s’il n’est satisfait ; car l’intelligence est très étroitement dépendante des fonctions nutritives.
L’étude analytique des besoins digestifs est plus facile que celle des besoins de circulation et de respiration ; car ils sont intermittents, comme les fonctions auxquelles ils se rapportent. Ce sont véritablement les besoins typiques. Dans tout le règne animal, ce sont les plus puissants mobiles d’activité. Ils ont un nom dans toutes les langues humaines, tandis qu’aucune langue n’a d’expression pour désigner les besoins de circulation et de respiration.
Chez les vertébrés supérieurs et chez l’homme, dont nous avons surtout à nous occuper, le mouvement nutritif intime ne s’arrête jamais. On a pesé les quantités d’azote, de carbone, d’eau, de sel, etc., quotidiennement nécessaires à l’homme pour la rénovation de ses tissus et le fonctionnement de ses organes. Ces aliments, il les faut à l’homme, comme il faut du combustible à une locomotive. Lui font-ils défaut, il se dévore lui-même. Quand le bilan nutritif penche quelque peu du côté de la dépense, les organes, et spécialement le système digestif, en donnent avis au moi cérébral, en y suscitant les besoins de la faim et la soif. Ces besoins, presque aussi primordiaux que le besoin de respirer, existent comme lui chez le nouveau-né et chez l’acéphale pourvu seulement d’un bulbe rachidien. Il importe beaucoup de les décrire.
Faim et soif débutent par un désir modéré, accompagné d’une impression point pénible, presque agréable. C’est un premier avertissement. N’en est-il pas tenu compte, le moi conscient subit une pénalité de plus en plus sévère. À l’appétit succède la faim ou la soif. Dans le premier cas, on éprouve à l’épigastre d’abord un sentiment de gêne ; puis cette gêne grandit jusqu’à la douleur la plus atroce : « Il me semblait, dit Savigny, qui a fait, dans une thèse célèbre, l’histoire médicale du radeau de la Méduse, il me semblait qu’on m’arrachait l’estomac avec des tenailles. » En même temps, le besoin de manger, de dévorer des substances plus ou moins alibiles devient irrésistible. M. Roulin, voyageant en Colombie et torturé, ainsi que trois personnes qui l’accompagnaient, par une faim furieuse, raconte que lui et ses compagnons mangèrent cinq paires de sandales de cuir non tanné et un tablier de peau de cerf. Les compagnons du capitaine Franklin, dans les régions arctiques, mangèrent leurs souliers, sucèrent la moelle que les vers avaient laissée dans de vieux os et qui leur excoriait les lèvres. Humboldt raconte, dans ses Tableaux de la nature, que, lors du débordement de l’Orénoque, les Otonaques, ne pouvant plus pêcher et par suite manger, apaisent tant bien que mal leur faim, en avalant chaque jour plus d’une livre d’une argile onctueuse, odorante, d’un gris jaunâtre. En temps de famine, les Kamtschadales et les Néo-Calédoniens distendent de même leur estomac, les premiers avec de la sciure de bois ; les seconds, avec une stéatite friable.
La soif est de beaucoup plus intolérable, plus impérieuse que la faim. C’est que l’eau est indispensable à tous les éléments anatomiques du corps humain. Elle les constitue en grande partie et c’est le véhicule nécessaire de tous les matériaux nutritifs solides. L’organisme inanitié trouve encore dans ses propres tissus une réserve d’aliments solides plus ou moins disponible ; mais où prendrait-il les trois kilogrammes d’eau, qu’il expulse quotidiennement par les urines, les sueurs, la perspiration pulmonaire ? Bientôt, par l’inanition, le sang se concentre, et il en est conséquemment de même de tous les liquides sécrétés ou excrétés. Les muqueuses ne sont plus humectées que par des liquides semi-visqueux, ce qui est particulièrement sensible dans la bouche, la gorge, le larynx. La voix s’éteint ; la langue adhère au palais. En même temps le sang épaissi circule de plus en plus difficilement, d’où la fréquence des battements du cœur, une respiration haletante, enfin de vraies inflammations des voies digestives supérieures et une mort prompte. Nous avons indiqué ailleurs dans quel ordre et dans quelle proportion les divers tissus du corps se fondent et se résorbent par l’inanition. Les centres nerveux sont le plus tardivement altérés ; ils vivent aux dépens du reste du corps. Néanmoins leur tour arrive et leurs fonctions se troublent de plus en plus gravement. L’étreinte du besoin ne laisse pas de trêve à l’affamé ; pendant le sommeil, elle lui suggère des visions, des mirages, ayant trait à sa situation. Les naufragés de la Méduse voyaient en rêves des ombrages frais et des ruisseaux. Pendant la veille, le rêve est remplacé par des hallucinations, du délire maniaque. Les matelots de la Méduse s’entre-égorgèrent ; car l’homme affamé n’est plus un être sociable, intelligent et plus ou moins moralisé, il se replonge dans l’animalité, dont très vraisemblablement il est sorti. Dans les sièges, les naufrages, le cannibalisme primitif reparaît souvent. C’est que l’homme obéit toujours au mobile le plus fort. Ainsi d’un tableau publié par Mélier il ressort que la moralité publique suit dans une large mesure les variations des mercuriales. Plus le blé est cher, plus les vols sont nombreux. Partisans du libre arbitre, que répondriez-vous à cela ? On est d’ailleurs tout disposé à excuser ces attentats à la propriété, quand on a lu le tableau fait par Meersmann des affamés belges, pendant la famine de 1846 à 1847 : « Ce qui frappait d’abord, dit-il, c’était l’extrême maigreur du corps, la livide pâleur du visage, les joues creuses et surtout l’expression du regard, dont on ne pouvait perdre le souvenir, quand on l’avait subi une fois. Il y a, en effet, une étrange fascination dans cet œil où toute la vitalité de l’individu semble s’être retirée, qui brille d’un éclat fébrile, dont la pupille, énormément dilatée, se fixe sur vous sans clignotement et avec un étonnement interrogatif où la bienveillance se mêle à la crainte. Les mouvements du corps sont lents, la marche chancelante ; la main tremble ; la voix, presque éteinte, chevrote.
« L’intelligence est profondément altérée ; les réponses sont pénibles ; la mémoire, chez la plupart, est à peu près abolie. Interrogés sur les souffrances qu’ils endurent, ces infortunés répondent qu’ils ne souffrent pas, mais qu’ils ont faim !… »
« Parmi les victimes de la disette, il s’en rencontrait que les affections accidentelles épargnaient, comme pour leur faire traverser toutes les épreuves de l’épuisement et de la dissolution organique. Dans ce cas, les symptômes d’anéantissement devenaient successivement plus intenses. La décrépitude avait envahi tous ces malheureux ; les enfants, les jeunes gens, les adultes, les hommes parvenus à la maturité de l’âge portaient sur tout le corps les rides, le dessèchement, l’exténuation de la vieillesse : c’étaient de véritables squelettes vivants, incapables de soulever leurs membres décharnés, gisant lourdement sans voix, avec un œil sans regard, enfoncé dans l’orbite et à moitié voilé par des paupières transparentes et chassieuses. Parfois ils étaient horriblement secoués par une toux sèche et convulsive. Enfin on voyait apparaître les derniers indices de l’extrême appauvrissement du sang : la peau se couvrait de vastes ecchymoses ou de taches pourprées, qui devenaient confluentes quelquefois, et ces tristes victimes de la famine rendaient le dernier soupir au milieu de l’agitation, de la carphologie ou de la fatigante loquacité du délire famélique. »
S’il était nécessaire de démontrer que les besoins nutritifs ont pour cause le défaut dans l’économie de certaines substances alimentaires, il suffirait de rappeler, d’une part, que toute grande déperdition de sang ou de l’une des humeurs du corps provoque immédiatement une soif ardente, d’autre part, que l’on apaise la soif en injectant dans les veines de l’eau ou du bouillon (expériences de Dupuytren) ou même par des bains prolongés. Mais, en dépit de la généralité de leur cause, la faim et la soif ont leur siège apparent, l’une dans l’estomac, l’autre dans la gorge, et leur siège conscient, psychique, dans l’âme, c’est-à-dire dans les cellules cérébrales. Cela a été mis hors de doute par des faits d’observation et d’expérience aussi nombreux que précis. En effet on peut exciter ou abolir la faim ou la soif, en agissant soit sur leur siège physiologique central, soit sur leur siège périphérique.
Une poule, à qui, Flourens avait amputé les hémisphères cérébraux, ne sentait plus le besoin de la faim. Cinq mois après l’opération, quand la cicatrisation était parfaite, elle supportait, sans paraître s’en apercevoir, un jeûne de trois jours ; elle ne mangeait pas, quand on la mettait sur un tas de blé, quand on lui posait du grain sur le bec ; elle ne buvait pas, quand on lui plongeait le bec dans l’eau. Elle avalait seulement mécaniquement, par pure action réflexe et indifféremment, les grains et les cailloux qu’on lui introduisait dans le bec. De même, dans l’espèce humaine, les enfants nés sans cerveau ou avec des centres nerveux très incomplètement développés (anencéphales, pseudencéphales) boivent difficilement, souvent ne peuvent même avaler.
Chez l’adulte normal, une émotion forte suffit pour abolir momentanément la conscience du besoin de la faim. L’opium produit un résultat semblable, et aussi la morphine injectée sous la peau. Inversement la vue, le souvenir de certains mets suffisent pour donner faim ou soif.
D’autre part, Brachet a pu abolir, ou du moins affaiblir considérablement, le désir de manger et de boire chez des animaux, en leur sectionnant les principaux nerfs de l’estomac, les nerfs pneumogastriques. On a voulu rapporter ce résultat à l’opération seule. L’incision du nerf sciatique aurait, dit-on, produit les mêmes effets et l’appétit serait revenu après la guérison chez les animaux opérés par Brachet, mais il est permis de supposer qu’alors la cicatrisation des nerfs sectionnés s’était opérée. Leuret et Lassaigne ont vu un cheval, à qui ils avaient excisé les deux nerfs pneumogastriques, manger ensuite plusieurs litres d’avoine. Mais cet animal mangeait vraisemblablement sans appétit, automatiquement, uniquement parce qu’il voyait des aliments, puisque Brachet a vu un animal opéré de la même manière manger indéfiniment, sans jamais éprouver le sentiment de la satiété et en se gorgeant complètement l’estomac et l’œsophage.
Le résultat de ces vivisections est corroboré par des expériences moins sanglantes et plus facilement praticables. Nous avons déjà vu que l’on apaisait plus ou moins la faim en introduisant dans l’estomac des substances non alibiles. Tout ce qui distend ou comprime l’estomac produit un effet analogue, par exemple les boissons gazeuses à l’intérieur, et, à l’extérieur, la constriction d’une ceinture au niveau de l’épigastre.
Inversement on peut facilement provoquer artificiellement la faim ou la soif. L’ingestion de certaines substances, par exemple, d’une petite dose d’extrait concentré de cresson, réveille le désir de manger, même après un dîner copieux. De même quantité d’épices peuvent exciter la soif.
Après la description générale qui précède, il est inutile de parler des besoins digestifs annexes. Signalons cependant un besoin nutritif secondaire, mais curieux en ce qu’il démontre bien quelle intime corrélation relie le besoin senti aux variations dans la composition chimique des éléments anatomiques. Nous voulons parler du besoin de sel marin. Ce besoin se fait sentir toutes les fois que l’on est astreint à un régime végétal. Livingstone dit en avoir souvent souffert durant ses longues pérégrinations au centre du continent africain, et des observations analogues ont plusieurs fois été faites pendant les longs sièges. Dans ce dernier cas, on a vu parfois les assiégés aller jusqu’à distiller leur urine pour se procurer les substances salines, dont ils éprouvaient un impérieux besoin.
La gradation des besoins, telle que nous l’avons indiquée précédemment dans notre tableau général, est en rapport avec le perfectionnement et la spécialisation des tissus et des organes. Plus un besoin se relie étroitement à la vie de conscience, plus il est élevé, noble, moins nombreux sont les êtres susceptibles de l’éprouver. La nature vivante n’est ni démocratique, ni égalitaire. Tout y est subordonné et hiérarchisé. Il est des fonctions communes au peuple entier des êtres vivant ? végétaux et animaux, par exemple la nutrition. Déjà les besoins nutritifs sentis sont l’apanage exclusif du règne animal ; communs à la plupart de ses citoyens, ils sont pourtant ignorés encore des plus humbles, par exemple des radiés dépourvus de système nerveux. Le besoin de rénovation est-il senti, alors il engendre les besoins digestifs que nous avons décrits, et nombre d’animaux n’en ont pas d’autres.
Au-dessus de ces besoins digestifs se placent des besoins qui, sans être encore des besoins cérébraux, tiennent déjà, pour une part plus ou moins large, à la vie de relation. On les pourrait appeler des besoins mixtes. Ce sont le besoin de mouvement et le besoin amoureux.
Le premier est de beaucoup le plus nutritif ; car, d’une part, c’est surtout dans le tissu musculaire si riche en vaisseaux capillaires, que l’oxygène brassé dans le sang se combine avec les substances nutrimentaires ; d’autre part, le besoin de mouvement musculaire se formule très vaguement dans la conscience, dans le cerveau ; néanmoins il y retentit. Dans l’enfance, il a une grande énergie. Dans la jeunesse, il est souvent très puissant encore ; à cet âge, toute inaction musculaire trop prolongée provoque une impression de malaise général, avec désir plus ou moins vif de se mouvoir et inaptitude aux travaux intellectuels. Cela veut dire que les fibres musculaires sont gorgées de substances albuminoïdes, qu’en traversant les capillaires des muscles, le sang subit une désoxygénation imparfaite, que le liquide interfibrillaire est fortement alcalin. Si alors le jeune homme peut céder à l’impulsion interne, qui l’excite au mouvement, il le fait avec une facilité, une énergie extrêmes, en éprouvant un vif sentiment de plaisir, parfois une sorte d’ivresse. En même temps le cerveau Auparavant opprimé se dégage ; l’intelligence est plus libre, plus active, plus capable de travail. C’est qu’on a brûlé une surcharge de globules sanguins. À son tour, l’excès du travail musculaire détruit le bien-être obtenu d’abord.
Après épuisement de la réserve alimentaire des muscles, surviennent l’atonie, la fatigue, la roideur musculaire. La chimie physiologique nous a appris qu’alors les substances albuminoïdes des muscles ont été brûlées et transformées, pour une grande part, en produits régressifs, en créatine, créatinine, urée, etc., en acide lactique, qui acidifie le tissu musculaire et occasionne la courbature et la rigidité.
En général, le besoin de mouvement est proportionnel à l’énergie de la respiration et de la circulation ; aussi le voyons-nous peu accusé chez les reptiles, si imparfaits au point de vue des organes respiratoires et circulatoires ; chez les mammifères, il est beaucoup plus énergique. Chez l’homme, ce besoin de mouvement domine dans l’enfance, s’accentue encore fortement dans la jeunesse, pour décliner et s’éteindre à mesure que s’approche l’échéance finale. Les oiseaux, étant de tous les vertébrés ceux qui brûlent le plus vite et respirent le plus fort, ce sont eux aussi qui éprouvent avec le plus d’intensité le besoin de se mouvoir. Nombre d’entre eux ne se reposent guère que pendant le sommeil, et chez certains, chez les colibris par exemple, il y a une vraie furie de mouvements incessants et tellement rapides, que le petit corps de l’animal fend l’air, comme une balle emplumée, en se dérobant presque à la vue.
Le second de nos besoins mixtes est beaucoup plus sensitif que l’autre ; c’est le besoin de volupté, improprement dénommé jusqu’ici besoin de la génération. Le puissant attrait qui nous porte à rechercher les relations sexuelles n’est pas, dans l’immense majorité des cas, le-besoin d’engendrer des enfants : c’est le désir d’éprouver la plus voluptueuse impression dont l’homme soit susceptible.
Il se range immédiatement après les besoins nutritifs, dont il a presque l’énergie. Souvent il est presque impossible à la volonté de le refréner. Sa non-satisfaction ne cause pas la mort, mais engendre parfois des névroses plus ou moins graves. Souvent il entraîne à des excès, d’où résultent diverses maladies nerveuses, des paralysies, des lésions de la moelle épinière, des maladies organiques, par exemple la dégénérescence tuberculeuse, expression d’un trouble profond dans la nutrition.
Le besoin voluptueux, plus ou moins énergique seulement suivant le climat, le tempérament, existe chez tous les hommes pendant la période moyenne de la vie ; mais les autres besoins sensitifs ne se rencontrent d’une façon bien tranchée qu’exceptionnellement. Tandis que le sens voluptueux domine dans le besoin générateur, le sens du goût dans le besoin digestif cède le pas à la faim. Ici l’impression nutritive l’emporte sur l’impression sensitive, et, chez quelques gourmands seulement, l’impression sensitive peut servir de racine à une passion.
Le besoin de sons musicaux, d’impressions auditives agréables est encore plus rare ; il en est cependant des exemples incontestables. À trois ans, Wolfgang Mozart trouvait un grand plaisir à chercher des tierces sur un piano. Dès lors et pendant toute sa vie il fallut le surveiller pour qu’il ne s’oubliât pas au piano. Sa sensibilité auditive était si grande, que le son d’une trompette lui donnait des convulsions. Ce fut un bien frappant exemple de l’intime rapport qui unit le sentiment artistique à l’impressionnabilité effective. Dans son enfance, il disait à chaque instant du jour aux personnes qui l’entouraient : « M’aimez-vous bien ? » et une réponse négative l’affligeait beaucoup. Sa physionomie extrêmement mobile, jamais en repos, exprimait sans cesse la peine ou le plaisir.
Naturellement cette impressionnabilité excessive désarmait chez lui le raisonnement. Incapable de gouverner ses affaires, car le plaisir du moment l’emportait toujours, il eut toute sa vie besoin d’un tuteur.
Il est d’autres exemples analogues. Dès l’âge le plus tendre, la musique fit à Haydn un plaisir étonnant. Tout enfant, il aimait mieux entendre jouer d’un instrument que d’aller courir avec ses petits camarades. À six ans il battait très exactement la mesure. Dès l’âge de huit ans on le vit travailler à son clavecin seize à dix-huit heures par jour. Jeune homme, il en jouait sans cesse, dans un grenier, sans feu, jusqu’au moment où le besoin de sommeil l’accablait, et il se trouvait très heureux.
L’enfance des grands peintres, notamment celle de Michel-Ange, a parfois offert des faits analogues relativement au dessin et à la couleur. Mais ce sont là des exceptions, et très généralement les besoins sensitifs sont si peu énergiques (le sens génésique à part), que l’homme peut à volonté et pendant un temps indéfini suspendre l’action des sens spéciaux, sans éprouver ni désir bien vif de les exercer, ni impression pénible. On a faim et soif d’aliments, rarement d’impressions sensitives.
Les plus intéressants à étudier en psychologie. Qu’est-ce en effet que l’homme pour le psychologue ? Un cerveau nourri et servi par d’autres organes, dont un grand nombre lui obéissent normalement, qui tous subissent son influence indirectement.
Ce siège de l’être sentant, de la conscience et aussi des facultés, fonctionne incessamment, comme tous les organes vivants, excepté pendant le sommeil sans rêves et dans certains cas pathologiques. Mais avant d’analyser à notre point de vue les très importantes fonctions propres au cerveau, voyons si les données générales de l’anatomie pourront nous guider dans la systématisation des faits cérébraux.
1° Il est aujourd’hui bien démontré que, dans tout le règne animal, les actes intellectuels, et même d’une façon plus générale les faits de conscience, sont indissolublement liés à l’existence d’un système nerveux, et que leur énergie est nécessairement en rapport avec le plus ou le moins de perfection de ce système. Pas de système nerveux, pas d’actes conscients, pas d’impressions senties.
Partout aussi le système nerveux est constitué par un tissu spécial, dont les cellules et les fibres sont sensiblement les mêmes chez tous les animaux.
De ces deux ordres d’éléments nerveux, les cellules et les fibres, les premières sont les centres d’action, les secondes jouent simplement le rôle de conductrices. Il y a là quelque chose d’analogue à la pile électrique et au fil qui transmet au loin le courant.
Dans tout système nerveux, les fibres partent des cellules ou y arrivent.
2° Ce qui précède s’applique aussi bien aux invertébrés qu’aux vertébrés ; mais l’étude des premiers prouve en outre que la condensation des cellules nerveuses en masses considérables, comme la moelle épinière et l’encéphale des animaux supérieurs, n’est pas indispensable aux phénomènes de conscience. Un grand nombre de petits centres reliés par des fibres formant cordons fonctionne d’une manière analogue. Les curieuses expériences de Dugès prouvent qu’alors, notamment chez les insectes, on peut, en sectionnant la chaîne nerveuse ganglionnaire en différents points, rompre l’unité du système. Chaque segment vit ensuite sans relation avec les autres, mais il paraît conserver pour son propre compte la faculté de sentir, de se mouvoir volontairement, sciemment, même de s’irriter. Chaque groupe ganglionnaire partiel ainsi formé devient un centre partiel, qui se suffit et possède les principales propriétés et facultés de l’ensemble. Que va dire la métaphysique ? une intelligence qui se coupe à coups de ciseaux !
Pourtant force est bien de faire des réserves. À première vue, l’expérience de Dugès semble décisive ; mais la coordination des mouvements, leur intention apparente, ne prouvent pas nécessairement qu’ils soient conscients. Nombre de mouvements réflexes très compliqués, mais parfaitement inconscients, se coordonnent très bien. On observe quantité de ces mouvements en apparence voulus, même chez les vertébrés, même chez les mammifères, où pourtant la coalescence des centres nerveux est bien autrement grande. Un poisson, une grenouille, privés de cerveau exécutent encore des séries de mouvements en apparence combinés. Il en était de même des pigeons, auxquels Flourens avait amputé le cerveau. Enfin des mouvements réflexes coordonnés s’effectuent encore sur un cadavre humain décapité, alors que l’on gratte avec un scalpel la peau de la poitrine, au niveau de l’auréole du mamelon. La moelle épinière semble être une source d’activité nerveuse automatique, un centre nerveux inconscient. Il en peut donc être de même des ganglions nerveux des anthropodes, chez qui, d’ailleurs, la prépondérance du ganglion cérébroïde est bien moins évidente et sûrement beaucoup moins absolue que celle du cerveau des vertébrés.
Cependant, même chez les invertébrés, la fusion, la coalescence des ganglions est liée à un plus grand développement intellectuel ; car la larve, la chenille, ont beaucoup plus de ganglions que l’insecte parfait.
3° De même dans la série des vertébrés, la fusion des centres nerveux est d’autant plus complète, que l’animal est plus parfait, plus intelligent, et chez l’homme, auquel nous revenons, la presque totalité des cellules nerveuses est condensée dans la moelle épinière, le cervelet et le cerveau.
Ces cellules reçoivent deux ordres de fibres, les unes qui les relient à tout l’organisme, les autres qui les relient entre elles. Donc intime solidarité anatomique entre tous les points de l’encéphale, ce qui rend raison du consensus étroit de toutes les facultés et rend compte de la difficulté qu’il y a à les localiser.
Les seuls départements encéphaliques, que l’anatomie comparée et l’embryologie nous autorisent à reconnaître sont : le cervelet, les lobes optiques, les lobes cérébraux et les lobes olfactifs, qui tous se fondent d’autant plus ensemble, que l’animal est plus élevé dans la série ou que l’embryon est plus développé. Or, cette division est d’un bien faible secours à la psychologie analytique, dès que l’on sort des données très générales. En effet, si nous demandons à la physiologie quelle est la fonction dévolue à chacune de ces parties, elle nous répondra :
Que le cervelet préside à la coordination des mouvements volontaires, peut-être au sens voluptueux et à la génération, peut-être au sens auditif. (Dans la série zoologique les lobes cérébelleux sont d’autant plus développés, que l’organe de l’ouïe est plus parfait.)
Que les lobes optiques sont liés à la vision ;
Les lobes olfactifs à l’odorat.
Restent les hémisphères cérébraux, où il faut loger en masse les faits intellectuels et moraux proprement dits.
4° La forme générale du cerveau, son volume, nous fournissent encore quelques données positives, et l’on peut considérer comme à peu près établies scientifiquement les propositions suivantes :
Dans la grande majorité des cas, il y a relation directe entre le volume du cerveau, ou plutôt des hémisphères, et la puissance intellectuelle. Cependant la quantité n’est qu’un des éléments du problème, et en cela le cerveau ne diffère pas des autres organes ; reste donc l’élément vital proprement dit, la qualité, qui paraît en relation avec la notion de tempérament, dont nous parlerons longuement. L’étude de la forme nous apprend encore, qu’au point de vue intellectuel les diverses parties du cerveau n’ont pas la même dignité et que l’intelligence paraît surtout en rapport avec les lobes antérieurs, les lobes frontaux, les seuls d’ailleurs à peu près nettement délimités en anatomie. Dans toute la série des vertébrés et même dans celle des races humaines, on voit ces lobes se développer de plus en plus en redressant le frontal, à mesure que grandit l’intelligence. En outre, l’anatomie pathologique, nous enseigne que généralement les lésions des lobes frontaux troublent plus ou moins l’intelligence et souvent abolissent la parole (troisième circonvolution frontale gauche Dax, Broca, etc.).
Mais chez l’homme et les animaux supérieurs, les centres nerveux sont moins fusionnés qu’ils ne le paraissent au premier abord. La moelle épinière d’un vertébré peut se sectionner en tronçons, qui continuent à vivre chacun pour leur compte, à exciter et à diriger des mouvements coordonnés, à la seule condition de recevoir toujours une suffisante provision de sang oxygéné. Alors il n’y a plus de vie nerveuse fédérale, mais la vie cantonale persiste encore. C’est quelque chose d’analogue à l’expérience ci-dessus mentionnée de Dugès. Or, chez les vertébrés supérieurs et chez l’homme, tout semble prouver que, des deux parties principales des centres nerveux, l’une, la moelle épinière, est inconsciente et que, seul, le cerveau est l’agent et le théâtre de la vie psychique. Or, avant de scruter les actes cérébraux, il importe de se faire une idée d’ensemble de la disposition des organes qui les engendrent. Sur ce point les récentes recherches du docteur Luys nous seront d’un précieux secours.





























