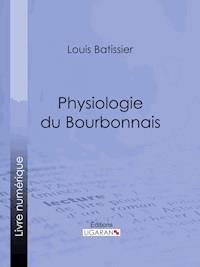
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "A Paris gravitent les grandes individualités, s'agitent les graves affaires, se développent les fortes passions. Là, apparaissent dans toute leur énergie les audacieux caractères, les âmes vigoureusement trempées ; là, les ambitions les plus ardentes se combattent, se jouent et se surpassent les unes les autres."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Paris gravitent les grandes individualités, s’agitent les graves affaires, se développent les fortes passions. Là, apparaissent dans toute leur énergie les audacieux caractères, les âmes vigoureusement trempées ; là, les ambitions les plus ardentes se combattent, se jouent et se surpassent les unes les autres. Vous y voyez les plus vastes fortunes comme les plus poignantes misères ; si les glorieuses renommés y jettent leur éclat, l’impudeur et l’effronterie s’y montrent aussi sans masque. Paris est un véritable chaos moral, où se mêle et se confond tout ce que la société humaine a de bon et de mauvais ; c’est une immense fourmilière où se produisent et se frottent les natures les plus opposées et les plus excentriques. Aussi, dans cette ville qu’on dit la capitale du monde civilisé, que de types curieux et bizarres n’observe-t-on pas de toutes parts ! Chaque profession a ses mœurs et ses habitudes, chaque classe a sa physionomie bien tranchée ; chaque individu perdu, pour ainsi dire, dans l’espace, emporté par le mouvement général, conserve ses croyances et ses allures. Les vertus et les vices s’y dissimulent à la vérité sous un vernis dont les exigences du monde les forcent à se revêtir, mais sous lequel il n’est pas difficile à un œil exercé d’aller les chercher.
Les conditions de la vie provinciale sont toutes différentes. La sphère d’activité est plus étroite, le théâtre est plus petit. L’homme est absorbé par la famille, élevé, façonné par elle. Il accepte malgré lui et à son insu les préjugés et les superstitions du monde au milieu duquel il est né et au milieu duquel il mourra. En Province, la tyrannie de l’opinion publique est toute puissante. Or, comme les sots sont toujours en majorité, c’est la loi des sots qu’il faut subir : malheur à qui se dévie du chemin battu, à qui professe des idées qui n’ont pas un cours général dans le pays ! il est renié, hué et vilipendé. On s’inquiétera sérieusement de la longueur de vos cheveux, de la forme de votre chapeau et de la coupe de vos habits. À cet égard on est impitoyable, et l’on vous montrera au doigt si tout cela dépasse en plus ou en moins les proportions adoptées. Il vous faut tout faire comme le vulgaire des hommes qui vous entourent, sinon on se méfie de vous, on vous fuit, on vous perd de réputation. Quand on est sur la pente de la médisance, on arrive si vite à la calomnie ! En Province il n’y a pas moyen d’échapper à l’esprit d’inquisition qu’on exerce incessamment les uns sur les autres. Les maisons sont de cristal pour ainsi dire, de sorte que la vie de chacun n’a de secret pour personne. On conçoit que dans un tel état de choses les petites villes de Province se ressemblent toutes entre elles, que leur séjour est d’une écrasante monotonie et ne présentent pas de ces types fortement dessinés qu’on observe dans Paris en si grand nombre.
Il ne faut donc pas chercher d’abord dans nos départements autre chose que les vertus, les vices et les travers, qui appartiennent à l’humanité. L’habitant du Bourbonnais, comme celui du reste de la France, a ses petites passions généreuses et méchantes. Asmodée, le spirituel et malin Diable-Boiteux, conduirait l’écolier don Cléophas dans une de nos villes Bourbonnaises, qu’il trouverait très certainement à lui montrer les mêmes misères et les mêmes ridicules en présence desquels il l’a mis dans Madrid ; il lui ferait voir chez nous, comme en Espagne, de sordides avares, d’adroits filous, des maris trompés, des amoureux surannés, des femmes qui font concurrence aux filles galantes, des ménages en désordre, des aventures à défrayer cent romans, des dévots hypocrites, des chambrières et des valets qui vendraient leurs maîtres dans un sac, d’effrontés mendiants, une foule de fous qui ne sont pas aux petites maisons, des jaloux mystifiés, des neveux qui font des prières du matin au soir, pour qu’il plaise à Dieu de conduire leur oncle au plus tôt en paradis ; de faux amis, de vieilles coquettes, de méchants poètes et de ridicules écrivains, d’insupportables oisifs, des fourbes de toute sorte et des riches parvenus qui se donnent des airs de grands seigneurs ; que sais-je encore ? Tous ces types n’appartiennent pas à un seul pays, à une seule époque : ils sont de tous les lieux et de tous les temps. Ne nous inquiétons donc pas de ces étranges individualités. Nous préférons passer sous silence toutes ces faiblesses humaines, et peindre avec les couleurs les plus vraies que nous pourrons trouver, quelques tableaux qui nous fassent connaître ce qu’il y a de pittoresque et d’original dans notre pays.
On a remarqué que le caractère physique et moral de l’homme se liait intimement à la nature et à la configuration du sol qu’il habitait. Les populations de la Bretagne, de l’Auvergne, de la Flandre, de la Provence, si diverses d’aspects, n’appartiennent pas à la même race, et ont une physionomie toute particulière, qui se révèle dans leur langue, dans leur costume, comme dans leurs monuments. Il n’en est pas absolument de même du Bourbonnais, formé aux dépens de trois provinces limitrophes. Quand on jette un coup d’œil général sur le pays, on voit que ses habitants doivent avoir une organisation, un tempérament différents suivant les lieux. Ceux du Sud tiennent de l’Auvergnat ; ceux de l’Ouest tiennent du Berrichon ; ceux du Nord et de l’Est ont plus de rapports avec le Bourguignon. Ces trois nuances, toutefois, se fondent au centre, entre l’Allier et le Cher. Aussi ne vois-je de distinction réelle à établir qu’entre l’habitant de la plaine et celui de la montagne.
Il ne se distingue ni par de grands vices, ni par de grandes qualités. Chez lui le cœur l’emporte sur la tête. Il est bon et affectueux, attaché au sol qui l’a vu naître, au clocher du village, à la maison paternelle ; il a l’âme douce et bienveillante. Il est glorieux, comme on dit dans le pays. Il aime le faste extérieur. Il préfère pâtir que de se passer de beaux habits. Il s’ôtera le pain de la bouche pour se donner le plaisir d’avoir le plus futile colifichet. Aussi a-t-on dit avec raison : Bourbonnichon, habits de velours, ventre de son. Ajoutez à cela qu’il est paresseux et oisif, sans spontanéité et sans ardeur. Nulle ambition ne le domine ni ne l’entraîne. Il est là, et il y reste. Il a un champ, c’est à peine s’il en désire deux ; il a un négoce, il ne lui demande guère que de le faire vivre. Par crainte et par paresse, il a horreur de toute espèce d’innovation, quand bien même il devrait en retirer une fortune assurée. S’il a un sou, il le garde, et ne le joue jamais dans une spéculation ; il a oublié le proverbe : qui ne hasarde rien n’a rien. Tout peut s’agiter, se remuer autour de lui, les idées et l’industrie, il écoute leur bruit et ne s’en émeut nullement. S’il ne voyait pas de temps en temps la gelée et la grêle jeter la désolation dans ses champs, ses vignes et ses vergers, il soutiendrait, comme le docteur Pangloss, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cette philosophie est excellente pour le bonheur de l’individu, mais elle nuit au progrès, à la grandeur de la société. Si tout est bien, à quoi bon chercher mieux ? Vivamus dum licet esse bene, comme dit Horace, vivons pendant que nous sommes bien. Voilà sans contredit la maxime que mes chers compatriotes mettent en pratique, sans y songer peut-être, ou plutôt sans oser se l’avouer.
Le moral se reflète sur le physique, dit-on. Chez nous, le physique n’a donc rien de vigoureux, rien de bien caractéristique, rien de fort original. La taille est médiocre et la force aussi. Ce n’est pas l’homme blond, le germain du Nord ; ce n’est point non plus l’homme haut en couleur du Midi ; c’est un mélange des deux races, une race mixte.
La figure est douce et honnête, l’œil est plutôt languissant qu’il n’est vif ; les allures du corps sont sans ardeur et sans brusquerie, la parole n’a point d’éclat ; la langue est paresseuse et escamote la moitié de chaque mot. Nous avons la singulière prétention de n’avoir point d’accent ; or il est certain que nous chantons d’une manière assez gracieuse en parlant. De plus, nous avons quelques locutions tout à fait locales, parmi lesquelles les ah ! et les oh ! jouent un rôle étourdissant. Je défie deux Bourbonnais de lier conversation sans que ces deux monosyllabes ne sortent de leur bouche au commencement de chacune de leurs phrases. Et puis, ce sont des dam ! en veux-tu ? en voilà ! Après cette exclamation, tout est fini. Dans ce mot, modulé de mille manières, il y a réponse à tout. Mais je ne veux pas épuiser le vocabulaire des idiotismes de notre langage, il y aurait trop à faire. En somme, ce langage n’a rien de désagréable, il a même quelque chose de sincère et de naïf qui plaît, à ce que bien des gens m’ont assuré, et cela surtout dans la bouche d’une jolie Bourbonnaise.
Chez l’habitant des montagnes, c’est une toute autre organisation, ce sont des mœurs toutes différentes. Il est grand et robuste, laborieux et plein d’activité. La superstition fait le fond de son caractère ; il est ignorant, et se laisse aller à toutes les brutales passions des peuples non civilisés. Sa vengeance ne connaît pas d’obstacles, de même que son hospitalité ne connaît pas de bornes. Il ne sait rien du monde au-delà de ses montagnes, et il est attaché au sol sur lequel il est né, comme les sapins des forêts qui entourent son hameau. Son patois tient des idiomes populaires du midi de la France. Nous nous réservons, dans un autre chapitre, de parler avec plus de détails de ses mœurs, de son costume et de ses croyances.
Si maintenant nous voulons jeter un coup d’œil sur la hiérarchie sociale du Bourbonnais, nous observerons les mêmes castes qu’on retrouve dans les autres provinces. Nous verrons d’abord les grands seigneurs de l’ancien régime, des marquis, des comtes en possession de noms illustres et de grandes fortunes ; gens qui mènent une existence retirée, vivent de regrets et d’espérances, et conservent les illusions chevaleresques d’une époque déjà loin de nous. Par leurs idées ils tiennent du passé, mais ils ont le bon esprit de se rattacher au présent en améliorant le sol de leurs vastes domaines, ou en consacrant une partie de leurs riches revenus aux grandes spéculations industrielles qui semblent devoir assurer la prospérité du pays. Ceux-là ne déchoient pas du rang élevé qu’ils doivent à leur naissance, et conservent dans la société leur influence d’autrefois. Mais il en est d’autres qui, séquestrés dans leur manoir, végètent dans la solitude, oisifs et découragés, poursuivant en rêve des fantômes qui leur échappent, et attendant sans bruit des temps meilleurs. La famille lit quelque gazette légitimiste ; le maître de la maison chasse sur ses terres ; on finit la journée, l’hiver, au coin du feu ; dans les beaux jours, sous les antiques charmilles du parc. On se voit de château à château. On reçoit le curé de l’endroit. La société est très restreinte mais aussi très sûre et très amicale. Dans le pays on aime ces gens pour le bien qu’ils font, et on les respecte pour les vertus qu’ils se lèguent souvent, de génération en génération, comme un précieux trésor que le ciel leur a confié. Par malheur, si leur charité est prodigue, il en est beaucoup d’entre eux qui dédaignent les affaires, dans notre siècle où l’on demande compte à chacun de sa force physique comme de son activité intellectuelle. Aussi, arrivera-t-il un jour où ils seront, s’ils n’y prennent garde, effacés, dévorés par les hauts barons de la finance et de l’industrie ; car aujourd’hui la grandeur se mesure à la puissance, et la puissance à la fortune. C’est le cas de répéter : Noblesse des sentiments du cœur, élévation des facultés de l’esprit, que votre éclat est pâle à côté de l’éclat corrupteur de l’or !
Aussi, considérez un honorable rentier, qui s’est acquis à force de travail et de persévérance le droit de se reposer, et vous verrez en quels termes orgueilleux il vous parlera de ses maisons et de ses fermes, de ses champs et de ses vignes, de ses fonds placés sur hypothèques, de ses acquisitions nouvelles, de ses économies, de sa cave, de ses enfants ! Quel contentement de soi-même ! Osez le contredire si vous n’êtes pas plus imposé que lui, et vous verrez comme son éloquence vous foudroiera. Dans cette nombreuse classe d’hommes qui sont arrivés à ne pas voir dans la vie d’autre but que d’attendre la mort le dos au feu et le ventre à table, qui tuent le temps, la nuit enfoncés dans un bon lit de plumes, et le jour en se délectant voluptueusement au soleil comme des lézards, vous trouverez les gens les plus ennuyeux, les plus bêtement suffisants que je connaisse ; ce qui n’empêche pas d’ailleurs qu’on ne doive mettre sur la tombe de chacun, après sa mort : « Il fut bon citoyen, bon époux, bon père et bon ami ». Pour la femme on fait une phrase qui ne rende pas moins hommage à ses vertus publiques et privées. En Province, du reste, cette ovation funèbre ne coûte pas cher. On peut se glorifier dans l’éternité sans faire tort à ses héritiers, quand on part pour ce lointain voyage de la vie future.
Le rentier est un homme essentiellement ami de l’ordre et de la paix. Il n’a qu’une passion politique, celle du statu quo. Il accepte sans discussion tous les faits accomplis, de quelque nature qu’ils soient, et il aime également tous les ministres, à quelque nuance qu’ils appartiennent ; leurs noms lui importent peu. Sous tous les régimes, les ministres sont, à ses yeux, nécessairement, des hommes éminents et de grands citoyens. Pour lui, qui dit mouvement, progrès, dit révolution ; or, pour lui, toute révolution ne se présente que sous l’idée de quelque horrible tempête, de quelque désastreux cataclysme qui doit ébranler notre planète sur son axe. C’est dire qu’à ce mot le pauvre homme tremble de tous ses membres et se cacherait volontiers dans sa cave.
Le rentier est, en effet, le lièvre du genre bimane. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donne la fièvre. Il a donc peur de tout, et comme tous les gens peureux il est excessivement crédule – C’est un homme toujours très rangé, très économe et très réglé dans ses habitudes. Ce n’est pas de ses jours qu’on peut dire qu’ils se suivent et ne se ressemblent pas. Il faut un évènement bien grave pour retarder l’heure de ses repas ou de sa promenade, et quand par hasard la chose arrive, il est malheureux au possible et d’une humeur massacrante.
Ses goûts d’ailleurs sont fort innocents : il aime son chien, sa chatte, ses fleurs. La pêche à la ligne est son exercice favori ; la promenade un de ses premiers besoins. Toutefois, il n’aime pas à se promener seul. C’est une nécessité pour lui d’écouter ou de raconter : autrement il s’ennuierait ; car il a un cerveau qui ne pense pas. Le seul organe qui fonctionne bien chez lui, c’est l’estomac.
À Moulins, vous êtes toujours sûr, dans l’été, de rencontrer le rentier à six heures du soir, enveloppé dans sa grande anglaise, sa canne sous le bras, au rond-point du cours de Bercy. Là il s’entretient avec deux ou trois connaissances ; je ne dis pas deux ou trois amis, car le rentier est trop égoïste pour avoir des amis. Sa mémoire est le répertoire le plus complet des anecdotes locales. Il connaît l’âge, le revenu, la biographie de tous les personnages marquants de la ville, et sait la chronique scandaleuse sur le bout du doigt. Vous l’enchantez quand vous le questionnez sur ce sujet, et vous le transportez au troisième ciel quand vous prêtez une oreille complaisante à ses interminables histoires, toujours assaisonnées au gros sel.
Il mène, comme vous voyez, une existence fort heureuse. En somme, c’est un être tout à fait inoffensif. S’il ne fait pas de bien, du moins ne fait-il pas de mal, et c’est quelque chose dans le monde où nous vivons.
Une classe intermédiaire à celles que je viens d’indiquer, c’est celle des bourgeois, propriétaires de race qui peuplent nos petites villes et nos campagnes ou ils mangent paisiblement les maigres revenus de leurs terres patrimoniales. Cette classe est honnête, considérée, mais oisive, paresseuse, bonne à rien. Son existence ne peut mieux se comparer, tant elle est restreinte, régulière et monotone, qu’à celle d’une huître dans sa coquille. Le bourgeois a passé inaperçu sur les bancs du collège, et plus tard a fait son éducation politique dans le Constitutionnel. Aujourd’hui il lit les journaux économiques à 40 f. Qui dit révolution, dit pour lui, massacre et partage des terres. La loi agraire est son croque-mitaine. Sa vie peut se résumer ainsi : il mange, il se promène dans ses biens, chasse, mange de nouveau, joue, mange encore, et dort du sommeil des bienheureux. C’est l’égoïsme en chair et en os.
Il fait une fois le voyage de Paris, et ne comprend pas qu’on puisse vivre dans cette ville au tumulte infernal. Il complote ce grand voyage pendant plusieurs années, et au jour fixé, jour solennel dans sa vie, où il ferait son testament s’il ne craignait le ridicule, il embrasse sa femme et ses enfants en pleurs, et prend un coin dans l’intérieur d’une diligence. Le voilà empaqueté, serré pendant deux jours et deux nuits à peu près, mourant de faim, dévorant des tourbillons de poussière, et tempêtant dans sa prison où il ne peut remuer ni bras ni jambes. Enfin, il arrive, il débarque. Les douaniers le tracassent, les commissionnaires le martyrisent, les hôteliers le harcèlent ; il est inquiet pour sa valise, inquiet pour sa montre, inquiet pour la ceinture de cuir qui renferme ses économies ; car il sait que les provinciaux sont souvent victimes des innombrables voleurs qui battent le pavé de Paris. Il se fait conduire dans un hôtel qu’on lui a recommandé. Là on le case dans une petite chambre d’où il peut à peine apercevoir un coin du ciel. C’est alors qu’il regrette sa maison et ses domestiques. Pendant quinze jours, il visite les curiosités de la capitale, et marche de désenchantements en désenchantements, dans ces rues boueuses, où il ne trouve pas le plus petit palais de marbre qu’il se figurait dans son imagination. Cependant ; comme il est de règle qu’il faut tout admirer, il admire tout sur parole ; il envoie chaque jour à sa femme le bulletin de ses excursions ; il lui détaille la carte de son restaurant, lui fait le récit des pièces qu’il a vues au théâtre ; lui rend compte de sa visite à la Chambre où il a été introduit par la faveur spéciale du député de son arrondissement. Quand il s’est bien fatigué, bien ennuyé, il achète des jouets pour ses enfants, une robe pour madame, fait des commissions pour tous les habitants de sa ville, et repart en jetant un regard de mépris sur les fous qui préfèrent le séjour d’une cité si bruyante au calme éternel dont on jouit en province. Le brave homme s’imagine en toute conscience connaître Paris, et ne suppose pas que là, comme ailleurs, on puisse avoir des affections, des intérêts et une famille.
C’est au sein de la bourgeoisie que s’élaborent les cancans, qui sont presque son unique et son plus doux passe-temps. Vous connaissez la charmante comédie de Picard, la Petite Ville ; rien de plus vrai, rien de mieux étudié. Sur les plus minces évènements vous entendrez les commentaires les plus ingénieux, les amplifications les plus étourdissantes. La boule de neige qui grossit de plus en plus, est l’image le plus vrai du cancanage, qui est tantôt une innocente malice, tantôt une bonne médisance, le plus souvent une niaiserie pour laquelle les cent bouches de la Renommée trouvent mille échos retentissants. Sans le cancan, le bourgeois mourrait du spleen ; et les femmes, grand Dieu ! dessécheraient sur pied comme des fleurs privées de la fraîcheur de la rosée et des regards du soleil ! Et remarquez bien que les cœurs les plus honnêtes, les esprits les plus droits, se laissent entraîner à ce travers, tant il est enraciné dans les mœurs, tellement il est un impérieux besoin ; pour cela seul, un Parisien prend les villes de nos départements en horreur. C’est là son grand cheval de bataille pour maudire la Province.
Pour ce qui est des femmes de la bourgeoisie, elles sont, avant tout, excellentes mères de famille ; le matin elles vont à la messe, le soir elles font leur partie ; le jour les vieilles tricotent, les jeunes brodent. Nos dames ont la haute direction de la cuisine, écument le pot-au-feu, et veillent à la basse-cour ; c’est ce qu’on appelle, chez nous, une excellente femme de ménage ; c’est la première qualité qu’on exige d’une jeune fille qui va se marier. Si, au besoin, elle peut suppléer le tailleur pour réparer les dévastations que subissent les habits de son mari, vous aurez une épouse accomplie. C’est un des plaisirs que lui réserve l’état de mariage. On s’est donné beaucoup de mal pour lui apprendre la musique : dès qu’elle est mariée il faut y renoncer ; on lui a appris quelques langues étrangères : aussitôt mariée aussitôt la langue doit être oubliée. Jusque-là, il est vrai, elle a nourri son intelligence de la Morale en Action, du Robinson Suisse, et des Contes de M. Bouilly ; mais maintenant on lui permet les romans ; c’est un nouveau monde de passions qu’on offre à sa curiosité. Ou bien elle ne les comprend pas, ou bien ils lui font tourner la tête, la poussent au sentiment, et la rendent fort malheureuse. Vous comprenez que quand elle compare les formes quelque peu rustiques de son maître légitime aux grâces séduisantes des héros qu’on lui dépeint, elle trouve fort triste et fort maussade leur chère moitié.
La vie que mènent les femmes dans notre Province leur serait un lourd fardeau, si elles n’avaient à un très haut degré le sentiment des devoirs que leur impose la famille. Les jours ne se passent point pour elles dans les plaisirs bruyants, dans les fêtes splendides, mais elles ont de calmes et doux loisirs et de tendres affections ; en un mot, ces femmes vivent plus par le cœur que par les sens. Il va sans dire qu’elles ont une profonde admiration pour le génie de leurs maris, ces oracles de la maison, et qu’elles les aiment non point parce qu’ils sont jeunes et beaux, car ils peuvent être antiques et laids, mais parce que cela se doit, parce que la religion l’enseigne et que les mœurs l’exigent. Avec tout cela on fait de bons ménages ; si l’on a peu de désirs, on a peu de mécomptes ; si l’on n’a pas de joies retentissantes, on n’a pas de chagrins poignants : enfin on vieillit en paix et l’on meurt de même.





























