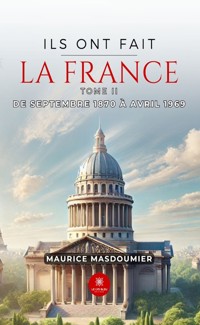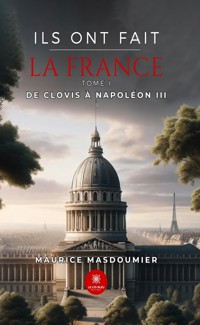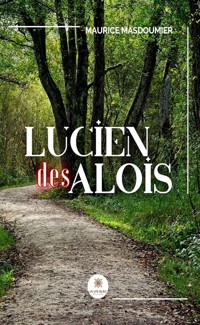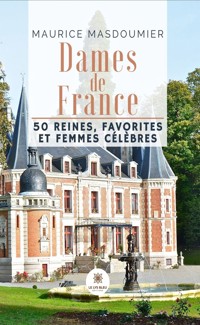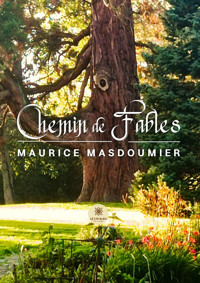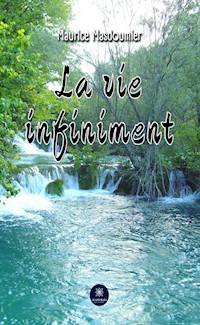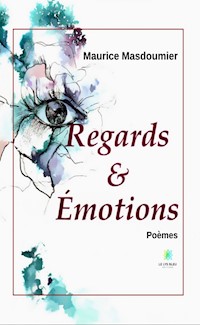Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
"Les pionniers", qu’ils soient hommes ou femmes, ont toujours marqué l’histoire par une audace presque irréelle. Ce sont ces êtres qui, les premiers, ont osé s’aventurer là où personne n’avait osé poser le pied, ouvrant des voies inconnues et incertaines. Par leur persévérance et leur capacité à défier l’impossible, ils ont atteint des sommets qui semblaient inaccessibles. Mais derrière ces succès, un mystère persiste : quel prix ont-ils payé pour ces découvertes ? Risques insensés, audace à la limite de l’inconscience, leurs parcours sont un mélange de préparation, de prises de risques et de secrets. Cet ouvrage nous plonge dans leurs vies fascinantes et nous révèle leurs démarches, leurs luttes et l’impact qu’ils ont eu sur notre monde.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maurice Masdoumier écrit depuis l’âge de 16 ans, s’intéressant particulièrement aux relations humaines. Auteur de poèmes, fables et récits, il s’inspire de la société contemporaine. Il a également exploré l’histoire des fables et publié des ouvrages historiques, dont "Dames de France", sur les femmes influentes de l’Histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurice Masdoumier
Pionniers
Essai
© Lys Bleu Éditions – Maurice Masdoumier
ISBN : 979-10-422-8129-8
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Note de l’auteur
Qu’ils soient femmes ou hommes, les pionniers ont toujours existé, ils représentent « la personne qui a été la première à se lancer dans une entreprise et qui a ouvert un chemin ».
C’est une caractéristique de certains éléments de l’humanité, qui, par leur démarche poussée à l’extrême, par leur pertinence et persévérance dans un domaine ou une direction, ont atteint ce qui semblait inaccessible.
Leur aboutissement ayant permis d’établir une ligne de vie, de nouvelles pratiques, ou de connaître de nouveaux espaces.
Leurs démarches furent structurées, préparées, accompagnées d’une dose d’inconscience, de prise de risques, parfois involontaires, de mystifications… mais nous leur devons un changement, une nouvelle connaissance, une nouvelle pratique dans nos vies.
Ces personnages m’ont toujours émerveillé, attisé ma curiosité et suscité mon admiration.
« Ils sont le moteur du progrès dans nos Sociétés. »
Je n’ai pu tous les recenser, mais le panel que j’ai mis à l’honneur fera mieux connaître aux lecteurs ce qui fait le progrès et le changement.
J’en ai cité quelques-unes et quelques-uns dans mes ouvrages « ILS ONT FAIT LA FRANCE » ou « DAMES DE FRANCE », j’en dresse une liste indicative en fin du présent livre, dont les portraits rapides viennent s’ajouter à ceux que je propose ici.
Les peuples du bassin méditerranéen : Égyptiens, Carthaginois, Grecs… dont les civilisations étaient très développées, ont produit des individus qui, dès qu’ils furent dotés de navires et de la maîtrise de se repérer pour naviguer, sont allés, soit commandités par leurs monarques soit par leur propre décision, voir au-delà de leur espace de connaissances traditionnelles.
D’autres, érudits et dotés de connaissances fort développées, ont poussé leurs savoir à l’envi pour comprendre les espaces où ils vivaient ainsi que les mystères de l’univers.
Leurs aventures ou explorations n’étaient cependant pas dénuées d’intérêts commerciaux.
Les premiers portraits que je propose illustrent la richesse des connaissances que les « sachant » de ces périodes possédaient et la curiosité qui les animait.
Mon énumération s’étale de la période « avant Jésus Christ » jusqu’à nos jours et certains de celles ou ceux que je mets en exergue sont encore parmi nous.
Tapputi Belatekallim
La première chimiste et alchimiste connue, elle vivait au XIIIe siècle avant Jésus Christ dans l’ancienne Mésopotamie.
Son existence nous est connue grâce à une tablette d’argile gravée, aujourd’hui conservée au Vorderasiatisches Museum, Berlin, Allemagne.
En dehors de ses activités d’alchimiste, elle était la parfumeuse principale à la cour du roi Tukulti-Ninurta (1245 – 1208 avant J.-C.) en Assyrie.
Elle n’était pas la seule au service de la réalisation des parfums de la cour, mais c’était elle qui régnait sur le personnel affecté à ces travaux.
Dans l’ancienne Mésopotamie, le parfum était une offrande religieuse standard et souvent utilisé pour oindre les icônes dans les sanctuaires au sommet des ziggourats (pyramides de Mésopotamie).
Il était également utilisé comme le parfum aujourd’hui et sa fabrication nécessitait une grande habileté.
Tapputi et les autres personnels qu’elle dirigeait utilisaient des fleurs, de l’huile, du calamus, du cyperus, de la myrrhe et du baume pour fabriquer une variété de parfums.
C’est elle qui aurait été la première à utiliser un alambic, sans doute de sa création.
Elle a également écrit le premier traité sur la fabrication des parfums.
Elle a développé des techniques, révolutionnaires pour l’époque, dans la distillation, l’enfleurage à froid, la teinture, l’extraction des parfums.
Elle a également développé une technique d’utilisation de solvants (comme l’eau distillée et l’alcool de grain) pour rendre les parfums plus légers, plus brillants, plus profonds et plus durables que ceux de toutes les autres huiles parfumées.
Tapputi est un exemple qui nous montre que, depuis fort longtemps, les femmes ont occupé des fonctions importantes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie, des mathématiques… même si les sociétés dans lesquelles elles ont vécu limitaient très souvent leurs droits.
Hannon le Navigateur
Explorateur carthaginois du Ve siècle avant J.-C. Né à Carthage vers 480-440 av. J.-C.
Roi de Carthage.
Le récit de son voyage fut d’abord gravé sur des plaques de marbre conservées au temple de Kronos, détruites aujourd’hui, mais un manuscrit est resté et permet de suivre son périple.
Il a quitté Carthage avec une flotte de navires à voiles carrés et dotés de rameurs.
La mission consistait à naviguer au-delà des colonnes d’Hercule (détroit de Gibraltar), puis d’explorer la côte ouest de l’Afrique, d’y créer des comptoirs ou de développer ceux qui existeraient déjà, jusqu’à l’île de Cerné, puis d’explorer au-delà.
La flotte aurait été composée d’une soixantaine de navires ayant chacun une cinquantaine de rameurs.
L’on dit que trente mille personnes étaient à bord : cinq mille paraît plus vraisemblable.
Il semble logique que la flotte ait navigué près des côtes étant donné son gréement.
Le premier circuit se fait en cinq étapes :
De Gadés jusqu’à l’embouchure de l’oued Sebou, près de Kénitra ;
De l’oued Sebou jusqu’au cap Beddouza, puis retour vers Tanger à Lixus ;
De Lixus à l’île de Cerné (côtes de Mauritanie) ;
Expédition de reconnaissance dans le delta du fleuve Sénégal
;
Expédition jusqu’au golfe de Guinée.
Et retour.
Compte tenu des langues parlées par les populations rencontrées, il fut parfois difficile d’établir des relations.
Selon son récit il ne trouve rien de concluant, il a dû croiser le mont Cameroun et un volcan du cap Vert, s’approcher des îles Canaries ainsi que des îles du cap Vert.
La récolte est modeste même s’il rencontre des curiosités voir des indigènes, tels des pygmées, des gorilles et des volcans en éruption.
Pourtant, ses voyages sont célébrés dans l’antiquité.
Il est, sans doute, celui qui a ouvert la voie aux grands navigateurs et à leurs explorations.
Marie la Juive
(aussi appelée Maria Hebraea ou Miriam Prophetissa)
IVe ou Vème siècle avant J.-C.
Marie vit vraisemblablement en Égypte, au cours de la période hellénistique et en pleine période d’essor de l’alchimie occidentale.
Ce que nous savons de cette personne nous est parvenu par les écrits laissés par l’alchimiste grec Zosime de Panapolis qui vécut à Alexandrie vers l’an 300
Zosime cite une œuvre attribuée à Marie la Juive, sur les fourneaux et les instruments (Peri kaminon kai organon), qui décrit des outils et instruments de métal, de verre et d’argile, utilisés pour la cuisson ou la distillation.
Le dispositif le plus célèbre qui lui est attribué est le bain-marie, méthode visant à réchauffer une substance en la plaçant dans un récipient rempli d’eau chaude.
Peut-être utilisé plus tôt dans la médecine grecque, le bain-marie est resté attribué à Marie, la Juive qui lui donne son nom.
D’autres outils sont attribués à Marie la Juive et décrits par Zosime : le « tribikos », un alambic en cuivre disposant de trois vases récepteurs, et la « kérotakis », un alambic en vase clos permettant aux alchimistes de soumettre des métaux à l’action de différentes vapeurs.
Marie la Juive a marqué durablement l’histoire de l’alchimie et nombre de ses successeurs la citent et encouragent à propager ses travaux.
Ce fut le cas jusqu’au 10e siècle, puis à partir de là, elle semble être entrée dans une phase d’oubli.
Elle a laissé quelques citations qu’elle énonce sous forme de principes qui méritent une réflexion partagée, en voici deux exemples :
Unissez le masculin et le féminin, et vous obtiendrez ce que vous souhaitez.
Un devient deux, deux deviennent trois, et du troisième naît l’un comme quatrième.
Celui-ci est cité comme « l’axiome de Marie ».
Pythéas le Massaliote
Entre le 4e siècle et le 3e siècle avant J.-C.
Astronome et explorateur
C’est un astronome grec, il doit être considéré comme l’un des plus anciens et premiers explorateurs scientifiques ayant laissé une importante trace dans l’Histoire.
C’est un scientifique, un mathématicien, un géographe, un astronome, un philosophe, mais aussi un naturaliste et un anthropologue.
Comme son nom l’indique, il est de Massalia, l’ancienne cité devenue Marseille.
C’est l’un des plus anciens auteurs que nous connaissions qui a décrit les phénomènes polaires, les marées, les effets de la lune, le mode de vie des peuples du nord de l’Europe.
Le récit de son voyage dans les mers et continents de l’Europe du Nord, qu’il effectua vers 325 avant J.-C. n’a pas été conservé, nous en connaissons l’essentiel grâce aux écrits de Pline l’Ancien notamment.
C’est avant tout un scientifique, et les soutiens à son expédition semblent potentiellement être de deux origines :
Alexandre Le Grand qui l’aurait commandité dans le cadre de ses recherches sur la compréhension du monde ;
La ville de Massalia devenue l’une des cités les plus prospères de la Méditerranée, et qui l’aurait financièrement soutenu.
Le but de son expédition était avant tout scientifique, il avait déjà effectué des recherches sur la mesure des latitudes et souhaitait les approfondir.
Il voulait établir une « table des latitudes » et vérifier les phénomènes que démontrait la géométrie, mais qu’il fallait prouver par des mesures sur le terrain.
Son expédition était bien préparée, notamment par le choix du navire : (selon la documentation rapportée) une galère mixte du IVe siècle avant J.-C., du type catascopium (bateau d’observation) avec un bordé doublé pour résister aux glaces de la mer du Nord.
Il n’est pas impensable qu’il ait réalisé à la fois de la navigation au long cours comme du cabotage.
L’itinéraire de son voyage est incertain : après être entré dans l’Atlantique, il croise l’Armorique et la Grande-Bretagne.
Au large des Orcades il atteint une région où la nuit ne dure que deux heures, il évoque l’île de Thulé qui pourrait être l’Islande, puis une zone où la navigation devient impossible au milieu d’un mélange de glace et d’eau, il est proche de la banquise.
Il est vraisemblable qu’il ait pu observer le soleil de minuit.
L’association de son nom à l’ambre laisse penser qu’il a pu explorer la mer Baltique où il a pu rencontrer le peuple des Teutons voir découvrir l’embouchure de l’Elbe.
L’on ne peut pas écarter l’hypothèse qu’il ait réalisé plusieurs voyages dans les mers du nord.
Par ses observations :
Il décrit le paysage du cercle polaire et les phénomènes qu’il y a observés ;
Il positionne avec précision le pôle céleste ;
Il contribue à prouver la rotondité de la terre, qui devient désormais une connaissance scientifique et non plus une hypothèse ;
Les mesures qu’il fait sur la latitude sont d’une précision remarquable ;
Il a pu comprendre et expliquer dans ses écrits le phénomène des marées et leur synchronisme avec les phases de la lune.
Grâce à ses travaux, Marseille est sans doute la première ville au monde dont on connaisse les coordonnées avec précision et qui en fait « le berceau des latitudes ».
Marseille ne l’a pas oublié :
Un collège et une rue parallèle à la Cannebiere portent son nom ;
Une statue et une stèle lui sont dédiées ;
Le musée d’Histoire de la ville édifié sur le site du port antique évoque son histoire.
Aglaonice de Thessalie
Elle vit au 2e siècle avant Jésus-Christ, ce que l’on sait, c’est qu’elle est la fille d’Hégétor, le roi de Thessalie, cette riche province fertile du centre de la Grèce, près du mont Olympe.
Aglaonice vient du grec ancien : aglaos « lumineux » et nike « victoire ».
C’était une femme cultivée qui avait étudié les astres, et, de ses nombreuses observations, elle avait tiré un grand savoir : c’est la première femme astronome de Grèce que l’on connaisse.
Elle fut « nourrie » des travaux de Thalès de Milet et de ceux d’Anaximandre qui au Vème siècle avant J.-C fit l’hypothèse du géocentrisme : le premier, il donna à l’univers la forme d’une sphère, dont la Terre, cylindrique, occupe le centre.
Il est l’auteur de la première théorie astronomique non mythologique.
Aglaonice était considérée comme « la maîtresse des astres » et la vox populi la considérait comme une sorcière, tant son savoir et son pouvoir de prédiction impressionnaient ses contemporains.
Elle était sans doute une grande prêtresse.
Aglaonice, à l’évidence, était très cultivée, elle avait reçu une éducation poussée dans le domaine des sciences et particulièrement de l’astronomie.
Il est probable qu’elle connaissait les cycles lunaires et solaires, lui permettant de déterminer l’occurrence des éclipses et qu’elle s’est livrée à des études sur ce sujet (malheureusement nous ne disposons d’aucune trace de ses travaux).
En effet le « saros » est déjà bien connu des astronomes babyloniens (le saros est, en astronomie, une période de 223 mois synodiques ou lunaisons qui peut être utilisée pour prédire les éclipses de Soleil et de Lune)
En fait c’est à travers les écrits de Plutarque que nous comprenons mieux la situation.
Il nous dit d’elle : qu’elle connaissait la cause des éclipses complètes de lune et prévoyait le moment où il arrive à cet astre d’entrer dans l’ombre de la terre.
Son savoir lui donnait l’occasion d’abuser des autres, notamment en leur affirmant qu’elle faisait « descendre la lune », et l’on disait qu’elle avait le pouvoir de commander à la lune, tout simplement parce qu’elle savait prévoir les éclipses.
C’est un mythe que l’on a souvent retrouvé dans les romans ou les bandes dessinées, et qui donne un pouvoir à ceux « qui savent » par rapport « au plus grand nombre » qui, ignorant de ces phénomènes, les craint et considère ceux qui semblent les maîtriser comme des êtres surnaturels.
Sa réputation a laissé des traces dans notre Histoire, c’est ainsi que l’un des cratères de la planète Vénus porte son nom, de même qu’un astéroïde.
Son nom est entré dans l’art contemporain, ainsi que dans le film Orphée de Jean Cocteau, où son rôle est tenu par Juliette Gréco.
Elle appartient aux grandes Dames de l’Histoire.
Hypathie d’Alexandrie
Elle serait née entre 335 et 350 et décédée en 415.
Elle est la fille du mathématicien Théon d’Alexandrie, et elle vit sous le règne de l’empereur Flavius Arcadius.
L’on ne sait que peu de choses sur sa famille ni sur les détails de son éducation.
Son père dirige une école dénommée Mouseion, ainsi que la grande bibliothèque d’Alexandrie, et il est vraisemblable qu’elle a reçu une éducation privée au sein de sa famille, puis fréquenté l’école dirigée par son père.
Rappelons-nous : Alexandrie est la cité la plus florissante de l’Antiquité tardive.
Au IVe siècle, la ville fondée par Ptolémée est le centre intellectuel, artistique et commercial de toute la Méditerranée.
Trait d’union entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, Alexandrie est une métropole multiculturelle où vivent des populations très diverses et où la philosophie brille de mille feux.
C’est dans ce foyer majeur des sciences et des lettres qu’Hypatie est formée à la philosophie.
Elle est initiée aux disciplines du quadrivium qui comprend l’arithmétique, la musique, la géométrie et l’astronomie.
La fille de Théon d’Alexandrie suit les préceptes de l’école pythagoricienne, comme de nombreux philosophes de culture hellénistique.
La jeune femme se fait remarquer pour son éloquence et son érudition.
Elle commente Platon et Aristote, mène ses propres recherches en astronomie et acquiert des connaissances remarquables en mathématiques et en philosophie.
Très jeune déjà, Hypatie est considéré comme un membre éminent de l’école néoplatonicienne d’Alexandrie, un courant philosophique antique alors en plein essor.
Célibataire, menant une vie respectable, affranchie de tout compromis, elle est l’égale des plus grands, voir les domine par son érudition, ses travaux et ses enseignements reconnus et que l’on vient suivre du monde entier.
Drapée dans le manteau des philosophes, la savante arpente les rues de sa cité et y explique publiquement la pensée des grands érudits, à la manière d’un homme.
Elle est libre de ses pensées et refuse de se convertir au christianisme, lequel, autorisé par l’empereur Constantin en 313, s’impose comme la religion officielle de l’empire.
Et en 391 l’empereur Théodose Ier fait détruire les « temples païens », ce qui entraînera la fermeture du Musée de la Bibliothèque, pourtant lieu dédié à la connaissance.
C’est à partir de cette époque qu’Hypatie commence à déranger certains chrétiens.
En 412, Cyrille devient le nouveau patriarche et ce dernier veut installer la religion chrétienne la plus pure.
Il va s’efforcer d’éradiquer le paganisme, il mène une répression brutale des juifs ainsi que des chrétiens qu’il juge hérétiques.
Au même moment le pouvoir impérial romain est représenté par le Préfet Oreste, préfet de la province et qui demeure inflexible sur les principes de vie de l’empire.
L’affrontement entre les deux hommes est sans merci et il est un fait : c’est que « les pouvoirs religieux et politique s’affrontent dans le sang »
Hypathie est une amie d’Oreste, comme d’autres hauts personnages de l’époque et sa volonté d’indépendance de pensée tout comme sa renommée agace profondément Cyrille.
Il la considère comme une « païenne insoumise » et ne peut le tolérer.
Le pouvoir religieux pousse à l’émeute contre Oreste et fait courir de multiples propos visant à discréditer Hypathie, elle s’est attiré la jalousie de l’évêque.
Un soir qu’elle rentre chez elle, lors du carême de l’année 415, elle est prise à partie par les troupes de la confrérie chrétienne des Parabalani (confrérie qui à l’origine était au service des malades, mais qui, sous l’autorité de Cyrille, s’est transformée en « milice » de répression anti païenne).
Hypatie est lynchée à coups de pots cassés et de coquilles d’huîtres, elle est traînée dans une église où elle est mise à mort, découpée et brûlée ; un véritable massacre dont l’Église se félicite, pour preuve : L’évêque égyptien Jean de Nikiou décrit une exécution salutaire et se félicite que la ville eût été délivrée des derniers restes de l’idolâtrie.
Quand le fanatisme religieux est gêné par la libre pensée : il la détruit.
Dans l’enquête qui fut menée, rien ne fut cité contre Cyrille, les Parabalani furent retirés de son autorité et placés sous celle du Préfet.
Hypathie reste dans notre histoire un exemple de courage et de libre pensée.
Sa mort subite non seulement laisse son héritage sans protection, mais aussi menace toutes les valeurs et les idéaux qu’elle défendait.
Hypathie devient un martyr de la philosophie.
Plus tard, cela n’empêchera pas Cyrille d’Alexandrie d’être reconnu comme saint par les orthodoxes et les catholiques.
Les Vikings
Peuples du Nord dont la période d’action et de domination se situe entre 750 et 1050
On les décrit comme un ensemble de peuples conquérants et barbares, mais il convient de regarder d’un peu plus près ce qui les animait.
Ce sont des peuples différents qui vivaient sur l’espace de l’actuelle Scandinavie et de la Norvège, ils vivaient de la culture de la terre et d’échanges commerciaux tout d’abord entre eux, puis avec les pays voisins.
Ils se querellaient entre peuples et allaient jusqu’à se faire la guerre entre eux.
Manquant d’espaces et de terres à cultiver, d’autant plus que le climat sous lequel il vivait n’était pas favorable à travailler le sol, ils entreprirent de s’implanter au-delà de leurs territoires.
À bord de leurs navires, ils vont parcourir les mers du nord et les fleuves : la mer de Barentz, la mer Noire, la mer du Nord, la mer de Norvège, l’océan Atlantique, et la mer Méditerranée.
Ils ont visité tous ces territoires, les ont souvent pillés.
En France ils ont remonté la Seine à plusieurs occasions, se livrant à des pillages et massacres après avoir pris pied sur la côte en Normandie (le pays des Normands, qui est leur autre nom).
Ce territoire leur avait été concédé comme « pied à terre » par le roi de France qui, ainsi, obtenait une relative paix avec eux.
Ils sont allés vers l’ouest, visitant les îles Britanniques, occupant les îles Féroé, l’Islande, puis l’ouest du Groenland.
Poussant plus à l’ouest, ils ont abordé une terre qu’ils ont appelée le Vinland, qui en fait est l’île de Terre-Neuve ainsi que les terres autour du golfe du Saint-Laurent : ceci se passe autour de l’an mil et est l’œuvre de Leif Erickson.
Ils auraient donc découvert le continent américain cinq siècles avant Christophe Colomb.
Partout ils vont rencontrer l’hostilité des populations locales, vont livrer bataille et être soumis à de durs et sanglants combats qui leur infligèrent de lourdes pertes.
C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas poussé leur avancée plus vers l’ouest et qu’ils se sont retirés de cette terre qu’ils avaient découverte.
Leurs bateaux, les drakkars, étaient adaptés au type d’expédition qu’ils conduisaient, bateaux aptes à naviguer en mer ou sur les fleuves, à la voile, à la rame, à fond relativement plat que l’on pouvait aussi faire rouler sur terre afin d’aller d’un fleuve à l’autre.
Bateaux de guerre ou de commerce, car ils n’étaient pas que guerriers conquérants.
Les équipages pouvaient être mixtes avec des femmes guerrières ou chefs de mission.
Ils ne connaissaient pas la boussole, peut-être utilisaient-ils la « pierre de soleil », mais surtout ils se fiaient à l’observation des courants, des types de poissons qu’ils rencontraient, au soleil et aux étoiles.
Le XIe siècle marque le début de leur déclin : l’on parle beaucoup d’un changement climatique et d’une élévation de niveau de la mer qui les auraient obligés à un repli vital ?
Différentes thèses s’affrontent sur ce même sujet, il faut encore laisser du temps aux différentes études qui ont lieu sur ce sujet.
Niccolo et Mattéo Polo et les marchands vénitiens
Niccolo Polo (v1230 – v1294) et Mattéo Polo (v1230 – v1309).
Père et oncle de Marco Polo.
Marchands vénitiens qui vont oser aller implanter des comptoirs commerciaux à Constantinople, puis en Crimée et dans l’Empire mongol.
Depuis le 12e siècle, les marchands vénitiens ont des échanges avec l’Orient, la famille Polo en représente l’apogée et la pénétration la plus poussée par des marchands.
Ils ont été précédés par des moines, prêchant le Christianisme, qui ont parfois subi un mauvais sort.
En 1264, accompagné d’un émissaire de Kubilai Khan (petit fils de Gengis Khan) qui est le chef de la dynastie des Yuans, ils se mettent en route pour aller le rejoindre.
Et c’est en 1266 qu’enfin ils parviennent au palais où ils sont reçus.
Le monarque les reçoit avec bienveillance et les charge d’une mission auprès du Pape Clément IV : fortement marqué par le christianisme et ce qu’il enseigne, le Khan demande à ce qu’on lui envoie cent personnes instruites pour venir enseigner le christianisme et les coutumes occidentales à son peuple etde l’huile de la lampe du Saint Sépulcre.
Il leur remetune tablette en or, d’environ trente centimètres par huit, objet réservé aux personnes importantes et qui leur permet d’obtenir le logement, la nourriture et les chevaux sur tout le territoire du Khan.
Lorsqu’ils arrivent à destination en 1268, ils constatent que le pape est mort et il leur faudra attendre 1271 pour la désignation de son successeur Grégoire X.
Celui-ci s’empresse de répondre à la requête du Khan et charge les frères Polo accompagnés du jeune Marco et de deux moines de procurer au Khan ce qu’il souhaite.
L’expédition atteindra sa destination en 1274.
Les Polo vont passer les dix-sept années suivantes en Chine au service du Khan qui apprécie particulièrement le jeune Marco pour ses talents de conteur et il va également lui confier de nombreuses missions au sein de son empire.
Les Polo ne sont pas vraiment retenus prisonniers, mais ils ne peuvent partir pour rentrer chez eux sans l’accord du monarque.
C’est seulement sur la fin de son règne qu’il va leur confier une mission qui va les ramener sur leurs terres.
Partis en 1291, ils atteindront Venise en 1293/1294.
Marco Polo, au service du grand Khan, est une sorte d’ambassadeur et de gouverneur : Il parcourt le pays.
Observateur attentif, il décrit les paysages de l’Asie Centrale, recueille des légendes, observe la vie quotidienne, les coutumes et les mœurs des peuples visités et dresse le fascinant tableau d’un royaume où cohabitent pacifiquement diverses religions.
Il évoque un pays dans lequel l’or et la soie abondent, mais où l’on utilise aussi un étrange minerai et une huile visqueuse, auxquels on donnera plus tard les noms de charbon et de pétrole.
Et, surtout, il trace l’attachant portrait d’un empereur idéal, le Grand Khan Koubilaï.
Emprisonné à Gênes, la cité rivale de Venise, il dicte en 1298 ses souvenirs à un codétenu, Rusticello de Pise.
Le succès de son Livre des merveilles, connu en français sous différents titres (Le Devisement du monde, La Description du monde, Le Livre de Marco Polo) est immédiat.
Marco Polo décède le 8 janvier 1324 à Venise, sa sépulture est en l’église San Lorenzo.
Zheng He
1371 (Yunnann Fu) – 1433 (Kozhikode en Inde)
Il est un eunuque chinois musulman et un explorateur maritime, que ses voyages amenèrent jusqu’au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est. Il est l’un des rares à se voir attribuer le titre bouddhique de Sanbao Taijian
« Grand Eunuque aux trois joyaux »
Né de confession musulmane, il fut placé au service de l’Empereur mongol, mais, lors de la prise de pouvoir des Ming, il fut arrêté puis castré et envoyé dans l’armée.
Il se fait apprécier par l’empereur, puis il se distingue lors des batailles, ce qui fait de lui un amiral, puis le ministre de la Navigation maritime.
Il va alors organiser sept expéditions maritimes qui ne sont pas des expéditions guerrières, Zheng He ne soumet pas les populations ni ne les réduits en esclavage, au contraire, il va même dans la plupart des cas les protéger, notamment contre les pirates japonais et coréens.
Cette attitude est reprise et diffusée de nos jours, politiquement, pour montrer les intentions traditionnelles non belliqueuses de la Chine.
Les grandes expéditions maritimes sont à la fois des entreprises de prestige, des expéditions militaires, des voyages diplomatiques et de grandes tournées commerciales destinées à procurer à la Cour, contre des produits de luxe chinois, des denrées exotiques, et des produits de luxe étrangers.
Les expéditions de Zheng sont soutenues par le royaume qui met à sa disposition les moyens matériels et humains pour la construction des jonques avec lesquelles il navigue.
Il y aurait eu une centaine de jonques de construites.
Les jonques étaient de taille gigantesque, la vérité est difficile à établir, mais il semble que certaines pouvaient faire 130 mètres de long, 55 de large et compter 9 mâts d’autres, plus petites et plus maniables, mesuraient 60 mètres et disposaient de 4 mâts.
Zheng He ne cherche pas de nouvelles voies, il emprunte les voies ouvertes avant lui, notamment par les Arabes.
Il effectue sept expéditions qui vont se solder par de nombreux échanges humains et commerciaux.
Il aura exploré :
Les côtes de l’Asie du Sud-Est, avec Java et Sumatra ;
De nombreuses contrées de l’océan indien (actuel Sri Lanka) ;
La mer Rouge jusqu’en Égypte ;
Les côtes africaines jusqu’au Mozambique.
Il noue des relations avec le sultan de Malindi (Kenya).
Il met un terme aux raids pirates dans le détroit de Malacca.
Les échanges commerciaux sont nombreux.
D’un de ces voyages, il ramène une girafe de Malindi, un bourg swahili (actuel Kenya), qui est considérée en Chine comme un exemplaire du qilin, un animal légendaire.
De l’or, de l’argent, de la porcelaine et de la soie sont échangés contre de l’ivoire et des animaux exotiques, tels le zèbre, le dromadaire ou l’autruche.
Beaucoup de voyages ont été attribués à Zheng He, mais n’ont pu être prouvés, certaines hypothèses lui font faire le tour du monde, voir lui accorde la primauté de voyages vers le pôle nord.
De nos jours il bénéficie en Chine d’une authentique vénération :
Des temples lui sont dédiés ;
En 2005, la Chine a célébré le 600e anniversaire de ses voyages ;
De nombreux récits et reportages ont été publiés dans
« le quotidien du peuple »
soulignant le côté pacifique de son œuvre ;
Une mosquée portant son nom a été construite à Surabaya.
Zheng He, âgé et malade, décéda sur le chemin du retour de son septième voyage, probablement au large de Calicut en Inde.
Son corps aurait été incinéré et les cendres dispersées en mer.
Après la mort de Zheng He, les voyages furent arrêtés, la flotte démantelée, la Chine se referma sur elle-même.
Quelques décennies plus tard, les navigateurs occidentaux s’engageaient à leur tour dans les grandes navigations.
Mais ils n’égalèrent jamais Zheng He.
Les grands navigateurs
Avec eux, c’est l’avènement des temps modernes, c’est le début d’une vie en connexions sur l’ensemble de la planète : notre monde entre dans une nouvelle ère au sein d’un nouvel espace de communication et de partage.
Ils sont d’origine italienne, espagnole ou portugaise, mais naviguent pour les monarques de la péninsule ibérique, ceux qui sont à la tête des royaumes influents de l’époque.
Ce temps avait été initié par Zheng He et ceux que nous citons dans cet ouvrage en sont les artisans.
C’est une « borne » dans notre Histoire.
Christophe Colomb (1451 – 1506)
Génois d’origine, il se met au service des rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon.
Il effectue plusieurs grands voyages de recherche des terres lointaines, dans ses objectifs : l’accès aux Indes et à la Chine par la mer.
Le premier voyage :
Trois caravelles quittent Palos de Moger le 3 août 1492, après une descente vers le sud, la flotte aborde les Canaries où ils vont rester un mois, puis, profitant des alizés, le cap à l’ouest est donné.
Le voyage est difficile et le moral se perd au fil des jours.
Une terre est en vue le 11 octobre : c’est Guanahani que Colomb baptise San Salvador (le saint sauveur), un lieu paradisiaque et luxuriant où les indigènes vivent nus et sont accueillants.
La flotte repart et aborde Cuba, où le contexte est identique, mais où les indigènes fument des plantes séchées.
Puis c’est le tour d’Hispaniola devenue Haïti où, enfin, un chef leur offre un masque d’or, ce qui les remplit d’espoir d’en trouver plus.
Un des bateaux s’est abîmé sur les rochers, les Espagnols construisent un abri pour laisser sur place 39 hommes qu’ils reviendront chercher plus tard.
Le retour se fait en passant par les Aç0res où ils font halte pour réparer un bateau, les Portugais les accueillent timidement, mais, en Espagne, le retour est triomphal.
Colomb prépare aussitôt un 2e voyage :
Le départ a lieu le 25 septembre 1493, il fait à nouveau relâche aux Canaries pour charger des plans de canne à sucre.
Choisissant une route plus méridionale, il atteint les premières terres plus au sud en Dominique le 3 novembre, puis ce seront Marie Galante, les Saintes, la Guadeloupe, mais les habitants sont plus hostiles et se livrent parfois à l’anthropophagie.
Des affrontements ont lieu sur l’île Sainte-Croix et ils atteignent enfin Haïti.
Le campement qu’ils avaient laissé n’est plus là, ceux qui étaient restés se sont livrés à des exactions et abus sur les indigènes et ceux-ci ont fini par les tuer.
Christophe Colomb et ses équipages armés se livrent à de terribles représailles.
Le 2 janvier une nouvelle colonie est fondée près des gisements aurifères de Cibao, La Isabella.
Colomb s’en déclare gouverneur.
Un fort et des moyens de défense sont édifiés.
La navigation découverte continue et il reconnaît la Jamaïque.