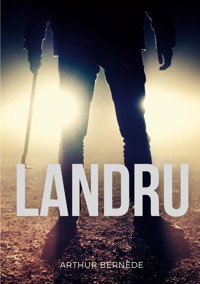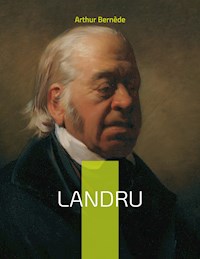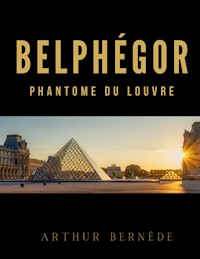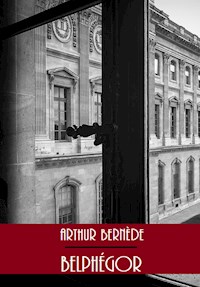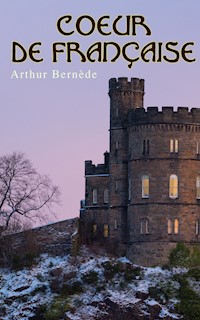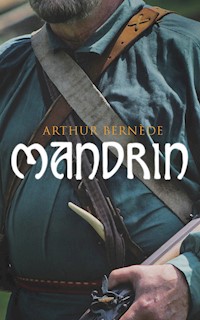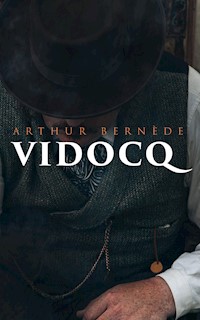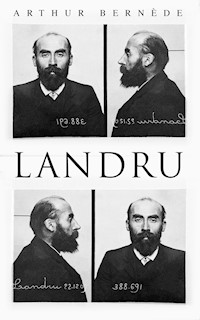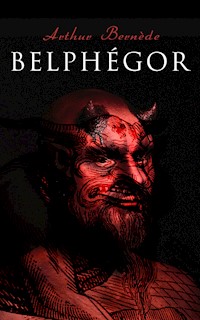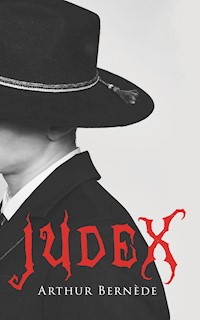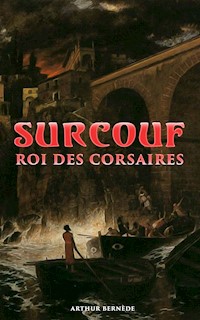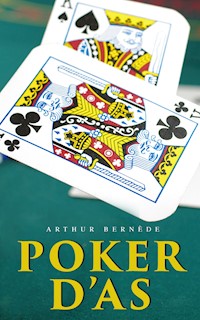
0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
Avec Poker d'as, Bernède signe un roman policier passionnant et original. La marquise de Rhuys a deux fils, des jumeaux aux caractères et aux vies totalement différents : le premier, Robert, est un écrivain reconnu et même académicien. Le deuxième, Jean, est un aventurier surnommé Poker d'As au passé plus tumultueux. Il a en effet commis un crime et vit donc à l'étranger pour se faire oublier. Il revient en France avec l'intention de dérober de l'argent à sa mère mais Robert le surprend. L'altercation qui s'ensuit est fatale : Robert tue Jean. Pour que le déshonneur ne tombe pas sur la famille, Robert va prendre l'identité de Jean et faire croire à son propre décès. Une situation des plus compliquées à tenir qui va engendrer de nombreux rebondissements. Arthur Bernède (1871 - 1937), est un romancier populaire français. Auteur très prolixe, il a créé plusieurs centaines de personnages romanesques, dont certains, devenus très célèbres, tels que Belphégor, Judex et Mandrin, ont effacé leur créateur. Il a également mis en scène Vidocq, inspiré par les exploits de ce chef de la Sûreté haut en couleurs. Il est également connu sous les noms de plume de Jean de la Périgne et de Roland d'Albret.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Poker d’As
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE : Le malheur près de la porte.
I : L’homme au chapeau marron.
Le 15 janvier 1926, l’Académie française procédait à la réception du comte Robert de Rhuys, ancien ministre plénipotentiaire et écrivain de grand talent.
Sous la coupole, c’était l’élégante affluence des grands jours.
Dans l’assistance, parmi toutes les illustrations de la littérature, des arts, de la politique et de l’aristocratie française, on remarquait la marquise douairière de Rhuys, dont la toilette sombre, discrète, rehaussait encore une distinction qui eût paru assez distante, presque hautaine, si un regard, tout de bonté lumineuse, n’eût éclairé ses traits demeurés très purs malgré les années.
Près d’elle était assise une jeune fille délicieusement jolie, toute rayonnante de jeunesse et de charme.
C’étaient la mère et la fille du nouvel académicien.
Toutes deux, sans chercher à dissimuler leur légitime orgueil et leur douce émotion, écoutaient attentivement le maître JB. Lerson, l’illustre professeur en philosophie, qui remplissait l’office de récipiendaire.
Dans un discours fréquemment coupé de murmures flatteurs et d’applaudissements unanimes, après avoir salué en M. de Rhuys l’une des plus nobles figures de notre époque, l’éminent philosophe poursuivait :
« Descendant d’une vieille famille tourangelle, héritier d’un nom et d’une fortune considérables, ancien élève de l’École des Chartes, après une courte mais brillante carrière diplomatique et à la suite d’une perte cruelle qui semblait avoir à jamais endeuillé vos légitimes espérances, vous avez voulu vous consacrer à l’étude de la sociologie et de l’histoire.
« Vous avez publié plusieurs livres de haute valeur, qui ont tout de suite attiré sur vous l’attention des lettrés et des érudits, et votre dernière œuvre, le Droit des peuples au bonheur, toute vibrante d’humanité, vous a valu le prix Nobel en même temps que l’admiration et le respect de toutes les hautes individualités de notre temps.
« Mais cela, monsieur, ne vous a pas suffi. L’activité de votre cœur s’est révélée au moins égale à celle de votre esprit, puisque, à la tête de nombreuses œuvres de bienfaisance, vous consacrez une partie de vos revenus au soulagement des malheureux. Voilà pourquoi votre nom est devenu pour tous le synonyme des mots : devoir, justice et bonté !
Tandis qu’une longue ovation saluait cet éloge si digne de celui en faveur duquel il était prononcé, la baronne Sternheim, femme du gros banquier de la rue de Castiglione, se penchait vers la grande poétesse française Marthe de Dolignac et lui murmurait, sur ce ton de rosserie permanente qu’elle donnait au moindre de ses propos :
— Vous voyez cette chaise vide ?
— Près d’Huguette de Rhuys ?
— Oui… Vous devinez sans doute à qui elle était réservée ?
— A Henri de Kergroix ?
— Naturellement.
— Pourquoi n’est-il pas là ?
— Je vous le demande.
— C’est également ce que doit se dire la jeune Huguette.
— Le fait est que j’ai remarqué qu’elle avait sans cesse les yeux dirigés vers la porte d’entrée.
— Tenez, en ce moment, elle se penche vers sa grand-mère.
— Comme elle a l’air triste !
— Il y a de quoi !… Kergroix n’est-il pas presque son fiancé ?… Et il me semble que sa présence…
M. de Rhuys se levait pour répondre à JB.Lerson… Mais, avant que le silence se fût complètement rétabli, Huguette, après avoir réprimé un profond soupir, glissait à l’oreille de la marquise :
— Grand-mère, Hervé ne viendra plus maintenant !
Tandis que les applaudissements retentissaient encore, au-dehors, devant l’Institut, une foule compacte attendait, avec cette patience, cette obstination qui caractérisent une catégorie de Parisiens toujours avides d’assister à ces spectacles gratuits que, de temps à autre, nous donnent, dans la rue, les grands ou les privilégiés de la terre.
Toutes les classes de la société y étaient représentées : le littérateur qui, n’ayant pas réussi à se procurer une carte d’entrée, et qui comptant bien en être un jour, tient à se rendre compte lui-même si l’heureux élu porte avec élégance l’uniforme palmé de vert auquel il aspire… Le vieux général en retraite qui espère être cinématographié tout à l’heure serrant la main au maréchal Joffre ou au maréchal Foch, ce qui lui donnera un certain prestige auprès de ses camarades du cercle militaire… Quelques jolies femmes venues là pour bêcher les toilettes de celles qui, plus favorisées qu’elles, ont eu accès sous la coupole… Des employés sans emploi, des midinettes en rupture d’atelier ; enfin, toute cette figuration incolore de gens surgis d’on ne sait où, d’oisifs toujours prêts à se précipiter vers ce qui les sort un peu de la monotonie quotidienne de leur existence ; des informateurs de journaux spécialement chargés de décrire les impressions de la rue, et, enfin, juchés sur des installations de fortune, protégés par les agents, qui ont réussi à concentrer la foule en une double rangée, laissant un espace libre permettant de défiler tout à l’heure aux Immortels et à leurs invités, des Opérateurs de cinéma, attendant, la main sur la manivelle de leurs « moulins à café », le moment de faire fonctionner utilement leurs appareils.
Depuis un instant déjà, un individu assez bien mis, un chapeau marron enfoncé sur les yeux et le col du pardessus relevé, s’était glissé parmi les curieux.
Evitant de parler à qui que ce fût, se tenant même à l’écart, il gardait l’attitude d’un homme qui veut voir sans être vu, et ses yeux ne quittaient guère la porte donnant dans la cour de l’Institut et dont les deux battants, largement ouverts, laissaient apercevoir la double haie des gardes républicains qui, au repos, attendaient l’apparition des « officiels » pour reprendre leur attitude réglementaire.
Bientôt, un commandement bref, sonore, militaire retentit. Les « cipaux » *(Gardes municipaux) rectifièrent la position… Les curieux esquissèrent un mouvement en avant ; mais ils se heurtèrent au barrage des agents courtois, mais énergiques…
L’ordre et le silence s’établirent, comme par enchantement, ainsi qu’on le disait autrefois dans les vieux contes des veillées… Et le défilé commença…
Ce furent d’abord quelques Parisiens connus que le public s’amusait à reconnaître, tandis qu’ils échangeaient, les uns avec agitation, les autres avec scepticisme, les impressions que leur avaient inspirées les discours de JB. Lerson et de M. de Rhuys.
Les maréchaux, bien qu’ils fussent en civil, provoquèrent quelques acclamations discrètes et de bon ton… On se désigna quelques hommes de lettres qui, déjà, faisaient partie de l’Académie, et d’autres qui n’en étaient pas encore, croyaient qu’ils en seraient et n’y entreraient peut-être jamais.
Enfin, M. de Rhuys apparut, entre sa mère et sa fille. Un murmure sympathique s’éleva. Tous, consciemment ou non, eurent l’impression qu’en accueillant dans son sein celui qui incarnait à la fois, en lui, l’aristocratie, la diplomatie et l’histoire, l’Académie avait voulu rendre un hommage à l’homme éminent qui semblait tout désigné pour servir d’agent de liaison entre le présent et le passé.
Tandis que Mme de Rhuys regagnait sa voiture, l’individu au chapeau marron enfoncé sur le front, qui n’avait cessé de regarder fixement le nouvel Immortel, se dégageait adroitement de la foule, et, sans bousculer personne, évitant même de coudoyer ses voisins immédiats, il se rapprochait de la chaussée.
Pendant ce temps, la marquise, Huguette et M. de Rhuys se dirigeaient vers une limousine somptueuse qui stationnait devant l’Institut.
Mme de Rhuys monta la première dans la voiture, suivie par sa petite-fille, qui s’installa en face d’elle, et par son fils, qui prit place à côté de sa mère.
L’auto se mit en marche.
Tout à coup, M. de Rhuys, remarquant la tristesse d’Huguette, lui demanda :
— Qu’as-tu donc, ma chère enfant ?
Seul, un profond soupir lui répondit.
Le visage assombri à son tour, M. de Rhuys fit :
— Tu songes à ta pauvre maman et tu regrettes, toi aussi, qu’elle ne soit plus avec nous en ce beau jour ?
— Oui, père, répondit la jeune fille d’une voix sourde. Mais Mme de Rhuys qui lisait plus clairement dans le cœur de sa petite-fille se penchait vers elle pour l’embrasser et, doucement, elle lui murmurait à l’oreille :
— Ne te chagrine pas ainsi… Hervé aura eu un empêchement sérieux.
Huguette, douloureusement, hocha la tête… L’auto s’arrêtait brusquement… Il ne s’agissait que d’un embarras des voitures.
La foule en profita pour se regrouper autour de l’auto du nouvel académicien.
Instinctivement, Mme de Rhuys lança un coup d’œil à travers la glace… Elle tressaillit. L’homme au chapeau marron, campé au premier rang, dirigeait vers elle un regard si dur, si menaçant, qu’un cri lui échappa.
— Qu’avez-vous ? interrogeaient son fils et sa petite-fille, surpris de la frayeur que manifestait soudain Mme de Rhuys.
— Rien ! fit-elle en s’efforçant de sourire.
M. de Rhuys, inquiet, voulut à son tour regarder au-dehors… Mais la limousine s’était remise en marche et filait déjà à bonne allure vers le quai Voltaire, dégagé de tout encombrement.
La marquise, sentant bien qu’elle devait l’explication de son attitude à son fils et à sa petite-fille, qui continuaient à l’interroger des yeux, fit, tout en s’efforçant de reprendre sa physionomie habituelle :
— J’ai cru que nous allions écraser un passant.
— Ah ! vraiment ! ponctua l’académicien sur un ton qui sonnait faux.
Et ce fut le silence. On eût dit qu’une sorte de brume, toute de mélancolie et de mystère, enveloppait ces trois êtres dont les cœurs, ce jour-là, n’auraient dû battre qu’au rythme du bonheur.
Quant à l’homme au chapeau marron, après avoir vu l’auto disparaître au loin, il rejeta son chapeau en arrière et rabaissa le col de son pardessus, comme s’il voulait respirer à son aise…
Sa figure apparut en pleine lumière… C’était celle de M. de Rhuys !
Impossible d’imaginer, en effet, une ressemblance plus frappante… Mêmes traits, même taille, même silhouette… Seules les expressions de leurs visages différaient.
L’une était celle d’un homme d’honneur, l’autre celle d’un bandit.
Tandis qu’un rictus amer et méchant écartait ses lèvres, l’inquiétant personnage grommela :
Je crois que, maintenant, nous allons rire !
II : Un secret de famille.
Robert de Rhuys demeurait à Neuilly, boulevard Richard-Wallace, dans un très bel hôtel particulier entouré d’un jardin, avec sa mère et sa fille, la délicieuse Huguette. Il avait reporté sur elles deux toute sa tendresse, gardant en lui l’incurable tristesse du deuil que rien n’avait pu lui faire oublier et n’avait jamais songé à choisir une nouvelle compagne.
Mais, père avant tout, il s’était refusé à ce que l’existence de sa fille fût attristée par son propre chagrin… Il avait tenu, au contraire, à ce que la jeunesse de son Huguette s’épanouît dans une atmosphère de joie sans mélange et d’élégance bien comprise.
Compris et aidé par la marquise, il réussit à faire d’Huguette le type accompli de la jeune fille française, c’est-à-dire un modèle de grâce, d’intelligence, de charme, d’esprit et de souriante pureté.
Partout où elle apparaissait, dans l’éclat de ses vingt ans, au tennis, au golf, en visite, au théâtre, au bal, c’était autour d’elle un rayonnement qui n’était pas sans attirer dans son sillage de nombreux papillons dont elle savait, en son horreur de tout flirt et de toute coquetterie, d’un regard subitement hautain ou d’un joli mouvement d’éventail, arrêter les propos trop directs et les approches trop audacieuses.
Cependant, l’un d’entre eux avait su éveiller et même retenir son attention. Il se nommait Hervé de Kergroix.
Agé de trente ans, très distingué, très beau, mais d’une beauté robuste et fière qui rehaussait l’énergie de son regard et la loyauté de son caractère, conscient de son intelligence, appuyé sur une fortune solide, se refusant à mener l’existence oisive et vide qu’adoptent trop souvent certains jeunes gens riches et titrés, il avait voulu être quel qu’un.
Intéressé, captivé même, par le progrès de l’industrie moderne, il fondait, à vingt-sept ans, avec les capitaux que ses parents, prématurément décédés, lui avaient laissés, une usine d’automobiles. Mais, se gardant bien d’exagérer la confiance qu’il s’accordait, il prenait pour associé l’ingénieur Pierre Boureuil, technicien de grande valeur doublé d’un homme d’affaires remarquable.
Les deux collaborateurs, déjà liés par une étroite amitié, s’étaient entendus à merveille, et la firme Fulgor, à l’heure présente, comptait parmi les plus cotées de France.
Si Hervé de Kergroix avait bientôt compris que le cœur d’Huguette battait pour lui, il s’était non moins vite aperçu que Mlle de Rhuys lui avait inspiré un grand amour… Pourtant, bien qu’il eût la certitude qu’une demande en mariage serait fort bien accueillie, et par Huguette et par M. de Rhuys, qui, grand ami des siens, l’avait connu tout enfant et n’avait cessé de lui témoigner une affection presque paternelle, non seulement il s’était tu, mais il avait même espacé et presque complètement cessé toute visite.
Huguette en conçut un vif chagrin, et sa grand-mère comprit qu’il ne s’agissait point pour elle d’une banale et éphémère amourette. Prévoyant les souffrances qui menaçaient la pauvre petite, la marquise en prévint aussitôt son fils.
Le comte Robert, auquel l’inexplicable attitude de Kergroix n’avait pas échappé, décida, néanmoins, de l’inviter à la réception de l’Académie française. Et voilà que, même sans s’excuser, Hervé de Kergroix laissait sa place vide. Cette fois, il était bien décidé à exiger une explication de ce jeune homme, auquel la parfaite éducation, à défaut de l’amitié et de la reconnaissance, aurait dû dicter d’autres procédés, lorsque, en rentrant chez lui avec sa mère et sa fille, il entendit le valet de pied qui, dans le vestibule, le débarrassait de son manteau, lui dire : — Aussitôt après le départ de Monsieur le comte, M. de Kergroix a téléphoné pour s’excuser.
A ces mots, Huguette dressa la tête. Le domestique poursuivait : — M. de Kergroix a été obligé de se rendre d’urgence à son usine où un accident très sérieux venait d’arriver. Aussitôt, Huguette se précipitait dans le hall d’architecture très moderne et d’ameublement somptueux qui servait, en quelque sorte, de living-room à la famille de Rhuys… S’emparant du téléphone, elle demanda fébrilement le numéro de l’usine… Sa grand-mère et son père, qui l’avaient rejointe, l’écoutaient en silence lancer dans l’appareil d’une voix saccadée : — Allô !… C’est vous, monsieur Trincard ?… Oui… Je vais bien, je vais très bien… Et M. de Kergroix ?… Voyons, c’est impossible !… Allô !… Puisqu’il nous a fait dire… Vous devez vous tromper, monsieur Trincard… Vous êtes sûr ?… Tout à fait sûr ?… C’est inimaginable… Je vous remercie, monsieur Trincard.
Elle raccrocha le récepteur… Puis, le visage douloureux, elle dit, en se retournant vers ses parents : — On ne l’a pas vu à son usine et il n’y a pas eu d’accident.
Elle n’ajouta rien… Elle s’en fut lentement vers l’escalier de pierre à rampe en fer forgé qui conduisait au premier étage de l’hôtel.
La marquise esquissa un mouvement, pour l’accompagner ; mais, d’un geste, le comte Robert la retint. Tous deux, figés sur place, la regardèrent gravir les marches comme si elle pliait sous le poids d’un fardeau déjà trop lourd pour ses épaules.
Lorsqu’elle eut atteint le palier et disparu dans le corridor qui conduisait à sa chambre, M. de Rhuys se rapprocha de sa mère et lui dit : — Huguette a beaucoup de chagrin.
— Depuis un mois, reprenait la marquise, elle est très malheureuse.
— Je ne comprends pas l’attitude d’Hervé, déclarait le comte Robert. Jadis, il saisissait toutes les occasions de se trouver avec Huguette… Il semble maintenant les fuir. Tout en s’asseyant sur un divan, Mme de Rhuys répliquait : — Il est certain qu’Hervé de Kergroix nous évite, et, cependant, je suis sûre qu’il aime Huguette.
— Je m’attendais même, ajoutait l’académicien, à ce qu’il me demandât sa main… Aussi, je ne m’explique pas cette froideur subite.
Soudain, Mme de Rhuys se leva et, incapable de dominer plus longtemps l’angoisse qui l’étreignait, elle s’écria, bouleversée : — Saurait-il ?
M. de Rhuys eut un sursaut… Et tandis que la marquise le contemplait, il se mit à arpenter le hall à grands pas… Puis, revenant vers sa mère, il s’arrêta devant elle.
— Le passé est mort, n’y pensons plus ! fit-il.
Mme de Rhuys, baissant la voix, affirmait, d’un ton tragique : — Je l’ai vu !
— C’est impossible !… scandait le comte Robert.
— Je l’ai vu, te dis-je, plusieurs fois déjà… Il nous guette ; et, tout à l’heure encore, quand nous sommes partis de l’Institut, il était là, dans la foule… Je n’ai vu que ses yeux, ses yeux mauvais, ses yeux terribles que je connais si bien. Cela a suffi pour me fixer sur ses intentions, et j’ai compris qu’elles étaient redoutables. Sans doute a-t-il attendu son heure et est-elle prête à sonner ?… Voilà pourquoi j’ai peur, oui, peur qu’il ait déjà parlé, agi, et que ce soit lui qui, en se révélant à Hervé de Kergroix, ait créé, entre lui et nous, l’irréparable.
M. de Rhuys reprenait :
— Je crois bien connaître Hervé… Il est l’honneur même et son premier soin eût été de nous prévenir.
— Peut-être n’a-t-il pas osé ?
— En ce cas, il aurait manqué de courage et il en est incapable.
— Alors ?
— Il y a un malentendu que je me charge de dissiper… Je vais lui téléphoner tout de suite que je désire le voir dans le plus bref délai… Il est impossible qu’il ne se rende pas à mon appel… Il faudra bien, alors, qu’il me dise la vérité.
— Mais l’autre ? interrogeait la marquise avec effort.
— L’autre !… répétait le comte Robert.
— Déjà l’autre jour, avenue du Bois, j’avais aperçu, arrêté sur un refuge, en compagnie de deux individus aux allures de métèques, un homme qui te ressemblait à un tel point que, si tu n’avais pas été absent de Paris ce jour-là, j’aurais juré que c’était toi. Aussi, quand je l’ai revu aujourd’hui, me fixant avec cette expression qui n’appartient qu’à lui et qui, malgré les années, a laissé en moi une impression ineffaçable, bien qu’il dissimulât le reste de son visage, je n’ai pas pu m’empêcher de me dire : « C’est lui ! »
— Alors ? reprenait M. de Rhuys, pourquoi est-il resté si longtemps sans nous donner de ses nouvelles ?
— Qui sait ce qui a pu lui arriver ?
— S’il a de mauvais desseins contre nous, pourquoi ne les a-t-il pas déjà exécutés ?
— Qui te dit qu’il n’a pas déjà commencé et que l’éloignement dans lequel Hervé de Kergroix se tient vis-à-vis de nous n’est pas son œuvre ?
— Tout d’abord, il faudrait être sûr que c’est bien lui.
— C’est lui, te dis-je… C’est ton frère !
Et, d’une voix brisée par les sanglots qu’elle ne parvenait plus à contenir, la marquise poursuivit : — Autant Jean et toi vous vous êtes toujours ressemblés physiquement, à un point qu’il était presque impossible de ne pas vous confondre l’un avec l’autre, autant vos deux âmes ont été sans cesse différentes. Toi, Robert, tu as toujours été l’honneur même !… Lui, on eût dit qu’un sang d’aventurier coulait dans ses veines. Quand il nous a quittés, emportant la part qui lui venait de l’héritage de son père, j’ai eu le pressentiment de sa déchéance. Et quand je songe à tout ce qu’il a déjà fait, comment ne tremblerais-je pas à la pensée de ce qu’il est capable de faire encore ?… C’est notre honneur qui est en jeu, Robert… Il faut le défendre.
— Je le défendrai ! affirmait le comte avec une énergie indomptable.
— Pourvu qu’Hervé n’ait pas surpris ce secret !… Ce serait effroyable !
— Vous si forte, si courageuse, s’exclamait le comte Robert, je ne vous reconnais plus !
— C’est que, en face du désespoir de ma pauvre Huguette, je me sens tout à fait désarmée.
— Etes-vous sûre qu’elle aime Kergroix à ce point ?
Deux larmes roulèrent sur les joues de la marquise.
— Elle l’aime à en mourir, affirmat-elle avec l’accent d’une conviction profonde.
Le comte Robert réfléchit un instant, puis il reprit :
— Rassurez-vous, mère, je la sauverai !
A peine M. de Rhuys avait-il prononcé ces mots qu’une sonnerie de téléphone vibrait dans le hall.
Le comte Robert saisit le récepteur.
A l’autre bout du fil, une voix lançait :
— Monsieur Robert de Rhuys ?…
— C’est moi. Qui est à l’appareil ?
— Jean.
Les traits altérés, M. de Rhuys, instinctivement, dirigea son regard vers sa mère qui, remarquant son trouble, avait pâli.
Au bout du fil, la voix répétait, railleuse :
— Allô ! Tu m’entends bien ? C’est moi, Jean.
Robert, un peu pâle, interrogeait :
— Que voulez-vous ?
— Je veux te voir.
— C’est impossible !
— J’ai absolument besoin de te parler.
— Tout est fini entre nous, tu le sais !
Mme de Rhuys voulut prendre le second récepteur… Son fils, doucement, mais fermement, l’en empêcha.
— Prends garde ! clamait Jean…
Haussant dédaigneusement les épaules, M. de Rhuys raccrocha le récepteur.
— C’était lui, n’est-ce pas ? interrogeait fiévreusement la marquise.
Son fils eut un signe de tête affirmatif…
La marquise, accablée, se laissa tomber sur un fauteuil, tout en disant : — Le malheur est à notre porte !
Les traits contractés, mais l’air résolu d’un homme qui est décidé à jouer crânement la partie, si périlleuse soit-elle, le comte Robert affirmait : — Quoi qu’il entreprenne, je ne céderai pas !
— Mais si un scandale éclate ?
— Eh bien ! il éclatera !
— Songe à notre honneur…
— Une branche pourrie ne suffit pas pour faire mourir un arbre séculaire.
— Et Huguette ?
— Si Hervé l’aime vraiment, ce n’est pas la divulgation d’un secret de famille dont elle ne peut pas être rendue responsable qui l’empêchera de l’épouser.
Et, se penchant vers sa mère, il l’entoura filialement de ses bras.
— Rappelez-vous la devise de nos ancêtres : « Sans rien craindre, sans rien feindre ! » Ce soir, j’aurai fait parler Hervé… Demain, j’aurai fait taire l’autre.
III : Le malheur près de la porte.
L’Infernal-Bar était une des innombrables boîtes de Montmartre qui, après la guerre, ont poussé sur la butte Montmartre comme autant de champignons plus ou moins vénéneux.
L’extérieur représentait une grossière contrefaçon en carton-pâte des sublimes portes de l’Enfer de Rodin. Puis, c’était un étroit vestibule éclairé en rouge et que l’on ne faisait que traverser pour pénétrer dans un vaste cabaret à l’aspect de grotte, dont le plafond, imitant la pierre, était soutenu par des colonnes camouflées en fausses stalactites et stalagmites… Tout autour, une corbeille de loges un peu surélevées et, plus bas, des tables rangées de façon à laisser vide un espace en demi-cercle qui servait de dancing et se terminait par une entrée de caverne obscure qui s’illuminait pour les entrées de ballet, principale attraction de la maison.
Sous la projection de lumières aux teintes changeantes, des couples assez chics exécutaient les danses les plus modernes, au son d’un orchestre de musiciens costumés en diables, ainsi que le barman qui, debout derrière son comptoir, procédait, avec la dextérité d’un prestidigitateur, à la confection de nombreux cocktails, et les garçons, en diables également, s’empressaient autour des consommateurs, faisant sauter bruyamment les bouchons de champagne.
Tout à coup, l’orchestre se tut. Les projecteurs s’éteignirent… Les danseurs mondains, qui, pour la plupart, étaient des habitués, regagnèrent leurs tables.
A peine s’y étaient-ils installés que la caverne du fond s’illumina, laissant apparaître une immense chaudière d’où sortit d’abord un jet de flammes, puis d’où jaillirent de jolies diablesses armées de petites fourches. C’était une troupe de girls qui, bondissant dans la salle, à la lueur d’un éclairage de pourpre, se mit à exécuter une série de pas assez originaux.
Ces ébats eurent le don de soulever l’enthousiasme des snobs et des snobinettes qui formaient la majorité du public.
Tandis que les applaudissements crépitaient et que les girls se préparaient à continuer leur numéro, deux hommes, d’une élégance un peu suspecte, l’un grand, élancé, au type de bellâtre étranger, sentant le métèque à plein nez, l’autre, petit, au nez retroussé, aux yeux en vrille, au sourire inquiétant, s’entretenaient à voix basse près d’une table sur laquelle deux consommations étaient servies. En face d’eux, une chaise vide semblait attendre un troisième client.
— Ah çà ! grommelait le bellâtre, est-ce que Poker d’As nous laisserait tomber ?
— Pourquoi dis-tu cela, Soreno ?
— D’ordinaire, il est très exact… Et, ce soir, il est en retard d’au moins une heure.
— A Paris, on ne fait pas toujours ce que l’on veut.
— Vois-tu, Aryadès, qu’il se soit défilé !
— Je connais Poker d’As. Ce n’est pas un type à jouer un pareil tour à des amis.
— Est-ce qu’on sait ?…
— Tais-toi, le voici…
Un homme de quarante-cinq ans environ, en habit, sous un mac-farlane à revers de soie et dont la silhouette élégante contrastait avec la flétrissure que le vice et sans doute aussi le crime avaient mise sur son visage, s’avançait vers les deux métèques.
Sans prononcer un mot, lentement, il s’assit sur la chaise vacante.
Remarquant son air soucieux, Soreno interrogeait :
— Alors, ça ne va pas ?
Poker d’As eut un sourire énigmatique et, d’un geste de la main, il fit signe à ses compagnons de se taire.
Soreno, après avoir adressé un léger signe de tête à Aryadès, regarda autour de lui afin de s’assurer qu’il n’était pas observé. Et il reprit sur un ton de sourde menace : — Poker d’As, il est temps que tu tiennes tes promesses.
Poker d’As eut un haussement d’épaules tout de flegmatique dédain.
Moins violent que son camarade, très insinuant, au contraire, mais plus dangereux à coup sûr, Aryadès intervenait à son tour : — Tu ne devrais pas oublier que, sans Soreno et moi, tu serais encore au Transvaal, au bagne, où tu avais été envoyé à perpétuité pour vol, meurtre, etc. Nous t’avons tiré de là à nos risques et à nos frais.
— Et tu nous avais juré, ponctuait Soreno…
Brutalement, les sourcils froncés, Poker d’As interrompait : — Que si vous me faisiez évader, nous nous rendrions tous les trois à Paris pour une grosse affaire !
— Voilà trois mois que nous attendons, observait Aryadès.
Eh bien ! s’écriait Poker d’As, dont le visage avait pris une expression vraiment satanique, demain soir je tiendrai parole.
— Tu peux bien maintenant, déclarait Soreno, nous raconter de quoi il s’agit.
— J’ai dit : demain.
— Pourquoi pas tout de suite ?
— Parce que…
— Tu n’as pas confiance en nous ?
— Autant que vous avez confiance en moi…
— Ce n’est pas une réponse…
— Laisse-le, conseillait Aryadès… Il n’est pas de bonne humeur.
— Je suis de très bonne humeur, protestait Poker d’As… Seulement… voilà… un coup comme celui que je prépare… ça demande de la réflexion… Mais ce que je peux déjà vous dire, c’est que vous verrez demain soir que je sais tenir mes promesses.
Une ruée de nouveaux clients envahissait la salle. L’un d’eux, un jeune homme aux allures distinguées et qui semblait quelque peu dépaysé dans ce milieu dont il n’était certainement pas un habitué, eut un mouvement de surprise en apercevant Poker d’As.
— Regardez donc… murmura-t-il à l’un de ses compagnons.
— Quoi ?
— Ce personnage attablé… avec deux individus plutôt suspects…
— Où donc ? Là, à droite. Tiens, mais l’on dirait…
— Le comte de Rhuys. En effet, c’est bien lui.
— Singulière façon de fêter sa réception à l’Académie !
Poker d’As, qui avait entendu cette réflexion, eut un sourire gouailleur… Et il se prit à grommeler entre ses dents : — Maintenant, à nous deux, monsieur mon frère.
Cet homme, nos lecteurs l’ont déjà deviné, n’était autre que celui que Mme de Rhuys avait cru reconnaître, c’est-à-dire Jean, son second fils, l’autre…
Ainsi qu’elle le prévoyait, le malheur était à sa porte !…
À la même heure, à l’hôtel de Rhuys, quelques intimes étaient venus féliciter le nouvel académicien.
Entouré de ses amis, M. de Rhuys faisait part à ceux-ci de ses impressions de séance… La marquise et la jolie Huguette cherchaient, non pas à bannir, mais à dissimuler leur angoisse secrète et à faire preuve, envers toutes et tous, de leur amabilité coutumière, lorsqu’un valet de pied annonça : — Monsieur Hervé de Kergroix.
A ce nom, Huguette sentit passer en elle le frisson d’un bonheur subit… Hervé, très élégant dans son frac impeccable, s’avança d’abord pour saluer Mme de Rhuys et serrer la main que lui tendait le comte Robert… Puis il revint vers Huguette qui, elle aussi, un peu tremblante, lui offrit la main. Hervé la prit et la serra avec une sorte de réserve volontaire. Mlle de Rhuys s’aperçut que son regard, son image, son attitude trahissaient en lui une froideur embarrassée… Aussitôt, la joie si brève qu’elle venait de ressentir fit place à une déception douloureuse qu’Hervé remarqua aussitôt… Ses yeux se fixèrent sur Huguette avec tendresse et il entrouvrit la bouche… On eût dit qu’il allait lui faire un aveu, une révélation… Mais, aussitôt, il se reprit, resta muet et quitta Huguette pour adresser ses salutations à d’autres personnes.
Comprenant qu’il devait des excuses à M. de Rhuys, il se rapprocha de lui et, avec un embarras grandissant, il lui dit : — J’espère, mon cher maître, que vous avez bien voulu me pardonner mon absence cet après-midi.
Le comte Robert répondit par un signe affirmatif… Et, profitant de ce que le cercle d’hommes de lettres et de mondains qui l’entourait se brisait pour s’attaquer aux rafraîchissements qu’un laquais en grande livrée faisait circuler sur de larges plateaux, il dit à Hervé, avec beaucoup de bienveillance : — J’ai besoin de vous parler très sérieusement.
Hervé n’en parut pas étonné. On eût même dit que ces quelques mots le libéraient du grand poids moral qui, visiblement, l’oppressait.
— Veuillez me suivre, invitait M. de Rhuys.
Occupés, les uns à potiner, les autres à se bourrer de sandwiches, de petits fours, ou à vider des coupes de champagne et des verres d’orangeade, les invités ne s’aperçurent pas de la disparition du maître de la maison et du jeune industriel, qui étaient passés tous deux dans un luxueux cabinet de travail communiquant directement avec la pièce qu’ils venaient de quitter.
Après avoir indiqué à Hervé de s’asseoir en face de lui, M. de Rhuys prenait place sur un siège, devant un admirable bureau Louis XV qui aurait pu rivaliser avec le chef-d’œuvre de Riesener, juste gloire de notre musée des Arts décoratifs, au Louvre.
— Mon cher ami, attaquait-il, vous savez toute l’amitié, toute l’estime que j’ai pour vous… Depuis la mort de vos parents, je me suis habitué à vous considérer comme mon fils.
— Et moi, déclarait Hervé avec élan, à vous aimer comme un père.
— Alors, s’écriait le père d’Huguette, pourquoi avez-vous cessé tout à coup de nous voir ?
Kergroix garda le silence. Le regard rempli d’une tristesse soudaine, on eût dit qu’il cherchait à éviter celui que le comte fixait obstinément sur lui.
— Tous ces derniers temps, reprit-il avec gêne, j’ai été très pris à l’usine.
— Je veux bien en convenir… Mais pourquoi nous avez-vous téléphoné que vous n’aviez pas pu vous rendre à l’Académie parce qu’un accident imprévu s’était produit dans l’un de vos ateliers ?
Hervé se tut encore.
— Vous avez dû vous douter, reprenait le comte Robert, qu’il m’était facile de contrôler la non-exactitude de ce prétexte.
Le jeune homme baissa le front.
Avec fermeté, M. de Rhuys martelait :
— Je ne veux pas qu’il y ait de malentendu et encore moins de mystère entre nous… Hervé, je veux savoir la vérité, toute la vérité.
— Je vous en supplie, monsieur, s’écriait Kergroix avec un accent d’étrange désespoir, ne me forcez pas à vous répondre.
A son tour, le comte Robert se tut ; et la même question que sa mère lui avait posée dans l’après-midi lui revint à l’esprit.
— Saurait-il ?
Dissimulant avec peine son inquiétude, il s’en fut vers Hervé qui, non moins ému, s’était levé et, le saisissant par le bras, il lui cria : — Vous n’avez pas le droit de vous réfugier ainsi dans l’équivoque… Je veux tout savoir, vous m’entendez ?… Tout ! … Je le veux, il le faut !
La gorge contractée, Kergroix murmura :
— J’aime votre fille !
— Je le savais, déclara M. de Rhuys en desserrant son étreinte.
Le jeune industriel se laissa tomber sur un siège… Le comte Robert l’observa un instant. Puis, s’avançant vers lui et dominant sa secrète anxiété, il lui demanda, d’un ton redevenu bienveillant, presque paternel : — Vous croyez peut-être qu’Huguette ne vous aime pas ? Eh bien ! moi, je vous affirme qu’elle vous adore.
Contrairement à son attente, ces paroles parurent grandir encore le désespoir d’Hervé.
De plus en plus étonné, le comte reprit :
— Vous redoutez que je vous refuse sa main ? Rassurez-vous, je suis prêt à vous l’accorder !
— Hélas ! mon cher maître, soupirait Kergroix, je n’ai pas le droit de vous la demander.
— Pourquoi ?
— Je ne suis pas libre.
— Une liaison ?
— Oui, une liaison que je ne peux pas rompre.
— Par crainte du scandale ?
— Non, par devoir, par pitié.
Profondément affecté, M. de Rhuys hocha la tête d’un air découragé. Puis il fit : — Comment avez-vous pu, mon pauvre enfant, vous laisser prendre ainsi ?
Hervé expliquait :
— Quand j’ai connu cette femme, Huguette était encore presque une enfant et elle ne m’inspirait qu’une affection toute fraternelle. Mais, à mesure qu’elle grandissait, je me sentais attiré vers elle par un sentiment de plus en plus vif que je croyais être encore de l’amitié, lorsqu’un soir, au bal de l’ambassade d’Angleterre, son charme m’enveloppa d’une lumière si pénétrante que je vis clair en moi. J’aimais Huguette d’amour, et d’un tel amour que je ne croyais pas qu’il pût en exister d’aussi grand au monde…
— Alors ?…
— Je voulus rompre avec… mon amie. Elle ne m’adressa aucun reproche… Elle ne chercha pas à me retenir et je ne vis même pas de larmes apparaître au fond de ses yeux qui me regardaient avec tristesse, mais sans amertume. Elle me dit simplement : « Va et sois heureux ! »
— Eh bien ?
— Le même soir, mon associé, Pierre Boureuil, me prévenait qu’elle avait voulu se tuer… Pouvais-je contre signer, par mon départ, un arrêt de mort auquel elle n’avait échappé que par miracle ?… Non ! Terrifié de la responsabilité que j’assumerais, je lui jurai de ne jamais la quitter.
— C’est effrayant ! murmura M. de Rhuys d’une voix sourde.
— Qu’avez-vous ? interrogeait Kergroix.
Le comte, haletant, répliquait :
— Huguette, elle aussi, peut en mourir.
Bouleversé, Hervé s’écriait :
— C’est abominable !… Non ! non ! cela ne se peut pas… cela ne sera pas…
Faisant appel à tout son sang-froid, M. de Rhuys demandait : — Quelle est cette femme ?
— Une malheureuse, définissait le jeune industriel… Un jour, il y aura bientôt trois ans, elle se présenta à l’usine pour demander du travail. Elle me dit qu’elle était seule au monde. Elle manifestait à la fois tant de dignité et tant de détresse que je l’accueillis sans hésiter. Je n’eus pas à le regretter. Elle était excellente dactylographe… et puis si douce, si sérieuse, si appliquée à son travail… si simplement dévouée… J’en fis ma secrétaire… Bientôt je crus l’aimer et elle se donna à moi… Mais jamais elle ne voulut accepter de moi une autre situation que celle qu’elle devait à son travail… Telle est la triste vérité.
— Et son passé ?
— Le peu qu’elle m’en a raconté me donne à penser qu’il a dû être un vrai calvaire.
— Mon pauvre ami !
Douloureusement, Kergroix poursuivit :
— Vous dire ce que je souffre, surtout après ce que vous venez de me confier, est impossible !… Huguette ! ma chère Huguette !… Moi qui donnerais ma vie pour elle !… Car c’est elle que j’aime, elle seule, je vous le jure !…
Avec cette volonté sereine qui n’appartient qu’aux âmes d’élite, le comte Robert déclarait : — Il ne faut pas qu’il y ait de sacrifiée… ni mon enfant, ni cette pauvre fille. Laissez-moi réfléchir… Ayez confiance en moi. Si Dieu le veut, nous sortirons de cette impasse… et Dieu le voudra ! Je vous remercie, monsieur, de m’avoir parlé ainsi…
— Maintenant, vous comprenez pourquoi je me suis éloigné de vous, et j’ose espérer que vous me pardonnez.
— Mon cher enfant, le seul reproche que j’ai le droit de vous adresser est que vous auriez dû me parler tout de suite avec la même franchise que ce soir. Mais je tiens à vous le répéter, soyez sûr que tout ce qui dépendra de moi pour assurer le bonheur d’Huguette et le vôtre dans le repos de votre conscience sera fait, avec toute la sincérité de l’affection que je vous porte.
— Encore merci, et au revoir.
— A bientôt, j’espère ?
— Au revoir, mon cher maître.
— Ayez confiance !
Après avoir serré la main du comte, Kergroix se retira.
Dès qu’il fut parti, une portière se souleva et Mme de Rhuys s’avança vers son fils. Son trouble évident signifiait qu’elle n’avait rien perdu de l’entretien précédent.
— Mère, s’écriait Robert, vous avez entendu ?
— Oui.
— Que faire ?
— Nous en reparlerons tout à l’heure, quand nos invités seront partis.
Mais la porte du salon s’ouvrait, démasquant Huguette qui, les yeux pleins de larmes, s’écriait : — Hervé vient de partir. On eût dit qu’il faisait semblant de ne pas me voir… et, lorsque je me suis avancée vers lui… c’est à peine s’il m’a dit adieu. Père, que s’est-il passé ?… Il ne m’aime pas, n’est-ce pas ?
Le comte fit un geste de dénégation ; mais la jeune fille insistait : — Je sens bien qu’il se passe quelque chose de grave.
Et elle se jeta dans les bras de sa grand-mère.
— Il ne m’aime plus ! sanglotait-elle. Il ne m’aime plus ! Et fermant les yeux, renversant sa tête en arrière, elle s’effondra sur le tapis avant que la marquise ait eu le temps de la retenir.
Vite, M. de Rhuys la transporta sur une chaise longue, puis se précipita dans le salon, où les invités commençaient à s’étonner de la disparition successive de leurs hôtes.
Se dirigeant vers un homme d’un certain âge qui, avec des airs de galanterie un peu surannés, s’entretenait avec la duchesse de Sallabris et la célèbre romancière Eve Myrtale, il fit à voix basse : — Docteur, voulez-vous venir un instant ?… Huguette vient de se trouver mal.
Le médecin, qui n’était autre que le célèbre professeur Martineau, s’empressa de suivre le comte Robert.
La duchesse de Sallabris, qui avait tout entendu, s’empressa de faire circuler la fâcheuse nouvelle ; et un mouvement de retraite s’esquissa.
Le professeur Martineau s’approcha d’Huguette, qui commençait à rouvrir les yeux… Il lui prit le pouls… et constata qu’il battait régulièrement.
— Allons, ça ne sera rien, fit-il… La fatigue de cette journée… Il faut que cette charmante jeune fille s’en aille tout de suite faire dodo.
— Te sens-tu assez forte pour monter dans ta chambre ? interrogeait la marquise.
— Oui, grand-mère.
Huguette, soutenue par son père, se redressa.
— Je vais mieux, fit-elle.
— Appuie-toi à mon bras, invitait Mme de Rhuys.
Elles s’en furent toutes deux par une porte qui donnait sur un couloir où elles prirent l’escalier qui conduisait au premier étage.
Le comte Robert regarda le médecin. Celui-ci n’avait plus cette expression d’optimisme qu’il manifestait un instant auparavant… Et, le front barré d’un pli, il fit : — Mon cher comte, voilà une enfant à laquelle il faut éviter toute émotion. Sinon !…
M. de Rhuys frémit… Sa femme était morte d’une maladie de cœur…
Dissimulant son angoisse, le comte Robert s’en fut, avec le docteur Martineau, rejoindre ses invités qui, aussitôt, l’entourèrent, lui demandant tous à la fois des nouvelles, s’apitoyant en des formules banales : — Quel dommage… au soir d’un si beau jour !
— Espérons que cela ne sera rien.
— Demain, nous téléphonerons pour avoir des nouvelles.
— Tous nos hommages à la marquise.
Enfin ce fut l’exode, et M. de Rhuys se retrouva seul avec le professeur Martineau.
— Rien de grave ? fit-il d’une voix angoissée.
— J’espère que non… Mais je ne puis pas encore me prononcer. Je reviendrai demain examiner plus sérieusement cette chère enfant… Au revoir, mon cher maître et ami.
— A demain.
Le professeur parti, le comte Robert se préparait à rejoindre sa fille lorsque sa mère reparut.
— Qu’a dit le docteur ?… interrogea-t-elle.
— Qu’il fallait éviter à Huguette toute espèce d’émotion.
— Mon Dieu !…
— Il reviendra demain.
— Pourvu que…
— Ma pauvre Marie-Louise, n’est-ce pas ?…
— Je vois que nous avons eu la même pensée…
— Ce serait affreux !
— Oh ! oui, trop affreux… !
Alors la marquise eut ce cri :
— Il faut la sauver !
Avec une expression de noblesse infinie, le comte Robert décidait : — Il faut les sauver…
— Tous les deux ?…
— Tous les trois !…
IV : Le cœur de Simone.
Sur le coteau de Suresnes, dans une très modeste villa enfouie sous la verdure, une jeune femme brune, au profil régulier et pur, se penchait au-dessus d’un parterre et y cueillait quelques roses.
C’était Simone Servat, l’amie d’Hervé de Kergroix.
Sa moisson terminée, elle rentrait dans la maison toute simple, un rez-de-chaussée recouvert d’un toit mansardé, dont les murs disparaissaient sous des treillages où s’accrochaient des frondaisons de vigne-vierge sur lesquelles des capucines piquaient leurs notes jaunes et rouges.
Elle pénétra dans un petit salon meublé sans la moindre recherche, mais presque coquet, tant il respirait le soin et la propreté, et, se dirigeant vers la cheminée, tout de suite elle disposa les fleurs dans un vase comme pour en ombrager et en embaumer le portrait d’Hervé, entouré d’un cadre joli et de bon goût.
Tout en contemplant le portrait de l’aimé avec un sincère amour et une profonde mélancolie, Simone murmura :
— Il ne m’aime plus, puisqu’il a voulu me quitter !… Alors, pourquoi n’ai-je pas la force de partir ?… Pourquoi n’ai-je plus la volonté de mourir ?
Douloureusement, elle secoua la tête… Des larmes affluaient à ses yeux… Cessant de regarder l’image, elle s’en fut vers une table sur laquelle il y avait une lettre ouverte dont elle s’empara. Et elle se mit à relire ces lignes datées de la veille :
Mademoiselle,
Pour des raisons graves, je voudrais vous parler seule à seule… Pouvez-vous m’attendre demain, chez vous, vers six heures du soir ?
Ceci confidentiellement.
Avec mes sentiments distingués, Marquise de Rhuys.
Ce message avait d’abord vivement surpris Mlle Servat. Bien qu’elle eût entendu, à plusieurs reprises, prononcer par Kergroix le nom des Rhuys et qu’elle n’ignorât pas que celui-ci entretenait avec cette famille des relations affectueuses et suivies, à cent lieues de soupçonner le véritable motif qui avait inspiré cette démarche à la grand-mère d’Huguette, elle se demandait avec une instinctive angoisse quelles pouvaient être ces raisons graves qui poussaient une femme d’aussi grande naissance à lui demander à elle, simple employée, un entretien chez elle.
Sa première pensée fut : « Pourvu qu’il ne soit pas arrivé malheur à Hervé !… »
Mais elle ne s’arrêta pas longtemps à cette conjecture. En effet, depuis qu’elle avait reçu cette lettre si étrange et si inattendue, elle avait revu le jeune industriel à l’usine. Il n’avait d’ailleurs fait qu’y passer… pour prendre connaissance de son courrier et dicter en hâte quelques lettres… Mais il semblait soucieux, préoccupé… Et, tout en traitant, comme toujours, sa secrétaire avec douceur, il l’avait quittée assez brusquement et oublié, pour la première fois depuis qu’ils étaient l’un à l’autre, de lui adresser son regard habituel qui lui disait non seulement « au revoir », mais aussi « à bientôt ».
Un soupçon l’envahit… soupçon qui la déchira, parce qu’il lui laissait entrevoir l’irréparable.
Hervé est toujours décidé à rompre, et, redoutant que je renouvelle ma tentative de suicide, il a demandé à la marquise de Rhuys de me convaincre que je dois le quitter, sans me laisser aller à un acte de désespoir qui pèserait à jamais lourdement, douloureusement, sur toute sa vie. Craignant que je ne me rende pas à son appel, elle a voulu venir elle-même… tout comme si elle était sa mère.
En un geste de découragement, elle laissa retomber la lettre sur la table… Machinalement, son regard s’en fut vers la pendule… Six heures étaient près de sonner… quelques secondes encore… Dans la rue… un roulement d’auto… A travers la fenêtre, elle aperçut une auto luxueuse qui stoppait devant la porte grillagée du jardinet.
Un tintement de sonnette retentit au-dehors… Le cœur battant, Simone sortit de la maison et s’en fut ouvrir… Une femme aux cheveux blancs, vêtue de noir, la dévisageait avec une bienveillance qui atténuait ce qu’il pouvait y avoir de naturellement distant en elle.
— Mademoiselle Servat ? interrogea-t-elle.
— C’est moi, madame.
— Je suis la marquise de Rhuys.
— Je vous attendais, madame, répondait Simone avec une politesse déférente qui trouvait immédiatement sa bonne éducation.
— Toutes deux, sans échanger un mot, franchirent les quelques mètres d’allée, puis l’amie d’Hervé fit entrer la grande dame dans la pièce qu’elle venait de quitter.
Bien qu’elle se sentît rassurée par la visible sympathie que Mme de Rhuys semblait lui témoigner, Simone, en présence de cette femme dont l’âge et les allures aristocratiques lui inspiraient un intuitif et profond respect, se sentait gênée, intimidée… car elle avait tout de suite compris, à la contrainte du sourire qui se dessinait sur les lèvres de la marquise, que celle-ci se présentait à elle en messagère de douleur…
— Madame, invitait Simone, en lui désignant l’unique fauteuil… veuillez vous asseoir.
Mme de Rhuys s’installa et promena son regard autour d’elle. L’aspect si simple de cette demeure et des objets qu’elle contenait parut à la fois la surprendre et la satisfaire… et avec beaucoup de douceur, elle dit à Simone, qui avait pris place sur une chaise en face d’elle :
— Mon nom ne vous est pas inconnu.
La jeune secrétaire eut un signe affirmatif.
La marquise reprit :
— J’ai beaucoup entendu parler de vous, mademoiselle, et ce que j’en ai appris m’a inspiré à votre égard le plus vif intérêt… Aussi ai-je voulu me procurer tout de suite votre adresse.
Elle s’arrêta… Maintenant qu’elle était en présence de la victime, elle hésitait à lui porter le coup fatal.
En effet, elle était bien telle qu’Hervé l’avait décrite au comte Robert, c’est-à-dire très tendre, toute fidèle, toute dévouée, et si noblement désintéressée. Son visage reflétait son âme… Et comme elle devait être jolie, cette âme, comme ne devait y entrer aucun calcul, aucune arrière-pensée !… Seule, une ambition devait y fleurir, la plus divine, celle d’être aimée autant qu’elle aimait ; et la grand-mère d’Huguette frémit à la pensée qu’elle allait être obligée de briser ce cœur si pur, de jeter pour toujours, peut-être, un voile de deuil sur tant de jeunesse charmante.
Combien elle eût préféré se trouver en face, sinon d’une aventurière, mais d’une femme tenant avant tout à sa situation et, par conséquent, parfaitement accessible à l’offre d’un dédommagement profitable !
Si répugnant qu’eût été pour elle un pareil marché, elle l’eût préféré à toutes les larmes qu’elle sentait prêtes à couler, à cette douleur poignante qu’elle devinait déjà à travers l’angoisse dont la pauvre petite était étreinte. Comprenant toute l’étendue du sacrifice qu’elle était venue imposer, persuadée qu’il n’y avait que de l’amour (et quel amour !) en cause, elle se dit :
Pourquoi faut-il que, pour sauver ma petite-fille, je sois obligée de condamner peut-être à mort cette malheureuse ?
Et la grande croyante qu’elle était, s’élevant vers celui qui, en ses heures de grande détresse, avait été si souvent pour elle le consolateur suprême, elle fit mentalement :
— Mon Dieu ! puisque je n’ai pas le droit d’avoir pitié d’elle, protégez-la !
Et elle reprit, réconfortée par cette courte prière :
— Mademoiselle, je ne suis pas une ennemie… Ne voyez en moi qu’une grand-mère qui veut sauver son enfant !
Simone tressaillit… Elle commençait à comprendre.
Mme de Rhuys précisait :
— Ma petite-fille aime Hervé de Kergroix.
Simone eut un sursaut de souffrance que, courageusement, elle réprima.
Avec l’accent d’une maternelle bonté, la marquise poursuivait
— Je sais que vous aimez, vous aussi, ce jeune homme à un tel point que vous avez voulu mourir pour lui.
— C’est vrai.
— Eh bien ! s’animait la marquise, j’ai la conviction que si ma petite-fille n’épouse pas M. de Kergroix, elle ne se tuera pas, mais elle s’en ira tout de même de consomption, de désespoir.
— Et, avec un sanglot dans la voix, elle ajouta :
— Cette enfant est toute ma vie !
Simone… elle aussi, eut un sanglot… et quel sanglot !… le premier glas qui sonnait l’enterrement de sa jeunesse et de son amour.
Se cachant la tête entre les mains, le front penché en avant… on eût dit qu’elle ne voulait plus rien voir, plus rien entendre… et que, morte moralement, elle n’attendait plus que le moment où on viendrait l’ensevelir dans le linceul de son bonheur à jamais détruit.
Mme de Rhuys se leva, s’en fut vers elle et lui murmura d’une voix brisée :
— Vous aurez pitié d’elle et de moi, n’est-ce pas, mademoiselle ?
A cet appel, Simone découvrit son visage baigné de larmes.
— Ma pauvre enfant ! fit Mme de Rhuys avec compassion.
— Si vous saviez, madame, haletait Simone, Hervé est tout pour moi… le seul rayon de soleil que j’aie connu dans ma vie ! Et vous me demandez de renoncer à lui pour toujours !
Tandis que Mme de Rhuys gardait un douloureux silence, Simone poursuivait :