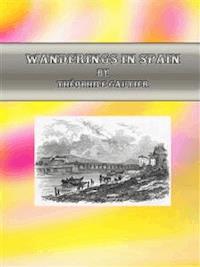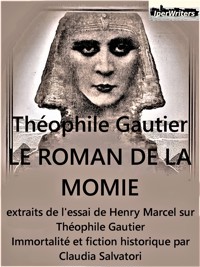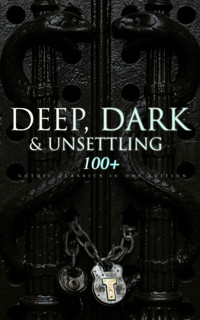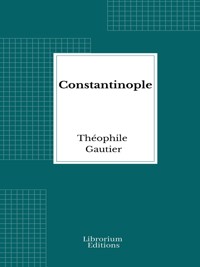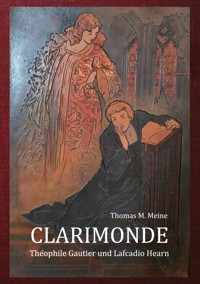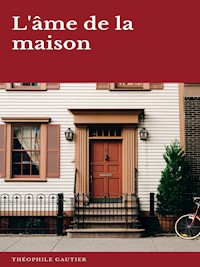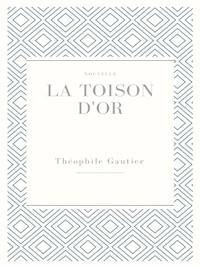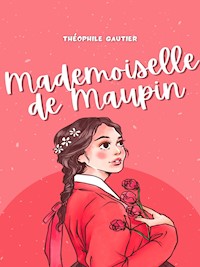Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Gérard de Nerval. "Les morts vont vite par le frais !" dit Bürger dans sa ballade de Lenore, si bien traduite par Gérard de Nerval ; mais ils ne vont pas tellement vite, les morts aimés, qu'on ne se souvienne longtemps de leur passage à l'horizon, où, sur la lune large et ronde, se dessinait fantastiquement leut fugitive silhouette noire."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Les morts vont vite par le frais ! » dit Bürger dans sa ballade de Lenore, si bien traduite par Gérard de Nerval ; mais ils ne vont pas tellement vite, les morts aimés, qu’on ne se souvienne longtemps de leur passage à l’horizon, où, sur la lune large et ronde, se dessinait fantastiquement leur fugitive silhouette noire.
Voilà bientôt douze ans que, par un triste matin de janvier, se répandit dans Paris la sinistre nouvelle. Aux premières lueurs d’une aube grise et froide, un corps avait été trouvé, rue de la Vieille-Lanterne, pendu aux barreaux d’un soupirail, devant la grille d’un égout, sur les marches d’un escalier où sautillait lugubrement un corbeau familier qui semblait croasser, comme le corbeau d’Edgar Poe : Never, oh ! never more ! Ce corps, c’était celui de Gérard de Nerval, notre ami d’enfance et de collège, notre collaborateur à la Presse et le compagnon fidèle de nos bons et surtout de nos mauvais jours, qu’il nous fallut, éperdu, les yeux troublés de larmes, aller reconnaître sur la dalle visqueuse dans l’arrière-chambre de la Morgue. Nous étions aussi pâles que le cadavre, et, au simple souvenir de cette entrevue funèbre, le frisson nous court encore sur la peau.
Le pic des démolisseurs a fait justice de cet endroit infâme qui appelait l’assassinat et le suicide. La rue de la Vieille-Lanterne n’existe plus que dans le dessin de Gustave Doré et la lithographie de Célestin Nanteuil, noir chef-d’œuvre qui ferait dire : « L’horrible est beau ; » mais la perte douloureuse est restée dans toutes les mémoires, et nul n’a oublié ce bon Gérard, comme chacun le nommait, qui n’a causé d’autre chagrin à ses amis que celui de sa mort.
Un immense cortège suivit le cercueil de la Morgue à Notre-Dame, – car l’Église ne refusa pas ses prières à cette belle âme inconsciente qui avait changé le rêve de la vie pour le rêve de l’éternité, – et de Notre-Dame au cimetière du Père-Lachaise, où une fosse l’attendait non loin de celle de Balzac, et que recouvrit une large dalle de granit portant son nom pour épitaphe. Hélas ! beaucoup de ceux qui marchaient derrière le corbillard ont fait le même voyage funèbre et ne sont pas redescendus vers la ville ; mais ceux qui restent pensent souvent à cette triste journée ; plus d’un sent qu’il lui manque quelque chose, éprouve un vague ennui dont il ne se rend pas compte, et se promène mélancoliquement sur le boulevard, auquel il ne trouve plus son ancien charme, et souffre comme si une ancienne blessure se rouvrait ; c’est l’absence de Gérard qui fait cela. Sa mort a causé un vide qui n’est pas comblé encore.
On était si bien accoutumé à le voir apparaître dans une courte visite, familier et sauvage comme une hirondelle qui se pose un instant et reprend son vol après un petit cri joyeux ! On le suivait avec tant de plaisir dans ses courses vagabondes d’un bout de la ville à l’autre pour profiter de sa conversation charmante, car demeurer en place était pour lui un supplice ! Son esprit ailé entraînait son corps, qui semblait raser la terre.
On eût dit qu’il voltigeait au-dessus de la réalité, soutenu par son rêve.
Nous l’avions connu à Charlemagne, déjà célèbre sur les bancs du collège comme auteur des Élégies nationales, qui promettaient, disaient les professeurs, un émule à Casimir Delavigne, la grande gloire du moment. C’était alors un jeune homme doux et modeste, rougissant comme une jeune fille, se dérobant volontiers à la curiosité admirative de ses condisciples, tout fiers d’avoir un camarade imprimé et dont on parlait dans les journaux. Il avait le visage d’un blanc rosé, animé d’yeux gris où l’esprit mettait son étincelle dans une douceur inaltérable. Son front, que laissaient voir très haut de jolis cheveux blonds d’une finesse extrême et pareils à une fumée d’or, était d’une admirable coupe, poli comme de l’ivoire et brillant comme de la porcelaine. Jamais voûte mieux arrondie, plus noble et plus vaste ne fut préparée par la nature pour la pensée humaine ; et cependant les idées y bourdonnèrent si nombreuses, tant de connaissances et de systèmes s’y logèrent, tant de théogonies, de philosophies et d’esthétiques y prirent place, que ce panthéon devint un capharnaüm et que la coupole se fêla. Le nez était fin, de forme légèrement aquiline, la bouche gracieuse avec la lèvre inférieure un peu épaisse, signe de bonté ; le menton bien accusé et frappé d’une fossette. Tel le représente, mais plus viril déjà, un médaillon de Jean Duseigneur – on disait alors : Jehan Duseigneur – daté de 1831. Ce médaillon, devenu très rare, est le seul portrait de Gérard à cette époque que nous connaissions. Il était habituellement vêtu d’une sorte de redingote d’étoffe noire brillante, aux vastes poches, où, comme le Schaunard de la Vie de bohème, il enfouissait une bibliothèque de bouquins récoltés çà et là, cinq ou six carnets de notes et tout un monde de petits papiers sur lesquels il écrivait d’une écriture fine et serrée les idées qu’il prenait au vol pendant ses longues promenades. Qu’on nous pardonne ces détails ; ils commencent à être rares, ceux qui ont vu Gérard tout jeune et avant la révolution de Juillet, et nous fixons, nous qui allons bientôt partir à notre tour, ces traits d’un ami disparu que la génération actuelle n’a pas connu sous cet aspect.
Gérard, comme toute la jeunesse du temps, se rattacha au grand mouvement romantique qui agitait alors la littérature. Il en était certes par le fond et la nouveauté des idées, par un certain germanisme intellectuel puisé dans la familiarité de Gœthe et de Schiller, d’Uhland et de Tieck, qu’il lisait en la langue originale ; mais il était, pour la forme, un disciple du XVIIIe siècle. Lorsque chacun cherchait les tournures excentriques et les couleurs violentes et se fût volontiers peint de vert et de rouge comme un Ioway partant pour la guerre, des plumes d’aigle sur la tête, des colliers de griffes d’ours au bas du col, des scalps, ou plutôt des perruques de classiques à la ceinture, pour avoir l’air plus étrange et plus formidable, lui se plaisait dans les gammes tendres, les pâleurs délicates et les gris de perle chers à l’école française de l’autre siècle. S’il admirait Hugo, il aimait Béranger ; il était ce qu’on appelait alors libéral et, de plus, impérialiste, deux nuances qui se fondaient dans une commune haine des Bourbons. Cette opinion chez lui se comprenait, car il était fils d’un ancien chirurgien-major des armées napoléoniennes. Ce culte de l’empereur n’était cependant pas aveugle, car, dans une de ses odes, Gérard reproche au grand capitaine
Cette préoccupation politique ne l’empêchait pas de marcher avec l’école dont la devise était : « La liberté dans l’art, » et d’être un chef de bande menant une escouade aux représentations d’Hernani. Il installait ses hommes, applaudissait consciencieusement et se retirait pour aller présenter ses devoirs à son père, qui se couchait à neuf heures, déférence filiale dont il ne se départit jamais, même plus tard, lorsqu’on joua ses propres pièces.
Sa traduction de Faust lui avait valu, du demi-dieu de Weymar, une lettre qu’il gardait précieusement et qui contenait ces mots : « Je ne me suis jamais mieux compris qu’en vous lisant. » Ce n’était pas là une vaine formule complimenteuse. Le style de Gérard était une lampe qui apportait la lumière dans les ténèbres de la pensée et du mot. Avec lui, l’allemand, sans rien perdre de sa couleur ni de sa profondeur, devenait français par la clarté.
C’est aux années qui suivirent immédiatement 1830 qu’il faut reporter les plus anciennes de ces petites pièces de vers charmantes qu’on a recueillies plus tard dans la Bohème galante, où l’odelette se marie au lied, et Ronsard à Uhland, dans une proportion exquise. Tout le monde, du moins parmi les lettrés, sait par cœur ces mignons chefs-d’œuvre qui ne dépassent guère une douzaine de vers d’un sentiment si tendre, d’une forme si discrète et si sobre, mais par malheur peu nombreux. Si la première manière du poète avait été féconde et relativement facile, la seconde, bien supérieure, le fut beaucoup moins. Il semblerait que la muse un peu timide de Gérard fût effrayée, tout en les admirant, des grands coups d’aile et du fracas de rimes du lyrisme romantique. On peut supposer que là n’était pas son secret idéal, et qu’il eût préféré une poésie plus naïve et plus simple, moins artiste en un mot, et se rapprochant des légendes ou des chansons populaires, qu’il recherchait déjà dans ses promenades à pied à travers les campagnes et dont il a recueilli quelques-unes. Il aurait au besoin admis l’assonance pour alléger la rime trop lourde à l’oreille, selon lui, à cause de cette monotonie ennuyeuse reprochée souvent à la versification française. Ces idées, que Gérard ne mit pas en pratique, étaient aussi celles de Gozlan, qui fit, dans l’Europe littéraire, une sorte de poésie assonante sur un coucou de village avec son cadran verni, son oiseau battant des ailes et ses poids suspendus qui tentent la patte des chats.
Puisque maintenant on recherche les moindres pages de Gérard, et qu’on essaye de lui créer toute une série d’œuvres posthumes qu’il renierait assurément, – car ce charmant paresseux, qui fit dans sa vie une si large part à la fantaisie, au rêve et au loisir, ne voudrait pas avoir tant travaillé après sa mort – il ne serait pas hors de propos d’indiquer d’après nos souvenirs, des œuvres plus réelles et plus authentiques qui semblent perdues ou ignorées, car nous ne les avons vues reproduites nulle part : une comédie en un acte, en vers, où figuraient Molière et sa servante Laforêt ; un mystère ou diablerie en vers de huit pieds, le Prince des sots, dont nous avions fait le prologue et qui avait pour acteurs principaux Satan et un ange jouant ensemble des âmes aux dés ; un drame en prose, Nicolas Flamel, dont quelques scènes, se passant sur la tour Saint-Jacques, ont été insérées dans le Mercure de l’époque ; plus, un autre drame envers, la Dame de Carouge, en collaboration avec nous-même, qui était basé sur cette idée d’un esclave sarrasin ramené des croisades et introduisant dans le donjon féodal les passions farouches de l’Orient. La Dame de Carouge ne fut pas jouée, et ce que le manuscrit est devenu, nous l’ignorons. Gérard le trimballa longtemps dans ses poches, où tout entrait, mais d’où rien ne sortait, comme ce tiroir du diable où Gœthe serrait ses vers et qui garda si longtemps le Second Faust. Notre Sarrasin Hafiz était le précurseur d’Yaqoub, mais il ne lui fut pas donné de montrer aux feux de la rampe sa figure teintée de jus de réglisse comme celle d’Othello.
Dès cette époque, Gérard commençait à rouler dans son esprit deux grands drames, l’un moderne, philosophique, l’autre oriental, biblique et social.
Le personnage principal du drame moderne était un médecin ambitieux qui dans son art trouvait de terribles ressources pour arriver à ses fins. C’était une sorte de Borgia en habit noir et en cravate blanche, et, en outre, un assassin scientifique comme Eugène Aram, qui sacrifiait des victimes à l’éclaircissement de quelque point obscur de son art. Il avait aimé, étant pauvre, une femme qui l’avait repoussé, et, à la scène de séparation, résolu à devenir riche, il lui disait cette phrase restée dans notre mémoire : « Cet or, comment vous le faut-il ? taché de sang ou taché de boue ? » Cette pièce, pleine de scènes remarquables, a-t-elle jamais été finie ? Nous n’en connaissons que des fragments et le scénario que nous raconta Gérard, qui essayait volontiers ses idées dans la causerie, et, pour cet usage, on peut dire qu’il ne regardait pas beaucoup au choix de l’auditeur. Il parlait devant le premier venu, comme il eût fait devant Victor Hugo, Sainte-Beuve ou Balzac. Il éprouvait le besoin d’ébaucher sa pensée avant de l’écrire, et d’en faire l’épreuve sur un être quelconque, même in anima vili.
Le second drame était la Reine de Saba. On ne saurait imaginer ce que Gérard lut de livres, prit de notes et de renseignements pour cette pièce. La Bible, le Talmud, Sanchoniathon, Bérose, Hermès, George le Syncelle, toute la bibliothèque orientale de d’Herbelot y passèrent ; tout fut consulté, jusqu’à l’histoire des soixante-dix rois préadamites et à la biographie de la dive Lilith, première femme d’Adam, pour bien prendre la couleur locale du sujet. Tout ce que les poètes persans ont raconté de Hudhad, l’oiseau merveilleux, Gérard le savait, et nous ne serions pas surpris qu’il eût entendu le langage de la huppe. Le Sir-Hasirim lui donnait le ton pour les scènes d’amour, et, afin de ne pas être pris au dépourvu quand il faudrait exprimer les magnificences du palais et du trône de Salomon, de la parure et du cortège de la reine de Saba venant d’Ophir, le pays de l’or et des perles, il avait dressé un catalogue de toutes les pierres précieuses fantastiques et réelles, depuis l’escarboucle du Giamschid jusqu’à l’azerodrach dont les bohémiennes se font des colliers. Ce qu’il avait entassé de notes et apporté de matériaux pour bâtir son monument était vraiment prodigieux. La Reine de Saba ne fit pas un heureux voyage et se perdit dans le désert avec sa suite bizarrement chamarrée d’or. Écrite d’abord en prose, elle tenta un instant Meyerbeer, que venait de révéler, sous sa forme nouvelle, l’éclatant succès de Robert le Diable, et qui voyait avec raison dans ce sujet la matière d’un magnifique opéra. La collaboration de Meyerbeer n’était pas à dédaigner, et Gérard se mit, non sans pousser plus d’un soupir, à tailler son drame en scénario. L’illustre compositeur parut ravi, demanda quelques modifications, quelques retouches, garda l’ouvrage plusieurs années, souriant toujours aux visites de Gérard avec cette exquise urbanité qui le caractérisait ; mais, selon son habitude d’éternelle hésitation, il ne fit rien. Au fond, il n’avait confiance qu’en M. Scribe et ses livrets. La pauvre Balkis, ainsi retenue, se fanait tristement dans l’ombre et la poussière d’un carton. Gérard l’en tira, arrangea les scènes en chapitres et en fit un roman qui parut, si nous ne nous trompons, dans le National. Plus tard, il reprit cette légende et l’inséra, sous forme de récit, dans les Nuits du Ramazan. Ainsi finit la caravane de la reine Balkis, cette vision d’Orient qui préoccupa Gérard autant que le jeune charpentier de la Fée aux miettes, et finit par l’amener comme lui dans la maison des lunatiques. Mais, moins heureux que l’ami de la Fée aux miettes, Gérard ne trouva pas la mandragore qui chante, et un vaisseau à la poupe dorée, aux huit mâts gréés de voiles de pourpre et de cordages de soie, ne vint pas le prendre chez le docteur Blanche pour le mener vers la mystérieuse Ophir, où l’attendait la belle reine, objet de son amour.
Malgré tous ces travaux, Gérard n’était pas connu hors du cercle littéraire où on l’estimait à sa juste valeur ; car, malgré l’envie dont on les accuse, les virtuoses de chaque art apprécient très bien la force respective de leurs confrères et les mettent à leur vraie place. À une époque où chacun aurait voulu marcher dans les rues précédé par les clairons de la Renommée, sur un char d’or à quatre chevaux blancs, pour mieux attirer les regards de la foule, Gérard cherchait l’ombre avec le soin que les autres mettaient à chercher la lumière. Nature choisie et délicate, talent fin et discret, il aimait à s’envelopper de mystère. Les journaux les moins lus étaient ceux qu’il préférait pour y insérer des articles signés d’initiales imaginaires ou de pseudonymes bientôt renouvelés, dès que l’imagination charmante et le style pur et limpide de ces travaux en avaient trahi l’auteur aux yeux attentifs. Comme Henri Beyle, mais sans aucune ironie, Gérard semblait prendre plaisir à s’absenter de lui-même, à disparaître de son œuvre, à dérouter le lecteur. Que d’efforts il a faits pour rester inconnu ! Fritz, Aloysius Block lui ont servi tour à tour de masque, et pourtant il lui fallut plus tard accepter la réputation qu’il fuyait. Dissimuler plus longtemps eût été de l’affectation.
Cette conduite n’était nullement, nous pouvons l’affirmer, le résultat d’un calcul pour irriter la curiosité, c’était l’inspiration d’une conscience rare, d’un extrême respect de l’art. Quelque soin qu’il mît à ses travaux, il les trouvait encore trop imparfaits, trop éloignés de l’idéal ; et les marquer d’un cachet particulier lui eût semblé une vanité puérile.
Nous habitions alors impasse du Doyenné. Camille Rogier avait un appartement assez vaste, dans une vieille maison tout près d’une église en ruine, dont un reste de voûte faisait un assez bel effet au clair de lune, et dont les fenêtres donnaient sur des terrains vagues encombrés de pierres de taille entre lesquelles verdissaient les orties, et que la galerie du Louvre baignait de son ombre froide. Arsène Houssaye et Gérard demeuraient avec Camille et faisaient ménage commun. Nous occupions tout seul, dans la même rue, un petit logement où nous ne rentrions guère que la nuit ; car nous passions les journées avec les camarades dans le grand salon de Rogier, vaste pièce aux boiseries tarabiscotées et ornées de rocaille, aux glaces d’un cristal louche surmontées d’impostes, aux étroites fenêtres vitrées de petits carreaux à la mode de l’autre siècle. Comme une ombre des marquises d’autrefois, errait dans ce logis fantastique, avec un œil de poudre sur ses blonds cheveux et une rose pompon à la main, cette jolie et délicate Cidalise, pastel sans cadre que devait effacer, au sortir du bal, un aigre souffle de bise. – Ce fut dans cet appartement qu’eut lieu cette fête où, selon le conseil de Gérard, les rafraîchissements furent remplacés par des fresques barbouillées sur les vieilles boiseries grises, au grand effroi du propriétaire, qui considérait les peintures comme des taches. Corot, Adolphe Leleux, Célestin Nanteuil, Camille Rogier, Lorentz, Théodore Chassériau, alors bien jeunes, exercèrent leurs brosses et improvisèrent des fantaisies charmantes.
Rogier, qui dessinait de très fines illustrations pour les Contes d’Hoffmann, et gagnait assez d’argent pour s’acheter des bottes à l’écuyère et des habits de velours nacarat, sur lesquels s’étalait sa magnifique barbe rousse, objet de notre envie, ayant à faire des dessins pour les Mille et une Nuits, partit en Orient, où il resta, et devint directeur des postes à Beyrouth. Réduite à trois, l’association se transporta rue Saint-Germain-des-Prés. Nous faisions notre cuisine nous-mêmes. Arsène Houssaye excellait dans la panade ; nous, dans la confection du macaroni. Gérard allait, avec l’aplomb le plus majestueux, chercher de la galantine, des saucisses ou des côtelettes de porc frais aux cornichons chez le charcutier voisin, car on s’imagine bien que notre livrée n’était pas nombreuse. Nous vivions ainsi de la façon la plus amicale, et ce sont les plus belles années de notre vie. Gérard, qui dormait très peu, lisait fort avant dans la nuit, et il avait trouvé un singulier, mode d’éclairage : il posait en équilibre sur sa tête un de ces larges chandeliers de cuivre qu’on appelle martinet, et la lueur se projetait sur les pages ouvertes ; mais quelquefois le sommeil le gagnait et le chandelier tombait, au risque de mettre le feu au lit. Michel-Ange et Girodet peignaient nocturnement de la sorte avec des bougies sur la tête, comme les Turcs du Bourgeois gentilhomme.
Ce fut à peu près vers cette époque qu’on nous confia le feuilleton dramatique de la Presse, avec Gérard pour collaborateur. Nous signions G.-G. par imitation du J.J. des Débats ; mais nous ne pesions pas à nous deux la monnaie de celui qu’on nommait déjà le prince des critiques. On trouverait sous cette double signature, facilement reconnaissables, les morceaux qui appartiennent en propre à Gérard. Nous étions d’humeur fort vagabonde, et chacun de nous venait tourner la meule du journal lorsque l’autre, emporté par son instinct voyageur, parcourait l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, ou l’Afrique. Fraternelle alternative que Gérard comparait à celle des Dioscures, dont l’un paraît quand l’autre s’en va. Hélas ! il est parti pour ne plus revenir.
Mais bientôt ce travail à heure fixe, bien qu’allégé par la collaboration et de nombreuses vacances lui devint insupportable, et nous dûmes continuer seul la fastidieuse besogne d’analyser les vaudevilles et les mélodrames.
On s’est attendri fort mal à propos sur la misère de Gérard, et l’on a voulu y voir une des causes de sa triste fin. Les journaux lui furent toujours ouverts, et chaque article qu’il présentait à un directeur était le bienvenu. Les ressources que l’époque offrait aux écrivains étaient à sa disposition, et sa connaissance de l’allemand, lorsqu’il n’était pas en train d’inventer, lui fournissait un facile moyen de travail. Il était juste aussi riche ou, si l’on veut, aussi pauvre que nous. Il fit même, vers ce temps-là, un petit héritage d’une quarantaine de mille francs qui dora les commencements de sa carrière, et lui permit l’accomplissement de quelque fantaisie, par exemple la fondation d’un journal, le Monde théâtral, dont le but était de faire valoir une actrice dans laquelle il croyait avoir trouvé la réalisation de son idéal. Au reste, l’argent était son moindre souci. Jamais l’amour de l’or, qui cause aujourd’hui tant de fièvres malsaines, ne troubla cette âme pure et vraiment antique. La richesse lui semblait un embarras, et, comme Diogène voyant un jeune berger puiser de l’eau dans sa main, il eût volontiers rejeté sa coupe inutile. Mais ne croyez pas, d’après cela, à un bohème, à un cynique ; personne n’eut des manières plus polies, un ton meilleur, un langage plus réservé, et ne se montra plus parfait gentleman. Seulement, les louis lui causaient une sorte de malaise et semblaient lui brûler les mains ; il ne redevenait tranquille qu’à la dernière pièce de cinq francs.
Nous avons tout à l’heure touché en pas un point délicat de la vie de Gérard sur lequel, malgré son amitié pour nous, il ne s’expliqua jamais formellement ; car c’était une âme discrète et pudique, rougissant comme Psyché, et, à la moindre approche de l’amour, se renfermant sous ses voiles. Nous voulons parler de sa passion pour une cantatrice célèbre alors dont nous tairons le nom, puisque son adorateur ne l’a jamais écrit. Cette passion très réelle a passé pour chimérique. Beaucoup d’entre nous en ont douté, car Gérard était un étrange amoureux. Nous l’avions parfois doucement raillé sur ses caprices soudains à l’endroit de femmes aperçues de loin et dont il évitait même de se rapprocher, pour ne pas détruire son illusion, disait-il. Le reproche lui était resté sur le cœur, et, dans son Voyage en Orient, il semble y répondre par ces lignes, auxquelles sa fin douloureuse prête une signification sinistre :
« J’ai entendu des gens graves plaisanter sur l’amour que l’on conçoit pour des actrices, pour des reines, pour des femmes poètes, pour tout ce qui, selon eux, agite l’imagination plus que le cœur : et pourtant, avec de si folles amours, on aboutit au délire, à la mort ou à des sacrifices inouïs de temps, de fortune ou d’intelligence. Ah ! je crois être amoureux ? ah ! je crois être malade, n’est-ce pas ? Mais, si je crois l’être, je le suis. »