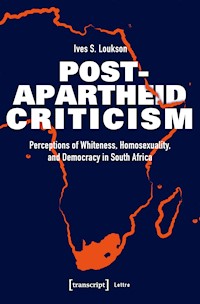Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le postcolonialisme offre des clés essentielles pour interpréter la culture dans ses diverses formes, telles que la littérature, le cinéma, la musique, la peinture, l’économie et l’éducation. Cependant, son application dans la littérature demeure parfois incertaine, tant ce courant théorique oscille entre simplicité et complexité. Cet ouvrage propose une exploration des pratiques et interventions postcoloniales à travers un exemple concret de lecture critique. Le roman The Pickup de Nadine Gordimer, lauréate du prix Nobel de littérature en 1991, sert de base à cette analyse, offrant un éclairage sur les dynamiques postcoloniales à l’œuvre dans l’œuvre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ives S. Loukson, diplômé des universités de Bayreuth en Allemagne et de Yaoundé 1 au Cameroun, enseigne les littératures et cultures africaines à l’université de Dschang – Cameroun –. Ses recherches se concentrent sur les défis et les potentialités que la postcolonialité africaine impose à l’éducation, à la philosophie et aux littératures anglophone et francophone du continent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ives S. Loukson
Postcolonialisme et migrations
Pratiques de la pensée
Essai
© Lys Bleu Éditions – Ives S. Loukson
ISBN : 979-10-422-7791-8
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Ce livre est dédié aux damné(e)s de la terre
Abréviations
Art. :Article
CD :Compact Disc
C.L.E. :Centre de Littérature Évangélique
Coll. :Collection
Conf. :Confère
C.R.A.C. :Club de Recherche et d’Action Culturelle
No:Numéro
p. (+ chiffre) :Page dans The Pickup
P.U.F. :Presses Universitaires de France
Reéd. :Réédition (ou réédité)
R.F.I. :Radio France Internationale
S/d :Sous la direction
USA :United States of America (ou États-Unis)
Préface
Il aime la littérature, le Cameroun, l’Afrique et le monde. L’univers de la recherche en sciences humaines et sociales dans lequel j’évolue me fascine, et l’Afrique me passionne tout autant, notamment à travers l’engagement de nos prédécesseurs ainsi que celui d’un vaste mouvement d’intellectuels contemporains qui pensent l’Afrique. L’initiative d’Ives S. Loukson de rendre hommage à la littérature postcoloniale, qu’il affectionne tout particulièrement et qu’il explore au quotidien dans son cours intitulé « Lectures postcoloniales », me paraît essentielle et opportune. Écrire cette préface sur le postcolonialisme et les migrations ne pouvait que m’enthousiasmer. Et même si cette réalité postcoloniale interroge un pan de la société, cela reste pertinent. En effet, s’il est une notion qui revient fréquemment dans les recherches en sciences humaines et sociales de nos jours, c’est bien celle de la colonisation, sous ses multiples facettes : décolonisation, postcolonialisme, décolonialité, etc.
Pourquoi Loukson s’interroge-t-il sur ces pratiques de pensée ? D’emblée, il affirme vouloir « échapper à cette forme d’irresponsabilité individuelle, voire professionnelle ». En amont, il prend soin de souligner ce qu’il identifie comme la source de cette posture individualiste. Il affirme que « l’une des raisons les plus essentielles est systémique, dans la mesure où aucun cadre théorique de projection collective ne préside aussi bien à la création qu’au fonctionnement de quelque institution que ce soit au Cameroun ». Par cette affirmation, l’auteur critique clairement l’implantation du système LMD dans les universités camerounaises.
Vouloir échapper à une telle posture suppose une observation attentive, un intérêt certain, un questionnement profond. L’auteur ne s’adresse pas exclusivement aux étudiants, car les enjeux liés aux migrations ou au postcolonialisme concernent l’ensemble de la société. Sa posture est critique : il tient à souligner que la fiction constitue un espace où se côtoient les fêlures postcoloniales, les silences de l’histoire et les possibles formes du vivre-ensemble.
Il n’est donc pas étonnant que, dans cet hommage, Loukson fasse référence à l’une des plus grandes écrivaines sud-africaines contemporaines, Nadine Gordimer. Son roman The Pickup, qui traite de la question migratoire de manière originale, constitue un point d’ancrage pour l’essai Postcolonialisme et migrations – Pratiques de la pensée. L’auteur y donne un sens particulier au roman, en en dévoilant la spécificité à travers les notions de migration, de représentation et de subalternité, révélatrices des tensions de notre univers contemporain.
Pour ma part, je demeure enthousiaste devant la clarté avec laquelle Loukson aborde les théories postcoloniales, les migrations, ainsi que son hommage à Fabien Eboussi Boulaga. Envisagé non comme une théorie figée, mais comme une ouverture perpétuelle sur le monde de la pensée, le postcolonialisme, tel que présenté par Loukson, engage une relecture transdisciplinaire. Il ne s’agit pas seulement d’un prolongement de la critique anticoloniale, mais d’un projet de décentrement épistémologique. Le postcolonialisme devient ainsi un outil d’analyse des recompositions du pouvoir, des identités et des récits dans un monde globalisé, traversé par une mobilité qui ne va pas toujours de pair avec l’évolution des imaginaires.
Dans ce voyage littéraire, l’essai dialogue avec d’autres penseurs africains qui ont réfléchi à la question postcoloniale avec lucidité et profondeur. Loukson attire notre attention sur les formes actuelles de souveraineté et de mobilité humaine, qu’il considère comme des expressions renouvelées du pouvoir biopolitique. Encore une fois, la figure de Fabien Eboussi Boulaga est mise en avant à travers l’exigence de penser par soi-même, de sortir d’une extériorité imposée, et de reconsidérer la critique comme fondement et comme fondation.
Au-delà de l’imaginaire, le roman de Gordimer, bien qu’il serve de miroir à une Afrique du Sud post-apartheid encore piégée par une modernité inachevée, met en lumière une dialectique de l’exil et de l’appartenance, de l’identité et de l’altérité. C’est dans ces dualités que se déploie toute la richesse de l’essai de Loukson : la migration y est pensée non seulement comme un déplacement physique, mais comme un événement ontologique et politique mettant en jeu les représentations.
À la croisée des chemins du postcolonialisme, cet essai, nourri d’une pensée critique, invite à une réflexion profonde sur la complexité, l’hybridité et les dynamiques de translation. Il soulève également la question du risque d’une dilution de cette théorie dans des discours académiques désincarnés, ou de sa récupération par des logiques politiques qui perpétuent l’impérialisme sous des formes plus subtiles.
Entre rigueur théorique et engagement critique, l’ouvrage de Loukson adopte une posture postcoloniale ancrée, éthique et transformatrice. Il y a une dimension personnelle et émouvante dans la démarche de l’auteur : ce deuxième essai, après Post-Apartheid Criticism. Perceptions of Whiteness, Homosexuality, and Democracy in South Africa, lui permet de parcourir par la pensée le monde, l’Afrique et les réalités migratoire et identitaire.
Ce livre offre au lecteur une occasion précieuse de réfléchir au postcolonialisme et aux migrations dans une perspective critique, qui « consiste à faire front aux méfaits de la représentation sous toutes ses formes », tout en ouvrant une fenêtre sur l’altérité.
Je remercie Loukson, frère littéraire, de m’avoir permis d’écrire cette préface.
Nathasha Pemba, PhD
Québec, le 7 juin 2025
Avertissement
L’idée du présent ouvrage est apparue lors du cours « lectures postcoloniales » que son auteur dispense à l’Université de Dschang. Le constat général qui en précise l’importance est le paradoxe étrange entre les performances finales des étudiant(e)s et leur enthousiasme débordant pour le même cours au départ. En pareille circonstance, se contenter d’énoncer quelques théories alambiquées dans l’espoir d’exorciser un problème concret serait une fuite en avant, tant cette attitude élude les responsabilités individuelles devant une question pratique de pédagogie. C’est pour échapper à cette forme d’irresponsabilité individuelle, voire professionnelle, que la nécessité du présent livre s’est manifestée. Avant d’en arriver, il n’est pas peut-être superflu de présenter quelques difficultés réelles auxquelles l’Université Camerounaise en général, ses étudiants en particulier font face et qui déteignent forcément sur leurs performances académiques.
Les raisons des médiocres performances des étudiants de l’Université Camerounaise sont multiples. Une des raisons les plus essentielles est systémique dans la mesure où aucun cadre théorique de projection collective ne préside aussi bien à la création qu’au fonctionnement de quelque institution du Cameroun que ce soit. Quelques idées pertinentes empruntées au philosophe Fabien Eboussi Boulaga et au critique littéraire Edward Said permettraient de mieux faire comprendre ce qui est en cause ici.
Dans une interview accordée au journaliste Valentin-Siméon Zinga, Eboussi identifie le problème majeur de l’institution Cameroun comme celui de « l’absence de pensée »1. Y aurait-il profusion de pensée qu’Eboussi appelle de ses vœux au Cameroun que le pays se soit doté de ce cadre théorique de projection collective (culture nationale, gage d’identité collective donc) dont l’absence handicape littéralement hélas le pays aujourd’hui. C’est à cette condition que le pays se serait donné les règles, le rythme et les principes de sa propre « grande narration » dont traite for à propos Edward Said dans Culture and Imperialism2.
Edward Said compare en effet l’idée de nation permanemment en chantier aux mécanismes intellectuels et inventifs mis en branle par le romancier à la seule fin d’assurer la narration dans son récit. En d’autres termes, alors que dans le récit, le romancier est l’auteur de la narration, dans la nation l’auteur en est la nation au sens de la communauté. Par « grande narration » camerounaise, on devrait donc entendre une sorte d’âme effectivement camerounaise, mais vivante en ce qu’elle résiste continuellement à la fixité, qu’elle soit endogène ou exogène. Cette âme est l’incarnation voire la traduction fidèle des aspirations, elles aussi évolutives par rapport au temps et à l’espace, de toutes les populations camerounaises, sans exception. Se doter d’une telle âme a l’avantage d’assurer à chaque membre du groupe comme à l’ensemble l’autonomie nécessaire pour résolument engager sa totale responsabilité individuelle et collective dans l’intérêt durable et effectif du groupe.
On le voit, pour y parvenir, on ne saurait se passer de « pensée » au sens de Fabien Eboussi Boulaga. C’est pourquoi, en l’absence aussi bien de « pensée » que de « grande narration », il devient presque naturel que l’amateurisme essentiellement caractérisé par la gestion des affaires de la nation par le haut, une trouvaille du colonialisme, prenne le pas pour se passer pour seule légitime à devoir forger et structurer la vie de toute la nation camerounaise, toutes ses institutions y compris. Et l’Université n’est pas de reste.
L’amateurisme et la mauvaise foi des institutionnels dans l’implémentation du système LMD (Licence-Master-Doctorat) à l’Université justifient considérablement les piètres performances de l’étudiant(e) du Cameroun aujourd’hui. On pourrait largement s’interroger si l’institutionnel Camerounais n’eut pas suffisamment de jugeote pour anticiper sur les défis importants et conséquences réelles de ce système sur la qualité de la recherche universitaire au Cameroun ? Quel intérêt y avait-il à introduire un système aussi onéreux que le LMD dans les institutions universitaires du Cameroun au cours de l’année académique 2007-2008 alors que le Cameroun ne réunissait pas (il est d’ailleurs très loin de les réunir même aujourd’hui) les conditions indispensables pour la capitalisation des biens faits du LMD ?
Les grèves répétitives du personnel enseignant et non enseignant, la soutenabilité discutable des contenus de la majorité des enseignements qui y ont cours, l’état de délabrement des infrastructures lorsqu’elles existent en renforcent d’ailleurs la gravité de la situation chaque jour. En plus de ce qui précède et sans prétention à l’exhaustivité, d’autres plaies sérieuses qui minent l’Université camerounaise sont : insuffisance d’enseignants lorsqu’ils ne sont pas recrutés sur hautes instructions, défaut de bibliothèques et de laboratoires dignes de l’Université, fourniture à compte-gouttes en électricité, non-couverture en internet (WLAN) de l’espace universitaire.
L’autre aspect du problème est le fait que des générations d’étudiants qui arrivent à l’Université sont essentiellement constituées de jeunes gens à qui personne n’a préalablement appris à lire, donc à penser. Et que celles-ci soient subitement engagées dans un processus aussi contraignant et exigeant comme le LMD à présenter des travaux de recherche conformes aux règles de l’art, deux années seulement après la licence, sans compter que pendant ces deux mêmes années, lesdits étudiant(e)s ont des unités de valeur à capitaliser, relève sinon du dressage collectif, du moins de la brimade ou de l’asservissement et non plus de la formation.
Bien que toutes pertinentes les unes les autres, ces explications n’en demeurent pas moins simplistes et leur simple énonciation peuvent s’avérer totalement irresponsable pour le pédagogue moulé à l’école du maître Innocent Futcha que l’auteur de ce livre est. En son temps, « l’homme décent3 » comme le qualifie son collègue enseignant et ami Ambroise Kom avait coutume de soutenir que « la leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes4 ». Aussi fallut-il sereinement s’interroger sur quel exemple pourrait être fourni aux étudiant(e)s en littérature et arts connexes, et intéressé(e)s par les théories postcoloniales comme grille d’analyse pour leurs travaux de recherche.
L’héritage de décence gratuitement légué à l’auteur de ce livre par son maître exige de reconnaître que l’essentiel de ce livre est le produit de la fréquentation par l’apprenant du maître. Une fréquentation souvent ponctuée par de nombreux coups d’essai erronés et de recommencements, de patience, d’assiduité, d’austérité, et surtout de labeur acharné et évidemment de découvertes sans cesse nouvelles qui assuraient, cinq bonnes années durant, la maturation intellectuelle et psychologique souvent imperceptible par l’apprenant que l’auteur de ce livre fut alors. L’idée d’un cadre plus approprié est peut-être à explorer pour rendre un hommage mérité à celui sans l’entregent duquel ce livre n’aurait sans doute jamais pu voir le jour.
Ce livre ne s’adresse naturellement pas et exclusivement aux seuls étudiant(e)s. Il peut aussi être utile à d’autres publics. De par son titre centré sur les migrations, il interpelle par exemple le plus grand public. L’espoir de son auteur est qu’en définitive, cet écrit puisse contribuer à une appréciation plus judicieuse et moins excessive des enjeux existentiels des migrations en Afrique et dans le reste du monde.
Ives S. Loukson
Dschang, le 02 mai 2025
Introduction
L’institution du régime de l’Apartheid en Afrique du Sud a naturellement provoqué la naissance d’une opposition ouverte à ce régime raciste. Que dans cette opposition, des écrivains sud-africains aient particulièrement été actifs n’a rien de surprenant. En effet, la littérature africaine en général se singularisant par sa sensibilité à l’injustice et à l’iniquité5, celle de l’Afrique du Sud ne pouvait se déployer dans l’indifférence à l’égard de l’Apartheid. De nombreux écrivains d’Afrique du Sud avaient trouvé en l’Apartheid un thème qui nourrissait leurs œuvres littéraires.
Ceux-ci furent tellement absorbés par le combat contre l’Apartheid que Mazisi Kunene ne manqua pas d’exprimer sa crainte quant au devenir de l’activité littéraire en Afrique du Sud. Kunene écrit précisément :
The trouble with South African writing about apartheid is that these people write about apartheid and one day it won’t exist and they’ll have nothing to write about6.
Le démantèlement du régime qui avait jusqu’alors institué l’horreur en Afrique du Sud ne pouvait pas avoir eu lieu sans répercussions évidentes quant à la pratique littéraire de ce pays. On a par exemple à faire à l’exploration de thèmes nouveaux tels la migration7 ou la protection environnementale8 chez une auteure comme Nadine Gordimer. Les conséquences du démantèlement de l’apartheid sur la littérature sud-africaine constituent une illustration de la réflexion de Georges Ngal pour qui :
Chaque décennie semble nous promettre de nouvelles formes langagières (littéraires), du moins proclamées comme telles (…) Les discours littéraires se modifient dans et avec l’évolution des sociétés et de l’histoire9.
La production littéraire postapartheid de Nadine Gordimer comprend des titres comme None to accompany me (1994), The House Gun (1998), The Pickup (2001)10, et Get a life (2005)11.
Des sources consultées12, nous avons pu apprendre que None to accompany me, à travers l’avocate blanche Vera Stark, personnage central, montre comment la mutation politique de 199413 en Afrique du Sud impose au Sud-africain des changements au plan du comportement individuel.
The House gun dévoile quant à lui une Afrique du Sud postapartheid qui, malgré le gouvernement de la majorité noire, celui de Nelson Mandela, continue de faire subir aux Sud-Africains les mêmes traitements que l’ancien gouvernement, celui de Frederick De Klerk. Gordimer s’appuie, pour ce faire, sur le paisible et riche couple blanc Harald et Claudia Lingard. Ces derniers ne comprennent pas comment leur fils Duncan a pu devenir l’assassin d’un jeune homme adopté par le couple. La fréquentation de la justice du pays par le couple lui permet de constater la responsabilité du gouvernement dans la transformation de Duncan en un assassin.
Get a life s’affirme pour sa part comme un prolongement de la réflexion commencée dans The House gun. En effet, comme l’Afrique du Sud fut autrefois rongée par le racisme, elle est aujourd’hui fragilisée par les erreurs du gouvernement dont les conséquences sont comparables à celles du racisme. Gordimer suggère dans ce roman que la construction d’une nouvelle identité sud-africaine s’opère à partir du présent tout en prenant appui sur des valeurs humaines et sur l’écologie. Voilà pourquoi le personnage central, Paul Bannerman, un écologiste atteint d’un cancer de la thyroïde, préfère quitter son épouse et son fils, peu humains, et accepte plutôt les soins chaleureux de ses vieux parents retraités dans la maison où il a autrefois grandi. Chez ses parents, Paul Bannerman passe beaucoup de temps dans le jardin familial à cause de ses vertus écologiques.
The Pickup, enfin, plonge le lecteur, en même temps, dans l’Afrique du Sud postapartheid et dans une contrée arabe géographiquement localisée dans une zone désertique. Les personnages centraux Musa et Julie sont des migrants quittant leurs pays respectifs pour s’établir ailleurs. À la base de leur migration se trouve une forme de représentation que je me propose d’analyser.
The Pickup de Nadine Gordimer est la preuve que cette auteure a rompu avec les thèmes littéraires favoris de l’époque de l’Apartheid qui lui ont pourtant permis de recevoir le prestigieux prix Nobel de littérature. En 1991, l’académie de Stockholm l’a honorée parce qu’elle aurait passé toute sa vie, à décrire avec minutie et obstination toutes les conséquences que les distinctions raciales ont inspirées à l’être humain.14
En effet, The Pickup est centré sur la question de la migration, une question dont l’actualité n’a d’égale que sa forte récurrence dans les médias tant classiques que numériques. Ann Skea n’a aucunement tort de soutenir à propos de ce roman que :
The Pickup is a superb story told by a very skilful storyteller. It is also a story which explores the changes in the wider world in surprising but important ways. V. S. Naipaul said in a recent interview that he believed that “the serious function of writing” (and he was talking about novels) is to help readers to understand society. The Pickup seems to me to do this enjoyably, topically and admirably. In a world of rapid social change, where issues of immigration are daily aired in the media, Gordimer offers insight into the radically different meaning which “another country” has for those who can choose to move and those who must overcome seemingly insurmountable odds in order to be chosen15.
Ce roman a également l’avantage d’aborder cette question de la migration qu’Ann Skea relève fort à propos, d’une manière spécifique. On y voit d’une part, un immigré qui quitte son pays à destination des pays qu’il considère comme riches, voire comme des eldorados. Cette dernière forme de migration correspond à la majorité des migrations actuelles en Afrique au sud du Sahara, où l’on voit parfois des fonctionnaires de ces pays abandonner fonction et familles afin de s’établir définitivement dans ces eldorados incertains.
D’autre part, une jeune femme issue de famille riche, Julie, qui abandonne les siens, son univers d’abondance et son pays pour un autre pays, certes pauvre, mais quelle choisit par amour pour son prince charmant. Cette forme de migration ouvre une perspective nouvelle quant au regard que les Sud-Africains de l’univers du roman posent sur eux-mêmes et sur les autres. Par effet de contamination, cette autre forme de migration pourrait contribuer à la relativisation des regards fixistes, révélateurs d’un certain étiolement anthropologique, voire culturel, sur les migrations. Elle pourrait même servir de prétexte pertinent pour énoncer des conceptions alternatives des phénomènes migratoires en ce sens qu’elles seraient plus saines et plus pragmatiques.
La critique littéraire Sue Kossew pense à cet effet que :
It is a novel that has his place in what Gordimer has called a postapartheid “literature of transition”; taking as its subject-matter the issues of displacement, economic exile and migration… Gordimer is fascinated by the kinds of power shifts that occur when people become displaced from their comfort zones (a theme she has, of course, already minutely explored in July’s people) and have to adapt to new ways of thinking and being16.
La présente étude intitulée Postcolonialisme et migrations – Pratiques de la pensée se nourrit aussi bien des potentiels symbolique et théorique que le roman The Pickup incarne, que de l’originalité qu’il témoigne en rapport au traitement qu’il fait de la migration. Afin d’éviter toute équivoque, ce dans un contexte où la manipulation, l’offre ou l’activisme des idées attestent plus que jamais de leur activisme, il importe de préciser le sens des termes constitutifs de l’étude.