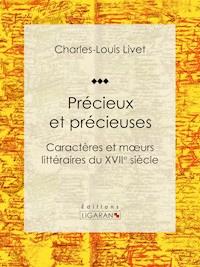
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est en tremblant que j'aborde le nom respecté d'une femme qui domina son siècle de toute la hauteur d'une vertu sans tache, et de toute l'influence de la vénération qu'elle inspirait. Des plumes plus exercées que la mienne, et, tout récemment, un écrivain illustre, je veux dire M. Rœderer, M. Walckenaër, et enfin M. Cousin, dans la Jeunesse de madame de Longueville, ont rendu à la marquise de Rambouillet une éclatante justice..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076394
©Ligaran 2015
DE LA SOCIÉTÉ PRÉCIEUSE AU XVIIe SIÈCLE
Cette période féconde de notre histoire, qui commence avec Richelieu et finit avec Mazarin, n’est pas seulement importante par les résultats politiques obtenus : les grands soumis à la loi, la maison d’Autriche abaissée, le parti des protestants ruiné, l’équilibre européen établi, le traité des Pyrénées signé ; il s’y produisit des faits purement civils, indépendants de toute action émanée du pouvoir royal, qui amenèrent à la fois dans les mœurs et même dans la langue des réformes suffisantes pour faire, à elles seules, la gloire du XVIIe siècle. Sous l’influence d’une femme justement vénérée, la marquise de Rambouillet, les hommes commencèrent à rechercher la Société des femmes ; celles-ci à recevoir dans une égale intimité les gens de lettres et les gentilshommes ; si bien qu’avant 89 l’esprit avait déjà conquis sa noblesse. Le langage prit une décence rarement observée jusque-là et demanda en outre à l’Italie la délicatesse et la galanterie, à l’Espagne la gravité et la noblesse. Alors enfin naquit l’esprit de conversation.
Si plus tard les qualités cherchées et obtenues finirent par se corrompre ; si, par suite d’un raffinement exagéré, on en vint à substituer la pruderie à la pudeur, l’afféterie à l’élégance, un pédantisme prétentieux au charme d’un savoir modeste, qu’on n’en accuse pas les premières réunions, formées sur le modèle des assemblées de l’hôtel de Rambouillet, mais ces coteries impuissantes, ces cabales bourgeoises dont les livres de Somaize et les comédies de Molière nous ont tracé de piquants tableaux.
Nous nous proposons d’aborder, dans un résumé rapide, l’histoire de cette société, si intéressante dans son origine et son progrès, comme dans la décadence qui suivit. Mais nous devons dès à présent faire ressortir un caractère commun aux deux époques ; c’est que les habitués de madame de Rambouillet ou les familiers de mademoiselle de Scudéry ont pu sans doute, en particulier, être mécontents du pouvoir ; mais uniquement sensibles aux choses de l’esprit, soumis au souverain, ils restèrent toujours, dans leurs réunions, étrangers à la politique et ne se montrèrent jamais hostiles aux actes du gouvernement. Si donc on peut remarquer que les principes d’égalité proclamés par 89 furent préparés dès cette époque par l’élévation non plus isolée, mais générale, des gens de lettres, il serait faux d’avancer que l’esprit de soumission s’y soit perdu et que l’indépendance ou la révolte y aient pris naissance ou trouvé un appui.
Le caractère entièrement privé des réunions de la société polie au XVIIe siècle nous dispense d’entrer dans le détail des évènements politiques ou des grandes mesures administratives qui signalèrent les ministères de Richelieu et de Mazarin ; quelques traits sont nécessaires cependant pour faire connaître et les mœurs qui s’y réformèrent, et le langage qui s’y polit, et les circonstances qui auraient pu servir ou qui aidèrent réellement le développement de l’esprit nouveau.
Les mœurs, pour chacun et pour tous, résultent de la pratique habituelle, constante de certaines règles de conduite plutôt inspirées par les sentiments que dominées par la réflexion : pour le plus grand nombre, en effet, le proverbe dit vrai, le cœur emporte la tête, et c’est dans l’étude des penchants, des inclinations, des tendances ordinaires d’une époque que nous trouverons le plus facilement l’explication des mœurs générales.
Or, au moment de la mort de Henri IV, quelle était la situation du pays ? Par ce qui était nous verrons ce qui restait à faire, et à quelles aspirations vers un autre avenir donnait lieu l’état actuel de la société.
Deux partis, plutôt politiques que religieux, bien qu’ils empruntassent leur nom des catholiques et des protestants, divisaient alors la France et essayaient à l’envi, ceux-là de conserver une supériorité laborieusement acquise, ceux-ci de ressaisir une influence vainement défendue. L’intrigue d’abord, les armes ensuite, avaient été appelées au service des deux causes ; l’habileté du feu roi avait su maintenir des deux côtés l’équilibre ; mais sa mort et les embarras d’une régence remettaient tout en question, relevaient le courage des ambitieux et prolongeaient en France, avec les discordes civiles, ces désordres qui atteignaient la population entière dans ses trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état.
Le clergé supérieur n’avait pas alors cette haute moralité, et n’était point recruté avec ce choix intelligent et sévère qu’on admire aujourd’hui ; il était en grande partie composé de jeunes gens nobles, engagés dans les ordres ou par force ou par l’habitude du temps ; de faciles dispenses leur apportaient, avant même l’âge des plaisirs, les richesses des abbayes ou les revenus des évêchés et des canonicats ; vivant pour l’ordinaire hors de leur diocèse, ils en ignoraient les besoins et menaient une vie toute mondaine. À de rares exceptions près, leur influence morale était nulle, et ils n’avaient aucune action sur le clergé inférieur. Maîtres de l’éducation dans les campagnes, ils se déchargeaient de la surveillance et de la direction des petites écoles sur le chantre de leur église métropolitaine ; s’ils connaissaient les abus, c’était pour les punir plutôt que pour les prévenir ou les réformer.
À la cour, les gentilshommes les plus nombreux, ceux qui n’imitaient personne et qui dominaient avec une autorité incontestée sur les modes, le langage ou les mœurs, étaient les gens de guerre. Témoins des débordements d’un roi dont l’âge semblait augmenter plutôt qu’affaiblir les passions obstinées ; peu scrupuleux sur la morale que cinquante années de guerre civile leur avaient singulièrement fait oublier, ils se livraient à l’amour immodéré des plaisirs, et c’était là encore une flatterie plus ou moins directe à l’égard du souverain. Toutes les provinces du royaume y avaient des représentants, tous les patois s’y parlaient ; des prononciations diverses défiguraient diversement les mots, et ce serait une grave erreur de penser qu’il y eût alors à la cour un langage choisi, homogène, qui pût agir avec succès sur la littérature : la langue écrite ne ressemblait en rien à la langue parlée ; telle qu’elle était, c’était en quelque sorte un idiome savant que tous entendaient, mais qui n’avait pas cours dans les relations habituelles. Apprise sans règles et sans grammaire, la langue n’avait guère obéi jusque-là qu’à l’usage. Que l’on mette en regard des vers de Malherbe, ses lettres chargées de solécismes et de locutions patoises, on se fera une idée de la négligence avec laquelle la langue était traitée. Si la politesse du langage ne préoccupait aucunement les gens de cour, leurs habitudes guerrières et la vie de garnison les rendaient peu scrupuleux sur la décence des expressions ; le goût des histoires graveleuses, l’emploi des termes les plus libres, les usages les plus grossiers arrêtaient dans leur expansion tous les sentiments de pudeur, toute cette réserve, cette délicatesse exquise et fine qui réclame impérieusement une langue particulière. Nous ne donnerons point d’exemples de ce qu’était alors la liberté du langage : les contes de la reine de Navarre, les poésies et les comédies du temps ne le montrent que trop.
Il était donc urgent, après les améliorations successives introduites depuis, qu’une influence puissante vînt enfin consacrer, pour ainsi dire, ces progrès déjà obtenus, et fit adopter formellement, d’une manière continue et régulière, un langage nouveau pour des mœurs nouvelles.
Aux femmes fut réservée cette tâche ; elles seules purent obtenir des hommes des manières plus délicates et un langage épuré ; mais en même temps qu’elles durent se faire rechercher par le charme de leur conversation, elles eurent à faire désirer, en le rendant difficile, l’accès auprès d’elles, et à commander le respect par la pureté de leurs mœurs. Elles avaient donc elles-mêmes à se réformer. Il nous reste à chercher d’où partit la réforme.
Pour qui s’est rendu compte du nombre des couvents et aussi de la quantité de jeunes filles qui y étaient élevées et qui y vivaient jusqu’à leur mariage, il semble que l’influence des maisons religieuses devait être grande sur la société contemporaine ; si ce n’est pas de là que sortirent ces femmes qui, les premières, songèrent à protester contre la corruption de la société, c’est un phénomène étrange qui demande une explication.
Les couvents étaient depuis longtemps dirigés par des abbesses qui songeaient plus au revenu qu’elles en tiraient qu’aux règles qu’elles y devaient faire suivre. Comme les évêques, qui restaient peu dans leur diocèse, les titulaires des abbayes observaient rarement la résidence et laissaient le champ libre aux petites ambitions, aux intrigues, aux révoltes, au relâchement et même à l’oubli de toute discipline. Au XVIIe siècle, les abus devinrent si criants qu’il fallut y porter remède. De pieux ecclésiastiques, de saintes femmes provoquèrent de nombreuses réformes, qui, malheureusement, s’opérèrent isolément et non d’une manière générale. Leurs écrits nous fournissent des peintures si vives des désordres qu’ils ont à réprimer qu’on les soupçonnerait volontiers d’exagérer le mal pour prouver mieux la nécessité de le combattre ; mais il n’est que trop d’autres sources qui confirment les faits avancés par eux, et qui nous révèlent cet état de choses déplorable d’où ne pouvait provenir aucun effet utile et qui se perpétua pendant tout le XVIIe siècle.
Non seulement les femmes de qualité étaient admises à suivre, ou plutôt à troubler les exercices des couvents, mais elles y avaient leur appartement, leur maison même, qu’elles y faisaient bâtir ; M. Cousin nous rappelle, dans la Jeunesse de Madame de Longueville, que la mère Agnès refusa 100 000 livres de mademoiselle de Guise, qui sollicitait à ce prix la permission d’entrer souvent dans la communauté. Cette somme, disait-elle, ne réparerait point la brèche faite par là à l’esprit de l’institution, qui ne se peut conserver que par la retraite et l’éloignement de tout commerce du monde ; mais, quelques pages plus loin, il rapporte un acte authentique, passé le 18 novembre 1637, au nom de Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, et de sa fille, mademoiselle de Bourbon, qui devint madame de Longueville, avec les Carmélites du Faubourg Saint-Jacques. Cette pièce importante, que nous empruntons au même ouvrage, nous dispensera d’en citer d’autres du même genre. On y lit que les religieuses, averties du désir que ces princesses « avoient fait paroistre d’être reçues pour fondatrices de la maison nouvelle que lesdites Révérendes font à présent construire et prétendent joindre à leurs anciennes clôtures ; après avoir proposé l’affaire en plein chapitre et avec la permission de leurs supérieures… ont volontairement admis lesdites princesses pour fondatrices, à l’effet de jouir de tous les privilèges accordés aux fondatrices… ; à savoir de la libre entrée du monastère toutes les fois qu’il leur plaira pour y boire, manger, coucher, assister au divin service et autres exercices spirituels… ; ont de plus consenti que ladite dame princesse puisse jouir des privilèges qu’elle a obtenus du Saint-Père, de faire entrer deux personnes avec elle trois fois le mois, comme elle a fait jusqu’icy…, à condition toutefois que lesdites deux personnes ne pourront demeurer dans les monastères passé six heures du soir en hiver, sept en esté… »
Non seulement les personnes laïques pouvaient être reçues, pour des motifs de piété, dans des couvents comme ceux de la réforme si sévère des Carmélites, mais là se retiraient encore des femmes comme la duchesse de Mazarin ou la marquise de Courcelles, qui avaient tant de scandales à faire oublier ; par les bruits vrais ou faux qu’on publiait sur la manière dont vivaient au couvent des filles Sainte-Marie, de la rue Saint-Antoine, ces femmes si compromises, on peut juger des infractions à la règle que causait la présence de telles pénitentes. Laissons parler madame de Mazarin :
Madame de Courcelles ayant été mise avec moi dans le couvent, j’eus la complaisance d’entrer pour elle dans quelques plaisanteries qu’elle fit aux religieuses. On en fit cent contes ridicules au Roi : que nous mettions de l’encre dans le bénitier pour barbouiller ces bonnes dames ; que nous allions courir par le dortoir pendant leur premier somme avec beaucoup de petits chiens, en criant tayaut, et plusieurs choses semblables ou absolument inventées ou exagérées avec excès…
« Sous prétexte de nous tenir compagnie, on nous gardoit à vue. On choisissoit pour cet office les plus âgées des religieuses, comme les plus difficiles à suborner ; mais, ne faisant autre chose que nous promener tout le jour, nous les eûmes bientôt mises sur les dents l’une après l’autre : jusque-là que deux ou trois se démirent le pied pour avoir voulu s’obstiner à courir avec nous. »
Mal protégées dans leur retraite par des grilles qui s’ouvraient trop facilement, les religieuses reprenaient dans leurs fréquentes conversations avec des étrangères le goût des choses mondaines qu’elles avaient fait vœu d’oublier, souvent moins sous l’influence d’un pieux détachement que parce qu’elles manquaient de fortune ou de beauté.
« Ces filles qu’on sacrifie tous les jours, comme le dit Fléchier (Grands Jours d’Auvergne), peuploient les couvents et y introduisoient le libertinage et le scandale. » C’étaient ces mêmes filles, victimes d’un usage cruel, qui cherchaient si souvent à se soustraire à la règle, soit en sortant fréquemment du couvent sous mille prétextes futiles, soit en y important les mœurs de la société la plus corrompue. Ainsi l’on voit au tome XIII des Manuscrits de la collection Godefroy, à la bibliothèque de l’Institut, l’histoire de cette Magdelaine Lamelin, religieuse à Bourbourg, que le maréchal de Schomberg put connaître et arracher à son couvent ; qui le suivit en Portugal et dont il eut plusieurs enfants. Ainsi lit-on encore dans le même volume de ce Recueil une requête adressée au roi contre l’abbesse de Rougemont et sa sœur, Françoise de Lucé, qui, « jusques icy, ont vécu d’une manière si dépravée qu’elles ont fait passer cette maison plutôt pour un lieu public et infâme que pour un monastère, ayant eu dix enfants tout au moins… »
Ce qu’il fallait donc pour remédier à la dépravation générale, c’était une règle faite par soi et pour soi par une société choisie qui tînt à honneur de l’observer, parce qu’elle-même l’avait librement établie. Le respect que l’on professait pour la marquise de Rambouillet, qui, blessée dans sa pudeur par les mœurs de la cour, s’en était de bonne heure retirée ; sa bienveillance que l’on voulait mériter et conserver, et à laquelle on voulait répondre ; le charme nouveau de ses réunions, tout concourut à établir son influence sur le cercle qui l’entourait, et par suite à multiplier ces assemblées (c’est le nom consacré), où, comme chez elle, on luttait d’égale ardeur, sans le dire hautement, sans parti pris et presque instinctivement, contre les mauvaises mœurs et le mauvais langage.
Des éléments heureux, qu’il s’agissait de féconder, avaient été apportés d’Italie par Marie de Médicis, d’Espagne par Anne d’Autriche, ou inspirés même et répandus dans toute la nation par un grand roi qui avait le sentiment des grandes choses ; la révolte de madame de Rambouillet contre tout ce qui choquait le goût ou la délicatesse était, pour ainsi dire, dans l’air plutôt même qu’elle ne fut spontanée chez la marquise, et elle ne pouvait être isolée dans un temps où de longs excès appelaient une prompte réaction. Mais elle sut tirer un admirable parti des tendances nouvelles, et si les germes existaient, c’est à son action vivifiante qu’on en doit l’éclosion si désirée. M. Cousin, dans la Jeunesse de madame de Longueville, l’a dit déjà en termes éloquents :
« La grandeur, dit l’illustre écrivain, était en quelque sorte dans l’air dès le commencement du XVIIe siècle. La politique du gouvernement était grande, et de grands hommes naissaient en foule pour l’accomplir dans les conseils et sur les champs de bataille. Une sève puissante parcourait la société française. Partout de grands desseins, dans les arts, dans les lettres, dans les sciences, dans la philosophie. Descartes, Poussin et Corneille s’avançaient vers leur gloire future, pleins de pensers hardis, sous le regard de Richelieu. Tout était tourné à la grandeur ; tout était rude, même un peu grossier, les écrits comme les cœurs. La force abondait. La grâce était absente. Dans cette vigueur excessive on ignorait ce que c’était que le bon goût. La politesse était nécessaire pour conduire le siècle à la perfection. L’hôtel de Rambouillet en tint particulièrement école. »
L’hôtel de Rambouillet fut le premier où l’on « tint compagnie » ; mais il eut des imitateurs à Paris, et bientôt même en province. Nous ne saurions songer à passer ici en revue toutes les maisons qui eurent un nom à cette époque ; mais nous dirons quel était le caractère général de ces réunions communes aux hommes et aux femmes, quelles lois en quelque sorte y présidaient, quels usages y régnaient, et quel était enfin l’aspect, la physionomie de ces assemblées.
Nous avons donné, dans notre Notice sur madame de Rambouillet, la description de son hôtel. Introduit par mademoiselle de Montpensier et mademoiselle de Scudéry, nous avons pénétré dans cette chambre où Arthénice, sans être duchesse, recevait même des princesses, et réunissait une cour plus choisie, sinon plus nombreuse que celle de la reine ; nous avons suivi à son château ses heureux habitués ; nous avons été de toutes leurs fêtes. Quel charme de bon goût dans tous ces divertissements ! quelle gaieté franche et vraie ! et que nous sommes loin de cette morgue prétentieuse qui distingue des vrais précieux les précieux ridicules !
Quelle différence, si nous suivons, dans une de ces ruelles qu’ils nous ont décrites, Somaize ou l’abbé de Pure !
Bélisandre arrive de province. Il a entendu parler de ces réunions charmantes où les femmes font assaut de coquetterie, les hommes de belles manières et d’élégance : il désire vivement y être admis, et, suivant le cérémonial en usage, il s’adresse à l’un de ces galants abbés connus, comme l’abbé de Buisson ou l’abbé de Belesbat, pour être les grands introducteurs des ruelles. Il prend jour et heure avec eux ; on ne le fait pas attendre : dès le lendemain Brundesius doit le présenter.
Le soir, et fort avant dans la nuit, Bélisandre lit des romans ; il étudie les entrées et les sorties, l’art de saluer en termes choisis, de dire toutes choses d’un air galant. Il se décide, à regret, à prendre quelques heures de repos ; ses cheveux sont d’avance frisés et fortement serrés ; ses moustaches relevées par une bigottère, ses mains enduites d’une pommade adoucissante et cachées dans des gants ; il se parfume à la fois de musc, de civette et d’eau d’ange : il se couche et s’endort en préparant dans son esprit la conversation du lendemain. C’est lui qui la dirigera. Il dira ceci, on lui répondra cela ; il est sûr du succès.
Dès la pointe du jour,
Il répand alors sur ses cheveux des nuages de poudre de Chypre ; il lave son visage avec une éponge imprégnée, depuis la veille, de lait virginal, et ses mains avec de l’huile d’amande douce ou de l’essence de néroli ; il parfume sa bouche avec des pastilles d’essence d’ambre et fait mettre dans ses poches des sachets de senteur. Ces sachets sont d’une étoffe de soie un peu jolie, longs de quatre doigts, un peu moins larges ; autour ils sont ornés de faveurs bouillonnées, d’une couleur convenable à l’étoffe, et sont remplis soit de poudre à la maréchale, soit de fleurs mélangées.
Après tous ces préparatifs, Bélisandre finit sa toilette : chemise à jabot, haut-de-chausses garni de sept ou huit rubans satinés des couleurs les plus éclatantes, et choisis chez Perdrigeon ; bas de soie d’Angleterre ; souliers très longs et qui ne permettent pas de lui supposer un petit pied ; canons bien empesés, à triple rang de toile de Hollande, garnis aussi de deux ou trois rangs de point de Gênes, pour accompagner le jabot ; cordons, aiguillettes, jarretières du dernier galant, chapeau orné d’un beau ruban d’or et d’argent ; gants isabelle vif : il est irréprochable dans son costume ; autour de ses bras il passe un ruban noir pour faire ressortir la blancheur de ses mains ; sur sa joue il pose une large mouche qui rend son visage blême comme il convient, et lui prête l’air langoureux qu’il veut prendre ; son carrosse, – car il a carrosse, – l’attend : fouette, cocher !
Bélisandre arriva chez Brundesius vers neuf heures et l’attendit quelque temps : Brundesius était chez La Vienne, l’étuviste. Enfin, il rentre, il est dix heures ; les deux amis se rendent chez Cléogarite.
Au Marais, dans la rue qu’elle habite, de nombreux carrosses montrent l’empressement des visiteurs. On heurte à sa porte. Le heurtoir était emmailloté de linge, pour que l’on n’entendît pas de la chambre les coups du marteau, qui eussent pu gêner la conversation. Un laquais les fait entrer et les annonce à Cléogarite.
La précieuse Cléogarite était encore dans son lit posé sur une estrade, et séparé du reste de la chambre par un balustre,
Les rideaux étaient tirés devant les fenêtres ; un paravent s’étendait de la porte à la cheminée ; aux murs étaient accrochés des portraits ; des tablettes portaient quelques livres nouveaux achetés chez Sercy ; dans la ruelle étaient assises sur des fauteuils quelques dames qualifiées de la cour, et, sur des chaises plusieurs dames de la ville ; la plupart jouaient avec de petites cannes qu’elles agitaient sans cesse.
Quant à leur costume,
Bélisandre, intimidé d’abord de voir tous les regards tournés sur lui, reprit vite sa présence d’esprit. Usant du privilège des nouveaux arrivants, il vint baiser à la joue Cléogarite, qui s’y prêta de bonne grâce ; puis cherchant un siège et ne trouvant ni chaise, ni pliant, ni perroquet, il fit comme Brundesius et s’assit aux pieds d’une dame sur son manteau.
L’entrée de Bélisandre et de Brundesius avait interrompu la conversation. Après les premiers compliments, Cléogarite demande à Brundesius pourquoi elle ne l’avait pas vu la veille.
– Hier, dit-il, j’étais de quartier chez Athénodore.
– A-t-elle grande foule d’alcôvistes ? Qui préside chez elle ?
– Elle en a plusieurs, et de la vieille roche, même des femmes de la petite vertu. Quoiqu’elle ait quelques diseuses de pas vrai, elle n’a point de ces diseuses d’inutilités qui ignorent la force des mots et le friand du goût.
– Sans doute quantité de celles qui la viennent voir lui servent de mouches, et l’on y en trouve aussi dont la neige du visage se fond.
– Il est vrai que l’on y en pourrait trouver qui lustrent leur visage ; mais outre que celles-là sont graves par leur antiquité, les troupes auxiliaires de leur esprit soutiennent assez bien leurs ambiguïtés d’appas.
La conversation, lancée sur ce terrain, arriva vite à la médisance.
En moins d’une heure, Bélisandre avait appris à connaître les ruelles de Salmis, de Sarraïde, de Sophie, de l’illustre Célie, de Stratonice, de la charmante Féliciane, de l’aimable Sophronie, de Félicie, le palais de Rozelinde, véritable palais d’honneur, les maisons de Nidalie, de Doralise, de Calpurnie, de Madonte et de l’incomparable Virginie ; il savait que ces noms, chez Cléogarite, désignaient mademoiselle de Sully, madame et mademoiselle de Scudéry, madame de Choisy, madame Scarron, madame de La Fayette, madame de Sévigné, madame de Fiesque ; que le palais de Rozelinde était l’hôtel de Rambouillet ; enfin que les autres maisons étaient celles de mademoiselle Ninon de Lenclos, de madame de La Suze, de madame de La Calprenède, de la comtesse de Maure et de la marquise de Villaine. Sans s’attacher beaucoup à retenir des noms précieux, qui, différents selon les divers romans, pouvaient, dans une autre ruelle, ne pas désigner les mêmes personnes, il chercha seulement à apprendre quelques particularités de ce monde auquel il ne voulait pas rester étranger.
– À propos, dit Ariston, je fus, il y a quelque temps, chez Aglanide. Que dites-vous d’elle ?
– C’est une personne qui a des lumières éloignées.
– Pour moi, je tiens qu’elle a l’âme mal demeurée.
– Et moi je ne sais qu’en croire. Il y a quantité de gens qui tiennent qu’elle a un œuf caché sous la cendre.
– Si vos sentiments sont partialisés là-dessus, dit alors Egistus en rougissant, vous devez au moins avouer qu’elle a les miroirs de l’âme fort beaux, la bouche bien façonnée, qu’elle est d’une vertu sévère, et qu’elle articule bien sa voix.
Cléogarite comprit le sentiment qui donnait au jeune Egistus le courage de défendre Aglanide absente ; elle reprit brusquement :
– Alcyon, qui nous a régalés de ses derniers sonnets nous en doit encore un.
– Le nombre des sonnets que j’avais à vous lire, Mesdames, est achevé ; s’il est vrai que je sois venu à bout de votre patience, la faute ne pouvant être réparée par moi le sera par un autre. J’espère même me rendre aucunement recommandable par le choix de mon successeur. Ce sera, s’il vous plaît, Mesdames, M. de M..
M. de M. , ainsi interpellé, prit alors la parole d’un air langoureux :
Mesdames, dit-il, j’ai à vous lire des méditations sur la croix. Je me trouve en un état bien différent de celui où se feignait être, il y a quelques jours, un des beaux esprits de cette compagnie ; et au lieu qu’il appréhendait de n’avoir rien qui fût assez plaisant pour vous l’offrir, je crains de ne pouvoir rien rencontrer qui soit assez triste pour vous satisfaire.
On lui fit la guerre sur sa modestie, et quand il eut recueilli tous les compliments qu’il attendait, il commença sa lecture. On l’applaudit fort ; puis, comme l’heure des nécessités méridionales était arrivée, on se sépara. Avant de se quitter cependant on convint, pour le lendemain, qu’on se réunirait chez Claristhène, où l’on devait s’occuper de la réforme de l’orthographe, qu’on trouvait trop chargée de lettres ; le surlendemain chez Émilie, où l’on aurait à examiner le Criminel innocent (Œdipe) de Cléocrite l’Aîné Plus tard, on se proposa de régler le blason des Précieuses ; ce qu’on fit en effet quelques jours après.
Le tableau que nous venons de faire, d’une matinée chez une précieuse, sans changer un seul des traits qui nous sont fournis par Somaize, peut donner une idée de ce qu’étaient ces réunions, dans les ruelles bourgeoises ou de second ordre.
Il ne faudrait pas croire cependant que le jargon bizarre, prêté par Somaize à ses personnages, ou par Molière à Cathos et Madelon, ces pecques filles de Gorgibus, fût le langage adopté par les cercles précieux : ce n’est point ainsi que l’on parlait chez madame de Rambouillet, chez mademoiselle de Montpensier ou chez mademoiselle de Scudéry ; ce n’est pas ainsi que s’expriment les héros galants du Cyrus ou de l’Esprit de Cour ; et l’on ne peut mieux montrer combien Somaize a outré les défauts qu’il signale, qu’en se reportant aux ouvrages où il a puisé ses exemples.
Le plus illustre des Précieux qu’il cite est Corneille. Œdipe, qui parut en 1659, est, dans le Dictionnaire, le sujet d’une longue discussion à laquelle prennent part mademoiselle d’Espagny, mademoiselle de Lanquais et M. Foucault, et qui nous initie au procédé suivi par l’auteur pour composer son recueil de mots précieux.
Ainsi Corneille avait dit dans son épître dédicatoire à Fouquet :
Les Précieuses de Somaize s’emparent de ces vers : tant de façons de parler extraordinaires et délicates qu’elles y voient les justifient, disent-elles, de toutes les accusations. Il est évident que l’autorité du poète permet de dire : Cette personne répand l’éclat de sa bonté sur l’endurcissement de mon oisiveté, au lieu de dire : Cette personne me fait de grands présents, afin que je quitte la paresse qui m’empêche de travailler. Corneille dit ensuite :
Il te seroit honteux d’affermir ton silence.
Les Précieuses auront donc le droit de dire : affermissez votre silence, au lieu de : gardez le silence, ou : taisez-vous.
En vain l’on fait observer à une des Précieuses que la poésie se permet de certaines hardiesses qui doivent rester étrangères à la prose. Léostène répondit à ce que lui objectoit Félix que, dans la prose, elles ne trouveroient pas moins lieu de se défendre que dans les vers ; puis elle poursuivit ainsi : – C’est ce que je vous montre dans l’endroit de la préface de cet illustre, dont je n’allègue les façons de parler extraordinaires et délicates que pour nous justifier de vos accusations, et non pour les condamner ; et vous le pouvez lire vous-même.
« Félix prit le papier et lut ce qui suit :… et qui n’ait rendu les hommages que nous devons à ce concert éclatant de rares qualités et de vertus extraordinaires… » Émilie prit la parole en cet endroit et dit : – « Eh bien ! brave Félix, qu’en dites-vous ? Un concert éclatant de rares qualités et de vertus extraordinaires, pour dire : un grand homme, ou : un homme parfait… En faisons-nous de plus nouvelles ? et n’avons-nous pas pour guides les grands hommes quand nous faisons des mots nouveaux ? »
À l’aide des mêmes subtilités, Léostène, ou plutôt Somaize qui la fait parler, arrive à prouver qu’on peut dire : terriblement beau, pour : extraordinairement beau, parce que Corneille a dit :
De même on dira : le partisan des désirs, pour l’amour ; et : transmettre son sang, pour : avoir des enfants, puisque Corneille, « après avoir mis : c’est d’amour qu’il gémit, adjouste plus bas dans le même sens :
De mes plus chers désirs ce partisan sincère, et encore :
En isolant ainsi certaines phrases ou certaines locutions de tout ce qui les entoure, on arrive à substituer la périphrase au mot propre, et la métaphore à l’expression simple, sans que rien justifie cet emploi hors de propos d’un mot qui, mis à sa place, avait sa force ou sa grâce.
Les Précieuses sont-elles jamais tombées systématiquement dans cette folie, et l’abus signalé, peut-être avec raison, dans quelques ruelles, devint-il aussi général qu’on serait tenté de le croire en lisant Molière ou Somaize ? Les Précieuses usèrent-elles jamais dans leurs réunions, en vertu d’une convention acceptée d’un commun accord, d’une langue particulière qui fût pour elle un moyen de se reconnaître, comme l’argot pour les voleurs à qui on les a comparées ? Il nous semble que la question ainsi posée est déjà résolue.
Si donc Somaize a extrait d’un certain nombre d’auteurs des termes qu’il traduit à sa façon, il ne faut en conclure ni que les mêmes auteurs employassent toujours et partout, sans choix, toutes ces expressions au lieu des locutions équivalentes, ni que toutes les Précieuses eussent fait, dans la langue écrite, un choix de phrases qu’elles aient transporté dans la langue parlée ; sur les six cents personnages de son Grand Dictionnaire, je ne sais si l’on en trouverait trente que l’on pût convaincre de cette manie. Ce qui est vrai seulement, c’est qu’à cette époque la mode, dont les cercles appelés précieux prenaient toujours l’initiative, adopta un grand nombre de locutions plus ou moins heureuses, plus ou moins nécessaires à la langue. Depuis, l’usage qui prend son bien où il le trouve ; l’usage, juge indépendant et souverain, a fait un tri parmi ces formes nouvelles ; il a rejeté les unes, et ce sont les seules qu’on attribue aux Précieuses ; mais il a adopté les autres, et l’on oublie de leur en faire honneur.
En fait, l’usage a toujours raison ; mais, dans ce cas particulier, le choix qu’il fit s’explique facilement par la diversité des sources où il a puisé.
En effet, au temps où Somaize publia son livre, on voyait régner un abus que la vanité a toujours produit, à toutes les époques, sous des formes différentes ; il se trouve toujours des gens dont le costume, le langage et les divertissements sont imités par d’autres avec une exagération ridicule : la haute société avait ses alcôves, les bourgeoises eurent aussi leurs ruelles ; la cour s’était fait naturellement un langage qui n’avait rien de vulgaire ; la ville et la province, qui ne pouvaient apprendre cette langue à la cour, la demandèrent aux livres et au théâtre.
Le naturel qu’elles poursuivaient leur échappa, et le vulgaire, si redouté de Cathos, fut remplacé par le ridicule.
Est-ce à dire que Somaize ou Molière ont supposé des monstres pour les combattre ? Nous n’irons point jusqu’à dire que leur satire était sans objet, mais nous voulons déterminer bien nettement quels ennemis ils attaquaient. Ces précieux et ces précieuses si ridicules vivaient de la vie commune, et passaient dans le monde tout aussi inaperçus que nos bourgeois qui, par un autre travers, ont leur salon comme ils avaient leurs ruelles ; qui jouent des comédies et donnent chez eux des concerts, comme on y discutait sur des questions littéraires. Ce sont là des divertissements dont le luxe n’est pas impunément cherché par toutes les classes de la société ; les jours où nos auteurs comiques nous égayeront aux dépens de ces salons où s’improvisent des artistes, toujours applaudis, ils nous montreront aussi que la vanité qui avait fait les précieuses ridicules a survécu à Molière et qu’elle a pu se déplacer sans disparaître. Ils seront applaudis aussi de ceux qui ont donné l’élan, comme Molière l’a été de tout l’hôtel de Rambouillet.
Somaize, qui s’est fait l’historien des précieuses, n’avait pas le génie qui rend à jamais impérissables les types qu’il crée ou qu’il fixe. Ses ouvrages et le roman de l’abbé de Pure, peu connus, sinon des curieux, auraient même été plus complètement oubliés encore si l’on n’avait pas eu à chercher l’explication du choix que fit Molière des Précieuses ridicules pour sujet d’une comédie, et à donner le commentaire de sa pièce. Imitateur, souvent copiste de Somaize, qui lui a fourni à peu près toutes les expressions qu’il met dans la bouche de Cathos, de Madelon et de Mascarille, Molière a moins encore songé à combattre un ridicule généralement répandu, qu’il n’a voulu exploiter, comme il le dit lui-même, la vogue d’un type de convention ; et l’on n’a pas assez remarqué en effet qu’il compare au Capitan, au Docteur, au Trivelin, cette Précieuse ridicule, pecque provinciale entichée des gens de qualité.
On comprend par ce dernier trait combien les dames de la cour, à qui leur fortune et leur rang faisaient presque un devoir ou tout au moins donnaient le droit d’avoir une ruelle ; combien des femmes comme madame de Rambouillet et tous ses visiteurs, durent applaudir la comédie de Molière. Chez la marquise, en effet, pas plus que chez ses illustres amis, on n’avait à courir ni après les gens de qualité, ni après un langage qui ne fût pas vulgaire ; chez elle, le goût des choses de l’esprit n’était point la préoccupation unique et constante des visiteurs ; la littérature et les arts avaient pris un trop rapide essor et avaient conquis dans le monde une place trop importante pour qu’on pût éviter d’en parler dans les conversations : il y eût eu alors plus d’affectation à les écarter qu’à les accueillir ; mais on n’oubliait ni les exigences du monde où l’on vivait, ni les graves intérêts du prince qu’on servait et auquel on était attaché par des liens plus ou moins étroits. Chez les habitués des ruelles qui s’ouvrirent bientôt par tout Paris, au contraire, c’est par l’affectation qu’on mettait à vivre loin des choses vulgaires auxquelles on touchait de si près, et où l’on était sans cesse ramené par des nécessités invincibles, qu’on cherchait à se distinguer, et qu’on voulait se rapprocher des sociétés d’un autre ordre.
Il y a là, certes, une preuve heureuse de la considération accordée à la littérature et aux littérateurs, dont on avait, pendant quelques années, fait trop bon marché. L’intérêt qu’on portait aux lettres, en effet, devait accroître leur développement ; là, sans nul doute, plus encore que dans la protection accordée aux savants par Colbert, est le secret de la gloire littéraire du siècle de Louis XIV.
Il n’en est pas moins vrai, quand la mode vint pour toute femme, quelle que fût sa fortune ou son esprit, d’avoir sa petite cour lettrée, que le goût équivoque de ces ruelles improvisées engagea de plus en plus un grand nombre des écrivains de ce temps dans une voie funeste, dont il fut plus tard fort difficile de sortir. Il ne fallut pas moins que des génies comme Pascal, Bossuet, Molière, Despréaux, pour résister avec avantage à des tendances qui ne furent pas sans influence parfois sur le style de Racine et de Corneille lui-même.
Les cabales bourgeoises ne furent donc pas sans action sur les œuvres de certains poètes de second ordre, dont on aimait les fades galanteries ; mais d’un autre côté s’élevait une école plus sérieuse, qui se rattachait par le bon sens et le naturel aux traditions du bon temps de l’hôtel de Rambouillet : ici était Somaize, là Molière ; ici Cotin, là Despréaux ; ici Pradon, là Racine.
Nous avons vu déjà que madame de Rambouillet fut des premières à applaudir les Précieuses ridicules ; est-il besoin de rappeler aussi que Montausier ne pardonna pas, sans doute, les attaques dirigées contre Chapelain, ami de sa jeunesse, par Boileau, un nouveau venu qui ne s’était encore exercé que dans un genre où la méchanceté peut parfois suppléer au talent ; mais qu’il accepta plus tard les éloges de l’auteur de l’Art poétique ? Dirai-je enfin que si le duc de Nevers, qui devait à son nom de protéger le génie, entra dans des coteries favorables à Pradon, mais plus qu’indifférentes à la gloire de Racine, il était intéressé, comme poète médiocre, à défendre ses égaux, tandis que le grand Condé se déclarait l’ami de l’auteur de Phèdre ?
Disons-le donc : tous les grands noms de la France furent toujours à cette époque protecteurs de nos grands écrivains. Tant que, pendant une période difficile, on n’eut à accueillir que des ouvrages médiocres, on témoigna de son intérêt pour les lettres en fêtant les auteurs même dont le mérite était le plus contestable. Mais on pouvait à bon droit se montrer plus difficile, et on le prouva par l’empressement qu’on mit à repousser ce qu’on avait d’abord accepté, dès qu’on put admirer des œuvres supérieures.
L’école précieuse ne disparut cependant pas sous le ridicule dont elle fut frappée : elle fut défendue par tous ceux qui avaient intérêt à conserver une réputation trop facilement acquise, et qui ne se sentaient pas la force de s’en faire une autre par d’autres mérites ; elle resta en honneur dans tous les cercles bourgeois, où l’on adoptait, même en littérature, toutes les modes de la cour une heure après qu’elles n’y étaient plus portées.
Cette persistance du genre précieux en littérature, des habitudes précieuses dans les cercles, et surtout le succès attaché à un type que les auteurs secondaires voulurent longtemps exploiter, expliquent les nombreux écrits qui les vinrent frapper plus d’un demi-siècle encore après la première attaque de Molière. Nos comédies, même dans les premières années du XVIIIe siècle, sont pleines de traits lancés contre des ennemis que l’on serait tenté de croire disparus depuis les Précieuses ridicules ; le lieu de la scène n’a pas changé, mais il est mieux indiqué ; les femmes ridicules qu’on voit en jeu sont des « bourgeoises de qualité ».
Les notices insérées dans ce volume sont consacrées à des noms qu’on trouve au premier rang et à des titres différents à toutes les époques de l’histoire de la Préciosité. Madame de Rambouillet est le type le plus pur et le plus élevé de la vraie précieuse, dans le meilleur sens du mot : elle paraît d’abord dans ce livre, et elle y occupe la principale place ; c’est par une pièce due à plusieurs des habitués de son hôtel que nous le terminons. On nous saura gré, nous l’espérons, d’avoir songé à donner un nouveau texte de la Guirlande de Julie, la galanterie la plus célèbre du monde des Précieux et des Précieuses.
Les noms que nous avons groupés autour de celui de madame de Rambouillet se présentent avec des caractères différents, qui n’échapperont point au lecteur. Bien d’autres personnages auraient pu trouver place dans un ouvrage consacré à la société précieuse : ils nous ont en partie fourni la matière d’un nouveau volume, publié sous le titre de Portraits du grand siècle.
CH.-L. LIVET.
L’HÔTEL DE RAMBOUILLET.– LA MARQUISE ET SA FAMILLE
C’est en tremblant que j’aborde le nom respecté d’une femme qui domina son siècle de toute la hauteur d’une vertu sans tache, et de toute l’influence de la vénération qu’elle inspirait. Des plumes plus exercées que la mienne, et, tout récemment, un écrivain illustre, je veux dire M. Rœderer, M. Walckenaër, et enfin M. Cousin, dans la Jeunesse de madame de Longueville, ont rendu à la marquise de Rambouillet une éclatante justice, et se sont attachés à faire connaître le caractère de ses réunions célèbres. Quelle part me reste donc, après des maîtres si autorisés ? Sont-ce les miettes de leur table que je viens offrir à des convives à peine sortis du festin ? des glanes, à ceux qui ont droit à la moisson ? Je ne sais trop ; on en jugera ; mais j’ai essayé d’agrandir, à l’aide de mes recherches particulières, le champ de leurs savantes études ; comme ce nain qui montait sur les épaules d’un géant pour étendre plus loin ses regards, j’ai cherché à découvrir d’autres horizons : puissé-je n’avoir pas trop présumé de la portée de ma vue !
Madame de Rambouillet peut être considérée sous deux aspects. Il y a dans son existence un côté brillant qui nous la montre au milieu d’une cour choisie, empressée autour d’elle, fière d’y être accueillie, attentive à s’y maintenir, heureuse de mériter les suffrages de son goût délicat ; d’un autre côté, dans une ombre obscure que percent à peine les puissants rayons de sa vie publique, j’aperçois une femme vivant auprès de son mari, dans son intérieur muré aux profanes, une mère entourée de sa nombreuse famille, éprise des joies intimes de son foyer, vaillante à supporter les chagrins sans nombre qui l’ont visitée, et dont sa constance courageuse dérobait à ses amis le secret et les amertumes. C’est toujours une nature exquise et fine, une sensitive que blesse tout ce qui la touche sans ménagement, tout ce qui est violent ou heurté, une lumière trop vive, le froid, la chaleur, comme une parole trop rude ou un sentiment peu délicat ; difficile dans le choix de ses amis, sincère, fidèle, indulgente pour eux ; si belle, qu’elle commandait l’amour ; si digne, qu’elle le faisait taire ; si pure qu’elle ne soupçonna jamais les passions qu’elle inspirait ; si bonne qu’elle put faire le bien sans trouver d’ingrat : noble et sainte femme dont le regard, comme le charbon du prophète, purifiait autour d’elle les cœurs et les lèvres, et dont la médisance n’osa jamais s’approcher.
Pour nous, c’est avec une vive et sincère sympathie que nous étudierons ce type élevé, que nous fournit le XVIIe siècle ; nous suivrons la marquise dans sa vie intérieure, en même temps que nous chercherons à apprécier son heureuse influence sur le monde où elle vécut.
Notre travail comprendra donc deux parties distinctes : l’une visera à faire connaître la femme privée, l’épouse et la mère ; l’autre mêlera la marquise à son époque et cherchera à donner un nouveau jour aux réunions de l’hôtel de Rambouillet. Nous commencerons par dire ce que nous avons vu d’abord, une lueur brillante dont l’éclat a traversé deux siècles ; et, avançant toujours, notre respectueuse curiosité essayera de pénétrer dans une intimité moins connue et non moins digne de fixer l’intérêt.
MALHERBE, COSPEAU, VOITURE, BALZAC, CHAPELAIN
Catherine de Vivonne, née à la fin de 1588, épousa bien jeune encore, en janvier 1600, le marquis de Rambouillet. Élevée en Italie et par une mère italienne, elle avait rapporté de cette terre classique de la politesse et de la galanterie une délicatesse extrême. Quelque temps elle fréquenta la cour ; mais ni les mœurs qu’elle y rencontrait, ni le langage qu’on y parlait n’étaient de nature à l’y retenir : une austère pudeur, la sagesse précoce d’un caractère déjà formé, le sentiment de sa dignité enfin l’éloignèrent bientôt d’une cour où ses yeux avaient trouvé la parcimonie sans grandeur, la familiarité sans noblesse, la dépravation sans voile et sans décence. Vers 1607 ou 1608, mère déjà d’une fille qu’une invincible prédilection lui fit toujours préférer à ses autres enfants, madame de Rambouillet quitta le Louvre et se consacra tout entière aux soins de sa famille ; en même temps elle s’appliquait à éclairer son esprit par la lecture, à cultiver et à mûrir son goût par la conversation d’hommes choisis, d’écrivains distingués qu’elle savait attirer auprès d’elle. Son hôtel, situé dans la rue Saint-Thomas-du-Louvre, entre les Quinze-Vingts et l’hôtel de Chevreuse, devint bientôt le rendez-vous d’une société nombreuse qui se dédommageait de ne la plus recevoir, en accourant auprès d’elle. Malherbe, Racan furent ses premiers visiteurs lettrés : une femme ne pouvait être à meilleure école pour se former l’esprit à une poésie sévère, châtiée, correcte, et décente ; le sel de Régnier, les hardiesses de Théophile n’auraient pu que l’effaroucher. L’Astrée, dont la première partie put encore être présentée à Henri IV, lui révéla de bonne heure une prose facile, élégante, mise au service des sentiments les plus délicats, de l’amour le plus épuré. La mort du roi, les embarras de la régence, les troubles de l’État, ses fréquentes grossesses enfin contribuèrent à l’éloigner de plus en plus de la cour où son mari avait une charge de grand maître de la garde-robe, dont il se démit en 1611 ; et dès lors le charme de sa conversation, son caractère facile et gai, sa vertu aimable, attiraient chez elle toute une génération nouvelle, impatiente d’une longue corruption, fatiguée des divisions qu’avait enfantées un demi-siècle de guerres civiles, avide, comme le dit M. Rœderer, de l’épanchement d’affections longtemps contenues.
Le succès de ses réunions fut grand, parce qu’elle y présidait avec un charme exquis. Il faut le dire aussi, à la même époque aucune autre maison n’était encore ouverte à ce monde distingué, mélange heureux de grands seigneurs et de littérateurs en crédit. Je sais que M. Cousin, dans ses belles pages sur madame de Longueville, regarde comme « une erreur beaucoup trop répandue que l’hôtel de Rambouillet ait été le premier et longtemps le seul salon de Paris où se soit assemblée la bonne compagnie » ; c’est là, pour nous, une assertion que l’autorité même de M. Cousin ne peut nous faire accepter, parce que nous avons vainement cherché les maisons hospitalières qu’on pouvait préférer à celle-ci ou fréquenter dans le même temps : nous aimons mieux lui demander la raison du succès de la marquise ; on ne peut en donner une meilleure explication.
« Elle n’a fait que suivre, dit l’illustre écrivain, l’heureuse révolution qui faisait succéder, en France, à la barbarie des guerres civiles et à la licence des mœurs, un peu trop accréditée par Henri IV, le goût des choses de l’esprit, des plaisirs délicats, des occupations élégantes. Ce goût est le trait distinctif du XVIIe siècle ; c’est là la pure et noble source d’où sont sorties toutes les merveilles de ce grand siècle. » Nous acceptons volontiers ces paroles ; elles montrent par quel concours de circonstances était soutenue madame de Rambouillet dans la révolution qu’elle eut l’honneur d’inaugurer, et combien les besoins et le goût du temps réclamaient le service qu’elle rendit à son siècle.
Dès le début des réunions de la marquise, un caractère nouveau tendit à se manifester dans les relations du monde ; les femmes y prirent bientôt une sorte de supériorité qui contribua puissamment à polir et les gens de plume et les gens d’épée ; l’esprit de conversation y naquit, s’y développa et s’y maintint ; les grands seigneurs apprirent à respecter les écrivains et à les fréquenter sur un pied d’égalité. M. Cousin a parfaitement fait ressortir ce point caractéristique : « À l’hôtel de Rambouillet, dit-il, tous les gens d’esprit étaient reçus, quelle que fût leur condition ; on ne leur demandait que d’avoir de bonnes manières ; mais le ton aristocratique s’y était établi sans nul effort, la plupart des hôtes de la maison étant de fort grands seigneurs, et la maîtresse étant à la fois Rambouillet et Vivonne. » – Et il ajoute : « La littérature n’était pas le sujet unique des entretiens : on y parlait de tout, de guerre, de religion, de politique ; les affaires d’État y étaient de mise aussi bien que les nouvelles plus légères, pourvu qu’elles fussent traitées avec esprit et avec aisance. Les gens de lettres étaient recherchés et honorés, mais ils ne dominaient pas. Voilà pourquoi l’hôtel de Rambouillet a exercé une influence générale sur le goût public… Chez la marquise de Rambouillet régnait la suprême distinction, la noblesse, la familiarité, l’art de dire simplement les plus grandes choses. »
Nous en avons assez dit, et les lignes qui précèdent font comprendre à merveille de quelle nature étaient les relations établies entre la maîtresse de la maison et ses hôtes, et de ceux-ci entre eux ; quelle utilité apportaient avec elles les réunions de la marquise, quelle influence elles exerçaient sur l’esprit public et sur les mœurs de la société qu’elle recevait. Il est temps de rechercher maintenant les évènements principaux qui constituent ce qu’on pourrait appeler les chroniques de l’hôtel de Rambouillet.
La construction de cet hôtel, entreprise et dirigée sur ses plans, doit nous occuper d’abord. C’est vers 1612 ou 1613 que la marquise, qui faisait en se jouant, dit Voiture, des dessins que Michel-Ange n’eût pas désavoués, mécontente de tous les projets des architectes, entreprit de réformer l’architecture. Jusque-là on avait suivi des règles bien simples pour les bâtiments de ce genre : « On ne savait que faire une salle à côté, dit Tallemant, une chambre à l’autre et un escalier au milieu. » Un soir, paraît-il, que la marquise était fort préoccupée de son idée favorite : « Vite, vite, s’écria-t-elle, du papier ; j’ai trouvé le moyen de faire ce que je voulais. » C’était l’eurêka de l’architecture civile. C’est d’elle, nous dit l’auteur des Historiettes, qu’on a appris à mettre les escaliers dans un des angles du corps principal de bâtiment pour avoir une grande suite de chambres, à exhausser les planchers et à faire des portes et des fenêtres hautes et larges, et vis-à-vis les unes des autres… C’est la première qui s’est avisée de faire peindre une chambre d’autre couleur que le rouge ou le tanné.
Sauvai a pris la peine de nous décrire longuement les beautés de l’hôtel, ses heureuses proportions, l’harmonie de ses dispositions intérieures. Nous lui emprunterons quelques détails. On entrait d’abord dans une cour ; à gauche était la basse-cour, entourée des bâtiments de service ; on passait, pour y entrer, sous une des ailes ; de toutes les parties de la cour on pouvait voir le jardin, dessiné comme tous les jardins du temps ; il était coupé de lignes droites qui venaient aboutir à un bassin rond placé au centre, et où les plans figurent un jet d’eau ; s’il n’était pas grand, il n’était du moins borné que par d’autres jardins, en tel nombre qu’aucun bâtiment de ce côté n’arrêtait la vue. Le corps principal de logis était en briques rehaussées d’embrasures, de chaînes, de corniches, de frises, d’architraves et de pilastres de pierre, comme les maisons de la place Royale, les châteaux de Verneuil et de Monceaux, et le palais de Fontainebleau. Ce bâtiment lui-même était accompagné de quatre beaux appartements, dont le plus considérable pouvait entrer en parallèle avec les plus superbes et les plus commodes du royaume ; on y montait par un escalier facile, arrondi en portion de cercle, attaché à une vaste salle ; de là on pénétrait dans une longue suite de chambres qui communiquaient entre elles par de larges portes toutes en correspondance. Les meubles en étaient d’une rare magnificence, changés toujours suivant les exigences de la mode : la chambre bleue elle-même, si célèbre dans Voiture, mais qui ne porte plus ce nom dans le Cyrus, ne vit pas renouveler ses tentures de velours bleu rehaussé d’or et d’argent, quand elles eurent perdu leur fraîcheur.
La chambre bleue était le lieu de réception de la marquise ; on n’avait pas encore inventé les salons, et la chambre à coucher, où l’on trouvait souvent la maîtresse de la maison assise sur son lit, était le lieu d’honneur où elle « recevait compagnie ». Dans cette pièce, les fenêtres, sans appui, régnaient depuis le plafond jusqu’au plancher, et laissaient, dit Sauvai, jouir sans obstacle de l’air, de la vue et du plaisir du jardin. Mademoiselle de Scudéry décrivant le palais de Cléomire dans la septième partie du Cyrus, livre Ier, ajoute quelques traits nouveaux ; « Tout est magnifique chez elle, et même particulier ; les lampes y sont différentes des autres lieux ; ses cabinets sont pleins de mille raretés qui font voir le jugement de celle qui les a choisies. L’air est toujours parfumé dans son palais ; diverses corbeilles magnifiques, pleines de fleurs, font un printemps continuel dans sa chambre, et le lieu où on la voit d’ordinaire est si agréable et si bien imaginé qu’on croit être dans un enchantement lorsqu’on y est près d’elle. »
Mademoiselle de Montpensier, dans ce petit roman allégorique, l’Histoire de la princesse de Paphlagonie, dont Segrais nous a si heureusement conservé la clef, renchérit encore sur les éloges donnés à la beauté somptueuse de cette chambre ; elle parle de la déesse d’Athènes, qui l’occupait, avec un sentiment de vénération bien rare sous sa plume, et qui donne à ce passage un charme particulier : Cette déité, dit Mademoiselle, étoit si honnête, si savante et si sage, que c’est sans doute ce qui a donné sujet à la fable de dire qu’elle étoit née de la tête de Jupiter et qu’elle avoit toujours été fille. Toute révérée qu’elle étoit, elle s’humanisoit quelquefois ; elle écoutoit les prières et les vœux d’un chacun, et y répondoit à toute heure sans distinction de la qualité, mais bien de la vertu, et souvent sans qu’elle en fût requise. Lorsque des personnes profanes ont eu la témérité d’entrer dans son temple, elle les en a chassées… Pour moi, j’aurois toutes les envies du monde d’aller à Athènes (Paris) pour la voir, car je me persuade que j’aurois grande satisfaction de l’entendre.
Je la crois voir dans un enfoncement où le soleil ne pénètre point et d’où la lumière n’est pas tout à fait bannie. Cet antre est entouré de grands vases de crystal pleins des plus belles fleurs du printemps, qui durent toujours dans les jardins qui sont auprès de son temple, pour lui produire ce qui lui est agréable. Autour d’elle, il y a force tableaux de toutes les personnes qu’elle aime ; ses regards sur ces portraits portent toute bénédiction aux originaux.
« Il y a encore force livres sur les tablettes qui sont dans cette grotte ; on peut juger qu’ils ne traitent de rien de commun. » – Au moment où Mademoiselle écrivait (1659), le temps était passé des grandes réunions de la marquise ; le bruit la fatiguait, et Mademoiselle ajoute : « On n’entre dans ce lieu que deux ou trois à la fois, la confusion lui déplaisant et le bruit étant contraire à la Divinité, dont la voix n’est d’ordinaire éclatante que dans son courroux… ; celle-ci n’en a jamais : c’est la douceur même. »
Si donc, à la fin de sa vie, madame de Rambouillet perdit le goût du monde, du moins ses infirmités précoces ne l’éloignèrent point d’abord de ses amis. Ses chagrins l’isolèrent d’eux, quand elle eut perdu M. de Rambouillet, que sa fille chérie l’eut quittée pour suivre son mari, M. de Montausier, gouverneur de l’Angoumois, et qu’une enfant rebelle, l’abbesse d’Yères, eut cherché à profaner la sainteté de son foyer par le scandale d’un douloureux procès.
Mais ne pressons pas les évènements ; ils accourent sous ma plume assez nombreux pour que j’aie besoin de les choisir et de les classer.
Arthénice, avons-nous dit, était le nom poétique de madame de Rambouillet. C’était Malherbe, qui, pour suivre l’usage et donner aux poètes un moyen de la chanter, sans trahir pour le vulgaire le secret d’un nom si respecté, avait trouvé dans Catherine cet anagramme doux à l’oreille. Arthénice devint presque pour elle un nom propre : il ne lui fut enlevé que par l’abbé Cotin, qui l’appliqua à madame de la Moussaye, Catherine de Champagne, et par Racan, qui nomme ainsi madame de Termes. Plus tard, quand ce fut la mode d’introduire des portraits et le récit d’aventures véritables dans les romans, on dut retirer à madame de Rambouillet le nom trop transparent d’Arthénice : on l’appela Cléomire ; on l’appela Minerve, la déesse d’Athènes.
Malherbe, qui avait été un de ses premiers hôtes, l’avait initiée à une poésie noble et sévère, qu’elle était, plus que personne, faite pour admirer ; il lui avait présenté Racan, son élève favori ; lui et Cospeau, l’éloquent prédicateur, formaient pour la marquise une société austère qui n’épouvantait point sa jeunesse. Nous n’oserions présenter ici, comme l’a fait M. Rœderer dans son intéressant Mémoire sur la société polie, une liste des familiers illustres que comptait, dès le début, l’hôtel de Rambouillet ; nous n’oserions surtout préciser nettement les dates ; cependant, si nous effaçons des noms signalés par M. Rœderer celui de Balzac qui, bien connu de la marquise, lui dédia plusieurs ouvrages avant de l’avoir vue, et n’avait pas encore paru chez elle en 1638, nous pensons aussi qu’avant la mort de Malherbe (1628), madame de Rambouillet recevait déjà Gombauld, l’auteur de l’Endymion, et Chapelain, connu par sa lettre apologétique imprimée en tête de l’Adone du Marini, Chapelain, le futur auteur de la Pucelle





























