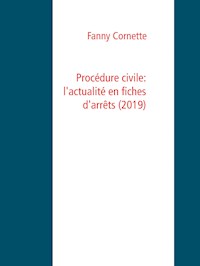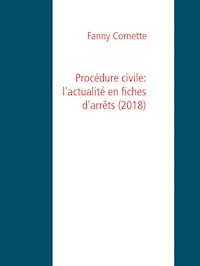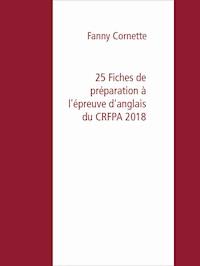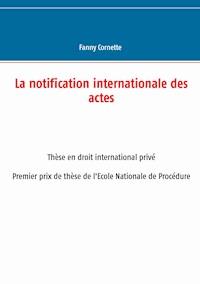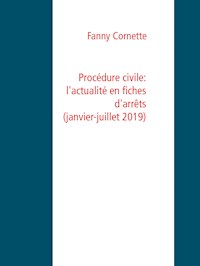
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Présentation des fiches d'arrêt d'une trentaine de décisions de la Cour de cassation rendue entre janvier 2019 et juillet 2019 et concernant la procédure civile. Ces fiches d'arrêt sont proposées en vidéo sur la chaine Youtube ABCJuris
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (janvier-juillet 2019)
Pages de titreLISTE DES FICHES D’ARRÊTCass. Civ 1re 23 janvier 2019, n°17-18.219Cass. Civ 1re 23 janvier 2019, n°17-18.219 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 1re 20 février 2019 n°17-21.006Cass. Civ. 1re 20 février 2019 n°17-21.006 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 11 avril 2019 no 18-11.268Cass. Civ. 2e 11 avril 2019 no 18-11.268 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 11 avril 2019 no 18-11.073Cass. Civ. 2e 11 avril 2019 no 18-11.073 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019 17-31.497Civ 2e, 11 avril 2019 17-31.497 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 11 avril 2019 n° 17-23.272Cass. Civ. 2e 11 avril 2019 n° 17-23.272 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 11 avril 2019 n°17-31.785Cass. Civ. 2e 11 avril 2019 n°17-31.785 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ 2e, 11 avril 2019 no 18-14.223Cass. Civ 2e, 11 avril 2019 no 18-14.223 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 18 avril 2019 no 18-14.202Cass. Civ. 2e 18 avril 2019 no 18-14.202 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ 2e, 18 avril 2019 no 18-15.683Cass. Civ 2e, 18 avril 2019 no 18-15.683 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 16 mai 2019 no 18-10.825Cass. Civ. 2e 16 mai 2019 no 18-10.825 (Fiches d'arrêt)Cass. Civ. 2e 16 mai 2019 no 18-10.033Cass. Civ. 2e 16 mai 2019 no 18-10.033 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e, 16 mai 2019 no 18-16.934Cass. Civ. 2e, 16 mai 2019 no 18-16.934 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ 2e, 16 mai 2019 no 18-13.434Cass. Civ 2e, 16 mai 2019 no 18-13.434 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e. 6 juin 2019 no 18-16.291Cass. Civ. 2e. 6 juin 2019 no 18-16.291 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e. 6 juin 2019 no 19-60.008Cass. Civ. 2e. 6 juin 2019 no 19-60.008 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-14.901Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-14.901 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-15.311Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-15.311 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-14.432Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-14.432 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e, 6 juin 2019 no 18-16.892Cass. Civ. 2e, 6 juin 2019 no 18-16.892 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ 2e, 6 juin 2019 no 18-17.910Cass. Civ 2e, 6 juin 2019 no 18-17.910 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-15.301Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-15.301 (Fiches d'arrêt)Cass. Civ 2e. 6 juin 2019 no 18-11.668Cass. Civ 2e. 6 juin 2019 no 18-11.668 (Fiches d'arrêt)Cass. Civ. 2e. 6 juin 2019 no 18-12.353Cass. Civ. 2e. 6 juin 2019 no 18-12.353 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-12.755Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-12.755 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 18-19.466Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 18-19.466 (Fiche d'arrêt)Cass. Civ. 2e, 27 juin 2019 no 18-14.198Cass. Civ. 2e, 27 juin 2019 no 18-14.198 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ 2, 27 juin 2019 no 17-28.111Cass. Civ 2, 27 juin 2019 no 17-28.111 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 18-12.194Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 18-12.194 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 17-17.354Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 17-17.354 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e, 27 juin 2019 no 18-12.615Cass. Civ. 2e, 27 juin 2019 no 18-12.615 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e, 11 juillet 2019 no 18-23.617Cass. Civ. 2e, 11 juillet 2019 no 18-23.617(Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 2e 11 juillet 2019 no 18-14.688Cass. Civ. 2e 11 juillet 2019 no 18-14.688 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ. 3e 28 mars 2019 no 17-17.501Cass. Civ. 3e 28 mars 2019 no 17-17.501 (Fiche d’arrêt)Cass. Civ.3e 23 mai 2019 no 18-10.140 et no 18-15.001Cass. Civ. 3e 23 mai 2019 no 18-10.140 et no 18-15.001 (Fiche d’arrêt)Cass. Com. 7 mai 2019 no 17-21.047Cass. Com. 7 mai 2019 no 17-21.047 (Fiche d’arrêt)Page de copyrightFiches d’arrêts de procédure civile janvier-juin 2019
Cet ebook présente les décisions de la Cour de cassation publiées sur son site internet (décisions PBRI) et rendues dans le domaine de la procédure civile.
Toutes ces fiches sont présentées en vidéo sur la chaine ABCJuris
LISTE DES FICHES D’ARRÊT
Cass. Civ. 1re, 23 janvier 2019, n°17-18.219
Cass. Civ. 1re, 20 février 2019 n°17-21.006
Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019 no 18-11.268
Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019 no 18-11.073
Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019 no 17-31.497
Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019 no 17-23.272
Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019 no 17-31.785
Cass. Civ 2e, 11 avril 2019 no 18-14.223
Cass. Civ 2e, 18 avril 2019 no 18-14.202
Cass. Civ. 2e, 18 avril 2019 no 18-15.683
Cass. Civ. 2e, 16 mai 2019 no 18-10.825
Cass. Civ. 2e, 16 mai 2019 no 18-10.033
Cass. Civ. 2e, 16 mai 2019 no 18-16.934
Cass. Civ 2e, 16 mai 2019 no 18-13.434
Cass. Civ. 2e, 6 juin 2019 no 18-16.291
Cass. Civ. 2e, 6 juin 2019 no 19-60.008
Cass. Civ. 2e, 6 juin 2019 no 18-14.901
Cass. Civ. 2e, 6 juin 2019 no 18-15.311
Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-14.432
Cass. Civ. 2e, 6 juin 2019 no 18-16.892
Cass. Civ 2e, 6 juin 2019 no 18-17.910
Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-15.301
Cass. Civ 2e. 6 juin 2019 no 18-11.668
Cass. Civ. 2e. 6 juin 2019 no 18-12.353
Cass. Civ. 2e 6 juin 2019 no 18-12.755
Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 18-19.466
Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 18-14.198
Cass. Civ 2, 27 juin 2019 no 17-28.111
Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 18-12.194
Cass. Civ. 2e 27 juin 2019 no 17-17.354
Cass. Civ. 2e, 27 juin 2019 no 18-12.615
Cass. Civ. 2e, 11 juillet 2019 no 18-23.617
Cass. Civ. 2e 11 juillet 2019 no 18-14.688
Cass. Civ. 3e 28 mars 2019 no 17-17.501
Cass. Civ. 3e 23 mai 2019 no 18-10.140 et no 18-15.001
Cass. Com. 7 mai 2019 no 17-21.047
Cass. Civ 1re 23 janvier 2019, n°17-18.219
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 2234 du code civil, ensemble l’article 1203 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que, selon le second, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir ; que l’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1er, du Code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 10 juin 2007, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Bernard Y... et à son épouse, Mme Y..., un prêt relais d’un certain montant, dont elle a reçu un remboursement partiel le 17 décembre 2010 ; qu’après le décès de Bernard Y..., survenu le [...], elle a, le 16 juillet 2013, assigné en paiement du solde du prêt Mme Y... ainsi que MM. F. et Y. Y..., pris en qualité d’héritiers du défunt ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en paiement de la banque, l’arrêt retient que celle-ci n’était pas dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de Mme Y..., ce qui aurait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de l’ensemble des codébiteurs solidaires ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la banque n’avait eu connaissance de la dévolution successorale de Bernard Y... que le 27 juin 2013, de sorte qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt jusqu’à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action en paiement formée contre MM. F. et Y. Y..., pris en qualité d’héritiers de Bernard Y..., l’arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/57_23_41183.html
Cass. Civ 1re 23 janvier 2019, n°17-18.219 (Fiche d’arrêt)
PRÊT - PRESCRIPTION CIVILE
FAITS
Une banque a consenti un prêt-relai à un couple marié par acte sous seing privé le 10 juin 2007. Les époux ont remboursé une partie de la somme due le 17 décembre 2010. Suite au décès de l’époux, la banque a assigné l’épouse et les héritiers du défunt en remboursement du solde.
PROCÉDURE
La banque est demandeur à l’action en justice. La CA de Versailles a rejeté la demande de la banque dans une décision du 23 mars 2017. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT
La prescription joue-t-elle lorsque le créancier est dans l’impossibilité d’agir contre certains codébiteurs solidaires d’une dette ou doit-il agir contre ceux contre lequel il a déjà la possibilité d’agir pour interrompre la prescription ?
DÉCISION DE LA CA
La CA a estimé que l’action de la banque était prescrite en retenant que la banque pouvait agir contre l’épouse pour interrompre la prescription vis-à-vis de l’ensemble des codébiteurs solidaires.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION
Au visa de l’article 2234 du code civil, ensemble l’article 1203 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation relève « qu’aux termes du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que, selon le second, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir ; que l’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1er, du code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux ».
La Cour de cassation conclut donc que la banque n’ayant eu connaissance de la dévolution successorale que le 27 juin 2013, elle ne pouvait pas agir contre les héritiers du défunt avant. Son action n’est donc pas prescrite.
BIBLIOGRAPHIE
https://www.youtube.com/watch?v=G9tjUBUc4eA&list=PLohj6OLELBgwq5mbWmtqJSd5HagutBDKa&index=59
Cass. Civ. 1re 20 février 2019 n°17-21.006
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2017), que Mme T..., fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
Attendu que Mme T... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/que l’article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : (…) les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale » ; que le droit de l’Union européenne est directement intégré dans le droit national ; qu’à supposer que l’exercice des activités juridiques ainsi visées par le texte soit limité au droit français, il n’impose pas que l’impétrant ait la maîtrise de toutes les branches de ce droit ; qu’aussi, la pratique pendant huit ans au moins de n’importe quelle branche du droit français, dont le droit de l’Union, est suffisante pour que cette condition soit remplie ; qu’au cas d’espèce, en décidant au contraire que Mme T..., fonctionnaire du plus haut grade à la Commission européenne, ne remplissait pas la condition tenant à la pratique du droit français dès lors qu’elle n’avait pratiqué que le droit de l’Union, auquel le droit national ne se limitait pas, la cour d’appel a violé les articles 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble le principe de l’intégration directe du droit de l’Union européenne dans les droits internes des États membres, ensemble l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/que le droit de l’Union européenne est directement intégré dans le droit national ; que la pratique du droit de l’Union équivaut donc à la pratique de toute autre branche du droit français ; qu’en l’espèce, en distinguant, pour l’application de l’article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, entre les fonctionnaires ayant pratiqué certaines branches du droit français hors droit de l’Union et les fonctionnaires qui ont pratiqué le droit de l’Union, pour exclure les seconds du bénéfice de la dispense instituée par le texte, la cour d’appel, qui a distingué là où la loi ne distingue pas, a violé les articles 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble le principe de l’intégration directe du droit de l’Union européenne dans les droits internes des États le principe de l’interprétation conforme, ensemble l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
3°/que le droit de l’Union européenne prohibe, non seulement les discriminations directes fondées sur la nationalité, mais aussi les discriminations indirectes, qui ne peuvent être justifiées que par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la notion de discrimination indirecte est d’interprétation large et inclut aussi les entraves d’importance secondaire qui concernent l’égalité d’accès à l’emploi sans distinction en fonction de la nationalité ; qu’à supposer que la dispense prévue par les articles 11, 3°, de la loi du 31 décembre 1971 et 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 doive être comprise comme étant limitée aux fonctionnaires de catégorie A et assimilés qui ont exercé des activités juridiques pendant huit ans, soit exclusivement sur le territoire français, soit en mettant en œuvre des règles de droit français ne trouvant pas leur source dans le droit de l’Union européenne, alors que ces textes ont nécessairement pour effet d’instaurer une discrimination indirecte en faveur des fonctionnaires de la fonction publique française – dont la grande majorité est de nationalité française –, qui sont en pratique les seuls à pouvoir remplir ces critères, et en défaveur des fonctionnaires ressortissants appartenant à une autre fonction publique, laquelle n’est pas justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; qu’en refusant sur ce fondement la demande de Mme T..., la cour d’appel a violé les articles 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 18, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’interprétés par la CJUE ;
4°/que l’ensemble des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter l’exercice des activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ses ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre ; qu’une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement ne peut être admise, à supposer qu’elle soit non discriminatoire, que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en l’espèce, à considérer que la dispense de l’article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 doive être refusée aux fonctionnaires de l’Union européenne ayant pratiqué le seul droit de l’Union, lequel fait partie intégrante du droit français, au motif que cette pratique ne garantirait pas au justiciable une défense pertinente et efficace, ou encore la protection des justiciables contre le préjudice qu’ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n’auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires, mais qu’elle puisse être accordée aux fonctionnaires ayant exercé dans certaines branches seulement du droit français (autres que le droit de l’Union), et ne présentent donc objectivement pas davantage de garanties, constitue une mesure restrictive qui, à supposer qu’elle poursuive le but légitime de protection du justiciable, est toutefois impropre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et va au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ; qu’en rejetant dans ces conditions la demande d’inscription au barreau de Mme T..., la cour d’appel a violé les articles 18, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la CJUE, ensemble les articles 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les principes de l’intégration directe du droit de l’Union dans les droits internes des États membres et de l’interprétation conforme du droit national ;
5°/qu’une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement ne peut être admise, à supposer qu’elle soit non discriminatoire, que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’aux termes de la jurisprudence de la CJUE, pour exercer ce contrôle lorsqu’est en cause l’accès à une profession réglementée, le juge national doit prendre en considération les périodes d’activité comparables de la partie concernée accomplies dans un autre État membre, moyennant une appréciation des qualifications et de l’expérience acquises, qui doit être faite in concreto ; qu’en l’espèce, la cour d’appel devait donc procéder à une comparaison des diplômes, qualifications et expériences professionnelles de Mme T..., fonctionnaire européen ayant certes pratiqué le droit européen pendant dix ans, mais titulaire d’une maîtrise, d’un DEA (master II) et d’un doctorat en droit français, avec ceux exigés d’un fonctionnaire français détenant uniquement une maîtrise en droit et ayant seulement pratiqué le droit français « commun », pendant huit ans, aux fins d’évaluer le niveau de l’impétrante en droit français « commun » ; qu’en se bornant à un rejet in abstracto fondé sur l’absence de pratique du droit français « commun » sans faire une évaluation globale incluant aussi les connaissances de l’intéressée, la cour d’appel a violé les articles 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 18, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’interprétés par la CJUE ;
6°/qu’une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement ne peut être admise, à supposer qu’elle soit non discriminatoire, que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en requérant une appréciation in concreto par le juge des connaissances de l’intéressé, le droit de l’Union impose une obligation de résultat de prendre en compte les connaissances et l’expérience équivalentes, obligation dont le non-respect donne lieu à une discrimination indirecte ; que, pour satisfaire à cette obligation, le juge national ne peut pas se borner à renvoyer aux catégories d’accès existantes en droit national si celles-ci ne permettent pas d’atteindre cette obligation de résultat ; qu’en l’espèce, en renvoyant la demanderesse au régime d’accès de droit commun ouvert aux juristes sans expérience professionnelle, alors que ses connaissances et son expérience professionnelle correspondaient au moins en partie à celles ouvrant l’accès dérogatoire aux fonctionnaires de la fonction publique française, que ce régime ne permettait pas la prise en compte effective de son expérience professionnelle et qu’un moyen moins strict pour atteindre l’objectif recherché aurait consisté à exiger la preuve des seules connaissances manquantes, la cour d’appel a violé les articles 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 18, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’interprétés par la CJUE, ensemble l’obligation d’interprétation conforme du droit européen ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 10 décembre 2009, Pesla, C-345/08, points 34 à 36) qu’en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications ; que, toutefois, le droit de l’Union pose des limites à l’exercice de cette compétence par les États membres dans la mesure où les dispositions nationales adoptées à cet égard ne sauraient constituer une restriction injustifiée à l’exercice effectif des libertés fondamentales garanties par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; que des règles nationales établissant des conditions de qualifications, même appliquées sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces libertés fondamentales si les règles nationales en question font abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par l’intéressé dans un autre État membre ;
Attendu qu’aux termes de l’article 45, paragraphe 2, du TFUE, la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ;
Attendu qu’il résulte de l’article 49, paragraphe 2, du même Traité que la liberté d’établissement reconnue aux ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, comporte notamment l’accès aux activités non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants ;