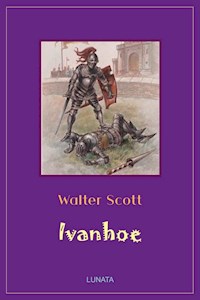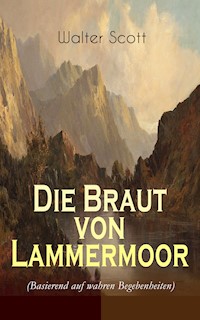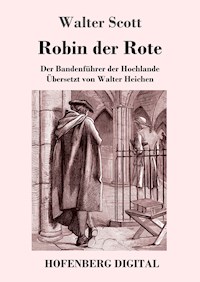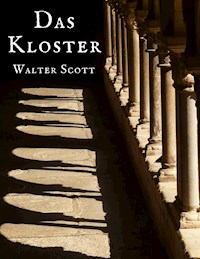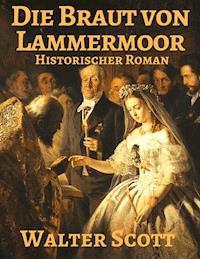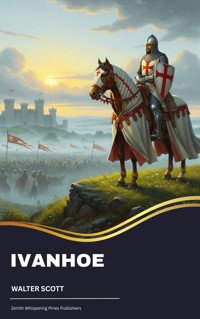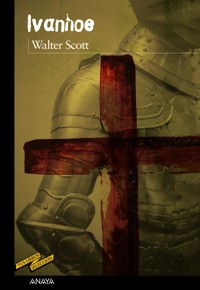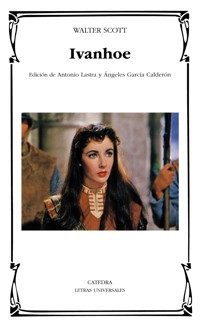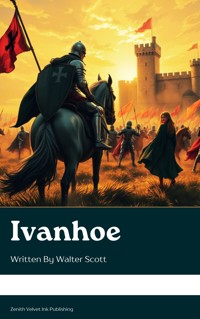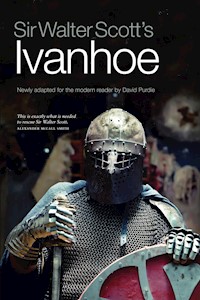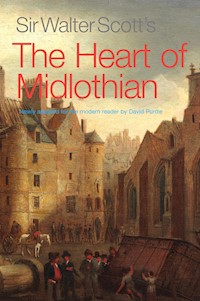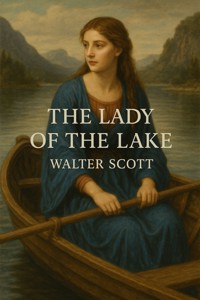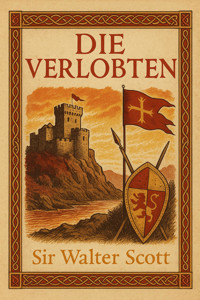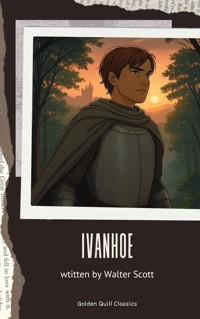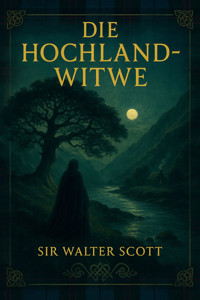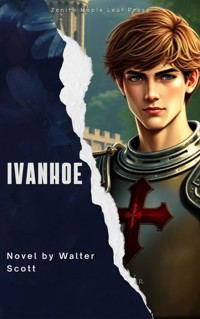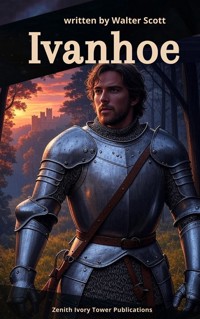Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Quentin Durward, jeune noble écossais, débarque en France sous le règne de Louis XI après la mort de sa famille, survenue lors d'une bataille qui a réduit son village en ruines. Il entre, en qualité d'archer, au service du roi, dans la garde écossaise de ce dernier. Louis XI va lui confier la mission d'accompagner une jeune demoiselle, de bonne famille, et sa tante vers, l'évêché de Liège. Quentin va déjouer bien des complots, faire preuve de courage, de bravoure, d'intelligence et d'à propos, enfin être un parfait chevalier. Il va aussi trouver l'amour... Ce roman nous permet de connaitre, un peu, le caractère de ce roi, plein de contradictions, et fin politique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 974
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Scott
QUENTIN DURWARD
(1830)Traduction M. Defauconpret
Table des matières
INTRODUCTION. 4
CHAPITRE PREMIER. Le Contraste. 46
CHAPITRE II. Le Voyageur. 58
CHAPITRE III. Le Château. 78
CHAPITRE IV. Le Déjeuner. 92
CHAPITRE V. L’Homme d’armes. 120
CHAPITRE VI. Les Bohémiens. 139
CHAPITRE VII. L’Enrôlement 170
CHAPITRE VIII. L’envoyé. 191
CHAPITRE IX. La Chasse au sanglier. 226
CHAPITRE X. La Sentinelle 244
CHAPITRE XI. La Galerie de Roland 268
CHAPITRE XII. Le Politique. 287
CHAPITRE XIII. L’Astrologue. 311
CHAPITRE XIV. Le Voyage. 329
CHAPITRE XV. Le Guide. 350
CHAPITRE XVI. Le Vagabond. 367
CHAPITRE XVII. L’Espion épié. 390
CHAPITRE XVIII. La Chiromancie. 407
CHAPITRE XIX. La Cité. 427
CHAPITRE XX. LeBillet. 450
CHAPITRE XXI. Le Sacdu Château. 471
CHAPITRE XXII. L’Orgie. 491
CHAPITRE XXIII. La Fuite. 514
CHAPITRE XXIV. La Prisonnière. 540
CHAPITRE XXV. La Visite inattendue. 560
CHAPITRE XXVI. L’Entrevue. 576
CHAPITRE XXVII. L’Explosion. 606
CHAPITRE XXVIII. Incertitude. 632
CHAPITRE XXIX. La Récrimination. 659
CHAPITRE XXX. L’Incertitude. 676
CHAPITRE XXXI. L’Entrevue des deux Amans. 707
CHAPITRE XXXII. L’Enquête. 725
CHAPITRE XXXIII. Le Héraut. 746
CHAPITRE XXXIV. L’Exécution. 765
CHAPITRE XXXV. Le Prix de la Bravoure. 779
CHAPITRE XXXVI. L’Attaque. 792
CHAPITRE XXXVII. La Sortie. 810
CONCLUSION. 835
INTRODUCTION.
« Et un homme qui a fait des pertes. – Allez ! »
Shakspeare. Beaucoup de bruit pour rien.
Quand l’honnête Dogberry1 récapitule tous ses titres à la considération, qui, à son avis, auraient dû le mettre à l’abri de l’apostrophe injurieuse que lui adresse Monsieur le gentilhomme Conrade, il est remarquable qu’il ne parle pas avec plus d’emphase même de ses deux robes (chose assez importante dans certaine ci-devant capitale que je connais 2),ni de ce qu’il est un aussi joli morceau de chair que qui ce soit dans Messine, ni même de l’argument conclusif qu’il est un camarade assez riche, que de ce qu’il est un homme qui a fait des pertes.
Dans le fait, j’ai toujours observé que les enfans de la prospérité, soit pour ne pas éblouir de tout l’éclat de leur splendeur ceux que le destin a traités moins favorablement, soit parce qu’ils pensent qu’il est aussi honorable pour eux de s’être élevés en dépit des calamités, qu’il l’est pour une forteresse d’avoir soutenu un siège ; j’ai toujours observé, dis-je, que ces gens-là ne manquent jamais de vous entretenir des pertes que leur occasionne la dureté des temps. Vousdînez rarement à une table bien servie, sans que les intervalles entre le champagne, le bourgogne et le vin du Rhin soient remplis, si votre Amphitryon est un capitaliste, par des plaintes sur la baisse de l’intérêt de l’argent, et sur la difficulté de trouver à placer celui qui reste improductif entre ses mains ; ou, si c’est un propriétaire, par de tristes commentaires sur l’arriéré des rentes et la diminution des loyers. Cela produit son effet. Les convives soupirent, et secouent la tête en cadence avec leur hôte, regardent le buffet chargé d’argenterie, savourent de nouveau les excellens vins qui circulent rapidement autour de la table, et pensent à la noble bienveillance qui, ainsi lésée, fait un usage hospitalier de ce qui lui reste ; ou, ce qui est encore plus flatteur, ils s’étonnent de la nature de cette richesse qui, nullement diminuée malgré ces pertes, continue, comme le trésor inépuisable du généreux Aboulcasem, à fournir des distributions copieuses sans qu’il y paraisse. Cette manie de doléances a pourtant ses bornes, de même que les plaintes des valétudinaires, qui, comme ils le savent tous, sont le passe-temps le plus agréable, tant qu’ils ne sont affectés que de maladies chroniques. Mais je n’ai jamais entendu un homme dont le crédit va véritablement en baissant, parler de la diminution de ses fonds ; et mon médecin, homme aussi humain qu’habile, m’assure qu’il est fort rare que ceux qui sont attaqués d’une bonne fièvre, ou de quelque autre de ces maladies aiguës
Dont la crise mortelle aussi-bien que prochaine
Pronostique la fin de la machine humaine,
trouvent dans leurs souffrances un sujet de conversation amusante.
Ayant bien posé toutes ces choses, je ne puis plus cacher, à mes lecteurs que je ne suis ni assez oublié, ni assez bas en finances pour ne pas avoir ma part de la détresse qui afflige en ce moment les capitalistes et les propriétaires des trois-royaumes. Vos auteurs qui dînent avec une côtelette de mouton, peuvent être charmés que le prix en soit tombé à trois pence la livre, et se féliciter, s’ils ont des enfans, de ce que le pain de quatre livres ne leur coûte plus que six pence ; mais nous qui appartenons à cette classe que la paix et l’abondance ruinent, – nous qui avons des terres et des bœufs, et qui vendons ce que ces pauvres glaneurs sont obligés d’acheter, – nous sommes réduits au désespoir précisément par les mêmes causes qui feraient illuminer tous les greniers de Grub-Street3, si Grub-Street avait jamais des bouts de chandelle de reste. Je mets donc en avant, avec fierté, mon droit de partager les calamités qui ne tombent que sur les riches ; je me déclare, comme Dogberry, un camarade assez riche, et cependant un homme qui a fait des pertes.
Avec le même esprit de généreuse émulation, j’ai eu recours récemment au remède universel contre le mal de l’impécuniosité 4pendant un court séjour dans un climat méridional ; par-là, non-seulement j’ai épargné plusieurs voitures de charbon, mais j’ai eu aussi le plaisir d’exciter une compassion générale pour la décadence de ma fortune parmi ceux qui, si j’eusse continué à dépenser mes revenus au milieu d’eux, auraient pu me voir pendre sans que cela les inquiétât beaucoup : ainsi, tandis que je bois mon vin ordinaire, mon brasseur trouve que le débit de sa petite bière diminue. Tandis que je vide mon flacon à cinq francs, ma portion quotidienne de Porto 5 reste au comptoir de mon marchand de vin. Tandis que ma côtelette à la Maintenon fume sur mon assiette, le formidable aloyau reste accroché à une cheville dans la boutique de mon ami à tablier bleu, le boucher du village. En un mot, tout ce que je dépense ici forme un déficit aux lieux de mon domicile habituel. Jusqu’aux petits sous que gagne le garçon perruquier, et même la croûte de pain que je donne à son petit chien au derrière tondu et aux yeux rouges, c’est encore autant de perdu pour mon ancien ami le barbier et pour l’honnête Trusty, gros mâtin qui est dans ma cour. C’est ainsi que j’ai le bonheur de savoir à chaque instant du jour que mon absence est sentie et regrettée par ceux qui s’inquiéteraient fort peu de moi, s’ils me voyaient dans mon cercueil, pourvu qu’ils pussent compter sur la pratique de mes héritiers. J’excepte pourtant solennellement de cette accusation d’égoïsme et d’indifférence le fidèle Trusty, mon chien de cour, dont j’ai raison de croire que les politesses à mon égard avaient des principes plus désintéressés que celles d’aucune des personnes qui m’aident à dépenser les revenus que je dois a la libéralité du public.
Hélas ! à l’avantage d’exciter cette sympathie chez soi sont attachés de grands inconvéniens personnels.
Veux-tu me voir pleurer ? pleure d’abord toi-même,
dit Horace ; et véritablement je pleurerais quelquefois quand je songe que mes jouissances domestiques, devenues des besoins par l’habitude, ont été échangées pour les équivalens étrangers que le caprice et l’amour de la nouveauté ont mis à la mode. Je ne puis m’empêcher d’avouer que mon estomac, conservant ses goûts nationaux, soupire après la bonne tranche de bœuf, apprêtée à la manière de Dolly, servie toute chaude en sortant du gril, brune à l’extérieur, et devenant écarlate au premier coup de couteau. Tous les mets délicats inscrits sur la carte de Véry, et ses mille manières d’orthographier ses bifsteks de mouton ne peuvent y suppléer. Ensuite le fils de ma mère n’a aucun goût pour les libations claires ; et aujourd’hui qu’on peut avoir la drèche presque pour rien, je suis convaincu qu’une double mesure de John Barley-Corn 6 doit avoir changé cette pauvre créature domestique, la petite bière, enune liqueur vingt fois plus généreuse que ce breuvage acide et sans force qu’on honore ici du nom de vin, quoique sa substance et ses qualités la rendent plutôt semblable, à l’eau de la Seine. Les vins français de première qualité sont assez bons ; il n’y a rien à dire contre le château-margot et le sillery ; et cependant je ne puis oublier la qualité généreuse de mon excellent vin vieux d’Oporto. Enfin, jusqu’au garçon et à son chien, quoique ce soient tous deux des animaux assez divertissans, et qu’ils fassent mille singeries qui ne laissent pas d’amuser, cependant il y avait plus de franche gaieté dans le clignement d’œil avec lequel notre vieux Packwood avait coutume d’annoncer au village les nouvelles de la matinée, que toutes les gambades d’Antoine ne pourraient en exprimer dans le cours d’une semaine ; et dans le mouvement de queue du vieux Trusty, il y avait plus de sympathie humaine et canine, que dans la patience de son rival Toutou, se fût-il tenu sur ses pattes de derrière pendant toute une année.
Ces signes de repentir viennent peut-être un peu tard, et je conviens (car je dois une franchise sans réserve à mon cher ami le public) qu’ils ont été un peu accélérés par la conversion de ma nièce Christy à l’ancienne foi papale, grâce à un certain prêtre madré de notre voisinage ; et par le mariage de ma tante Dorothée à un capitaine de cavalerie à demi-solde, ci-devant membre de la Légion-d’Honneur, qui, à ce qu’il nous assure, serait aujourd’hui officier-général, si notre ancien ami Buonaparte avait continué à vivre et à triompher. Quant à Christy, je dois avouer que la tête lui avait tellement tourné à Édimbourg, en courant jusqu’à cinq routs7 par nuit, que, quoique je me méfiasse un peu des causes et des moyens de sa conversion, je ne fus pas fâché de voir qu’elle commençait à envisager les choses sous un aspect sérieux, n’importe de quelle manière. D’ailleurs la perte ne fut pas très-grande pour moi, car le couvent m’en a débarrassé pour une pension fort raisonnable. Mais le mariage terrestre de ma tante Dorothée était une chose toute différente des épousailles spirituelles de ma nièce : d’abord elle avait 2000 livres sterling, placées dans les trois pour cent, et qui sont aussi-bien perdues pour ma famille que si l’on avait fait un biffage général sur le grand livre de la dette publique ; car qui aurait cru que ma tante Dorothée se fût mariée ? Bien plus, qui aurait jamais pensé qu’une femme, ayant cinquante ans d’expérience, aurait épousé un squelette français, dont les bras et les jambes, offrant les mêmes dimensions, semblaient deux compas entr’ouverts, placés perpendiculairement l’un sur l’autre, et tournant sur un pivot commun tout juste assez fort pour figurer un corps ? Tout le reste n’était que moustaches, pelisses et pantalons. Elle aurait pu acheter un polk de véritables cosaques en 1815, pour la moitié de la fortune qu’elle a abandonnée à cet épouvantail militaire. Mais il est inutile d’en dire davantage sur ce sujet, d’autant plus qu’elle en était venue au point de citer Rousseau pour le sentiment : – qu’il n’en soit plus question.
Ayant ainsi expectoré ma bile contre un pays qui n’en est pas moins un pays fort agréable, et auquel je n’ai nul reproche à faire, puisque c’est moi qui l’ai cherché, et non lui qui m’a cherché, j’en viens au but plus direct de cette Introduction. Si je ne compte pas trop, mon cher public, sur la continuation de vos bonnes grâces (quoique, pour dire la vérité, la constance et l’uniformité de goût soient des qualités sur lesquelles ceux qui courtisent vos faveurs doivent à peine compter), ce but pourra peut-être me dédommager des pertes et dommages que j’ai essuyés en amenant ma tante Dorothée dans le pays des beaux sentimens, des moustaches noires, des jambes fines, des gros mollets et des membres sans corps ; car je vous assure que le drôle, comme le disait mon ami L***, est un vrai pâté d’abatis, tout ailerons et pattes. Si elle avait choisi sur le contrôle de la demi-paie un montagnard écossais à grandes phrases, ou un fils élégant de la verte Erin8 je n’aurais pas dit un seul mot ; mais, de la manière dont l’affaire s’est arrangée, il est bien difficile de se garantir d’un mouvement de rancune en voyant ma tante dépouiller si gratuitement ses héritiers légitimes. Mais… – silence, ma mauvaise humeur, – et offrons à notre cher public un sujet plus agréable pour nous et plus intéressant pour les autres.
À force de boire le breuvage acide dont j’ai déjà parlé, et de fumer des cigares, art dans lequel je ne suis pas novice, je parvins peu à peu, tout en buvant et en fumant, à faire une sorte de connaissance avec un homme comme il faut. Je veux dire qu’il était du petit nombre de ces vieux échantillons de noblesse qu’on trouve encore en France, et qui, comme ces statues antiques et mutilées, objets d’un culte suranné et oublié, commandent encore un certain respect et une certaine estime, même à ceux qui ne leur accordent volontairement ni l’un ni l’autre.
En fréquentant le café du village, je fus d’abord frappé de l’air singulier de dignité et de gravité de ce vieux gentilhomme, de son attachement constant pour les bas et les souliers, au mépris des demi-bottes et des pantalons. Je remarquai la croix de Saint-Louis à sa boutonnière, et la petite cocarde blanche de son chapeau à bras. Il y avait en lui quelque chose d’intéressant ; et, d’ailleurs, sa gravité semblait d’autant plus piquante au milieu de la vivacité de tous ceux qui l’entouraient, comme l’ombre d’un arbre touffu frappe davantage les regards dans un paysage éclairé par les rayons ardens du soleil. Je fis, pour lier connaissance avec lui, les avances que le lieu, les circonstances et les mœurs du pays autorisaient : c’est-à-dire, je me plaçai près de lui ; et, tout en fumant mon cigare d’un air calme et de manière que chaque bouffée intermittente de fumée était presque imperceptible, je lui adressai ce petit nombre de questions que partout, et surtout en France, le savoir-vivre autorise un étranger à faire, sans l’exposer au reproche d’impertinence. Le marquis de Haut-Lieu, car c’était un marquis, fut aussi laconique et aussi sentencieux que la politesse française le permettait ; il répondit à toutes mes questions, mais ne m’en fit aucune, et ne m’encouragea nullement à lui en adresser d’autres.
La vérité était que, n’étant pas très-accessible pour les étrangers de quelque nation qu’ils fussent, ni même pour ceux de ses compatriotes qu’il ne connaissait pas, le marquis avait surtout une réserve toute particulière à l’égard des Anglais. Ce sentiment pouvait être un reste de l’ancien préjugé national ; peut-être aussi venait-il de l’idée qu’il avait conçue que l’Anglais est un peuple hautin, fier de sa bourse, et pour qui le rang, joint à une fortune bornée, est un objet de dérision autant que de pitié ; ou peut-être enfin qu’en réfléchissant sur certains événemens récens, il éprouvait, comme Français, quelque mortification, même des succès qui avaient rétabli son Maître sur le trône, et qui lui avaient rendu à lui-même des propriétés forts diminuées, d’ailleurs, et un château dilapidé. Son aversion pourtant n’allait jamais au-delà de cet éloignement pour la société des Anglais. Lorsque les affaires de quelque étranger exigeaient l’intervention de son crédit, il l’accordait toujours avec toute la courtoisie d’un gentilhomme français qui sait ce qu’il se doit à lui-même et ce qu’il doit à l’hospitalité nationale.
Enfin, par quelque hasard, le marquis découvrit que l’individu qui fréquentait depuis peu le même café que lui était Écossais, circonstance qui milita puissamment en ma faveur. Il m’informa que quelques-uns de ses ancêtres étaient d’origine écossaise ; et il croyait même que sa maison avait encore quelques parens dans ce qu’il lui plaisait d’appeler la province de Hanguisse en Écosse. La parenté avait été reconnue de part et d’autre au commencement du siècle dernier ; et, pendant son exil, car on peut bien penser que le marquis avait joint les rangs de l’armée de Condé et partagé les privations et les infortunes de l’émigration, il avait eu l’envie une fois d’aller renouer connaissance avec ses parens d’Écosse, et réclamer leur protection : – Mais, tout bien réfléchi, me dit-il, il ne s’était pas soucié de se présenter à eux dans une situation qui n’aurait pu leur faire que peu d’honneur, ou qu’ils auraient pu regarder comme leur imposant quelque fardeau et leur faisant même quelque honte ; il avait donc cru que le mieux était de s’en rapporter à la Providence, et de se tirer d’affaire comme il le pourrait. Qu’avait-il fait pour cela ? c’est ce que je n’ai pu savoir, mais jamais rien, j’en suis sûr, capable de compromettre la loyauté de cet excellent vieillard, qui soutint ses opinions et conserva sa loyauté contre vent et marée, jusqu’à ce que le temps l’eût ramené, vieux et indigent, dans un pays qu’il avait quitté à la fleur de l’âge, riche alors et animé par un ressentiment qui se promettait une prompte vengeance. J’aurais pu rire de quelques traits du caractère du marquis, particulièrement de ses préjugés relativement à la noblesse et à la politique, si je l’avais connu dans des circonstances plus prospères ; mais dans la position où il était, quand même ses préjugés n’auraient pas eu une base honorable, quand ils n’auraient pas été purs de tout motif bas et intéressé, on devait le respecter comme nous respectons le confesseur et le martyr d’une religion qui n’est pas tout-à-fait la nôtre.
Peu à peu, devenus bons amis, nous bûmes notre café, fumâmes notre cigare, et prîmes notre bavaroise ensemble pendant plus de six semaines ; des deux côtés, les affaires ne mirent pas grande interruption à ce commerce. Ayant, non sans difficulté, trouvé la clef de ses questions relativement à l’Écosse, grâce à une heureuse conjecture que la province de Hanguisse ne pouvait être que notre comté d’Angus, je fus en état de répondre d’une manière plus ou moins satisfaisante à tout ce qu’il demanda sur les alliances qu’il avait dans ce pays : à ma grande surprise, le marquis connaissait la généalogie de quelques-unes des familles les plus distinguées de ce comté, beaucoup mieux que je n’aurais pu m’y attendre.
De son côté, il éprouva tant de satisfaction de notre liaison, qu’il en vint jusqu’à prendre la résolution de m’inviter à dîner au château de Haut-Lieu, château très digne de ce nom, puisqu’il est situé sur une hauteur qui commande les bords de la Loire. Cet édifice est à environ trois milles du village où j’avais fixé mon domicile temporaire ; et, quand je le vis pour la première fois, je pardonnai aisément la mortification qu’éprouvait le propriétaire en recevant un hôte dans l’asile qu’il s’était formé au milieu des ruines du palais de ses ancêtres. Avec une gaieté qui couvrait évidemment un sentiment plus profond, il m’avait préparé peu à peu à la vue du lieu que je devais visiter. Il en eut même tout le temps le jour qu’il me conduisit à cette antique demeure, dans son petit cabriolet traîné par un grand cheval normand.
Les restes du château de Haut-Lieu sont situés sur une belle colline qui domine les bords de la Loire, et qui conduisait, divisée en diverses terrasses, par des degrés en pierre, ornés de statues et d’autres embellissemens artificiels, jusqu’au fleuve même. Toute cette décoration architecturale, les parterres de fleurs odoriférantes et les bosquets d’arbres exotiques avaient disparu depuis bien des années pour faire place aux travaux plus profitables du vigneron. Cependant les terrasses nivelées et les pentes artificielles, travaux exécutés trop solidement pour pouvoir être détruits, subsistent encore, et prouvent combien l’art avait été judicieusement employé pour embellir la nature.
Il est peu de ces maisons de plaisance parfaitement conservées aujourd’hui ; car l’inconstance de la mode a effectué en Angleterre le changement total que la dévastation et la fureur populaire ont accompli de l’autre côté du détroit. Quant à moi, je me contente de souscrire à l’opinion du meilleur juge de notre temps9, qui pense que nous avons poussé à l’excès notre goût pour la simplicité, et que le voisinage d’une habitation imposante exige des embellissemens plus recherchés que ceux qu’on doit au gazon et aux sentiers sablés. Une situation éminemment pittoresque serait peut-être dégradée par une tentative pour y introduire des décorations artificielles ; mais combien de sites où l’intervention de plus d’ornemens d’architecture qu’il n’est d’usage d’en employer aujourd’hui me semblerait indispensable pour racheter la nudité uniforme d’une grande maison s’élevant solitairement au milieu d’une pelouse de verdure, et qui ne paraît pas plus en rapport avec tout ce qui l’environne, que si elle était sortie de la ville pour aller prendre l’air.
Comment le goût vint à changer si subitement et si complètement, c’est une circonstance assez singulière ; et l’on ne peut l’expliquer que par le principe d’après lequel, dans une comédie de Molière, les trois amis du père lui recommandent un remède pour guérir la mélancolie de sa fille, et qui est de remplir son appartement de tableaux, de tapisseries ou de porcelaines, suivant le commerce différent que fait chacun de ces donneurs de conseil10. En faisant l’application de ces motifs secrets au cas dont il s’agit, nous découvrirons peut-être qu’autrefois l’architecte traçait lui-même les jardins et les parterres qui entouraient une maison ; naturellement il déployait son art en y plaçant des vases et des statues, en y distribuant des terrasses et des escaliers garnis de balustrades ornées, tandis que le jardinier, placé à un rang subordonné, faisait en sorte que le règne végétal se conformât au goût dominant : pour y réussir, il taillait ses haies vives en remparts avec des tours et des créneaux, et ses arbustes isolés comme l’aurait fait un statuaire. Mais, depuis ce temps, la roue a tourné : le jardinier décorateur, comme on l’appelle, est presque au niveau de l’architecte ; et de là vient l’usage libéral et excessif que le premier fait de la pioche et de la hache, et l’ostentation avec laquelle le second ne vise qu’à faire une ferme ornée, aussi conforme à la simplicité que déploie la nature dans la contrée environnante, que cela peut s’accorder avec l’agrément et la propreté nécessaires dans les avenues de la résidence d’un riche propriétaire.
La célérité du cabriolet de monsieur le marquis avait été grandement retardée par l’embonpoint de Jean-Roastbeef11 que le cheval normand maudissait probablement d’aussi bon cœur que son compatriote exécrait autrefois l’obésité d’un stupide serf saxon ; mais la digression que je viens de terminer lui a donné le temps de gravir la colline par une chaussée tournante, maintenant en fort mauvais état. Nous aperçûmes enfin une longue file de bâtimens découverts et tombant en ruines, qui tenaient à l’extrémité occidentale du château.
– M’adressant à un Anglais, me dit alors le marquis, je dois justifier le goût de mes ancêtres, qui ont joint à leur château cette rangée d’écuries ; car je sais que, dans votre pays, on a coutume de les placer à quelque distance. Mais ma famille mettait un orgueil héréditaire à ses chevaux ; et, comme mes aïeux aimaient à les aller voir fréquemment, ils n’auraient pu le faire si commodément, s’ils les avaient éloignés davantage. Avant la révolution, j’avais trente beaux chevaux dans ces bâtimens ruinés.
Ce souvenir d’une magnificence passée lui échappa par hasard ; car, en général, il faisait très-rarement allusion à son ancienne opulence. Il fit cette réflexion tout simplement, sans avoir l’air d’attacher de l’importance à la fortune qu’il avait possédée autrefois, ou de demander qu’on le plaignît de l’avoir perdue. Elle éveilla pourtant quelques idées tristes, et nous gardâmes tous deux le silence pendant le peu de temps que dura encore notre voyage.
En arrivant à la porte du château, je vis sortir d’une sorte de masure, qui n’était qu’une partie de l’ancienne loge du portier, une paysanne pleine de vivacité, dont les yeux étaient noirs comme du jais et brillans comme des diamans. Elle vint à nous avec un sourire qui laissait apercevoir des dents assez belles pour faire envie à bien des duchesses, et elle tint la bride du cheval pendant que nous descendions de cabriolet.
– Il faut que Madelon exerce aujourd’hui le métier de palefrenier, dit le marquis en lui faisant un signe de tête gracieux, en retour de la révérence profonde qu’elle avait adressée à monseigneur. Son mari est allé au marché ; et, quant à La Jeunesse, il a tant d’occupations, qu’il en perd presque l’esprit. – Madelon était la filleule de mon épouse, et destinée à être la femme de chambre de ma fille, continua le marquis pendant que nous passions sous la porte principale, dont le cintre était surmonté des armoiries mutilées des anciens seigneurs de Haut-Lieu et à moitié cachées sous la mousse et le gramen, sans compter les branches de quelques arbrisseaux sortis des fentes du mur.
Cette dernière phrase, qui me fit comprendre, en passant, que je voyais en lui un époux, un père, privé de son épouse et de sa fille, augmenta mon respect pour un infortuné vieillard que tout ce qui avait rapport à sa situation actuelle devait, sans aucun doute, entretenir dans ses réflexions mélancoliques. Après une pause d’un instant il continua d’un ton plus gai.
– Mon pauvre La Jeunesse vous amusera, dit-il ; et, soit dit en passant, il a dix ans de plus que moi (le marquis en a plus de soixante), il me rappelle un acteur du Roman comique, qui jouait lui seul dans toute une pièce. Il prétend remplir à la fois les rôles de maître-d’hôtel, de chef de cuisine, de sommelier, de valet de chambre, et de tous les domestiques à la fois. Il me rappelle aussi quelquefois un personnage de la Bride12 de Lammermoor. Vous devez avoir lu ce roman, car c’est l’ouvrage d’un de vos gens de lettres qu’on appelle, je crois, le chevalier Scott.
– Oui, précisément ; lui-même. – J’oublie toujours les mots qui commencent par cette lettre impossible13.
Cette observation écarta des souvenirs plus pénibles, car j’avais à redresser mon ami français sur deux points. Je n’eus raison qu’avec peine pour le premier ; car le marquis, avec toute sa répugnance pour les Anglais, ayant passé trois mois à Londres, prétendait que notre langue n’offrait aucune difficulté qui pût l’arrêter un instant, et il en appela à tous les dictionnaires, depuis le plus ancien jusqu’au plus nouveau, pour prouver que bride signifiait la bride d’un cheval. Son scepticisme sur cette question de philologie était tel, que, lorsque je me hasardai à lui dire que, dans tout le roman, il n’était pas une seule fois question de bride, il rejeta gravement la faute de cette inconséquence sur le malheureux auteur. J’eus ensuite la franchise de l’informer, d’après des motifs que personne ne pouvait connaître comme moi, que l’homme de lettres, mon compatriote, dont je parlerai toujours avec le respect que méritent ses talens, n’était pas responsable des ouvrages frivoles qu’il plaisait au public de lui attribuer avec trop de générosité et de précipitation. Surpris par l’impulsion du moment, j’aurais peut-être été plus loin, et confirmé ma dénégation par une preuve positive, en lui disant que personne ne pouvait avoir écrit des ouvrages dont j’étais l’auteur ; mais le marquis m’épargna le désagrément de me trahir ainsi, en me répliquant, avec beaucoup de sang-froid, qu’il était charmé d’apprendre que de pareilles bagatelles n’avaient pas été écrites par un homme de condition.
– Nous les lisons, ajouta-t-il, comme nous écoutons les plaisanteries débitées par un comédien, ou comme nos ancêtres écoutaient celles d’un bouffon de profession, dont ils s’amusaient, quoiqu’ils eussent été bien fâchés de les entendre sortir de la bouche d’un homme qui aurait eu de meilleurs droits pour être admis dans leur société.
Cette déclaration me rappela complètement à ma prudence ordinaire ; et je craignis tellement de me laisser surprendre, que je n’osai pas même expliquer au digne aristocrate, mon ami, que l’individu qu’il avait nommé devait son avancement, à ce que j’avais entendu dire, à certains ouvrages qu’on pouvait, sans lui faire injure, comparer à des romans en vers.
La vérité est qu’indépendamment de quelques autres préjugés injustes auxquels j’ai déjà fait allusion, le marquis avait contracté une horreur mêlée de mépris pour toute espèce d’écrivains, à l’exception peut-être de ceux qui composent un volume in-folio sur la jurisprudence ou la théologie ; et il regardait l’auteur d’un roman, d’une nouvelle, d’un poème, ou d’un ouvrage de critique, comme on regarde un reptile venimeux, c’est-à-dire avec crainte et dégoût. – L’abus de la presse, disait-il, surtout dans ses productions, les plus légères, a empoisonné en Europe toutes les sources de la morale, et regagne encore peu à peu une influence nouvelle après avoir été réduite au silence par le bruit de la guerre. – Il regardait tous les écrivains, excepté ceux du plus gros et du plus lourd calibre, comme dévoués à la mauvaise cause, depuis Rousseau et Voltaire, jusqu’à Pigault-Lebrun et l’auteur des romans écossais, quoiqu’il convînt qu’il les lisait pour passer le temps ; cependant, comme Pistol mangeant son poireau14, il ne dévorait l’histoire qu’en exécrant la tendance de l’ouvrage qui l’occupait. Cette observation me fit reculer le franc aveu que ma vanité avait projeté de faire, et j’amenai le marquis à de nouvelles remarques sur le château de ses ancêtres. – Ici, me dit-il, était le théâtre sur lequel mon père obtint plus d’une fois un ordre pour faire paraître quelques-uns des principaux acteurs de la Comédie-Française, quand le roi et madame de Pompadour venaient l’y voir, ce qui lui arriva plus d’une fois. Là-bas, plus au centre, était la salle baronniale, où le seigneur exerçait sa juridiction féodale, quand son bailli avait quelque criminel à juger, car nous avions, comme vos anciens nobles écossais, le droit de haute et basse justice, fossa cum furcâ, comme le disent les juristes. En dessous est la chambre de la question, c’est-à-dire où l’on donnait la torture ; et véritablement je suis fâché qu’un droit si sujet à abus ait jamais été accordé à personne. Mais, ajouta-t-il avec un air de dignité que semblait même augmenter le souvenir des atrocités que ses ancêtres avaient commises dans le souterrain dont il me montrait les soupiraux grillés, – tel est l’effet de la superstition, que même encore aujourd’hui, les paysans n’osent approcher de ces cachots dans lesquels on dit que le courroux de mes aïeux commit plus d’un acte de cruauté.
Comme nous approchions de la fenêtre, et que je montrais quelque curiosité de voir ce séjour de terreur, nous entendîmes sortir des éclats de rire de cet abîme souterrain, et nous découvrîmes aisément qu’ils partaient d’un groupe d’enfans qui s’étaient emparés de ce caveau abandonné, pour y jouer à Colin-Maillard.
Le marquis fut un peu déconcerté, et il eut recours à sa tabatière ; mais il se remit sur-le-champ. – Ce sont les enfans de Madelon, dit-il, et ils se sont familiarisés avec ces voûtes qui inspirent la terreur au reste des habitans. D’ailleurs, pour vous dire la vérité, ces pauvres enfans sont nés depuis l’époque des prétendues lumières qui ont banni la superstition et la religion en même temps ; cela me fait penser à vous dire que c’est aujourd’hui un jour maigre. Je n’ai d’autres convives que vous et le curé de ma paroisse, et je ne blesserais pas volontiers ses opinions. D’ailleurs, ajouta-t-il d’un ton plus ferme et perdant toute contrainte : l’adversité m’a donné sur ce sujet d’autres idées que celles qu’inspire la prospérité ; et je remercie le ciel de ne pas rougir en vous avouant que je suis les commandemens de mon Église.
Je me hâtai de lui répondre que, quoiqu’ils pussent différer de ceux de la mienne, j’avais tout le respect convenable pour les réglemens religieux de chaque communion chrétienne, sachant que nous nous adressions au même Dieu, adoré d’après le même principe de la rédemption, quoique sous des formes différentes ; et que, s’il avait plu au Tout-Puissant de ne pas permettre cette variété de cultes, nos devoirs nous auraient été prescrits aussi distinctement qu’ils l’étaient sous la loi de Moïse.
Le marquis n’avait pas l’habitude de secouer la main15, mais en cette occasion il saisit la mienne et la secoua cordialement. C’était peut-être la seule manière qu’un zélé catholique pût ou dût employer pour me faire sentir qu’il acquiesçait à mes sentimens.
Ces explications, ces remarques et celles auxquelles donnèrent encore lieu les ruines étendues du château, nous occupèrent pendant deux ou trois tours que nous fîmes sur la longue terrasse, et pendant un quart d’heure que nous restâmes dans un petit pavillon, dont le toit en voûte était encore en assez bon état, quoique le ciment fût détaché sur les côtés.
– C’est ici, dit-il en reprenant le ton de la première partie de notre entretien, que j’aime à venir m’asseoir à midi pour y trouver un abri contre la chaleur, ou le soir pour voir les rayons du soleil couchant s’éteindre dans les belles eaux de la Loire. C’est ici que, comme le dit votre grand poète, avec lequel, quoique Français, je suis plus familier que bien des Anglais, j’aime à m’asseoir,
Montrant le code d’une imagination douce et amère16.
J’eus grand soin de ne pas protester contre cette variante d’un passage bien connu de Shakspeare, car je présume que notre grand poète aurait perdu quelque chose dans l’opinion d’un juge aussi délicat que le marquis, si je lui avais prouvé que, suivant toutes les autres autorités, il a écrit :
Ruminant les pensées d’une imagination douce et amère17.
D’ailleurs notre première discussion littéraire me suffisait, étant convaincu depuis longtemps (quoique je ne l’aie été que dix ans après être sorti du collège d’Édimbourg) que l’art de la conversation ne consiste pas à montrer des connaissances supérieures dans des objets de peu d’importance, mais à augmenter, à corriger, à perfectionner ce qu’on peut savoir, en profitant de ce que savent les autres… Je laissai donc le marquis montrer son code suivant son bon plaisir, et j’en fus récompensé par une dissertation savante et bien raisonnée qu’il entama sur le style fleuri d’architecture introduit en France pendant le dix-septième siècle. Il en démontra le mérite et les défauts avec beaucoup de goût ; et après avoir ainsi parlé de sujets semblables à celui qui m’a fait faire une digression quelques pages plus haut, il fit en leur faveur un appel d’un autre genre, fondé sur les idées que leur vue faisait naître.
– Qui pourrait détruire sans remords les terrasses du château de Sully ? me dit-il. Pouvons-nous les fouler aux pieds sans nous rappeler cet homme d’état aussi distingué par une intégrité sévère que par la force et l’infaillible sagacité de son jugement ? Si elles étaient moins larges, moins massives, ou si l’uniformité solennelle en était dénaturée, pourrions-nous supposer qu’elles furent le théâtre de ses méditations, patriotiques ? Pouvons-nous nous figurer le duc sur un fauteuil, la duchesse sur un tabouret, dans un salon moderne, donnant des leçons de courage et de loyauté à leurs fils, de modestie et de soumission à leurs filles, celles d’une morale rigide aux uns et aux autres, tandis qu’un cercle de jeune noblesse les écoute avec attention, les yeux modestement baissés, sans parler, sans s’asseoir, à moins de l’ordre exprès donné par Sully lui-même ? Non, monsieur, détruisez le pavillon royal dans lequel cette édifiante scène de famille se passait, et vous éloignez de l’esprit la vraisemblance et la vraie couleur d’un tel tableau. Pouvez-vous vous figurer ce pair, ce patriote distingué, se promenant dans un jardin à l’anglaise ? Autant vaudrait vous le représenter en frac bleu et en gilet blanc, et non avec son habit à la Henri IV et son chapeau à plumes. Comment aurait-il pu se mouvoir dans le labyrinthe tortueux de ce que vous avez appelé une ferme ornée, au milieu de son cortège ordinaire de deux files de gardes suisses ? En vous rappelant sa figure, sa barbe, ses haut-de-chausses à canon, attachés à son justaucorps par mille aiguillettes et nœuds de rubans, si votre imagination se le représente dans un jardin moderne, en quoi le distinguerez-vous d’un vieillard en démence qui a la fantaisie de porter le costume de son trisaïeul, et qu’un détachement de gendarmes conduit à une maison de fous ? Mais, si elle existe encore, contemplez la longue et magnifique terrasse où le loyal, le grand Sully, avait coutume de se promener solitairement deux fois par jour, en méditant sur les plans que son patriotisme lui inspirait pour la gloire de la France, ou lorsqu’à une époque plus avancée et plus triste de sa vie, il rêvait douloureusement au souvenir de son maître assassiné, et au destin de son pays déchiré par des factions ; jetez sur ce noble arrière-plan d’arcades des vases, des urnes, des statues, tout ce qui peut annoncer la proximité d’un palais ducal, et le tableau sera d’accord dans toutes ses parties avec la noble figure du grand homme. Les factionnaires portant l’arquebuse, placés aux extrémités de cette longue terrasse bien nivelée, annoncent la présence du souverain féodal ; sa garde d’honneur le précède et le suit avec la hallebarde haute, l’airmartial et imposant, comme si l’ennemi était en présence ; tous semblent animés de la même âme que leur noble chef, mesurant leurs pas sur les siens, marchant quand il marche, s’arrêtant quand il s’arrête, observant même ses légères irrégularités de marche et ses haltes d’un instant, occasionnées par ses réflexions ; tous exécutant avec une précision militaire les évolutions requises devant et derrière celui qui semble le centre et le ressort de leurs rangs, comme le cœur donne la vie et l’énergie au corps humain. Si vous riez d’une promenade si peu conforme à la liberté frivole des mœurs modernes, ajouta le marquis en me regardant comme s’il eût voulu lire dans le fond de mes pensées, pourriez-vous vous décider à détruire cette autre terrasse que foula aux pieds la séduisante marquise de Sévigné, et au souvenir de laquelle s’unissent tant de souvenirs éveillés par de nombreux passages de ses lettres délicieuses ?
Un peu fatigué de la longue tirade du marquis, dont le but était certainement de faire valoir les beautés naturelles de sa propre terrasse, qui, malgré son état de dilapidation, n’avait pas besoin d’une recommandation si solennelle, j’informai mon ami que je venais de recevoir d’Angleterre le journal d’un voyage fait dans le midi de la France par un jeune étudiant d’Oxford, mon ami, poète, dessinateur, et fort instruit, dans lequel il donne une description intéressante et animée du château de Grignan, demeure de la fille chérie de madame de Sévigné, et où elle résidait elle-même fréquemment. J’ajoutai que quiconque lirait cette relation, et ne serait qu’à quarante milles de cet endroit, ne pourrait se dispenser d’y faire un pèlerinage. Le marquis sourit, parut très-content, me demanda le titre de cet ouvrage, et écrivit sous ma dictée : Itinéraire d’un voyage fait en Provence et sur les bords du Rhône, en 1819, par John Hughes, maître ès-arts du collège Oriel, à Oxford. Il ajouta qu’il ne pouvait maintenant acheter des livres pour le château, mais qu’il en recommanderait l’achat au libraire chez lequel il était abonné dans la ville voisine. – Mais, ajouta-t-il, voici le curé qui arrive pour couper court à notre discussion, et je vois La Jeunesse tourner autour du vieux portique, sur la terrasse, pour aller sonner la cloche du dîner, cérémonie assez inutile pour appeler trois personnes ; mais je crois que le brave vieillard mourrait de chagrin si je lui disais de s’en dispenser. Ne faites pas attention à lui en ce moment, attendu qu’il désire s’acquitter incognito du service des départemens inférieurs ; quand il aura sonné la cloche, il paraîtra dans tout son éclat en qualité de majordome.
Tandis que le marquis parlait ainsi, nous avancions vers la partie orientale du château, seule partie de cet édifice qui fût encore habitable.
– La bande-noire, me dit-il, en dévastant le reste du château pour en prendre le plomb, le bois et les autres matériaux, m’a rendu un service sans le vouloir ; celui de le réduire à des dimensions plus convenables à la fortune du propriétaire actuel. La chenille a encore trouvé de quoi placer sa chrysalide dans la feuille : peu lui importe quels sont les insectes qui ont dévoré le reste du buisson.
à ces mots nous arrivâmes à la porte. La Jeunesse nous y attendait avec un air respectueux et empressé, et sa figure, quoique sillonnée de mille rides, était prête à répondre par un sourire à chaque mot que son maître lui adressait avec bonté ; ses lèvres laissaient voir alors deux rangs entiers de dents blanches qui avaient résisté à l’âge et aux maladies. Ses bas de soie bien propres, si souvent lavés qu’ils en avaient pris une teinte jaunâtre, sa queue nouée avec une rosette, les deux boucles de cheveux blancs qui accompagnaient ses joues maigres, son habit couleur de perle, sans collet ; le solitaire qu’il avait au doigt, son jabot, ses manchettes, et son chapeau à bras, tout annonçait que La Jeunesse avait regardé l’arrivée d’un convive au château comme un événement extraordinaire et qui exigeait qu’il déployât lui-même toute la magnificence et tout l’éclat de son service.
En considérant ce bizarre mais fidèle serviteur du marquis, des préjugés duquel il héritait sans doute comme de ses vieux habits, je ne pus m’empêcher de reconnaître la ressemblance qui existait, ainsi que l’avait dit son maître, entre lui et mon Caleb, le fidèle écuyer du maître de Ravenswood. Mais un Français, un vrai Jean-fait-tout par nature, peut seul se charger d’une multitude de fonctions et y suffire avec plus d’aisance et de souplesse qu’on ne pourrait l’attendre de la lenteur imperturbable d’un Écossais. Supérieur à Caleb par la dextérité, sinon par le zèle, La Jeunesse semblait se multiplier suivant l’occasion, et il s’acquittait de ses divers emplois avec tant d’exactitude et de célérité, qu’un domestique de plus aurait été complètement superflu.
Le dîner surtout fut exquis. La soupe, quoique maigre, épithète que les Anglais emploient avec dérision18, avait un goût délicieux, et la matelote de brochet et d’anguille me réconcilia, quoique Écossais, avec ce dernier poisson. Il y avait même un petit bouilli pour l’hérétique, et la viande était cuite si à propos, qu’elle conservait tout son jus et était aussi tendre que délicate. Deux autres petits plats non moins bien apprêtés servaient d’accompagnement au potage ; mais ce que le vieux maître d’hôtel regardait comme le nec plus ultra de son savoir-faire, et qu’il plaça sur la table d’un air satisfait de lui-même et en me regardant avec un sourire, comme pour jouir de ma surprise, ce fut un énorme plat d’épinards, ne formant pas une surface plane comme ceux qui sortent des mains sans expérience de nos cuisiniers anglais19, mais offrant à l’œil des coteaux et des vallées où l’on découvrait un noble cerf poursuivi par une meute de chiens et par des cavaliers portant des cors, des fouets, et armés de couteaux de chasse ; cerf, chiens, chasseurs, tout était fait de pain artistement taillé, puis grillé et frit dans du beurre. Jouissant des éloges que je ne manquai pas de donner à ce chef-d’œuvre, le vieux La Jeunesse avoua qu’il lui avait coûté près de deux jours de travail pour le porter à sa perfection ; et voulant en donner l’honneur à qui de droit, il ajouta qu’une conception aussi brillante ne lui appartenait pas en entier ; que Monseigneur avait eu la bonté de lui donner quelques idées fort heureuses, et avait même daigné l’aider à les mettre à exécution, en taillant de ses propres mains quelques-unes des principales figures.
Le marquis rougit un peu de cet éclaircissement, dont il aurait probablement dispensé volontiers son majordome ; mais il avoua qu’il avait voulu me surprendre en me mettant sous les yeux une scène tirée d’un poème qui avait eu du succès dans mon pays, milady Lac20. Je lui répondis qu’un cortège si splendide retraçait une grande chasse de Louis XIV, plutôt que celle d’un pauvre roi d’Écosse, et que le paysage en épinards ressemblait à la forêt de Fontainebleau, plutôt qu’aux montagnes sauvages de Callender. Il me fit une gracieuse inclination de tête en réponse à ce compliment, et reconnut que le souvenir de l’ancienne cour de France, quand elle était dans toute sa splendeur, pouvait bien avoir égaré son imagination. La conversation tomba bientôt sur d’autres objets.
Le dessert était excellent. Le fromage, les fruits, les olives, les cerneaux et le délicieux vin blanc étaient impayables chacun dans son genre : aussi le bon marquis remarqua, avec un air de satisfaction sincère, que son convive y faisait honneur très-cordialement.
– Après tout, me dit-il, et cependant ce n’est qu’avouer une faiblesse presque ridicule, je ne puis m’empêcher d’être charmé de pouvoir encore offrir à un étranger une sorte d’hospitalité qui lui semble agréable. Croyez-moi, ce n’est pas tout-à-fait par orgueil que nous autres, pauvres revenans, nous menons une vie si retirée, et voyons si peu de monde. Il est vrai qu’on n’en voit que trop parmi nous qui errent dans les châteaux de leurs pères, et qu’on prendrait plutôt pour les esprits des anciens propriétaires que pour des êtres vivans rétablis dans leurs possessions. Cependant c’est pour vous-mêmes, plutôt que pour épargner notre susceptibilité, que nous ne recherchons pas la société des voyageurs de votre pays. Nous nous sommes mis dans l’idée que votre nation opulente tient particulièrement au faste et à la grande chère ; que vous aimez à avoir toutes vos aises, toutes les jouissances possibles ; or, les moyens qui nous restent pour vous bien accueillir sont généralement si limités, que nous sentons que toute dépense et toute ostentation nous sont interdites. Personne ne se soucie d’offrir ce qu’il a de mieux, quand il a raison de croire que ce mieux ne fera pas plaisir ; et, comme beaucoup de vos voyageurs publient le journal de leur voyage, on n’aime guère à voir le pauvre dîner qu’on a pu donner à quelque milord anglais figurer éternellement dans un livre.
J’interrompis le marquis pour l’assurer que, si jamais je publiais une relation de mon voyage, et que j’y parlasse du dîner qu’il venait de me donner, ce ne serait que pour le citer comme un des meilleurs repas que j’eusse faits de ma vie. Il me remercia de ce compliment par une nouvelle inclination de tête, et dit qu’il fallait que je ne partageasse guère le goût national, ou que ce qu’on en disait fût grandement exagéré ; il me remerciait de lui avoir montré la valeur des possessions qui lui restaient ; l’utile avait sans doute survécu au somptueux à Haut-Lieu comme ailleurs ; les grottes, les statues, la serre chaude, l’orangerie, le temple, la tour, avaient disparu ; mais les vignobles, le potager, le verger, l’étang, existaient encore, et il était charmé de voir que leurs productions réunies eussent suffi à composer un repas trouvé passable par un Anglais. J’espère seulement, ajouta-t-il, que vous me prouverez que vos complimens sont sincères, en acceptant l’hospitalité au château de Haut-Lieu, toutes les fois que vous n’aurez pas d’engagemens préférables pendant votre séjour dans ces environs.
Je me rendis bien volontiers à une invitation faite d’une manière si gracieuse, qu’il semblait qu’en l’acceptant j’obligeasse celui qui la faisait.
La conversation tomba alors sur l’histoire du château et de ses environs ; sujet qui plaçait le marquis sur son terrain, quoiqu’il ne fût ni grand antiquaire, ni même très-profond historien dès qu’il ne s’agissait plus de sa propriété. Mais le curé était l’un et l’autre, homme aimable, de plus causant fort bien, plein de prévenance, et mettant dans ses communications cette politesse aisée qui m’a paru être le caractère distinctif des membres du clergé catholique, quel que soit leur degré d’instruction. Ce fut de lui que j’appris qu’il existait encore au château de Haut-Lieu le reste d’une fort belle bibliothèque. Le marquis leva les épaules, tandis que le curé parlait ainsi, porta les yeux de côté et d’autre, et parut éprouver de nouveau ce léger embarras qu’il avait montré involontairement quand La Jeunesse avait jasé de l’intervention de son maître dans les arrangemens de la cuisine.
– Je vous ferais voir mes livres bien volontiers, me dit-il ; mais ils sont en si mauvais état, et dans un tel désordre, que je rougis de les montrer à qui que ce soit.
– Pardon, monsieur le marquis, dit le curé ; mais vous savez que vous avez permis au docteur Dibdin, le célèbre bibliomane anglais, d’examiner ces précieux restes, et vous n’oubliez pas quel éloge il en a fait.
– Pouvais-je en agir autrement, mon cher ami ? répondit le marquis : on avait fait au docteur des rapports exagérés sur le mérite des restes de ce qui avait été autrefois une bibliothèque. Il s’était établi dans l’auberge voisine du château, déterminé à emporter sa pointe, ou à mourir sous les murailles. J’avais même ouï dire qu’il avait mesuré trigonométriquement la hauteur de la petite tour, afin de se pourvoir d’échelles pour l’escalader. Vous n’auriez pas voulu que je réduisisse un respectable docteur en théologie, quoique membre d’une communion différente de la nôtre, à commettre cet acte de violence ; ma conscience en aurait été chargée.
– Mais vous savez aussi, monsieur le marquis, reprit le curé, que le docteur Dibdin fut si courroucé de la dilapidation que votre bibliothèque avait soufferte, qu’il avoua qu’il aurait voulu être armé des pouvoirs de notre Église pour lancer un anathème contre ceux qui en avaient été coupables.
– Je présume, répliqua notre hôte, que son ressentiment était proportionné à son désappointement.
– Pas du tout ! s’écria le curé ; car il parlait avec tant d’enthousiasme de la valeur de ce qui vous reste, que je suis convaincu que, s’il n’avait cru devoir céder à vos instantes prières, le château de Haut-Lieu aurait occupé au moins vingt pages dans le bel ouvrage dont il nous a envoyé un exemplaire, et qui sera un monument durable de son zèle et de son érudition21.
– Le docteur Dibdin est la politesse même, dit le marquis ; et, quand nous aurons pris notre café (le voici qui arrive), nous nous rendrons à la petite tour. Comme monsieur n’a pas méprisé mon humble dîner, j’espère qu’il aura la même indulgence pour une bibliothèque en désordre ; et je m’estimerai heureux s’il y trouve quelque chose qui puisse l’amuser. D’ailleurs, mon cher curé, vous avez tous les droits possibles sur ces livres, puisque, sans votre intervention, leur propriétaire ne les aurait jamais revus.
Quoique ce dernier acte de politesse lui eût été en quelque sorte arraché malgré lui par le curé, et que le désir de cacher la nudité de son domaine et l’étendue de ses pertes parussent toujours lutter contre sa disposition naturelle à obliger, il me fut impossible de prendre sur moi de ne pas accepter une offre que les règles strictes de la civilité auraient peut-être dû me faire refuser. Mais renoncer à voir les restes d’une collection assez curieuse pour avoir inspiré au docteur Dibdin le projet de recourir à une escalade, c’eût été un acte d’abnégation dont je ne me sentis pas la force.
Cependant La Jeunesse avait apporté le café tel qu’on n’en boit que sur le continent22, sur un plateau couvert d’une serviette, afin qu’on pût croire qu’il était d’argent, et du pousse-café de la Martinique dans un porte-liqueurs qui était certainement de ce métal. Notre repas ainsi terminé, le marquis me fit monter par un escalier dérobé. Je fus introduit dans une grande galerie, de forme régulière, et qui avait près de cent pieds de longueur, mais tellement dilapidée et ruinée, que je tins constamment mes yeux fixés sur le plancher, de crainte que mon hôte ne se crût obligé de faire une apologie pour tous les tableaux délabrés, les tapisseries tombant en lambeaux, et, ce qui était encore pire, les fenêtres brisées par le vent.
– Nous avons tâché de rendre la petite tour un peu plus habitable, me dit le marquis en traversant à la hâte ce séjour de désolation. C’était ici autrefois la galerie de tableaux ; et dans le boudoir qui est à l’autre bout, et qui sert à présent de bibliothèque, nous conservions quelques tableaux précieux de chevalet, dont la dimension exigeait qu’on les considérât de plus près.
En parlant ainsi, il écarta un pan de la tapisserie déjà mentionnée, et nous entrâmes dans l’appartement dont il venait de parler.
C’était une salle octogone, répondant à la forme extérieure de la petite tour dont elle occupait l’intérieur. Quatre des côtés étaient percés de croisées garnies de petits vitraux semblables à ceux qu’on voit dans les églises, et chacune de ces fenêtres offrait un point de vue magnifique sur la Loire et sur toute la contrée à travers laquelle serpente ce fleuve majestueux. Les vitraux étaient peints ; et les rayons du soleil couchant, qui brillaient de tout leur éclat à travers deux de ces croisées, montraient un assemblage d’emblèmes religieux et d’armoiries féodales qu’il était presque impossible de regarder sans être ébloui. Mais les deux autres fenêtres, n’étant plus exposées à l’influence de cet astre, pouvaient être contemplées avec plus de facilité ; on devinait qu’elles étaient garnies de vitraux qui, dans l’origine, ne leur avaient pas été destinés. J’appris ensuite qu’ils avaient appartenu à la chapelle du château, avant qu’elle eût été profanée et pillée. Le marquis s’était amusé, pendant plusieurs mois, à accomplir ce rifacimento avec l’aide du curé et de l’universel La Jeunesse ; et, quoiqu’ils n’eussent fait qu’assembler des fragmens souvent fort petits, cependant les vitraux peints, à moins, qu’on ne les examinât de très-près et d’un œil d’antiquaire, produisaient un effet fort agréable.
Les côtés de l’appartement qui n’avaient pas de fenêtres étaient, à l’exception de l’espace nécessaire pour la petite porte, garnis d’armoires à tablettes, en bois de noyer parfaitement sculpté, et à qui le temps avait donné une couleur foncée de châtaigne mûre. Quelques-unes étaient en bois blanc, et elles avaient été faites récemment pour suppléer au déficit occasionné par la dévastation. Sur ces tablettes étaient déposés les restes précieux échappés au naufrage d’une magnifique bibliothèque.
Le père du marquis avait été un homme instruit, et son aïeul s’était rendu célèbre par l’étendue de ses connaissances, même à la cour de Louis XIV, où la littérature était, en quelque sorte, regardée comme un objet à la mode. Ces deux seigneurs, dont la fortune était considérable, et qui s’étaient libéralement livrés à leur goût, avaient fait de telles augmentations à une ancienne bibliothèque gothique fort curieuse, qui leur venait de leurs ancêtres, qu’il existait en France peu de collections de livres qu’on pût comparer à celle du château de Haut-Lieu. Elle avait été complètement dispersée par suite d’une tentative mal avisée faite par le marquis actuel, en 1790, pour dissiper un rassemblement révolutionnaire. Heureusement le curé, qui par sa conduite charitable et modérée, et par ses vertus évangéliques, avait beaucoup de crédit sur l’esprit des paysans du voisinage, obtint de plusieurs d’entre eux, pour quelques sous, et souvent même pour un petit verre d’eau-de-vie, des ouvrages qui avaient coûté des sommes considérables, et dont les coquins qui avaient pillé le château s’étaient emparés uniquement par envie de mal faire. Ce digne ecclésiastique avait ainsi racheté un aussi grand nombre de livres de son seigneur, que sa petite fortune le lui permettait ; et c’était grâce à ce soin généreux qu’ils étaient retournés dans la petite tour où je les trouvai. On ne peut donc pas être surpris qu’il fût fier et charmé de montrer aux étrangers la collection dont il était le restaurateur.
En dépit des volumes dépareillés et mutilés, et de toutes les autres mortifications qu’un amateur éprouve quand il visite une bibliothèque mal tenue, il se trouvait dans celle de Haut-Lieu beaucoup d’ouvrages faits, comme le dit Bayes23, pour surprendre et enchanter le bibliomane ; et, comme le docteur Ferrier le dit avec toute la sensibilité d’un amateur, on y voyait un grand nombre de ces ouvrages rares et curieux,
De ces petits formats jadis dorés sur tranche,
des missels richement enluminés, des manuscrits de 1380, de 1320, ou même de plus ancienne date ; enfin, des ouvrages imprimés en caractères, gothiques pendant le quinzième et le seizième siècle. Mais j’ai dessein d’en rendre un compte plus détaillé, si je puis en obtenir la permission du marquis.
En attendant, il me suffira de dire qu’enchanté du jour que j’avais passé à Haut-Lieu, j’y fis de fréquentes visites, et que la clef de la tour octogone était toujours à ma disposition. Ce fut alors que je me pris d’une belle passion pour une partie de l’histoire de France que je n’avais jamais suffisamment étudiée, malgré l’importance de ses rapports avec celle de l’Europe en général, et quoique traitée par un ancien historien inimitable24. En même temps, pour satisfaire les désirs de mon digne hôte, je m’occupai de temps en temps de quelques mémoires de sa famille qui avaient été heureusement conservés, et contenant des détails curieux sur l’alliance de cette maison avec une famille écossaise, alliance à laquelle j’avais dû, dans l’origine, les bonnes grâces du marquis de Haut-Lieu.
Je méditai sur cet objet, more meo, jusqu’à l’instant où je quittai la France pour aller retrouver le roasbeef et le feu de houille de la Grande-Bretagne ; ce qui n’eut lieu qu’après que j’eus mis en ordre ces réminiscences gauloises. Enfin le résultat de mes méditations prit la forme dont mes lecteurs pourront juger dans un instant, si cette préface ne les épouvante pas.
Que le public accueille cet ouvrage avec bonté, et je ne regretterai pas mon absence momentanée de mon pays.
QUENTIN DURWARD.
CHAPITRE PREMIER.Le Contraste.
« Voyez ces deux portraits : cesont ceux de deux frères. »
Shakspeare. Hamlet, acte III, scène 4.
La fin du quinzième siècle prépara pour l’avenir une suite d’événemens dont le résultat fut d’élever la France à cet état formidable de puissance qui a toujours été depuis le principal objet de la jalousie des autres nations de l’Europe. Avant cette époque, il ne s’agissait de rien moins que de son existence dans sa lutte contre les Anglais, déjà maîtres de ses plus belles provinces ; et tous les efforts de son roi, toute la bravoure de ses habitans, purent à peine préserver la nation du joug de l’étranger. Ce n’était pas le seul danger qu’elle eût à craindre ; les princes qui possédaient les grands fiefs de la couronne, et particulièrement les ducs de Bourgogne et de Bretagne, en étaient venus à rendre si légères leurs chaînes féodales, qu’ils ne se faisaient aucun scrupule de lever l’étendard contre leur seigneur suzerain, le roi de France, sous les plus faibles prétextes. En temps de paix, ils gouvernaient leurs provinces en princes absolus, et la maison de Bourgogne, maîtresse du pays qui portait ce nom et de la partie la plus riche et la plus belle de la Flandre, était si riche et si puissante par elle-même, qu’elle ne le cédait à la couronne de France ni en force ni en splendeur.
à l’imitation des grands feudataires, chaque vassal inférieur de la couronne s’arrogeait autant d’indépendance que le lui permettaient la distance où il était du point central de l’autorité, l’étendue de son fief et les fortifications de sa tour féodale : tous ces petits tyrans, affranchis de la juridiction des lois, se livraient impunément à tous les caprices et à tous les excès de l’oppression et de la cruauté. Dans l’Auvergne seule on comptait plus de trois cents de ces nobles indépendans, pour qui le pillage, le meurtre et l’inceste n’étaient que des actes ordinaires et familiers.