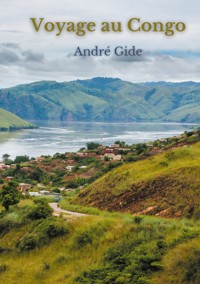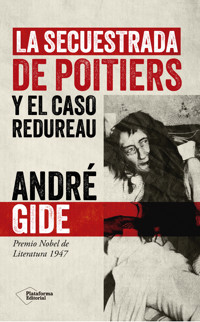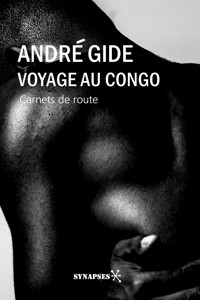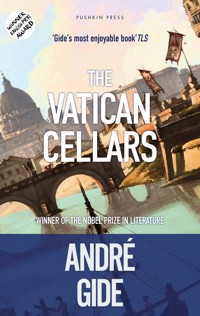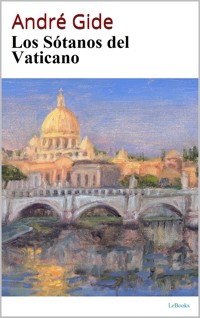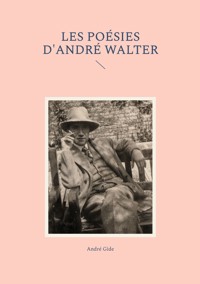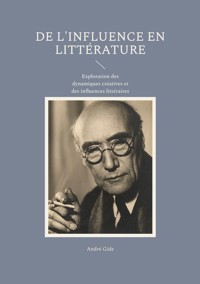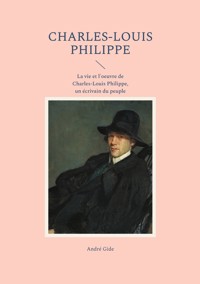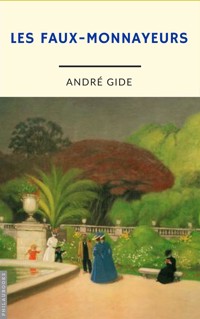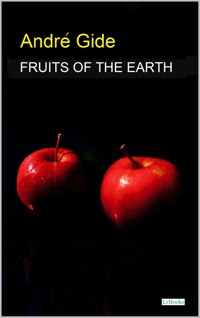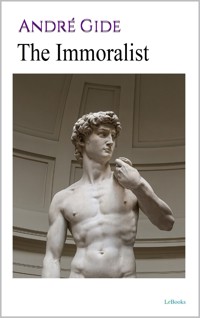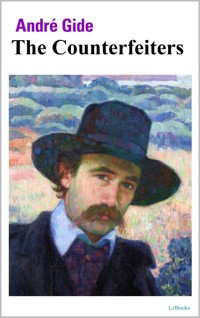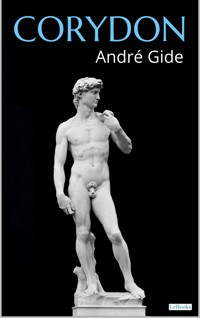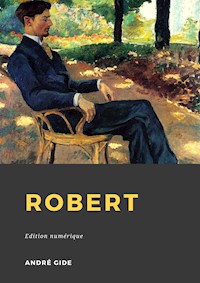
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Robert, sous-titré « Supplément à L'École des femmes », est un roman d'André Gide publié en janvier 1930 aux éditions de La Nouvelle Revue française chez Gallimard. Ce roman fait partie d'une trilogie, dont il constitue le « deuxième tome » incluant L'École des femmes (1929) et Geneviève (1936). André Gide se voit adresser une réponse épistolaire par Robert X — le mari de la défunt Éveline X qui fit publier de manière posthume son journal intime, sous le titre L'École des femmes, par les soins de sa fille —, qui demande à l'écrivain de publier son droit de réponse à la suite du dévoilement de sa vie de couple par son épouse. Robert, tout à la fois scandalisé par l'action de sa femme et plus encore de sa fille, présente sa version de l'évolution de son mariage où il transparaît que son amour, toujours intact d'une certaine manière pour Éveline, s'est heurté avec le caractère de plus en plus « libre-penseur » de sa femme.
À PROPOS DE L'AUTEUR
André Gide (1869 - 1951) était un auteur français et lauréat du prix Nobel de littérature (en 1947). La carrière de Gide s'étend de ses débuts dans le mouvement symboliste à l'avènement de l'anticolonialisme entre les deux guerres mondiales. Auteur de plus de cinquante livres, au moment de sa mort sa nécrologie dans le New York Times le décrivait comme "le plus grand homme de lettres contemporain de France" et "jugé le plus grand écrivain français de ce siècle par les connaisseurs littéraires".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 54
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert
André Gide
– 1930 –
ROBERT
ÀERNEST ROBERT CURTIUS
Cuverville, 5 septembre 1929.
Mon cher ami,
Une lettre de vous, après lecture de mon École des Femmes, m’exprimait vos regrets de ne connaître le mari de mon « héroïne » qu’à travers le journal de celle-ci.
« – Combien l’on souhaiterait, m’écriviez-vous, de pouvoir lire, en regard de ce journal d’Éveline, quelques déclarations de Robert. »
Ce petit livre répond peut-être à votre appel. Il est tout naturel qu’il vous soit dédié.
PREMIÈRE PARTIE
Monsieur,
Encore que mon premier sentiment, à la lecture de votre École des Femmes, ait été l’indignation, je ne me permettrai pas de vous en vouloir à vous personnellement. Vous avez jugé bon de livrer au public le journal intime d’une femme, journal que celle-ci n’aurait jamais consenti d’écrire si elle eût pu se douter du sort qui lui serait fait un jour. La mode est aux confessions ; aux révélations indiscrètes, sans souci du préjudice matériel ou moral que ces indiscrétions peuvent causer aux survivants ; sans souci non plus de leur déplorable exemple. Je laisse à votre conscience (nous en avons tous une) le soin d’examiner s’il vous appartenait vraiment d’aider à une publication si nettement désobligeante pour un tiers, et, la couvrant de votre nom, d’en tirer à vous gloire… et profit. Ma fille vous y invitait, me répondrez-vous ? J’exprimerai plus loin ce que je pense de sa conduite. Je sais d’autre part, et par vos propres aveux, que vous attachez volontiers plus de poids à l’opinion des jeunes gens qu’à celle de leurs parents. Libre à vous ; mais, en l’occurrence, nous voyons où cela mène ; et où cela mènerait si plus de gens vous ressemblaient, ce qu’à Dieu ne plaise ! Suffit.
Vous étonnerai-je beaucoup si je vous dis que je ne suis pas le seul à ne consentir point à me reconnaître dans l’être inconséquent, vain, sans importance, que ma femme a portraicturé. « Protester, c’est s’avouer atteint par l’injure », a dit un ancien. Quand bien même l’injure m’aurait atteint, je serais seul à le savoir, puisque mon nom n’a jamais été prononcé. Si je dis tout cela, c’est pour que vos lecteurs comprennent que ce n’est nullement le besoin de réhabilitation qui me fait aujourd’hui prendre la plume, mais bien uniquement un souci de vérité, de justice et de remise au point.
L’opinion se forme plus facilement, mais plus injustement aussi, après l’audition d’un seul témoin qu’après qu’on a prêté l’oreille aux témoignages contradictoires. Après avoir couvert de votre nom L’École des Femmes, c’est L’École des Maris que je vous propose ; je fais appel à votre dignité professionnelle pour publier, en pendant à cet autre livre et dans les mêmes conditions de présentation et de lançage, la réfutation que voici.
Mais, avant d’entrer en matières, j’en appelle aux honnêtes gens. Que pensent-ils, je le leur demande, d’une jeune fille qui, sitôt après la mort de sa mère, s’empare des papiers intimes de celle-ci, avant même que le mari n’en ait pu prendre connaissance ? Vous avez écrit quelque part, il m’en souvient : « J’ai les honnêtes gens en horreur », et sans doute applaudissez-vous aux gestes hardis où vous pourriez reconnaître l’influence de vos doctrines. Dans l’audace éhontée dont ma fille fit preuve, je vois le triste résultat de l’éducation « libérale » qu’il plaisait à ma femme de donner à nos deux enfants. Mon grand tort fut de lui céder, selon mon habitude, par crainte du despotisme et par horreur des discussions. Celles que nous eûmes à ce sujet furent des plus graves, et je m’étonne de n’en trouver point de traces dans son journal. J’y reviendrai.
Que l’on ne s’attende pourtant pas à me voir revenir sur tous les points où le témoignage de ma femme me paraît inexact. Et en particulier sur certaines insinuations auxquelles je croirais au-dessous de ma dignité de répondre : celles qui ont trait à mon courage patriotique et à ma conduite pendant la guerre. Éveline ne semble du reste pas se rendre compte que, douter que j’aie vraiment mérité ma citation, c’est jeter nécessairement un discrédit sur l’honorabilité ou la compétence des chefs qui me l’ont accordée. Les phrases de moi qu’elle cite, à ce sujet, les ai-je vraiment dites ? Sincèrement, je ne le crois pas. Ou, si je les ai dites, ce n’est pas avec le ton et les intentions que sa malignité leur prête. En tout cas, je n’en ai pas gardé souvenir. Et je ne l’accuse pas à mon tour d’avoir volontairement et sciemment falsifié mon personnage. (Je ne l’accuse de rien.) Mais je crois qu’à un certain degré de prévention (que les Anglais appellent si bien : prejudice) nous entendons sincèrement autrui dire ce que nous nous attendons à l’entendre dire, et que nous obtenons, en quelque sorte, des paroles de lui que le souvenir n’aura même pas à déformer.
Ce dont, par contre, je me souviens fort bien, c’est que je sentais qu’Éveline en était arrivée à ce point que, quoi que ce soit que je dise, le son que mes paroles feraient dans son âme serait le même. Elle ne pouvait plus m’entendre que mentir.
Mais mon intention, je l’ai dit, n’est point de me défendre. Je préfère raconter simplement à mon tour mes souvenirs de notre vie commune. Je parlerai en particulier de ces vingt années que son journal passe sous silence. Ma tâche est ardue, car il me semble sentir, tandis que j’écris, se pencher sur mon épaule le lecteur à l’affût du moindre mot où se révèlent ma « fourberie », ma « duplicité », etc. (ce sont les mots dont se sont servis les critiques). Pourtant, si je surveille trop mon écriture, je risque de fausser ma ligne et de donner dans le piège de l’apprêt, au moment même et d’autant plus que je m’applique à l’éviter… La difficulté n’est pas mince. Je n’en triompherai, ce me semble, qu’en n’y pensant point ; qu’en écrivant au courant de la plume ; qu’en repartant à pied d’œuvre ; qu’en ne tenant pas compte de ce qu’a pu dire de moi Éveline, ni penser de moi le public. Ne suis-je pas un peu en droit d’espérer que le public voudra bien faire de même ; je veux dire : n’apporter point, en me lisant, un jugement trop préconçu ?
Une autre chose me gêne, il faut bien que je l’avoue. Les critiques ont loué à l’envi le style de ma femme. Et j’étais loin de me douter qu’Éveline pût si bien écrire. Je n’en pouvais guère juger, car, comme nous vivions toujours ensemble, je n’avais point à recevoir de lettres d’elle. Suprême éloge : on a même été supposer que ce journal avait été écrit par vous, M. Gide, qui1