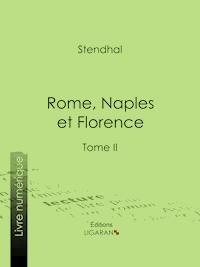
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait: "Dès qu'on approche d'un mensonge nécessaire, un petit sourire fin et presque imperceptible avertit qu'on va parler un instant pour la galerie..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BOLOGNE, 9 janvier 1817. – Ce soir j’ai eu l’honneur de faire la conversation pendant longtemps avec S.E. Mgr le cardinal Lante. Voudrait-il me tâter ? Mais, en vérité, à quoi bon ? Quoiqu’il en soit de la cause de ma faveur, les manières de Son Éminence dans la discussion sérieuse sont à peu près celles d’un conseiller d’état sous Napoléon. Son Éminence a moins d’importance, plus d’esprit et plus de gestes. Dès qu’on approche d’un mensonge nécessaire, un petit sourire fin et presque imperceptible avertit qu’on va parler un instant pour la galerie. Dès le huitième jour, il me dit :
« Monsieur, j’ai remarqué qu’un Français, non militaire, s’il est allé à la guerre, ne manque pas de raconter comme quoi il lui est arrivé une nuit de dormir sur un mort qu’il n’avait pas aperçu dans la paille, au fond d’une grange. De même, un Français rencontre-t-il un cardinal, il ne manque guère de peindre ce prince de l’Église lui lançant de prime-abord deux ou trois phrases bien athées, et allant ensuite prendre une glace à côté de sa maîtresse qu’il ne quitte plus de toute la soirée. »
– Un cardinal parlant mal de Dieu, Éminence, cela est à peu près aussi vraisemblable qu’un conseiller d’état de Napoléon médisant du système continental. »
La supériorité d’un cardinal est tellement incontestable, en terre papale, que, pour peu que ce personnage ne soit pas le dernier des hommes, il a de la bonhomie. Un cardinal crée le souverain deux ou trois fois en sa vie, et, du reste, se moque de toutes les lois. J’ai eu la gloire d’inspirer au cardinal Lante l’envie de parler. Il dit à un étranger, par imprudence et besoin de sfogarsi (to give vent to his passion), des choses qu’il éviterait avec un habitant de Bologne. Il me questionne de préférence sur des ridicules que je n’aimerais pas qu’on trouvât décrits dans mes papiers. Hier, après m’avoir parlé une heure, « Allons, monsieur, me dit-il, il faut de l’égalité dans le commerce. Payez-moi mes contes sur Rome par des anecdotes sur Paris. Par exemple, quel homme est-ce que monsieur I-o-bez-dou-i-ou-ra ? » J’ai été fort embarrassé ; je ne comprenais pas du tout, et le cardinal croit parler français supérieurement. Pendant que je cherchais en vain un mot pour me tirer d’affaire, et que je devenais gauche à vue d’œil, le cardinal redit deux ou trois fois : « Monsieur I-o-bez-dou-i-ou-ra. – C’est donc un personnage bien puissant, ajoute-t-il enfin, que ma question vous embarrasse ? » Faute de mieux, je n’ai protesté que faiblement du peu de terreur que m’inspirait monsieur I-o-bez-dou-i-ou-ra. « Il a bien mal mené votre ministre de la guerre, » ajoute le cardinal. Ce mot me rend la vie ; j’ai vu qu’il s’agissait de M. Jobez du Jura. Après ma réponse, ce C’est Paris, a dit en soupirant le cardinal Lante, qui est la capitale du monde ; un homme qui monte à la tribune est connu en Europe. – Éminence, Rome a été deux fois la maîtresse du monde, sous Auguste comme sous Léon X, et j’admire bien plus la seconde fois que la première. » Je note une réponse aussi simple, parce qu’il est toujours indispensable de flatter un Romain sur Rome ; c’est comme un Français vulgaire sur la gloire de nos armées, la victoire, etc. Le cardinal a repris d’un air rêveur : « Oui ; mais si vous Français, vous continuez à être les maîtres de l’opinion, que sera Rome dans cent ans ? » L’aide-de-camp du cardinal me dit, comme fait sérieux, mais sans louer ni blâmer (cette nuance caractérise le prélat romain), que Ravenne, petite ville de douze mille habitants, vient d’acheter soixante-deux exemplaires de la Logique de M. de Tracy, traduite par M. Compagnoni, Ancônitain brillant d’esprit. C’est l’un des hommes les plus remarquables recrutés par Napoléon, qui, l’ayant entendu parler, le fit sur le champ conseiller d’état.
Ce même prélat m’a dit une chose que je pense depuis la mort du maréchal Ney, mais que je me garde d’avouer. Un des grands et signalés bonheurs de la France, c’est d’avoir perdu la bataille de Waterloo ; ce n’est pas la France, c’est la……… qui a perdu cette bataille.
Une femme de la société, dont l’amant est mort il y a six mois, et qui est triste, c’est-à-dire réfléchissante sur le sort de l’humanité, me disait ce soir, à la fin d’une longue conversation :
« Une Italienne ne compare jamais son amant à un modèle. Dès qu’ils sont amis intimes, il lui conte les caprices les plus bizarres pour ses affaires, sa santé, sa toilette ; elle n’a garde de le trouver singulier, original, ridicule. Comment arriverait-elle à cette idée ? Elle ne le garde et ne l’a pris que parce qu’elle l’aime ; et l’idée de le comparer à un modèle lui semblerait aussi bizarre que celle de regarder si le voisin rit pour savoir si elle s’amuse. Ses bizarreries lui plaisent, et, si elle le regarde, c’est pour chercher à lire dans ses yeux comment il l’aime en ce moment. – Je me souviens, dis-je, qu’une Française écrivait il y a un an : Je ne crains rien tant dans mon amant que le ridicule. – Une Italienne, eût-elle l’idée du ridicule, reprend madame T ***, son amour l’empêcherait à jamais de l’apercevoir dans ce qu’elle aime. »
– Heureuse erreur ! Elle est, je n’en doute pas, la principale source du bonheur de ce pays.
Je supprime trente pages de descriptions de Bologne que l’on trouvera écrites, et avec une grâce que je ne saurais atteindre, à la fin du premier volume du président de Brosses, page 350. M ; de Lalande, l’athée, passa huit mois en Italie ; mais tous les jésuites du pays eurent l’ordre de lui envoyer des mémoires sur le lieu de leur séjour : de là son plat voyage en neuf volumes. Il voit tout par la lorgnette des jésuites ; mais c’est un bon itinéraire. Il rabaisse tous les hommes distingués vivant en 1776 ; c’était l’usage des bons pères, rien ne maintient davantage le statu quo. Le meilleur itinéraire est celui dont le libraire Vallardi, de Milan, vient de publier la quinzième édition. MM. Reina, Bossi, de Cristoforis, Compagnoni et autres savants milanais, ont bien voulu fournir quelques notices. Je conseille le protestant Misson et Forsyth ; le premier voyagea en 1688, le second en 1802. On peut consulter Montaigne (1580) et Duclos (1760).
10 janvier 1817. – Je me trouve en quelque sorte le favori du cardinal. C’est un homme vif qui oublie souvent la prudence, surtout à la fin des soirées, quand le vent est chaud et qu’il ne souffre pas. Pour n’être pas victime de ma faveur, je me suis mis sur le pied de lui faire librement des questions sur les femmes. Si le cardinal fait l’important, je le planterai là. À quelle place peut-il me nommer ? Jusqu’ici Son Éminence me répond par les biographies les plus comiques, c’est-à-dire les plus singulières ; car il ne cherche nullement à être plaisant. Un Italien ne fait jamais grimacer ses figures ; aussi elles ne se ressemblent pas toutes comme celles de nos conteurs gens d’esprit. Les personnages de ceux-ci sont toujours convenables, comme dans les comédies de Picard, c’est-à-dire jamais individuels. Nos conteurs ne sont pas peintres ; ils construisent de la philosophie contemporaine (ceci est un mot de mathématiques), et par conséquent n’apprennent rien au philosophe. Leurs histoires sont le contraire du Pecorone ou de la Vie de Benvenuto Cellini. C’est le livre qu’il faut lire avant tout, si l’on veut deviner le caractère italien. Le cardinal Lante est un homme de beaucoup d’esprit, et cependant je remarque que souvent ses anecdotes manquent de chute piquante. L’anecdote, en Italie, se contente souvent de peindre d’une manière forte, mais correcte et non exagérée, une nuance de sentiment.
Si j’avais un secrétaire ce soir, je dicterais un volume de tout ce que Son Éminence m’a dit de caractéristique sur les femmes dont la beauté ou la physionomie m’intéresse. Par exemple, celle dont je n’ai pu apprivoiser l’amant, la Marchesina Nella. Un homme en était éperdument amoureux ; c’était un avocat gênois qui venait de lui faire gagner un procès considérable, et qui, pendant six mois, l’avait vue tous les jours. La veille du départ de ce pauvre amant qui, après mille retards, retournait à Gênes, voyant sa passion sans espoir, comme il était dans le salon à pleurer en silence, Nella prend un flambeau et lui dit : Suivez-moi […] malheur de cet homme.
Il n’y a peut-être pas une femme d’esprit à Bologne qui n’ait aimé d’une manière originale. Une des plus belles s’est tout à fait empoisonnée, parce que son amant lui préférait une dame russe. Elle a été sauvée, parce que cette nuit-là le feu prit à sa maison. On la trouva déjà privée de sentiment dans sa chambre remplie de vapeur de charbon. Un serin dans sa cage était tout à fait mort ; ce qui, le lendemain, produisit un sonnet en bolognese. Excepté en matière d’argent, l’insouciance de l’avenir est un grand trait du caractère italien ; toute la place est occupée par le présent. Une femme est fidèle à son amant qui voyage, pendant dix-huit mois ou deux ans ; mais il faut qu’il écrive. Meurt-il, elle est au désespoir ; mais par l’effet de la douleur d’aujourd’hui et non en pensant à celle de demain. De là le manque de suicides par amour. C’est une maxime parmi les amants, que lorsqu’on va passer quelques mois loin de sa maîtresse, il faut la quitter à demi brouillé. À Bologne, l’amour et le jeu sont les passions à la mode ; la musique et la peinture, les délassements ; la politique, et sous Napoléon, l’ambition, le refuge des amants malheureux. Mais les anecdotes qui prouvent tout cela et qui me font un plaisir extrême, à moi curieux, sembleraient plates et sans sel au nord des Alpes. Elles peignent peut-être avec vérité des âmes singulières ; mais il ne faut pas être singulier. L’on me nierait mes faits tout simplement, et l’on s’écrierait ensuite qu’il y a bien un peu de mauvais goût à raconter de telles choses. La société de Paris déclare de mauvais goût tout ce qui est contre ses intérêts. Or, décrire d’autres manières sans les blâmer, peut faire douter de la perfection des siennes.
La société est bien moins francisée ici qu’à Milan ; elle a bien plus de raciness italienne, comme dirait un Anglais : je trouve plus de feu, de vivacité, plus de profondeur et d’intrigue pour arriver à ses fins, plus d’esprit et de méfiance.
Mais c’est, je crois, pour la vie que je suis amoureux des façons naïves des heureux habitants de Milan. J’ai senti en ce pays-là que le bonheur est contagieux. D’après ce principe, je cherche quel est à Bologne le degré de bonheur des basses classes. Je me suis lié avec un curé de la ville, qui me répond, parce qu’il voit le légat me parler ; il me prend sans doute pour quelque agent secret.
Avant 1796, on commençait à soupçonner à Milan ce que c’est que la stricte impartialité et la justice. Malgré tout ce qu’a fait Napoléon, cette idée n’a pu encore franchir l’Apennin (la Toscane exceptée, bien entendu). Les coquineries incroyables faites à Rome du temps du pape Pie VI (affaire Lepri), par les premiers ministres successifs, leurs favoris et les favoris de leurs favoris, forment le magasin d’anecdotes que l’on répète sans cesse à Bologne. Le jeune homme de dix-huit ans, entrant dans le monde, est sur le champ corrompu, quant à la probité, par ces anecdotes ; ce sont elles qui font sa seconde éducation. Le bas peuple, tel que mon ami le marchand de Salam, en est encore aux anecdotes bien pires du 17e siècle. Pour réussir, il s’agit, à Bologne, de plaire à la personne qui, pour Le moment, a le pouvoir : non en l’amusant, mais en lui rendant quelque service. Il faut donc connaître la passion dominante de l’homme qui a le pouvoir ; et souvent il nie cette passion : car il est homme, mais il est p… La connaissance du cœur humain est donc nécessairement bien plus avancée dans le pays papal qu’à New-York, où je suppose que la plupart des choses se font légalement et honnêtement. Certes, il doit y être beaucoup moins important de connaître la passion dominante du sheriff, qui d’ailleurs est invariablement : gagner de l’argent par des moyens honnêtes. Cette profonde connaissance de l’homme n’est rien moins qu’agréable, c’est une vieillesse anticipée : de là le dégoût des Italiens pour la comédie de caractère et leur passion pour la musique qui les enlève hors de ce monde et les fait voyager dans le pays des illusions tendres. Il est un pays où c’est en mentant huit fois par jour, et pendant trois ans, que l’on se rend digne d’une place de 12 000 francs : quel genre d’esprit doit briller en ce pays ? L’art de parler. Aussi tel ministre y est-il admiré, parce qu’il peut parler sur tous les sujets, élégamment et sans rien dire, pendant deux heures.
L’abbé Raynal fut le bienfaiteur de la haute Italie ; Joseph II lut son livre par hasard, et depuis ce prince, les prêtres sont réduits à leur juste degré d’importance dans l’Italie autrichienne. À Venise, ils étaient encore plus savamment comprimés depuis l’immortel Fra Paolo.
C’est uniquement à cause de cette circonstance qu’en 1817, la masse du peuple est plus heureuse à Milan et à Vérone qu’à Bologne ou à Ferrare. À l’égard de toutes les personnes qui ont de l’aisance, c’est-à-dire 100 louis de rente, la tyrannie est plus visible et plus incommode à milan et à Venise. Elle s’exerce sur les pamphlets venant de Paris, sur les propos tenus dans les cafés, sur les réunions de gens mal pensants ; mais beaucoup de presbytères de campagne n’y sont pas le centre d’intrigues de libertinage souvent atroces, et qui portent le malheur profond et la rage impuissante, suivie la plupart du temps de la scélératesse dans la moitié des maisons du petit village. Telle est la cause secondaire du nombre de brigands enragés qui infestent l’État de l’Église. La première cause, c’est que l’industrie y est mal récompensée. Pour faire fortune, il faut non travailler constamment et économiser cent écus chaque année, mais avoir une jolie femme et acheter la faveur d’un m…. . Et ce n’est pas d’hier qu’il faut suivre ce chemin infâme ; il y a déjà trois cents ans : depuis qu’Alexandre VI et son fils César Borgia domptèrent par le poison Astor et les autres petits tyrans des villes de la Romagne (1493-1503). Nous avons vu qu’à moins de posséder un grand nom, il ne faut pas s’aviser d’être propriétaire en terre papale. Le mécanisme social est à Bologne, en 1817, ce qu’il était en 1717 ; aucun nouvel intérêt n’a été créé : mais les mœurs se sont adoucies. Les gouvernails de ce pays ne font plus de cruautés, ils se bornent à quelques friponneries et à chercher leurs plaisirs. Plusieurs sont dévots de bonne foi ; mais on les trompe, ou ils tolèrent les abus. M. Tambroni, un homme très fin de ce pays-ci, m’a donné des détails curieux sur ce triste sujet. Je ne rendrai pas au lecteur le mauvais service de les mettre sous ses yeux. Si sa place l’empêche d’y croire, il n’y croirait pas davantage, sur mon seul témoignage. Napoléon, qui avait une gendarmerie et qui faisait sentir aux p… la main de fer de son inexorable justice, avait supprimé les brigands ; et peu à peu ses sous-préfets supprimaient les infamies dans les petits villages. Mais la friponnerie n’étonne pas encore le paysan de la Romagne. Si j’avais de l’argent où le cacher ? vous dit-il avec candeur ; il croit que le voleur qui le découvrirait y a presque autant de droit que lui.
J’ai vu ce soir un prince fort galant homme qui réside à Crémone, ses discours m’ont amusé ; c’est ainsi qu’on devait être en 1600. À Crémone, ville opulente, superstitieuse, arriérée, une société de quarante dames fort nobles, fort riches, quelques-unes très jolies, entreprend, vers 1809, de résister à toutes les mesures du gouvernement, favorise les conscrits réfractaires, facilite leur évasion, décrie le préfet, etc., etc. ; ces dames étaient dirigées par un moine, le plus bel homme de la ville, encore jeune. Napoléon exila ce bel homme à vingt lieues de chez lui, à Melegnano (Marignan), près de Milan. Ces belles dames le regrettent encore en 1816, et viennent de le demander au gouvernement autrichien, qui, grand ami du statu quo, le leur a refusé.
Je paie cette anecdote par l’histoire de Rosenfeld, si connue à Berlin. Vers 1760, Rosenfeld, beau jeune homme, ressemblant aux figures du Christ peintes par Luccas Cranagh, se mit à prêcher qu’il était le vrai Messie ; que Jésus-Christ n’avait été qu’un faux prophète ; mais qu’en revanche le roi Frédéric-le-Grand était Satan. Dans le pays de l’imagination et des rêveries, Rosenfeld se vit bientôt suivi de nombreux adhérents ; il choisit sept jeunes filles fort belles, et persuada à leurs parents de les lui livrer. Son objet était, disait-il, de lever les sept sceaux dont parle l’Apocalypse. En attendant le succès de cette grande opération, Rosenfeld vivait en fort bonne intelligence avec ses sept femmes. Six étaient occupées à filer de la laine, et il vivait honnêtement du produit de cette petite industrie ; la septième, désignée tous les mois par le sort, était chargée du soin de sa personne. Au bout de dix à douze ans de cette vie tranquille, toujours prêchant, un de ses partisans auquel il avait promis des miracles, las d’attendre, le dénonça à Frédéric. Ce qui amusa le Roi, c’est que cet homme ne doutait nullement que Rosenfeld ne fût le Christ ; mais il croyait aussi que Frédéric étant Satan, autre autorité constituée, aurait le pouvoir de forcer le Messie à opérer les miracles promis. Frédéric envoya le Messie en prison jusqu’à l’accomplissement des prodiges.
Les premiers personnages du Paradis n’agissent jamais en Italie ; l’inquisition se fâcherait : mais tous les quatre ou cinq ans, dans quelque village écarté, quelque Madone tourne les yeux ou fait un signe de tête ; ce qui produit le miracle d’enrichir le cabaretier voisin. Toutefois les prêtres de Notre-Dame de Lorette persécutent ces Madones de campagne.
Dans le pays de la sensation, il faut un miracle visible. Quelque Madone, figure céleste copiée du Guide, tourne les yeux, et un pauvre qui jouait l’estropié depuis un an, moyennant une écuelle de soupe et une bouteille de vin chaque jour, est guéri devant des milliers de témoins. C’est ordinairement deux mois après qu’on a commencé à parler de la Madone qu’arrive la guérison miraculeuse. Dans le pays de la rêverie et du raisonnement creux, il y a prédication par un nouveau Messie, ou guérison par S.A. Mgr le prince de H ***, sans prodige visible.
11 janvier. – Nous avons trouvé ce soir neuf Anglais chez le cardinal : sept étaient muets ; les deux autres ont parlé pour tous. Ils accablaient d’injures les Italiens et Bonaparte. Entre autres belles choses, ils disaient que l’invasion démoralisante de 1796 arrêta la civilisation de l’Italie, dont le duc de Parme et l’Autriche allaient s’occuper sérieusement. L’un d’eux a beaucoup loué la littérature italienne pour avoir l’occasion de rabaisser celle des Français. Ces deux hommes formaient spectacle pour le cardinal et sa cour. Son Éminence a dit, en parlant d’eux : Je ne vis jamais tant de gravité et si peu de logique. Je vois que depuis le fameux manquement de foi de la nation anglaise envers les Gênois (proclamation signée Bentink), la vertu anglaise passe ici pour de la pure tartuferie.
Le prélat, mon ami, me dit : Je compare le peuple anglais à un homme qui a un défaut dans l’épine dorsale. Il est un peu bossu ; ce vice de conformation a longtemps contrarié sa croissance, mais à la fin, malgré cette difformité, quelques-uns de ses membres ont acquis un état de santé florissant, et tel qu’on ne le trouve encore chez aucun peuple de l’Europe. Si la Charte française est mise en pratique, vers 1840 vous serez un joli petit jeune homme de quinze ans assez bien pris dans sa taille, et l’Angleterre un puissant bossu de trente ans, énergique et très fort, malgré sa difformité. – Vers 1840, l’Amérique, ce pamphlet constant contre les abus, aura réformé l’aristocratie, les substitutions et les évêques qui ravallent tellement le cœur du peuple anglais, qu’il faut encore des coups de bâton à leurs soldats.
– Vous oubliez que les évêques ont persécuté Locke, et que l’étude de toute logique est sévèrement prohibée, et avec raison, par l’opinion aristocratique. On n’étudie à Oxford que la quantité des mots grecs qui entrent dans le vers sapbique.
– Si vous dites ici, en parlant de quelqu’un : C’est un homme d’esprit, tout le monde s’attend à des actions et non à des paroles. A-t-il gagné deux millions depuis six mois ? Quoique déjà d’un âge mûr, a-t-il fait la conquête de la plus jolie femme du pays ? L’esprit amusant est flétri du nom de bavardage (è un chiacherone). Le mécanisme social qui a produit cette opinion est bien simple. Si cet esprit avait quelque profondeur, l’homme d’esprit irait mourir au château de San-Leo, dans l’Apennin, à cinquante milles d’ici, où jadis l’on étouffa Cagliostro. Les passants entendirent ses cris de la route, à deux cents pas du château-fort. L’esprit sans profondeur ne peut être que de la satire plus ou moins aimable. Or, les gens qui gagnent des millions ou de jolies femmes, et qui étant heureux sont, après tout, ceux aux dépens desquels l’esprit plaisant pourrait s’exercer, s’entendent pour décréditer le plaisant et ne plus l’inviter. Pour avoir des mots heureux, il faut beaucoup parler : voyez les gens d’esprit de Paris. Ici, personne ne veut beaucoup écouter ; qui aurait l’esprit de briller, l’emploie à conquérir.
Un de ces soirs, Frascobaldi me dit en sortant de chez madame Pinalverde :
« Demain, je n’irai pas dîner avec vous à San Michele (c’est une auberge) ; aujourd’hui j’ai été plaisant, j’ai dit de bons mots en parlant à don Paolo, cela pourrait me faire remarquer. »
Comparez cette manière de voir à celle d’un Français de trente-six ans, et millionnaire. Ajoutez à ces qualités que Frascobaldi n’est rien moins que sot ou timide ; né avec 1,200 fr. de rente, il a fait sa fortune en cet heureux pays, et le connaît parfaitement. Ne vaut-il pas mieux, pour qui aime les curiosités morales, voyager en Italie qu’aux îles de la Cochinchine ou dans l’état de Cincinati ? L’homme sauvage ou peu raffiné ne nous apprend sur le cœur humain que des vérités générales qui, depuis longtemps, ne sont plus méconnues que par des sots ou des jésuites. Le mot de Frascobaldi m’a éclairé sur mon bonheur ; à cause de ce mot, je ne me suis pas impatienté en trouvant encore aujourd’hui sur la poussière des marbres de ma chambre, des mots que j’y ai tracés il y a trois jours.
Je flânais avec ce même Frascobaldi sous le long portique qui borde au midi la place de St.-Pétrone, c’est le boulevard de Cologne. Je dis, en regardant certaines estampes : Mon Dieu que c’est mauvais !
« Ah ! que vous êtes bien de votre pays ! me répond Frascobaldi, qui ce jour-là était d’humeur parlante et raisonnante, chose rare ; ces estampes se vendent six paules (3 f. 18 c.), elles sont pour des gens grossiers ; voulez-vous que tout le monde ait autant de tact que nous ? Si toute la terre était couverte de hautes montagnes, comme le mont Blanc, elle ne serait qu’une plaine. Dans tous les genres, vous autres Français, vous vous fâchez de ce qui est déplaisant, et prenez la peine de faire des épigrammes, nous, nous avons l’habitude de détourner la tête ; et cette habitude est si rapide, qu’on peut dire que nous n’apercevons même pas la grossièreté d’un fat ; c’est que nous avons l’âme plus délicate que vous. La vue un peu intime d’un sot m’empoisonne jusqu’à la révolution morale qui suit le prochain repas ; mais à vous autres la vue du sot vous est nécessaire pour débiter vos épigrammes. Tanto meglio per voi, ajoute-t-il d’un air froid, toute l’Europe dit que vous avez plus d’esprit que nous. »
Hier, Frascobaldi me dit : « Nous avons l’habitude, dans la rue, de ne jamais regarder un passant plus haut que la poitrine : on trouve tant de perversité et de sottise dans les yeux de l’homme ! Pour moi, je ne remonte jusqu’à la figure d’un inconnu, que si je vois sur son habit la couronne de fer. »
Je lui fis exprès l’éloge d’un beau parleur ; à la fin il me répondit : « Si cet homme a quelque esprit (qualche talento), comment n’a-t-il pas une jolie maîtresse ? ou pourquoi ne fait-il pas des affaires avec le gouvernement, de manière à gagner trente mille scudi par an (159,300 f.) ? De tels gains sont possibles con questi matti di preti. »
L’emploi, fort rare, de briller dans la société, est réservé à quelques vieillards aimables ; comme ils n’ont plus d’intérêts actifs, les gens dont ils se moquent ne peuvent leur nuire ; d’ailleurs leur esprit est beaucoup moins satirique, comme Voltaire, que brillant par l’imagination et les contes singuliers, comme l’Arioste.
Faire de la satire parlée aux dépens du gouvernement, est du plus mauvais ton en Italie ; chez le bourgeois cela passe pour dangereux, et l’est en effet ; parmi les nobles, que la police n’ose attaquer, on trouve qu’il y a de la sottise à exciter chez les auditeurs de la haine impuissante, c’est-à-dire un sentiment malheureux. On se dit dans tous les genres : Jouissons de la vie telle qu’elle est, ou plutôt on a cette habitude, et l’on n’en parle pas ; d’ailleurs, il serait assez dans le génie de la société italienne, de placer le beau parleur dans un dilemme fâcheux : « Puisque vous parlez si bien, agissez ; « il y a demain telle occasion d’agir. »
Dans un pays où la vengeance a été une passion généralement répandue, jusque vers la fin du dix-septième siècle, époque où la fermeté des caractères est tombée si bas, qu’elle ne peut plus atteindre même à la vengeance, rien n’est plus méprisé que les paroles menaçantes. Il n’y a pas de duel, et la menace ne conduit à rien qu’à mettre tout au plus votre ennemi sur ses gardes.
La société de Bologne a beaucoup plus le ton du grand monde que celle de Milan ; on se voit dans de beaucoup plus grands salons. Elle est beaucoup plus liée avec le gouvernement. Le cardinal légat entre dans le salon de M. Degli Antonj, parle, s’échappe, sans qu’on fasse plus d’attention à lui qu’à tout autre.
Je ne décrirai pas, qui pourrait la décrire ? mais je noterai, pour ne pas en oublier la date, la divine soirée que nous venons de passer chez madame M ***. Nous avons lu Parisina, nouveau poème de lord Byron, qu’un aimable Anglais a envoyé de Livourne à la maîtresse de la maison. Quelle sensation ! quelle fraîcheur de coloris ! Vers le milieu du poème, à la strophe
nous avons été obligés de cesser de lire, exactement à cause de l’excès et de la fatigue du plaisir. Nos cœurs étaient si pleins, qu’être attentif à quelque chose de nouveau, quelque beau qu’il fût, devenait un effort trop pénible, nous aimions mieux rêver au sentiment qui nous occupait.
Après avoir essayé en vain de parler d’autre chose, et un assez long silence, nous sommes revenus aux morceaux moins passionnés du poème. Quelle description de ce moment si doux en Italie, qu’on appelle l’Ave Maria ! Le jour finissant, toutes les cloches se mettent à sonner l’Angélus ; le travail cesse et le plaisir commence.
Je puis jurer que je n’ai pas surpris pendant trois heures la moindre affectation, ni surtout la moindre exagération : on avait plutôt l’air froid. On restait dans le silence, mais parce que le sentiment excédait toute parole. Nous étions onze, trois n’entendaient pas assez l’anglais. Je me suis bien gardé de hasarder aucune critique, d’abord pour moi, j’aimais mieux sentir ; et puis ma réflexion aurait offensé comme un son faux ; mais, à mon avis, le goût italien aurait supporté et par conséquent désiré le développement de la naissance de la passion de Parisina pour Hugo.
12 janvier. – J’oubliais le plus essentiel : voici quelle est la position d’un étranger qui débute dans un salon italien : au bout d’une heure, chaque femme a peu à peu formé son groupe, et cause avec l’homme qu’elle préfère, et deux ou trois amis qui ne songent pas à troubler leurs relations. Les femmes âgées, ou qui ont l’humiliation de ne pas avoir d’amant, sont au jeu. Le pauvre étranger est réduit à la société des amants en butte à la colère des maris, et qui se tiennent au milieu du salon, cherchant à masquer par quelque apparence de conversation les coups d’œil qu’ils échangent de loin avec la femme qu’ils aiment. Chacun s’occupe de soi, et si l’on songe au voisin, c’est pour s’en méfier et le regarder presque comme un ennemi. Quelquefois le groupe de madame A. entre en commerce de plaisanteries avec le groupe de madame B. ; mais là encore il n’y a point de place pour l’étranger. Les loges de Milan lui sont bien plus favorables ; la conversation y est générale, et l’étranger, assis dans l’obscurité, n’est point embarrassé de la figure qu’il fait.
Beaucoup de Français, outrés du rôle que leur vanité a joué dans un salon italien, prennent la poste le lendemain, et toute leur vie décrient la société de ce pays avec la perfidie de l’amour-propre offensé. Ils ne veulent pas comprendre que le marché à la vanité n’est pas ouvert en Italie. On demande le bonheur aux émotions, et non pas aux mots piquants, aux contes agréables, aux aventures plaisantes. Qu’ils aillent, lire des sonnets dans quelque académie, et ils verront avec quelle politesse on y applaudit l’auteur des plus mauvais vers ; la vanité s’est réfugiée dans son quartier-général, le cœur d’un pédant.
Si je me suis bien expliqué, le lecteur doit voir aussi clairement que moi pourquoi il n’y a pas de place pour l’esprit français dans un salon italien. La rêverie n’y est pas rare, et l’on sait que la rêverie ne répond pas même à la meilleure plaisanterie ou au conte le plus piquant. J’ai cent fois observé que l’italien voit plutôt dans un conte ce qu’il prouve, la lumière qu’il jette sur les profondeurs du cœur humain, que la position plaisante dans laquelle il met un personnage, et le rire qu’il doit faire naître. Si l’on voyait les cœurs, l’on trouverait ici plus souvent le bonheur que le plaisir, l’on verrait que l’italien vit par son âme beaucoup plus que par son esprit. Or, c’est à l’esprit que peut plaire un voyageur arrivé de Paris depuis deux jours.
Réunissez trente indifférents dans un salon, si vous voulez qu’ils s’amusent et que même ils forment un spectacle agréable pour un étranger, il faut absolument que ces indifférents soient de Paris ou des départements voisins.
Le bon prince Léopold de Toscane (1780), si vanté par nos philosophes, qui en faisaient un repoussoir (terme de paysagiste), avait un espion dans chaque famille ; que sera-ce des […] actuels qui ont plus de peur de perdre leur place, que le moindre préfet ? (Comptez les milliers de prisonniers renfermés dans les petites îles voisines de la Sicile, ou chargés de fers à Venise et dans les forteresses de l’Autriche ; total trente mille, dit M. Angeloni.)
L’Anglais, placé à côté d’hommes qui ne lui ont pas été présentés, se gardera d’ouvrir la bouche, son voisin est probablement d’une caste différente de la sienne ; et quel désagrément si, de retour sur le pavé de Londres, ce voisin allait lui adresser la parole ! J’ai souvent observé que les regards des voisins torturent la timidité anglaise ; une femme vient d’Edimbourg à Londres sans oser descendre de voiture.
En France, depuis la société de la […], par laquelle un pied-plat tutoie un nom historique, il n’est pas trop sûr de faire l’aimable avec des inconnus ; outre les dangers sérieux, vous pouvez entendre dire d’une proposition que vous venez d’avancer : Il n’y a qu’un scélérat de jacobin ; ou bien : Il n’y a qu’un infâme jésuite qui puisse dire que……
Dans l’état actuel de l’Europe, j’en appelle aux personnes qui ont voyagé, les Allemands sont peut-être le peuple chez lequel trente indifférents réunis bavardent avec le moins de méfiance et le plus de cordialité ; bien entendu qu’il ne faut pas demander à des Allemands l’esprit et l’agrément que portent dans la conversation des Français bien élevés et déjà un peu guéris de la fatuité par l’arrivée de six ou sept lustres. Jadis, à Paris, l’homme du grand monde n’avait le loisir d’être ému de rien. Le manque total de cette sécurité qu’on trouve en France depuis si longtemps, a donné un caractère opposé à la société italienne : l’individu vivant d’émotions, la société est beaucoup moins étendue, elle prend moins de temps et d’attention dans la vie de chacun. Galilée fut mis en prison en 1633, Gianonne y mourut en 1758 ; combien d’autres, moins célèbres, ont péri dans d’affreux cachots ! Les prisons et l’espionnage faisant de la conversation le plus dangereux des plaisirs, l’habitude s’en est perdue, et la vanité, qui a besoin de suffrages nombreux et répétés, n’a pu naître. À quoi bon à Bologne l’influence sur les autres ? Daignez suivre un instant la vie de tous les Français remarquables par cet esprit qui est compris des contemporains ; elle fut aventureuse ; Beaumarchais a dit : ma vie est un combat ; Voltaire, Descartes, Bayle, livrèrent des batailles morales, non sans péril. En Italie, ils eussent été engloutis bien vite par les cachots des petits princes.
Peut-être aussi que, même avec un degré tolérable de sécurité, l’énergie que les autres passions ont sous ce climat, eût empêché la vanité de prendre l’accroissement gigantesque que nous lui voyons en Angleterre et en France. L’Italien qui, à deux heures sonnantes, se hâte d’aller passer sous les fenêtres de la femme qu’il aime, parce qu’il sait que quelquefois à cette heure son mari monte à cheval, est capable de se présenter à elle avec un jabot qui va mal ; elle ne s’en apercevra pas. Mais, il y a plus, en courant vers cette porte qu’il tremble de trouver fermée, peu importe à l’italien de rencontrer des personnes de la société qui diront : Mon Dieu ! de quoi M. un tel a-t-il l’air ? Il aura passé trois heures dans sa chambre à rêver à la femme qu’il aime, au lieu d’arranger son jabot. La vanité disparaît quelquefois en ce pays pendant plusieurs heures de suite, récit qui doit paraître extravagant à un peuple chez qui sa plus longue éclipse ne dure pas dix minutes. Il est sûr que le climat seul de l’Italie produit sur l’étranger qui arrive un effet nerveux et inexplicable. Lorsque le corps d’armée du maréchal Marmont, qui était embarqué au Texel, après avoir traversé l’Allemagne en 1806, arriva dans le Frioul vénitien, une âme nouvelle sembla s’emparer de ces quinze mille Français ; les caractères les plus moroses parurent adoucis, tout le monde était heureux ; dans les âmes, le printemps avait succédé à l’hiver.
L’Italien pour qui la société générale et les jouissances de salon sont impossibles, ne porte que plus de feu et de dévouement dans ses relations particulières ; mais il faut avouer que le voyageur français que j’ai laissé debout au milieu du salon de M. le sénateur de Bologne, est en dehors de ces sociétés particulières. L’étranger n’est quelque chose ici que quand il a pu parvenir à exciter la curiosité.
Les premiers jours après mon arrivée, quand M. le cardinal légat ne me faisait pas l’honneur de m’interroger, et que l’ami qui me menait dans le monde m’avait quitté pour aller causer avec sa maîtresse, la ressource ordinaire de mon désœuvrement était de m’asseoir près d’un beau tableau, que je me mettais à regarder comme si j’eusse été dans un musée. Cette occupation innocente m’a un peu lié avec un jeune homme de vingt-six ans de la plus noble figure : c’est l’image de la force et du courage, et il a des yeux qui peignent le malheur le plus tendre. Il y a trois mois que le comte Albareze eut des doutes sur la fidélité de sa maîtresse qui, vivant d’ailleurs fort bien avec lui, se rendait tous les jeudis, lui dit un espion, dans une certaine maison écartée. Albareze feint de partir pour la campagne le dimanche, et va se placer au premier étage de cette maison, dans une chambre inhabitée dont il ouvre la porte avec un crochet. Là il se tient tranquille quatre jours, sans sortir, sans ouvrir la porte, sans faire le moindre bruit, vivant frugalement de quelques provisions apportées dans sa poche, lisant Pétrarque et faisant des sonnets. Il observe, sans être soupçonné, tous les habitants de la maison. Enfin le jeudi, à onze heure du matin, il a la douleur de voir arriver sa maîtresse, qui monte au second étage ; lui, sort de sa cachette, monte après elle, et arrive à la porte de la chambre où elle venait d’entrer, il entend la voix de son rival, qui était arrivé, à ce qu’on présume, par le toit d’une maison voisine donnant dans une autre rue. Lorsque, quelques heures après, sa maîtresse sortit de la chambre fatale, elle trouva Albareze évanoui sur le seuil ; on ne put le rappeler à la vie qu’après beaucoup d’efforts. Il fallut le transporter chez lui, où il resta à peu près fou pendant un mois. Tous ses amis venaient le consoler de son malheur, qui fait encore la nouvelle de la ville. J’ai remarqué qu’on ne blâme la dame que du manque de franchise ; l’idée d’un duel avec le rival heureux ne s’est peut-être pas présentée à une seule personne dans tout Bologne. En effet, 1° le rival n’a fait que son métier ; 2° le duel, où le plaignant peut être tué, est une pauvre manière de se venger dans un pays où il n’y a pas cent ans qu’on employait une méthode plus sûre.
13 janvier. – Un brave libéral de ce pays-ci, que je ne connaissais pas il y a huit jours, me donne le moyen de me débarrasser de toutes mes notes, qui étaient une source d’inquiétudes (inquiétudes qui sembleront bien ridicules à MM. les voyageurs de Paris à Saint-Cloud.)





























