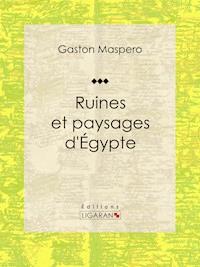
Extrait : "Le ciel est gris, des traînées de brume mélancolique flottent sur les berges, une tache jaunâtre marque par intervalles la place où le soleil devrait briller ; est-ce bien l'Égypte, et qu'a-t-elle fait de sa lumière, depuis treize ans que je l'ai quittée ? On grelotte sur le Nil, et le pont du bateau serait bientôt inhabitable, si l'on ne se résignait à endosser un paletot d'hiver."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335033410
©Ligaran 2015
J’ai passé jusqu’à présent seize années de ma vie en Égypte, comme chef du Service des Antiquités, et, chaque hiver, ma fonction m’a commandé d’inspecter les monuments. De 1881 à 1886, pendant mon premier séjour, je disposais d’un bateau à vapeur, le MENCHIEH, plus connu des riverains sous le nom de NIMRO HADACHERE, le n° 11. C’était une galiote plate, armée d’une machine à qui son type archaïque aurait mérité une place au Musée des Arts et Métiers. Elle avait fait la navette régulièrement deux fois par mois entre Alexandrie et le Caire, de 1840 à 1860, puis, réformée pour cause de vieillesse, elle avait été remise à neuf en l’honneur du prince Napoléon, lorsque celui-ci visita l’Égypte en 1863. Donnée à Mariette en 1875, après de longs repos à l’Arsenal, j’avais hérité d’elle et jel’avais habitée cinq années durant, mais mes successeurs ne surent point la conserver, et, à mon retour, je trouvai à sa place une vieille dahabièh princière, la MIRIAM, de laquelle je me suis accommodé depuis lors. Au début de la campagne, vers le milieu de décembre, je la remorque d’une seule traite jusqu’à l’extrême limite de sa course, Assouân ou Ouadi-Halfah, et de là je m’abandonne au fil de l’eau, secondé quelquefois par le vent, le plus souvent combattu par lui et luttant à la rame jour après jour, afin de gagner quelques kilomètres. Cette façon de naviguer, qui n’est plus beaucoup au goût des touristes, n’offre guère que des avantages pour le Directeur des Antiquités : elle lui fournit l’occasion d’explorer des sites secondaires où personne ne s’arrête volontairement, et qu’il n’aurait pas songé lui-même à visiter, si l’impossibilité d’avancer contre la bourrasque ne l’avait pas contraint à relâcher dans le voisinage. J’ai rapporté, quant à moi, de ces stations imprévues, outre plusieurs monuments qui ne font pas mauvaise figure au Musée, des impressions d’Égypte moderne qui m’ont aidé à mieux comprendre l’Égypte ancienne. Je les ai notées au jour le jour, sans m’inquiéter d’autre chose que de bien exprimer ce que j’éprouvais ou ce que je voyais, et, depuis 1900, j’ai publié chaque année dans le journal le TEMPS celles d’entre elles qui meparaissaient de nature à intéresser les égyptologues sans trop rebuter le grand public. Lorsqu’il y en eut plus d’une vingtaine d’articles, l’éditeur qui publia naguère les CAUSERIES D’ÉGYPTE, M. Guilmotoy me proposa de les réunir en volume. L’offre m’agréait trop pour que j’eusse le courage de la refuser : j’obtins le consentement de M. Hébrard pour les articles du TEMPS, puis je joignis à ceux-ci quelques morceaux extraits de la GRANDE REVUE et de la REVUE D’ORIENT. M’est-il permis d’espérer que ceux des lecteurs qui auront déjà vu le pays le reconnaîtront dans ce livre, et que ceux qui ne l’ont pas vu encore y puiseront le désir de le connaître ?
Bibéh, le 25 février 1940.
G. MASPERO.
Bibéh, le 14 décembre 1899.
Le ciel est gris, des traînées de brume mélancolique flottent sur les berges, une tache jaunâtre marque par intervalles la place où le soleil devrait briller ; est-ce bien l’Égypte, et qu’a-t-elle fait de sa lumière, depuis treize ans que je l’ai quittée ? On grelotte sur le Nil, et le pont du bateau serait bientôt inhabitable, si l’on ne se résignait à endosser un paletot d’hiver. Je sortis du Caire avant-hier, fort incertain de mes impressions et assez inquiet de savoir si l’aspect du fleuve et de ses rives avait changé autant que le climat. Il semblait naguère qu’en perdant de vue les derniers minarets de la citadelle on dit adieu au siècle présent. Quelques cheminées d’usines se dressaient çà et là parmi les palmiers, ou l’un des bateaux de Cook filait à grand bruit emportant sa cargaison de touristes, mais ces derniers accidents de civilisation s’effaçaient vite à l’horizon, et, les Pyramides aidant, qu’on longeait pendant deux jours, on éprouvait bientôt la sensation d’un départ pour un coin de monde antique attardé au milieu de notre monde. C’était une Égypte du passé qu’on parcourait entre le Caire et Philæ, non pas une Égypte d’époque précise, mais un pays d’âge et de couleur mal définis, qui tenait plus des Pharaons en certains endroits, des Turcs ou des mamelouks en certaine autres, si bien que chacun, selon la nature de ses études ou la tournure de son imagination, pouvait se figurer qu’il partait en visite chez le Pharaon Sésostris ou chez les sultans des Mille et une Nuits. Voici trois jours que les paysages d’autrefois défilent de nouveau sous mes yeux. Si j’en reconnais les lignes et les masses principales, quelque chose s’y manifeste en plus qu’ils ne renfermaient pas auparavant et qui en a modifié le caractère : la vie industrielle s’est emparée d’eux et elle travaille à les transformer obscurément.
Le changement est sensible, sitôt qu’on a démarré du pont de Kasr-en-Nil. Le fond du tableau est demeuré le même, l’île verte de Rodah, ses bouquets d’arbres et son nilomètre bariolé à la pointe méridionale, puis les masures pittoresques du Vieux-Caire, la jolie mosquée d’Atar-en-Nabi, campée si hardiment sur son promontoire, les hauts monticules de décombres que couronnent les moulins à vent de l’occupation française, et, à mesure qu’on s’éloigne, le panorama de la citadelle se lève et se maintient une heure durant ; mais partout sur la rive les bâtisses neuves se succèdent presque jusqu’à Hélouan en face du site de Memphis, les casernes s’échelonnent, les cheminées fument, et dès la tombée de la nuit les lampes électriques s’allument de droite et de gauche. On devait s’attendre à ce que le Caire, en s’enrichissant, suscitât des faubourgs, ainsi qu’il arrive à toutes les grandes capitales, et il faut remercier la fortune qui a voulu que l’outillage des industries modernes s’implantât dans ces beaux sites sans trop les défigurer. Au-delà d’Hélouan et de Bédréchéin, si l’on suit avec attention la fuite des berges, les modifications, pour s’afficher moins fréquentes que dans la banlieue immédiate, ne sont pas moins réelles. Du côté libyque, la digue côtière, qui jadis se déployait en courbes désordonnées et se brisait par endroits sans que personne songeât à en rectifier les caprices, court désormais d’une allure sage et soutenue, sans brèches ni dentelures à la crêté. Des bornes en fer, plantées régulièrement d’espace en espace, en jalonnent le trajet et permettent de la rétablir dans sa direction première lorsqu’un assaut plus violent de la crue l’entame par hasard : on a, grâce à cette stabilité, gagné définitivement à la culture des terrains qui menaçaient à chaque instant de devenir la proie du Nil, et j’ai trouvé près de Bédréchéin un champ de dourah en plein rapport à l’endroit même où j’avais flotté naguères sur deux ou trois mètres d’eau. Du côté de l’Arabie, le progrès n’est pas moins sérieux, et je me suis étonné d’abord de voir de la verdure et des groupes de maisons bien bâties, où ma mémoire s’obstinait à me représenter le jaune ininterrompu du sable et des amas de cahutes misérables : d’Atfiéh jusqu’à Bibéh, pendant une journée entière, j’ai cessé presque complètement d’observer l’autre rive pour concentrer mon attention sur celle-ci.
Lors de mon premier séjour, elle continuait encore à peu près telle que les savants français l’avaient décrite à la fin du siècle passé. Bien que la montagne s’éloigne parfois à grande distance vers l’intérieur, la région utilisée était en général étroite et inégalement défrichée, faute d’eau en quantité suffisante. Deux ou trois tronçons de canaux l’arrosaient çà et là, et dans les endroits où l’on apercevait un peu de verdure, la chadouf ou la sakiéh fournissaient seules aux besoins des paysans au prix d’un travail opiniâtre. Presque partout le sable ou la lande arrivaient jusqu’au bord même du courant ; quelques villages, pétris de boue, s’espaçaient aux meilleures places ; un santon ou un couvent délabré de moines coptes s’intercalaient à de longs intervalles. Les rares tentatives ébauchées sous Méhémet Ali, puis sous Ismaïl pacha, pour ranimer cette terre agonisante avaient échoué, et il semblait que l’Égypte fût à peu près morte de ce côté-là de son fleuve. Elle sort aujourd’hui de sa longue défaillance, et rien n’est plus curieux que d’y noter à la volée tous les signes de la vie qui se réveille. Au sortir de la passe tortueuse où l’insuffisance de la crue oblige le courant à circuler au sud du bourg de Karimât, un couvent ruiné à demi, le Déîr Mêmoun, ralliait jadis autour de ses murailles quelques douzaines de fellahs, les seuls êtres humains, avec les moines, qui s’obstinassent à ne pas abandonner ces parages : une vingtaine de palmiers mal soignés abritaient leurs paillotes, et leurs chétifs carrés de fèves ou de dourah posaient à peine une ombre verdâtre sur les premiers plans du paysage. Aujourd’hui, le couvent a réparé son enceinte ; des maisons de pierre se sont groupées auprès de lui, les palmiers se sont multipliés et déjà ils forment un petit bois, les champs ont empiété largement sur le désert, et le mouvement de bestiaux et de baudets qui règne aux alentours trahit la présence d’une population laborieuse et aisée. Six ou huit hameaux ont poussé dans l’espace vide qui s’étendait entre Déîr-el-Mêmoun et El Marazi, et les colons, émigrés en partie de l’autre bord, conquièrent peu à peu ces solitudes. La chadouf tirée à main d’homme n’a pas renoncé encore à monter l’eau d’un effort rythmique, mais partout à côté d’elle, des pompes à vapeur installées à demeure ou des locomobiles qu’on déplace selon les nécessités du moment la suppléent et tendent à la remplacer. La canne à sucre gagne de proche en proche, puis la dourah, le blé, les fèves, et sur le limon que la crue découvre, les légumes aimés de l’indigène, le lupin, l’oignon, la mauve, le concombre, la pastèque. La plupart des villages neufs sont en pierre taillée, et l’accroissement inespéré des constructions a exigé l’ouverture de carrières nombreuses dans tous les endroits où la falaise serre le fleuve d’assez près pour rendre l’exploitation aisée. De temps à autre, les hangars et les tuyaux d’une usine naissante, puis une grande ferme flanquée d’un rudiment de jardin, puis des bouquets de dattiers en bas âge, puis des paquets de barques amarrées à un débarcadère en attendant leur chargement : l’une d’elles, près du Déîr-el-Bayâd, portait une locomobile toute neuve, et les matelots de l’équipage se hâtaient de mettre une autre locomobile en batterie sur la berge, en avant d’un champ de canne en pleine croissance.
Rôdah, le 17 décembre 1899.
Le soleil a reparu et l’Égypte s’est retrouvée. La douceur de l’air et la beauté du ciel invitent le regard et l’esprit à la contemplation paresseuse ou à la méditation somnolente : il faut un effort réel pour reprendre l’étude de la rive droite et pour me décider à enregistrer ce qu’elle me révèle d’imprévu. D’abord, au-delà de Bibéh, il me semble que l’activité s’alanguit et que les sites sont confinés partout dans leur immobilité d’autrefois : l’industrie s’est reportée sur la gauche, dans les domaines et dans les usines de la Daïrah Sanièh. Les pentes rugueuses du Gébel Ghéikh Embarek se rapprochent si fort de nous qu’elles excluent toute possibilité d’irrigation par les machines, et les rubans d’alluvions sans largeur qui s’étirent à leurs pieds sont arrosés et cultivés à la vieille mode. Mais au-delà de Charronah, un changement à vue se produit. Une large traînée verte surgit et se continue des kilomètres durant, où je me rappelais une plaine poudreuse, parsemée maigrement de palmiers malheureux et de champs étriqués, bornée, vers le sud, par les cheminées toujours éteintes de Chéîkh-Fadl. L’usine, fondée aux beaux temps d’Ismaïl pacha, n’avait jamais été terminée. Le sable s’accumulait au pied de ses murs imparfaits ; des tuyaux de fonte et des ferrailles de machinerie gisaient sur le sol, abandonnés avant d’avoir servi. À présent les cultures et les plantations de jeunes arbres alternent presque à partir de Charronah, des pompes à vapeur distribuent l’eau régulièrement derrière les digues, des voies ferrées sillonnent la plaine, et au moment de notre passage, plusieurs locomotives manœuvrent sur le quai à ranger des wagons de canne à sucre. Des barques encombrées autant que tes trains s’alignent contre la berge et hâtent leur déchargement ; trois canots à vapeur attendent sous pression qu’elles aient fini de se vider pour s’atteler à elles et les remorquer, une douzaine à la fois, aux villages où elles prendront une cargaison nouvelle. Tout cela se fait rapidement, au milieu de ce bruit assourdissant sans lequel il n’y a point de bonne besogne en ce pays : les matelots hurlent après les portefaix et ceux-ci leur répondent sur un diapason plus suraigu, les cheminées ronflent, les locomotives soufflent et sifflent, les ânes braient d’un accord commun. L’usine elle-même est devenue méconnaissable : ses ateliers se sont achevés, et des constructions fort propres sont sorties de terre à leur suite. C’est d’abord une très belle maison, qui semble être celle du directeur. Puis une sorte de porte triomphale de style mauresque ouvre son ogive en fer à cheval, encadrée d’inscriptions arabes tracées au noir sur un fond rouge et blanc ; elle précède des bâtiments en briques cuites, dont on ne saisit pas bien la destination du fleuve. Plus bas, un édifice long, à deux rangs d’arcades superposés, contient des magasins au rez-de-chaussée, à l’étage supérieur, des logements avec balcon réservés aux employés ; on dirait le siège social d’une société coopérative. Je déchiffre à la hâte plusieurs enseignes : Épicerie et café, tabacs, etc., le tout en français. C’est, en effet, un ingénieur français, M. Mahoudeau, qui a monté cette immense machine et tiré ce canton de sa torpeur, pour le compte de la Compagnie Say-Suarès ; ce n’est pas une satisfaction médiocre de constater quelle part nos compatriotes ont prise à la rédemption du pays.
N’est-ce là qu’une devanture, derrière laquelle la misère ancienne sévit aussi poignante toujours, et que revient-il au fellah de toute cette richesse ? Par-delà Chéîkh-Fadl, le paysage reprend sa physionomie d’autrefois et ne paraît qu’à peine effleuré par l’activité moderne. Le Déîr-el-Bakara a reblanchi les dômes de ses églises et taillé des rampes commodes sur la face de sa falaise, au lieu des escaliers en casse-cou par lesquels ses moines nus dévalaient afin d’aller mendier à bord des dahabiéhs. La région des tombes antiques qui commence par le travers de Miniéh n’a rien adouci de sa sauvagerie primitive : seulement les maçons et les fellahs de l’autre rive se sont attaqués partout à la montagne, et ils la déchiquètent plus qu’ils ne l’exploitent en carrière. Le changement ne paraît plus qu’aux endroits où la Compagnie Cook amarre ses chalands pour la promenade aux tombes de Béni-Hassan ; les maisons y sont plus soignées, les habitants s’y habillent plus proprement et la demande du bakhschîsch y retentit universelle.
Le 20 janvier 1904, par le travers du Gébel-Abou-Fédà.
Ce matin, dès que les premiers rayons du soleil ont effleuré le Nil, le brouillard s’est levé. Des famées blanches se sont mises à courir sur l’eau : en moins de dix minutes elles nous ont enveloppés et nous avons dû jeter l’ancre en plein courant. Ce n’est pas notre brume d’Europe épaisse et lourde, qui éteint le jour et qui assourdit les sons. C’est une fabrique aérienne et fluide, un flot de mousselines presque transparentes que la lumière imprègne de tons argentés et où tous les bruits filtrent affaiblis à peine. La vie continue autour de nous, mais invisible, et on l’entend sans plus savoir où elle est. Un âne braie quelque part, un coq claironne dans un chœur de poules caquetantes, un tumulte de querelle éclate sur une des barques voisines, une caille rappelle et, tout au loin, vers le Sud, le gros vapeur qui nous rencontra dès l’aube avec sa charge de touristes, siffle désespérément pour écarter les bateaux de sa route. Par moments, le rideau se fend et un coin de paysage s’ébauche flottant au hasard, mais le soleil, s’insinuant aussitôt par l’ouverture, fouette l’eau encore froide et en fait jaillir des vapeurs qui nous engloutissent de nouveau. Au bout d’une heure pourtant, un mouvement se propage dans la masse : elle s’atténue, elle s’étire, elle se déchire, elle s’envole par lambeaux qui s’usent et s’évanouissent en un clin d’œil. Le monde reparaît, à moitié perdu dans un chaos de formes tremblotantes qui vont se fixant de seconde en seconde. Cinq femmes émergent sur un éboulis étroit de terre brune, affairées autour de leurs cruches. Une berge surgit derrière elles et monte rapidement par échelons de verdure ; une digue l’arrête, au-dessus de laquelle des aigrettes de palmiers pointent, et bientôt, presque sans intervalle de temps, la ligne des collines se dessine toute rose sur le fond opalin du ciel. Pendant quelques minutes, un reste de buée estompe les contours, accuse les ombres, accentue les reliefs et, frôlant les objets, sépare nettement les plans qu’ils occupent. À mesure qu’il s’évapore, le relief s’amoindrit, les contours se précisent jusqu’à la sécheresse, les distances s’effacent ; il semble que les lointains de l’horizon se jettent en avant et que les plans, avec tous les objets qu’ils renferment se rapprochent jusqu’à se rejoindre et à se superposer l’un au-dessus de l’autre, tels qu’on les voit dans les tableaux qui décorent les murailles des hypogées memphites ou thébains.
Qui, en effet, après avoir navigué sur le Nil deux ou trois jours seulement, ne s’est pas senti amené à constater combien les scènes que les vieux Égyptiens retraçaient sur leurs monuments sont conformes à la nature présente et l’interprètent fidèlement, même dans celles de leurs conventions qui nous semblent le plus éloignées d’elle ? Le brouillard dissipé, la dahabiéh a repris sa course. Les matelots rament vigoureusement en rythmant la nage sur la voix du chanteur :
Fi’r-rodh ra’et – hebbi’l-gamil.
(Dans le jardin j’ai vu – mon ami joli,)
et ils répètent tous à l’unisson, avec une intonation basse et traînante, Hebbi’l-gamîl. Avant même qu’ils se soient tus, le soliste attaque dans les notes hautes le refrain sacramentel, ia lêl, ô nuit ! Il bat le trille, prolonge les sons, les enfle, les étouffe, puis, à bout d’haleine, il arrête la dernière note d’un coup de gosier sec. Il se rengorge dans sa roulade, et, tandis que l’équipage éclate en applaudissements, je regarde à l’aventure le fleuve et les deux rives. Là-bas, bien en ligne sur un banc de sable fauve, une bande de grands vautours se chauffe au soleil ; les pattes écartées, le dos voûté, le cou plié et rencogné dans les épaules, les ailes ramenées en avant de chaque côté de la poitrine, ils reçoivent béatement la large coulée de lumière qui se répand sur leurs plumes et les pénètre de sa tiédeur. C’est ainsi que les vieux sculpteurs représentaient au repos le vautour de Nekhabît, la déesse protectrice des Pharaons et qui les ombrage de ses ailes. Séparez par l’esprit le plus gros de la bande, coiffez-le du pschent ou du bonnet blanc, mettez-lui le sceptre de puissance aux griffes, campez-le de profil sur la touffe de lotus épanouis qui symbolise la Haute-Égypte, vous aurez le bas-relief qui décore un des côtés de la porte principale au temple de Khonsou, mais vous aurez aussi, sous le harnachement, un vautour véritable : la surcharge des attributs religieux n’aura pas supprimé la réalité de l’oiseau. Un aigle pêcheur va et vient à vingt mètres au-dessus de nous en quête de son repas du matin. Il décrit des cercles immenses, en battant l’air lentement, puis soudain il s’abandonne et il glisse appuyé sur ses ailes, le corps suspendu entre elles, les pattes allongées, la tête tendue, interrogeant de l’œil les dessous de l’eau. À le voir filer ainsi, presque immobile, on dirait un épervier des sculptures thébaines, l’Horus qui plane sur le casque du Pharaon dans les batailles ou qui, déployé aux plafonds des temples, domine le trajet de la nef centrale des portes de l’hypostyle à celles du sanctuaire. Qu’il se laisse tomber tout à l’heure et qu’il se relève avec sa proie, il l’emportera du même geste et de la même allure dont l’Horus promenait à travers la mêlée son chasse-mouche mystique et son anneau symbole de l’éternité. Une bande d’ânes qui sort d’un creux derrière la digue, sous un faix de sacs gonflés, pourrait être celle-là même qui servit de modèle aux dessinateurs du tombeau de Ti pour la rentrée des gerbes. Le troupeau mi de moutons et de chèvres, qui suit trotte menu, se découpe d’un profil si précis qu’on le croirait composé uniquement de silhouettes en promenade ; c’est un tableau descendu d’une paroi antique pour aller au marché voisin. Et tandis que les rivages défilent avec leurs épisodes de vie contemporaine, je reconnais animés et de grandeur naturelle les bas-reliefs des hypogées, les bœufs qui se rendent aux champs de leur pas mesuré, le labour, les pêcheurs attelés à leur filet, les charpentiers qui construisent une barque : ils ont installé leurs bers sur une plage en pente, et accroupis dans des attitudes de singes, ils clouent les membrures à force marteaux.
C’est du Nil que les créateurs de l’art égyptien prirent leur point de vue, lorsqu’ils s’ingénièrent à rassembler ces motifs isolés et à les graver harmonieusement dans les chapelles des tombeaux, pour assurer à leurs morts la continuation indéfinie de l’existence terrestre. Ils reléguèrent au bas de la muraille tout ce qui caractérisait la vie sur le fleuve même ou sur les canaux, les convois de bateaux chargés, les joutes de matelots, les scènes de pêche, la chasse aux oiseaux aquatiques. Plus haut, ils rangèrent les saisons de l’année agricole, le labourage, les semailles, les récoltes, le battage, la mise au grenier. Plus haut encore, ce sont les pâturages avec leurs bœufs ruminant à l’aise et par-dessus, touchant presque le plafond, le désert et les battues sur la piste des gazelles. Le panorama s’élargit ou il se resserre selon l’étendue des aires à couvrir, et tous les éléments qui le composent ne se retrouvent pas nécessairement reproduits partout : telle portion est supprimée chez l’un, développée chez l’autre ou amalgamée aux portions voisines, mais ce qui en est conservé se suit de bas en haut dans un ordre constant. Ces variations du thème antique se font et se défont à chaque instant sous mes yeux à mesure que la journée avance. À certains endroits, la rivière est déserte et ses berges sont vides, mais les charrues sillonnent la plaine, et les montagnes versent leurs pentes bises au-dessus d’elle. Un peu plus loin, la montagne s’est abaissée derrière l’horizon, et la plaine apparaît comme une plaque nue, sans végétation et sans habitations visibles. À trois ou quatre kilomètres en amont, le Nil s’anime soudain et de longues théories de bateaux s’y croisent, contrariées ou poussées allègrement par le vent du nord. Partout les plans où la vie circule, au lieu de fuir les uns derrière les autres, semblent s’élever les uns au-dessus des autres, comme dans les œuvres des vieux maîtres. Ceux-ci ont, il est vrai, simplifié à la fois et compliqué les motifs divers qu’ils se plaisaient à réunir. Ils ont presque de règle renoncé à rendre les terrains et ils leur ont substitué une seule ligne droite, sur laquelle les personnages compris dans une même scène se meuvent ou s’appuient. Ils ont exprimé dans les registres du haut des scènes que l’éloignement ne leur permettait pas plus qu’à nous d’apercevoir malgré la transparence incroyable de l’air, et ils leur ont prêté des proportions égales à celles qu’ils avaient données aux scènes des registres inférieurs. Ces défauts leur étaient imposés par le rituel de leur religion : ces tableaux qu’ils exécutaient avec une recherche si curieuse de l’exactitude, n’étaient-ils pas des charmes magiques, de la composition desquels dépendait la survivance d’un être humain après la mort ? Le moindre oubli risquant de compromettre les destinées du double, les artistes avaient dû sacrifier les vraisemblances de la perspective à la vérité minutieuse du détail.
La dahabiéh vogue toujours, et le chanteur fatigué s’est interrompu pour reprendre haleine, mais ses camarades le rappellent brutalement à son devoir : « On te paie cinquante piastres de plus que nous pour que tu chantes et tu veux te reposer : allons, ouvre ton bec et joue de la voix ». Il se fait prier quelques minutes, puis il recommence :
Dans le jardin j’ai vu – mon ami joli,
Qui s’agitait doucement – comme la branche du nabéca,
et l’équipage repart à sa suite : comme la feuille du nabéca,
Permets et accorde, – ô mon aimé,
Et remplis tes promesses pour le mieux.
Sur le rivage, les gens des barques arrêtées, les charpentiers, les conducteurs d’ânes, les femmes qui puisaient l’eau, suspendent leur travail, écoutent ; quand le refrain arrive, leur contentement éclate en « Ah ! » enthousiastes : « Allah ! Allah ! – Bénie soit ta mère, l’homme aux chansons ! – Que notre maître divin te préserve ! – Encore, encore, encore, et que le salut du prophète soit sur toi ! » Nous avançons au bruit de la joie populaire et nos matelots répondent par des rires approbatifs aux bénédictions qui pleuvent de la rive. L’air est lent, doux, un peu triste, adapté au rythme de l’aviron ; il n’a subi aucune altération depuis vingt-cinq années que je l’entends, et certes, il s’est transmis intact depuis des générations. On devait le chanter avec des paroles égyptiennes, au temps où l’Égypte avait des Pharaons, et Ramsès II l’entendit peut-être alors que, revenu de ses campagnes syriennes, il regagnait triomphant Thèbes la victorieuse.
Le 18 février 1906.
Un peu avant Omm-el-Kouçour, la falaise se fend, et par la déchirure on aperçoit une traînée de tombeaux blancs et rouges que domine un mur de briques grisâtres appuyé au rocher ; c’est une apparition furtive, presque aussitôt effacée qu’entrevue, si étrange pourtant qu’elle se grave dans l’esprit d’un trait inaltérable. Une fois, il y a quatre ans, j’avais voulu l’approcher, mais j’y étais arrivé vers la tombée de la nuit, et mes matelots m’avaient conté des histoires de goules à l’affût dans les replis de la montagne : il y allait de la vie si nous nous aventurions à terre passé le coucher du soleil, peut-être même n’étions-nous pas en sûreté sur le Nil, à bord de la dahabiéh. Je respectai leur angoisse et je consentis à attendre au lendemain. Le lendemain dès l’aube, le réis démarra tandis que je dormais encore, et il me fallut remettre la visite à des temps meilleurs.
Je viens de la faire enfin, grâce à une brise fraîche du nord qui nous contraignit hier à relâcher ici. Il était deux heures et demie de l’après-midi, et sur la berge, des portefaix chargeaient du moellon dans des bateaux : comme les goules et les afrites ne se risquent pas volontiers au soleil, personne n’eut peur et ne refusa de m’accompagner. L’ouady ne mesure guère plus de cent mètres de large. Il se dirige au nord l’espace de quinze cents mètres environ, puis il se divise en deux branches dont l’une court droit vers le sud parallèlement au fleuve, tandis que l’autre oblique au nord-est et se perd dans le désert. Des carrières anciennes s’ouvraient il y a vingt ans sur le versant méridional, en vue du rivage ; elles ont été détruites. Détruits également, la plupart des tombeaux gréco-romains qui prolongeaient vers l’intérieur la ligne des carrières ; un seul subsiste où l’on distingue les débris d’une scène de résurrection, un Anubis à masque de chacal et une Nephtys en faction devant une momie couchée sur son lit funèbre. Tout autour, la montagne est à vif et la pierre s’étale en larges plaques blanches tachetées de noir aux points où les fourneaux de mine ont fait explosion. Combien d’étés faudra-t-il pour qu’elle se patine au soleil ? Quelques saisons d’exploitation maladroite ont ravagé misérablement ce que vingt siècles avaient respecté, et gâté comme à plaisir un des paysages les plus originaux de l’Égypte.
Vu de près, le cimetière ne garde pas l’aspect pittoresque qu’il avait à distance. Il était abandonné depuis longtemps lorsque, dans le milieu du XIXe siècle, les Coptes le réoccupèrent. Ils y revinrent d’abord un par un, à des intervalles éloignés, puis la mode s’en mêlant, les notables des villages bâtis sur la rive occidentale tinrent à honneur d’y reposer, comme dans une terre sanctifiée par les ossements des moines bienheureux. Le convoi arrive en plusieurs bateaux, atterrit bruyamment, et sitôt débarqué, il se forme, le clergé en tête avec ses cymbales et sa grosse caisse qui appuie la cadence des prières liturgiques, la bière à bras recouverte de son drap violet, la famille et les amis en costume de cérémonie, les femmes échevelées méthodiquement et prêtes à hurler au premier signal. Les tombeaux sont établis sur le même principe que ceux des musulmans. Pour les pauvres, un simple trou ou tout au plus une fosse basse maçonnée de briques sèches, l’un et l’autre chargés d’un amas de terre ou de cailloux avec une pierre levée à la tête et aux pieds. Un degré de plus dans l’ordre social, et le monticule irrégulier devient une banquette, un mastaba rectangulaire de briques, nu ou barbouillé sommairement d’un lait de chaux. Il y a pour les familles aisées de véritables concessions perpétuelles. Le caveau est réservé au milieu d’un radier de briques surmonté d’une voûte cylindrique également en briques, dont la hauteur atteint parfois deux mètres. Les faces étroites rappellent par l’apparence les stèles cintrées de l’époque pharaonique, et sur l’une d’elles, sur celle de l’ouest le plus souvent, le maçon dessine en briques cuites la croix grecque, le monogramme du Christ, une couronne, un losange. Les riches ont des clos où on les emmure en pompe quand leurs jours sont révolus. On n’y voit ni le crénelage à merlons arrondis, ni les chapelles à coupoles des cimetières musulmans ; ils renferment chacun plusieurs tombes pour le maître, pour sa femme, pour ses frères, pour ses enfants. Tout cela est entassé sans ordre et se rencontre aux angles les plus imprévus, le tertre affaissé du pauvre diable à côté du mausolée battant neuf du propriétaire de cent feddans. Les sépultures les plus anciennes se pressent au voisinage du fleuve. Quand la place manqua en cet endroit, les nouvelles gagnèrent rapidement vers l’est : peu s’en faut aujourd’hui qu’elles ne touchent le fond de la vallée.
Lorsque les moines s’installèrent là, peut-être dès le début du VIe siècle, ils se logèrent au versant méridional, dans les hypogées païens, et ils aménagèrent en église une des carrières creusées sur le versant nord. Elle comprenait une partie à ciel ouvert faisant esplanade, et deux ou trois chambres souterraines soutenues par des piliers épargnés dans le roc ; ils les consacrèrent au culte, et ils construisirent tout autour une muraille assez robuste pour les protéger contre une attaque soudaine. Ruiné à plusieurs reprises, ce déîr a été toujours réparé, et naguère encore il a été remis à neuf par un riche personnage que la tradition locale appelle l’émir Tadrous. C’est, du dehors, un bloc de briques adossé au rocher et percé sur le front sud de cinq lucarnes haut placées. La porte s’ouvre en retour, à l’extrémité méridionale de la face ouest, une baie juste assez large pour admettre un seul homme, puis deux marches dans l’épaisseur de la maçonnerie, un lourd battant en bois, une pente raide resserrée entre deux bâtisses massives. La cour est bordée sur trois côtés de constructions, dont les unes persistent et dont les autres ont été rasées jusqu’aux fondations : au nord, des banquettes sur lesquelles les visiteurs ou les gardiens campaient la nuit, puis des pièces voûtées, dont l’une, celle qui occupe l’angle de la paroi rocheuse et de la courtine occidentale, renferme une boulangerie et des fourneaux de cuisine, tandis que les autres tenaient lieu de magasins à fourrage et à provisions. L’usage des chambrettes échelonnées le long de la face sud est indécis ; il y a dans l’une quatre jarres pour l’eau, et peut-être une autre servait-elle de cabinet d’aisances. Au milieu, le sol a été piétiné récemment ; il est semé de fientes d’âne. Des cendres sont accumulées dans un coin autour des pierres d’un foyer rustique : on y a cuit du pain et on a veillé auprès de la flamme. Des garde-côtes ont-ils bivouaqué ici pendant une de leurs rondes ? Des carriers empêchés de rentrer chez eux par un vent mauvais ? Des fidèles accourus de la rive opposée afin de célébrer une fête ou de prier sur leurs morts ? Les indigènes sont peu sensibles à l’intérêt pittoresque des lieux, et la seule beauté du site ne suffirait pas à les y attirer ou à les y retenir. Et pourtant la vue qu’on a d’ici, sans être des plus belles qui se puissent rencontrer, exerce un charme irrésistible sur l’Européen. À nos pieds, les tombes d’un blanc funèbre, l’ouady sillonné aux pluies de janvier, puis les hypogées violés, la montagne écorchée et meurtrie, une échappée de Nil reluisant, un va-et-vient de barques sous voile, une berge rayée de noir et de vert, une ligne d’arbres, un fond de montagnes roses, et répandue sur le tout, cette lumière d’Égypte qui harmonise les tons les plus disparates et caresse les yeux sans les blesser.
Un écran de briques barre rentrée de la carrière jusqu’à environ quatre-vingts centimètres du plafond. Il est décoré à mi-hauteur d’un losange et d’une croix de briques cuites qui s’enlèvent en ronge sur les grisailles de la terre crue. La petite porte basse, enfoncée, revêche, qui s’abrite sous la croix, est fermée d’un battant bardé entièrement de fer et hérissé de gros clous. La clef se trouve probablement sur l’autre rive, à cinq ou six kilomètres d’ici, mais il y a toujours des accommodements avec les serrures orientales : l’un de nos matelots tire à droite, presse à gauche, applique deux ou trois coups de poing vers l’angle du bas, invoque le nom du Prophète, et nous voilà dans l’église. Les architectes coptes n’avaient pas modifié sensiblement l’œuvre des païens. Ils ont conservé les deux piliers qui étayaient le plafond, et par derrière, sur le grand axe, ils ont bâti une enceinte rectangulaire percée à l’ouest des portes rituelles : c’est l’hékal, le sanctuaire à trois niches où la table d’autel est dressée, où le prêtre dit ses messes. Il est revêtu de l’inévitable badigeon blanc auquel le temps prête des tons crémeux de vieil ivoire, et il est décoré, ainsi que les piliers, de croix et d’entrelacs rouges, semblables à ceux qu’on rencontre comme en-têtes de chapitres dans les évangéliaires soignés des Xe et XIe siècles. Il y a assez d’espace entre l’hékal et les piliers, puis entre les piliers et la façade, pour y simuler la disposition des basiliques ordinaires et pour y figurer tant bien que mal la nef et le narthex. Un petit nombre de fidèles y tenaient en se serrant au moment de la communion : le reste de la congrégation s’espaçait dans le large couloir qui tourne autour du sanctuaire. Là, derrière l’autel, des bancs ont été découpés pour elle dans le rocher et une chambrette qui paraît avoir rempli l’office de sacristie. Sur la paroi méridionale, en face de la porte, un escalier aux marches inégales mène à une sorte de courtine le long de la paroi Est, presque sous le plafond. Une fissure irrégulière la fait communiquer au sud avec un réduit long, bas, étroit, qui reçoit le jour de côté par trois lucarnes ouvertes sur l’ouady. C’était une galerie à peine amorcée que les moines ont négligé d’utiliser quand ils ont approprié le reste. Elle agit comme une manière de soufflet, et l’appel d’air qu’elle provoque maintient l’atmosphère fraîche et pure autour du Saint des Saints : on n’éprouve point dans cette église presque toujours close la sensation de lourdeur et d’étouffement qui est si pénible dans la plupart des cryptes de l’Égypte chrétienne.
Une lanterne commune, fer-blanc tailladé et verre trouble, pend entre les deux piliers ; un escabeau en bois gît renversé dans un coin, près d’un lambeau de natte trouée : il n’y a ni mobilier ni vaisselle qui tentent la cupidité d’un voleur ou excitent la rage d’un fanatique. Lorsqu’on chante un office, ce qui arrive trois ou quatre fois l’an, le prêtre apporte avec lui le matériel du culte. Le reste du temps, l’église est à l’abandon, mais sa nudité n’a rien de triste. La vie journalière devait être dure aux malheureux que la vocation religieuse exilait dans ce coin du désert. On y a froid l’hiver, lorsque la bise s’engouffre dans l’ouady et qu’elle le balaie en rafale ; par contre, la chaleur y est torride en été et les nuits n’y apportent point de soulagement aux ardeurs des jours. Les moines, mal vêtus, plus mal nourris, affaiblis par les jeûnes démesurés que la règle leur prescrivait, isolés chacun dans son hypogée parmi les reliques et les souvenirs de la mort païenne, ne tardaient pas à y endurer les mêmes tourments que subissaient les solitaires des laures thébaines. Les momies dont ils ont usurpé la demeure s’animaient à côté d’eux et elles leur racontaient l’histoire de leur damnation. Des satyres et des monstres tournoyaient sous leurs yeux et cherchaient à les entraîner au désert. Des fées impures s’offraient à eux dans l’éclat de leur beauté provocatrice, et parfois, tandis qu’ils méditaient sur l’Écriture, des démons experts aux subtilités de la théologie leur intentaient à l’improviste les objections les plus captieuses. Au sortir de ces luttes infernales, l’église était pour eux le port de refuge. Le malin n’osait pas les y poursuivre, et pendant le répit qu’il leur y accordait par force, ils raffermissaient leurs esprits pour les assauts prochains, dans l’entretien de leurs pères et de leurs frères spirituels ou dans la communion du Seigneur. On me dit que les tentations démoniaques se produisent quelquefois encore dans les couvents des bords de la Mer Rouge. Le temps en est passé pour nous, mais le sentiment de paix retrouvée que les moines éprouvaient ici persiste encore, assez pénétrant pour que même les étrangers de passage en soient saisis. Il nous gagne presque à notre insu, il nous imprègne, et lorsque nous quittons le couvent aux premières ombres du soir, nous en emportons quelque chose avec nous à bord de la dahabiéh.
Chékalkîl, le 2 février 1903.
Les cavernes que les remous du fleuve ont forées dans les assises basses du Gébel Abou-Fédâ ont abrité les derniers crocodiles de l’Égypte moyenne. On en comptait une vingtaine il y a trente ans : il n’y en a plus aujourd’hui. Les habitants des villages voisins les ont-ils tués un à un, ou bien ont-ils émigré en sourdine pour rejoindre au loin, vers le Sud, leurs cousins de Nubie ? Personne ne soupçonnerait à quel point ils avaient pullulé dans ces parages, si nous n’en possédions la preuve dans les milliers et les milliers de momies dont les débris encombrent l’hypogée de Maabdéh.
C’est au hameau de Chékalkîl qu’il faut débarquer lorsqu’on veut les aller visiter. La berge est si hante qu’elle masque entièrement le pays au-delà, et qu’elle ne nous permet pas d’évaluer la distance qui sépare la montagne du Nil ; il semble en mettant pied à terre qu’on en soit à cent on deux cents mètres à peine, mais dès qu’on est monté sur la crête, on reconnaît qu’on était loin de compte. Une plaine se révèle, large, profonde, variée d’aspects et de cultures : beaucoup de blé, beaucoup d’orge, du helbèh, des fèves en fleur dont l’odeur encore engourdie par la fraîcheur du matin nous caresse douce et fine, des pois chiches, des lupins, du trèfle, le tout chétif et maigre, car depuis deux hivers la crue est insuffisante et le sol ne prodigue plus ses récoltes accoutumées. Déjà une partie des fourrages ont été coupés en herbes, faute d’eau pour les irriguer, ou bien on y a lâché le bétail avant qu’ils ne fussent desséchés. Nous croisons une avant-garde de chèvres et de chevreaux qui vagabondent, oreilles ballantes, sous la conduite de deux petites filles. Plus loin, une quarantaine de buffles et de vaches paissent au piquet et s’interrompent pour nous étudier. Le bouvier, un énorme gaillard barbu qui charme ses loisirs à filer de la laine, n’en revient pas de voir tant d’Européens ensemble : dans l’étonnement où notre brusque apparition le jette, il nous salue gravement d’un salam aleikoum





























