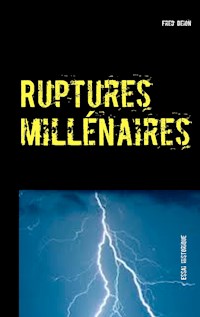
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Si l'histoire se répète, le passé indique le futur. Que peut nous dire le passé sur notre XXIème siècle ? Ce livre jette un coup de projecteur sur quelques événements historiques qui ont marqué la vie des hommes. Ces périodes chaotiques ont eu un impact considérable sur les populations qui ont vu leurs destins basculer. Gardons à l'esprit leurs tragiques épreuves, pour mieux faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans la mythologie grecque, Deion est fils d'Eole (homonyme d'Eole, maître et régisseur des vents) et roi de Phocide.
La Phocide reçoit beaucoup de visiteurs et prospère grâce à la présence de l'oracle de Delphes.
L'oracle est la réponse donnée à une question personnelle, concernant généralement le futur.
A Cerise
Muse-guerrière rebelle et imperturbable
Elle choisit d’avancer sur les chemins les moins fréquentés,
En l'y accompagnant, gare aux remous tumultueux de son sillage
Sommaire
A Cerise
Prologue
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Epilogue
Références bibliographiques et lectures suggérées
Remerciements
Prologue
Temps historiques et cycles hégémoniques
Si l'histoire se répète, le passé indique le futur. Que peut nous dire le passé sur notre XXIème siècle ? Loin du sensationnalisme et de la nouvelle immédiate qui passe du scoop à l'oubli du jour au lendemain, le temps historique informe plus sûrement sur les cycles séculaires et les tendances lourdes qui marquent la vie des hommes.
Ces quelques pages vont donc jeter un bref coup de projecteur pour mettre en lumière quelques événements sélectionnés qui ont eu un impact souvent considérable, voire dramatique, pour ceux qui en ont été les contemporains, et parfois les innocentes victimes.
Des traits d'union peuvent relier ces événements éloignés dans le temps. Un de ces fils rouges est appelé cycle hégémonique. Ainsi, une organisation politique (Empire, Etat) devient une puissance hégémonique lorsqu'elle parvient à établir puis à dicter aux autres ses propres règles, à faire prospérer l'économie et à imposer à tous sa paix (la Pax Romana de l'Empire romain, la Pax Britannica de l'Empire britannique du XIXème siècle, la Pax Americana de la seconde moitié du XXème siècle)1. Ce rôle est toutefois coûteux car il faut financer et entretenir un appareil militaire important, pour pouvoir maintenir sa domination.
Lorsque la puissance hégémonique n'y parvient plus et s'affaiblit, l'ordre est remplacé par l'incertitude et l'instabilité, voire le chaos et l'anarchie. Ainsi, à la chute de l'Empire romain d'Occident suivent les "Dark Ages", âge sombre du début du Moyen Age. Au déclin britannique de la fin du XIXème siècle succède une première moitié du XXème siècle cataclysmique avec deux guerres mondiales, une crise financière et économique planétaire.
Le déclin hégémonique occidental d'aujourd'hui est révélateur de l'incapacité actuelle à réformer l'Etat-providence exsangue, après qu'il ait distribué avec trop de prodigalité le contenu de sa corne d'abondance désormais vide. Il en découle une situation de crise hégémonique (caractérisée par des conflits sociaux), puis un effondrement de l'ancienne puissance hégémonique (caractérisée par une situation chaotique et des violences anarchiques qui peuvent dégénérer jusqu'au conflit).
Il va sans dire que les populations qui traversent ces périodes de transition sont malmenées par les événements qu'elles subissent, sans n'être plus maîtres de leur avenir, jusqu'à y perdre parfois la vie. Pions anonymes sacrifiés par les convulsions du passé qui les balaient comme des fétus de paille, ils sont emportés injustement et dans l'indifférence dans les oubliettes de l'histoire.
Il est donc maintenant temps de retourner à quelques unes de ces périodes mouvementées dont les tragédies ont fait basculer les destins du plus grand nombre, en gardant à l'esprit les épreuves qu'il leur a bien fallu affronter. Retour en arrière pour notre première étape, il y a près de 2000 ans.
1 Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers Jacques Attali, Demain, qui gouvernera le Monde ?
Chapitre 1
La chute de l’Empire romain d’Occident
En septembre 394 après Jésus-Christ, Théodose 1er, âgé alors de 47 ans, remporte à Aquileia le succès le plus éclatant de sa carrière militaire. Cette victoire, c'est la sienne, celle qui place l'ensemble des territoires de l'Empire romain sous le pouvoir d'un seul homme, le sien. Son rival, l'usurpateur Eugenius, est fait prisonnier et implore sa clémence. Théodose 1er, désormais seul empereur légitime, le fait décapiter.
Au faîte de sa puissance, Théodose 1er peut savourer son triomphe. Il règne sur l'entier du bassin méditerranéen, et au-delà : toute la côte de l'Afrique du Nord jusqu' à l'Asie mineure; de l'Angleterre actuelle, la Gaule et la péninsule ibérique, jusqu'à la Grèce, la Palestine et l'Egypte.
Il prépare aussi sa succession : à sa mort, son fils aîné Arcadius aura en charge la partie orientale de l'empire, son cadet Honorius la partie occidentale; le généralissime Stilicon d'origine Vandale devant veiller sur eux.
En janvier 395, Théodose 1er n'a plus que quelques jours à vivre. Lors de ses derniers instants, se doute-t-il que l'Empire romain d'Occident, après avoir dominé un demi-millénaire le monde méditerranéen, est lui aussi au crépuscule de son existence? 80 ans plus tard, en 476, le dernier empereur, le jeune Romulus Augustule, sera déposé, mettant ainsi un terme à cinq siècles de domination romaine sur une grande partie de l'Europe.
Jusqu'à nos jours, l'effondrement de l'Empire romain d'Occident a suscité bien des controverses. Une explication souvent avancée est celle des grands mouvements migratoires germaniques, qui amènent différentes peuplades à déferler en vagues successives sur l'empire romain à partir du 3ème siècle après Jésus-Christ.
Ces invasions dites "barbares" (les Romains désignent ainsi les peuples extérieurs à leur empire) donnent lieu à la fois à un processus d'intégration, à des périodes troublées, violentes, voire chaotiques, et à un lent déclin économique.
Rome a eu d'autant plus de difficultés pour contenir ces envahisseurs du Nord, que l'essentiel des légions a été envoyé aux confins de ses frontières orientales pour mater, dès le 3ème siècle, les incursions perses provenant de l’empire des Sassanides.
Le siècle suivant, en 376, des milliers de réfugiés Goths, poussés par les migrations des Huns, demandent la permission de traverser le Danube et de s'installer à l'intérieur des frontières de l'empire. Les autorités romaines chargées de leur accueil sont vite débordées, si bien que les Goths sont rapidement réduits à la famine. Ils se révoltent contre les Romains en 377, qu'ils battent l'année suivante à Andrinople, défaite qui a un retentissement durable, mettant à mal le mythe d'invincibilité des légions. Les années suivantes, des bandes de guerriers Goths pillent la région des Balkans, vivant sur le pays au dépend de l'Empire qui doit se résigner à les accepter.
Ainsi, à la fin du 4ème siècle, Rome semble de moins en moins en mesure d'assimiler des arrivants supplémentaires au sein de son empire. Des accords sont conclus avec différents peuples barbares pour leur permettre de s’établir sur le territoire romain, notamment avec les Francs, à la frontière du Rhin et avec les Wisigoths, en Illyrie. Cela n'empêche pas ces derniers de se soulever dès 395 et d'envahir l'Italie en 401. Pour faire face à cette menace, le général Stilicon rassemble toutes ses garnisons, y compris avec des éléments pris aux frontières, pour battre les Wisigoths en 402 et 403. Ces victoires ont néanmoins des conséquences négatives. D'une part, elles affaiblissent militairement les provinces du Nord, qui ont été dégarnies de leurs troupes. D'autre part, elles vident la trésorerie de l'Empire, ne lui permettant plus de financer les légions restantes sur les frontières, dont le rôle est pourtant de contenir la poussée des Germains, refoulés par les Huns.
A cette époque, le poète Claudien écrit : "Le Rhin, dont les garnisons se sont éloignées, est protégé par la seule terreur qu'inspire le nom romain. La postérité le croira-t-elle jamais ? La Germanie, naguère si orgueilleuse de ses peuples, et que jadis la présence des empereurs, avec la totalité de leurs forces, suffisait à peine à tenir en respect, se soumet docilement aux ordres de Stilicon; elle ne tente pas de franchir une frontière dégarnie, ni d'avancer dans un pays largement ouvert, elle redoute de passer un fleuve dont la rive est sans défense."
Les faits donnent tort à Claudien : le 31 décembre 406, diverses tribus venues d'Europe centrale (Vandales, Alains et Suèves-Quades) composées de conquérants armés, de pillards et d'aventuriers qui convoitent des terres, franchissent le Rhin sans rencontrer de résistance et envahissent la Gaule romaine qu'elles saccagent et pillent jusqu'en 4092. Rome se révèle être impuissant à faire cesser ces dévastations qui entraînent appauvrissement, famines, dépopulation et désorganisation générale. Le général romain Constantin III veut profiter de ce chaos; il quitte la Grande-Bretagne avec ses troupes pour tenter d'établir sa propre autorité sur la Gaule, laissant l'île sans défense, et permettant à cette province romaine de devenir autonome. Les mêmes peuplades germaniques qui franchissent le Rhin en 406, après la ruine des provinces gauloises, traversent les Pyrénées trois ans plus tard et se déversent dans la péninsule ibérique, semant la mort et la désolation sur leur passage.
En Italie, les Wisigoths n'obtiennent pas l'ouverture de négociations qu'ils ont demandées à l'Empereur Honorius qui ne cède pas. Suite à ses refus, ils assiègent Rome (ce qui n'était plus arrivé depuis 8 siècles), la réduisent à la famine et la mettent à sac en 410. Le pillage dure trois jours, avec son cortège de meurtres, viols, destructions, et la ville est partiellement brûlée. La prise de Rome cause un immense traumatisme à travers tout l’Empire et les chrétiens y voient les premiers signes de la fin du monde. En 418, après plusieurs années d'errances et de pillages en Italie et en Espagne, les Wisigoths obtiennent finalement la permission de s'installer en Aquitaine, et cette région devient aussi de plus en plus autonome au fil des ans.
En Hispanie, où de nouveaux arrivants germaniques s'étaient installées depuis 410, des Vandales et certaines autres tribus traversent le détroit de Gibraltar en 429 pour envahir les provinces romaines d'Afrique, grenier de l’empire occidental. Celui-ci n'ayant plus les moyens pour s'opposer à cette invasion, plusieurs traités sont négociés, en 435 puis en 442. Les Vandales s'étant emparés de la flotte romaine stationnée à Carthage, l'Italie est coupée de son approvisionnement en céréales.
En s’emparant ainsi de plusieurs provinces, les peuplades germaniques privent Rome des ressources financières qui lui permettent de maintenir la puissance de son armée. L'Italie, la Gaule et l'Espagne ont été ravagés, la Bretagne, l'Aquitaine et l’Afrique deviennent autonomes. On assiste ainsi à l’'effondrement lent mais inexorable de l’administration impériale à l’Ouest.
En 450, l'empire Hun s'étend de la mer Caspienne à la mer Baltique, au Rhin et au Danube. Après avoir repoussé les peuples germaniques vers l'Empire romain depuis le début du siècle précédent, leur chef Attila envahit la Gaule à la tête d’une imposante armée en 451. Les Huns se dirigent vers Orléans qu’ils assiègent. Le général romain Aetius réunit ce qui reste des forces gallo-romaines dans la région, composées de plus en plus de soldats provenant de peuples fédérés comme les Burgondes, les Wisigoths, les Francs et les Alains. La bataille des champs catalauniques n’est pas décisive, mais Attila doit se replier, d'abord au Nord de l'Italie que ses armées pillent, puis il retourne en Europe centrale où il meurt subitement en 453.
En 454, l'empereur Valentinien III poignarde son général Aetius, persuadé qu’il veut s’emparer du pouvoir. L'année suivante, deux anciens officiers d’Aetius le vengent en assassinant Valentinien III.
Après leur mort, les rois barbares fédérés à l'Empire romain d'Occident cherchent tous à accroître leur puissance et à agrandir leurs territoires. En 455, les Vandales d'Afrique du Nord attaquent Rome qu’ils pillent, puis ils s'emparent de la Corse et de la Sardaigne. L’Empire romain d’Occident va progressivement se réduire à l’Italie, la Provence et la Dalmatie, et la valse des empereurs fantoches va commencer jusqu'à la déposition en 476 de Romulus Augustule par





























