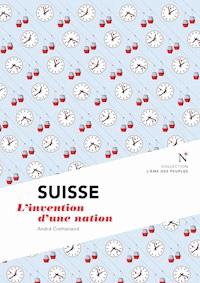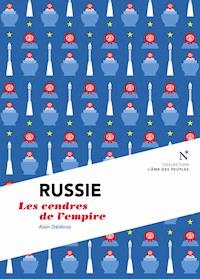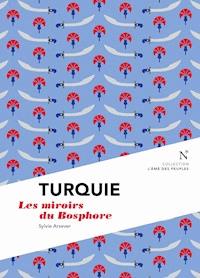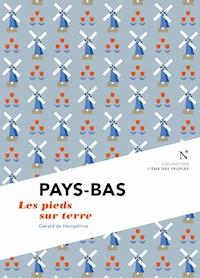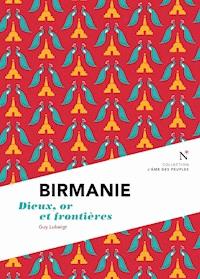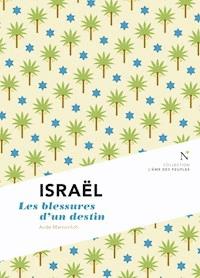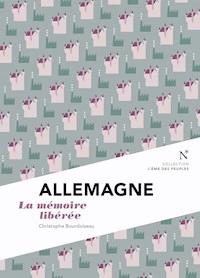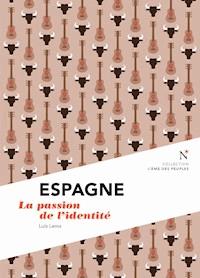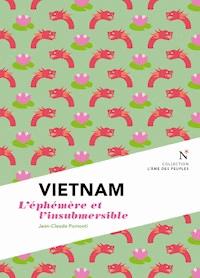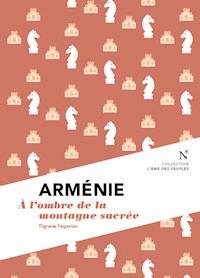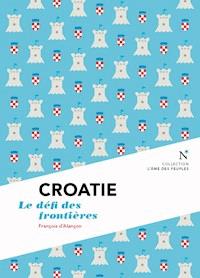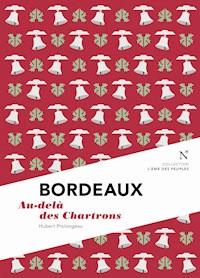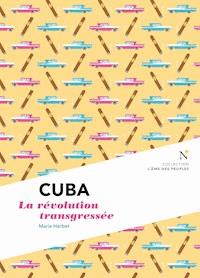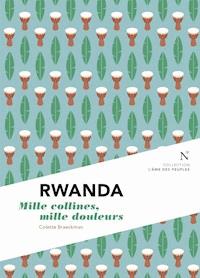
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Parce que pour connaître les peuples, il faut d’abord les comprendre
Le Rwanda est un mystère. Il y a vingt ans, en avril 1994, un effroyable génocide s’y déroulait, révélant au monde l’envers d’une colonisation manipulatrice, où tout fut mis en oeuvre pour faire s’affronter les Hutus et les Tutsis. Changement de décor complet aujourd’hui : le pays-martyr affiche sa prospérité et se rêve en plaque tournante de l’Afrique de l’Est. Le Front patriotique Rwandais au pouvoir depuis deux décennies y a, à la hussarde et d’une poigne de fer, transformé les villes, les paysages, l’économie, les mentalités.
Ce petit livre n’est pas un guide. C’est un décodeur. Il nous donne à comprendre, à travers le récit d’une journaliste devenue au fil des ans l’une des plus grandes chroniqueuses des bonheurs et des malheurs de l’Afrique, la tourmente d’un peuple et les fatales erreurs de ceux qui l’asservirent. Un récit poignant, écrit à la première personne et accompagné de grands entretiens. Une parole libre et dérangeante pour raconter ce pays aussi fascinant que déroutant.
Un grand récit suivi d'entretiens avec Jean-Pierre Chrétien (Les Rwandais sont aussi les acteurs de leur propre histoire) et Dorcy Rugamba (Une société martiale et solidaire)
Un voyage historique, culturel et politique afin de mieux connaître les passions rwandaises. Et donc mieux les comprendre.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "(...) Belle et utile collection petit format chez Nevicata, dont chaque opuscule est dédié à un pays en particulier. Non pas un guide de voyage classique, mais, comme le dit le père de la collection, un «décodeur» des mentalités profondes et de la culture. Des journalistes, excellents connaisseurs des lieux, ont été sollicités (...). A chaque fois, un récit personnel et cultivé du pays suivi de trois entretiens avec des experts locaux. -
Le Temps
- "Comment se familiariser avec "l'âme" d'un pays pour dépasser les clichés et déceler ce qu'il y a de juste dans les images, l'héritage historique, les traditions ? Une démarche d'enquête journalistique au service d'un authentique récit de voyage : le livre-compagnon idéal des guides factuels, le roman-vrai des pays et des villes que l'on s'apprête à découvrir." -
Librairie Sciences Po
À PROPOS DE L'AUTEUR
Spécialiste de l'Afrique pour le journal Le Soir (Bruxelles), auteur de nombreux livres, Colette Braeckman a fait du reportage de terrain, aux côtés des grandes et petites gens, sa marque de fabrique. Une authentique exploratrice des âmes et de la culture rwandaises.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’ÂME DES PEUPLES
Une collection dirigée par Richard Werly
Comprendre l’autre, c’est apprendre à le connaître.
Signés par des journalistes écrivains de renom, fins connaisseurs des pays, des métropoles et des régions sur lesquels ils ont choisi d’écrire, les livres de la collection L’âme des peuples ouvrent grandes les portes de l’histoire, des cultures, des religions et des réalités socio-économiques que les guides touristiques ne font qu’entrouvrir.
Écrits avec soin et ponctués d’entretiens avec de grands intellectuels rencontrés sur place, ces riches récits de voyage se veulent le compagnon idéal du lecteur désireux de dépasser les clichés et de se faire une idée juste des destinations visitées.
Une rencontre littéraire intime, enrichissante et remplie d’informations inédites.
Richard Werly (1966), journaliste et auteur, suit les questions européennes et internationales au quotidien suisse Le Temps. Ses reportages de terrain lui ont démontré combien, derrière chaque idée reçue sur un pays et un peuple, se cachent à la fois des mythes, des peurs et des parts de vérité. D’où le pari de ces livres-décodeurs, intimistes, littéraires et engagés. Pour que le voyage et la découverte ne soient jamais des fruits secs.
AVANT-PROPOS
Pourquoi le Rwanda ?
Avec le Congo, le Rwanda est sans doute le pays d’Afrique où je me suis le plus souvent rendue. Dès l’aéroport, j’y retrouve des visages connus. Et dans la rue, je salue des gens comme si j’étais dans mon village.
Au moment de rassembler mes idées et de me mettre à écrire, la panique a toutefois remplacé mon engouement initial pour ce projet de livre consacré à « l’âme du Rwanda ». J’ai vérifié la pertinence du vieil adage selon lequel après quinze jours dans un pays on écrit un livre, après quinze ans on n’écrit plus rien. Que dire alors après trois décennies ? Seule émerge une brutale évidence : plus je vais au Rwanda, plus ce pays m’accompagne et parfois me hante, mais moins je le comprends. Il me désarçonnera toujours, dans l’horreur et la cruauté, mais aussi dans l’accueil, la beauté, la dignité, les capacités de progrès.
N’étant sûre de rien et ayant pris la mesure de mon ignorance, j’ai donc choisi le seul chemin que je connaissais pour l’avoir moi-même parcouru. J’ai décidé de me référer à mon propre périple. Mes débuts dans ce pays, alors que j’avançais lestée d’un savoir qui s’avèrerait inutile. La manière dont des versions successives de l’histoire me furent proposées. Ma découverte progressive d’une trajectoire qui allait mener au génocide. J’ai choisi de partager avec vous, lecteurs, au gré des souvenirs, dans l’ordre ou le désordre, ma fascination, mon horreur, mon chagrin, mais aussi ma perplexité, mon admiration et mon affection.
Depuis longtemps, je m’interrogeais sur la culture rwandaise, si différente de la luxuriance congolaise, et il m’a semblé qu’elle était peut-être une clé de compréhension si je voulais aller au-delà de l’événement, en me souvenant du génocide, mais aussi en revenant sur cette lancinante question : comment un tel déni d’humanité a-t-il été rendu possible ?
Il me semble aujourd’hui qu’en plus de l’enchaînement fatal des circonstances (la préparation matérielle, le conditionnement des esprits, la guerre, le rôle de la communauté internationale), ce crime absolu a été une sorte de paroxysme des manipulations de l’histoire, le prix maximal que le peuple rwandais a été obligé de payer pour sortir des chaînes de la domination coloniale et postcoloniale. Le génocide de 1994 fut un événement à la fois dévastateur et fondateur. Une table rase sur laquelle s’édifie désormais autre chose. Bien ou mal, mais autre chose.
Dans ces quelques pages, j’ai donc voulu, de manière totalement incomplète, imparfaite et que beaucoup jugeront partiale, faire partager mon propre cheminement. De nombreux interlocuteurs rwandais m’ont aidée, parfois sans le savoir et, craignant d’avoir déformé leur pensée, j’ai préféré ne pas les citer nommément. Je suis néanmoins certaine qu’ils reconnaîtront la place qu’ils occupent dans ce récit.
Mille collines, mille douleurs
Les insomnies d’Imana
Depuis des années, je passais devant le musée de Butare sans m’arrêter. J’avais l’impression d’avoir déjà vu et revu les clichés de l’époque coloniale, les guerriers, les danseurs aux coiffes de paille. Dans l’ancienne Astrida, la première ville fondée par le colonisateur belge, proche du Burundi, je n’avais plus envie de revoir les paniers tressés, similaires à ceux de la boutique de souvenirs, en face de l’hôtel Ibis. En ce dimanche après-midi de fin de saison sèche, alors que les passants semblaient encore revenir de la messe ou de visites familiales, je suis cependant retournée au musée.
Nicole, que je connaissais via des amis communs, m’y avait donné rendez-vous. Vêtue d’une longue robe aux couleurs vives, elle était accroupie sur un petit tabouret de bois et consultait son téléphone portable, comme la plupart des jeunes Rwandais que j’avais croisés depuis la frontière du Burundi, tous accrochés à leur tablette ou scotchés à leur écran. Lorsque Nicole se déplia de toute sa taille et entreprit de me guider à travers le musée, tout ce que je croyais savoir prit soudain un coup de vieux.
Alors que mes compatriotes, lorsqu’ils abordaient l’histoire du Rwanda, s’étaient toujours perdus dans de longues digressions, où se mêlaient féodalités, migrations et luttes intestines, la jeune femme, d’une voix claire, entreprit de me raconter l’histoire d’un peuple très ancien, rassemblé autour de ses rois depuis onze siècles. J’appris que le nom du pays lui-même – Rwanda – venait du terme kuu anda, qui signifie littéralement « dispersion ». Il désignait la progression d’un peuple dont chaque citoyen appartenait à un bataillon militaire chargé de défendre le pays ou de conquérir de nouveaux territoires.
Désignant un panneau illustrant l’ordre de succession des rois successifs, ma nouvelle amie m’expliquait que le nom de chacun de ces souverains indiquait le rôle qui lui était assigné. Kigeri, le roi censé ouvrir les hostilités et lancer la conquête, devait avoir pour successeur Mibambwe, poursuivant la guerre et stabilisant les territoires conquis. Mutara et Cyilima étaient, eux, chargés d’assurer la prospérité. Le dernier dans l’ordre de succession, Yuhi, était le roi du feu, chargé d’établir le lien entre les rois pasteurs et les guerriers.
À l’instar des lettrés d’autrefois qui transmettaient leur savoir en récitant de longs poèmes épiques, Nicole énumérait de mémoire la liste des rois et de leurs conquêtes. Elle soulignait que des linguistes avaient retrouvé dans toute la sous-région des Grands Lacs – jusque Lubumbashi, la capitale de l’actuelle province congolaise du Katanga et jusque Kisangani, capitale de la Province orientale, à l’orée de la forêt congolaise – des traces de la langue parlée par ce peuple de guerriers. Aux yeux de ces conquérants, la grande forêt équatoriale (dont les piliers, c’est-à-dire les arbres, soutenaient le ciel) qui s’avançait autrefois jusqu’au Masisi – au cœur de la province congolaise du Kivu – marquait la fin du monde habité.
Rassemblés dans le même ordre que dans les vitrines du Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren1, les objets usuels, paniers de raphia, gobelets de bois, cloisons de paille délimitant l’enclos familial, racontent, au musée de Butare, l’histoire d’un très vieux peuple. Un peuple qui, jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle, s’était suffi à lui-même et rejeta toutes les incursions étrangères, y compris celles des esclavagistes.
Les clichés jaunis, soigneusement encadrés, légués par les ethnologues et les explorateurs, permettent de comprendre la surprise éprouvée en 1894 par les premiers visiteurs allemands lorsqu’ils découvrirent des hommes de belle stature, qui les toisaient en abaissant sur eux un regard oblique. L’un des clichés les plus célèbres montre le comte von Götzen, envoyé spécial de l’empereur d’Allemagne, le premier à avoir traversé le Rwanda dans toute sa longueur, attendant d’être reçu en audience par le roi : de jeunes guerriers, s’exerçant au saut en hauteur, passent loin au-dessus de la tête du visiteur stupéfait.
« Tous les jeunes Rwandais, me précisa Nicole, appartenaient à des formations militaires et dans leurs académies, ils n’apprenaient pas seulement l’art de la guerre mais aussi l’histoire et les valeurs de leur peuple. » Il leur fallait aussi maîtriser la langue, converser avec élégance, réciter des poèmes épiques retraçant les hauts faits des rois successifs. Un héritage qui n’est pas oublié. « De nos jours encore, conclut-elle, les jeunes, à la fin du secondaire, doivent suivre durant l’été une session d’amatorero, où on leur rappelle l’histoire de leur pays et les valeurs de leur peuple, dont le courage, le sens du respect, de la dignité. »
Durant des heures, alors que la brume enveloppait cette fin de dimanche, la jeune fille m’a longuement parlé d’un Rwanda ancien, harmonieux, où celui que l’on appelait Imana, le dieu unique, fondateur et symbole de l’unité de son peuple, revenait dormir chaque nuit. Au-dessus de l’arboretum qui en 1994 abrita tant de crimes, je croyais entendre résonner les tambours royaux. Quel contraste avec ce que j’entendais avant 1994, où les guides insistaient sur la complexité du pays, recouraient aux objets exposés pour mettre l’accent sur le fossé qui séparait les agriculteurs hutus, les éleveurs tutsis et les pygmées Twas, forgerons ou devins.
Perdue dans mes pensées, écartelée entre l’histoire racontée dans ce musée rénové et le souvenir des enseignements d’autrefois, j’ai quitté le musée en longeant la grand-route sillonnée par les minibus et les motos taxis. J’ai flâné au rythme des étudiants qui déambulaient en direction de l’Université de Butare, dépassé l’hôtel Faucon à la façade marquée d’une plaque commémorative, puis l’hôtel Ibis.
Là, le propriétaire belge Michel Campion m’a raconté que le maire de la ville, au nom de la modernité, venait de l’obliger à dresser un deuxième étage au-dessus d’une terrasse ouverte sur la rue. Depuis les années 1930, lorsque le père de Michel s’était installé dans cette ville fondée par les Belges, cette terrasse, arrêt obligé pour tous les voyageurs, avait été le lieu de rendez-vous de tous les conteurs du Rwanda, les intellectuels, les beaux parleurs et les politiciens…
Comme autrefois, je me suis assise face à la rue. J’ai commandé une bière froide, c’est-à-dire sortie du réfrigérateur et, regardant la cohue où se croisaient motos, taxis, vélos et simples charrettes, je me suis laissée envahir par mes premiers souvenirs. Bien avant de pouvoir voyager au Rwanda, je croyais déjà tout savoir de ce pays. N’avais-je pas été à bonne école ?
Le manifeste des Bahutu
C’est au sein de la rédaction du journal La Cité, organe de la démocratie-chrétienne, que j’ai entamé ma carrière de journaliste à Bruxelles. Vers la fin des années 1960, le Rwanda du président Grégoire Kayibanda était encore l’enfant chéri de la Belgique. Cette dernière, jusqu’à l’indépendance proclamée en 1962, avait exercé sur cette ancienne colonie allemande le pouvoir de tutelle qui lui avait été accordé à la suite de la défaite de l’Allemagne en 1918.
Hutu de Gitarama, bon chrétien, père de famille nombreuse, rédacteur en chef du journal catholique Kinyamateka, le président Kayibanda avait contribué à la rédaction du Manifeste des Bahutu, un document remis à la tutelle belge qui dénonçait les discriminations dont étaient victimes des Hutus. Ces discriminations n’étaient pas imaginaires, puisque le colonisateur avait systématiquement favorisé les Tutsis, écartant les Hutus de tout poste à responsabilité.
Nostalgiques de leurs propres luttes syndicales, les milieux de la gauche chrétienne belge avaient alors salué la publication de ce manifeste et appuyé la révolution sociale rwandaise, qui, en 1959, allait être le prélude à l’indépendance. Des termes appelés bien plus tard à devenir tragiquement familiers revenaient déjà dans les propos et les articles de l’époque : « menu peuple », « masse » des « petits » qui devaient se libérer du joug des « féodaux », être délivrés du servage et des corvées obligatoires, devenir maîtres de leur terre et de leur destin. Dans ces milieux belges-là, on détestait de manière bien peu chrétienne ceux que l’on appelait les Inyenzi, les « cafards », un terme utilisé pour désigner les Tutsis chassés dès 1959 et qui, depuis lors, tentaient de s’organiser pour regagner leur pays.