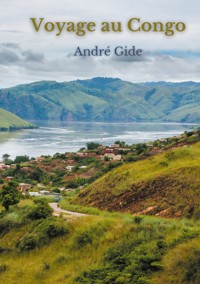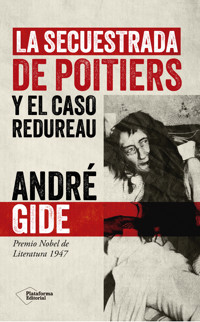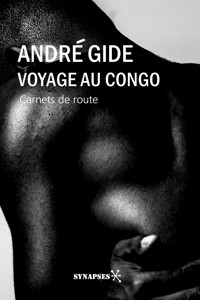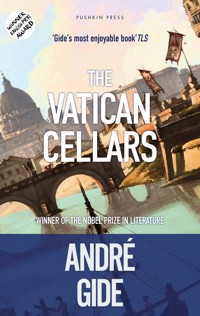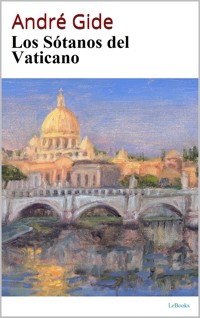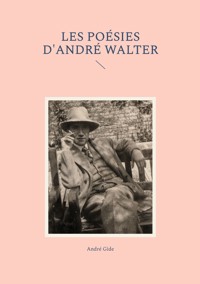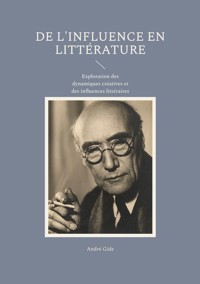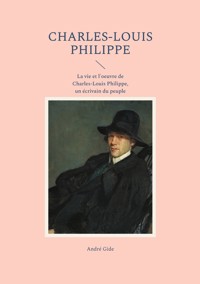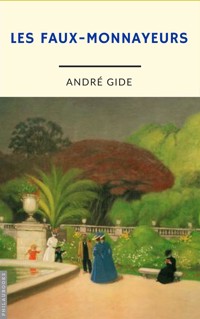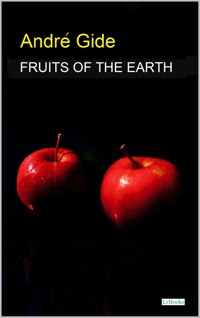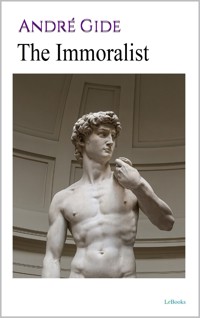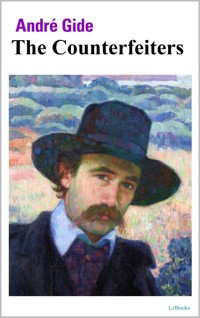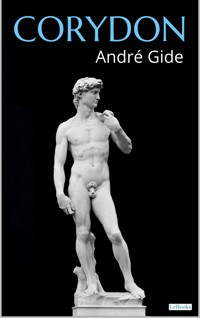Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Écrite en Italie et publiée en 1903, la première pièce de théâtre de ce recueil reprend le mythe biblique de Saül et David. Privé de vision, hanté de démons, Saül a compris que son fils Jonathan ne lui succédera jamais. Pour connaître le secret qui hante le roi, la reine fait appel à David, un berger joueur de lyre. Se découvrant trahi, Saül tue la reine. Ne reste plus que des hommes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Saül
SaülDE L’ÉVOLUTION DU THÉÂTRE-SAÜLPRÉFACEACTE ISCÈNE ISCÈNE IISCÈNE IIISCÈNE IVSCÈNE VSCÈNE VISCÈNE VIISCÈNE VIIISCÈNE IXSCÈNE XSCÈNE XIACTE IISCÈNE I. 2SCÈNE IISCÈNE III. 2SCÈNE IV. 2SCÈNE V. 2SCÈNE VI. 2SCÈNE VII. 2SCÈNE VIII. 2SCÈNE IX . 2ACTE IIISCÈNE I. 3SCÈNE II. 3SCÈNE III. 3SCÈNE IV. 3SCÈNE V. 3SCÈNE VI. 3SCÈNE VII. 3SCÈNE VIII. 3ACTE IVSCÈNE I . 4SCÈNE II. 4SCÈNE III . 4SCÈNE IV. 4SCÈNE V . 4ACTE VSCÈNE I. 5SCÈNE II. 5SCÈNE III. 5SCÈNE IV. 5SCÈNE V. 5SCÈNE VI. 5LE ROI CANDAULEDISTRIBUTION-PRÉFACEPRÉFACE POUR LA SECONDE ÉDITION DU ROI CANDAULEACTE I. 2PROLOGUESCÈNE I . 6SCÈNE II. 6SCÈNE III. 6ACTE II. 2SCÈNE I. 7SCÈNE II. 7ACTE TROISIÈME. 2SCÈNE I. 8SCÈNE II. 8SCÈNE III. 8SCÈNE IV. 8SCÈNE V. 8Page de copyrightSaül
André Gide
DE L’ÉVOLUTION DU THÉÂTRE
À Émile Verhaeren.
CONFÉRENCE PRONONCÉE LE 25 MARS 1904 À LA « LIBRE ESTHÉTIQUE » DE BRUXELLES[1]
Mesdames et Messieurs,
L’évolution de l’art dramatique est un sujet tout particulièrement difficile. Je voudrais commencer par vous dire pourquoi. Peut-être me permettrez-vous, après, de causer plutôt que de discourir et plutôt autour du sujet que sur le sujet lui-même.
Et parce que je considère que l’œuvre d’art dramatique ne trouve pas, ne veut pas trouver sa fin suffisante en elle-même – ce qui cause une des pires difficultés du sujet – mais que l’auteur dramatique la dresse pour ainsi dire entre les spectateurs et l’acteur, c’est successivement au point de vue de l’auteur, puis de l’acteur, puis du spectateur, que je me propose de me placer, essayant d’envisager tour à tour, de cette même évolution, les trois faces.
Une autre difficulté, non des moindres, vient de ce que, dans le succès d’une pièce, ou même d’un genre de pièces, bien des considérations peuvent entrer en jeu qui n’ont rien à voir avec la littérature. Je ne parle pas seulement de ces multiples éléments auxquels l’œuvre d’art dramatique, pour être exécutée, et avec succès, fait appel : richesse des décors, éclat des costumes, beauté des femmes, talent et célébrité des acteurs ; je parle surtout des préoccupations sociales, patriotiques, pornographiques ou pseudo-artistiques de l’auteur.
Les pièces à succès d’aujourd’hui sont souvent tissues de ces préoccupations-là, à ce point qu’en les faisant choir une à une on supprime à peu près la pièce[2].
Mais la plupart du temps, c’est à ces préoccupations précisément que la pièce doit sa vogue ; l’auteur qui n’y obéit pas, que la seule préoccupation d’art fait écrire, risque fort, non seulement de n’être pas couru, mais même de n’être pas représenté.
Or, l’œuvre d’art dramatique ne vivant que virtuellement dans le livre, ne vivant complètement que sur la scène, le critique qui s’occuperait aujourd’hui de l’évolution du théâtre se verrait obligé, pour ne négliger point l’évolution parallèle de l’acteur et du public, de parler d’œuvres qui n’ont qu’un très lointain rapport avec la littérature, et de négliger au contraire des pièces de mérite purement littéraire, je ne dis pas seulement comme le Phocas de Francis Vielé-Griffin, la Gardienne de Henri de Régnier, ou comme Un Jour de Francis Jammes, en qui je comprends qu’on ne consente à voir que des poèmes, – mais comme les premières pièces de Maeterlinck, comme les drames de Claudel, comme le Pain de Henri Ghéon, comme d’autres encore – et j’allais dire : comme le Cloître de Verhaeren, si je ne me souvenais de l’heureux succès qu’il a pu remporter à Bruxelles. Ou s’il en parle, ce critique, ce ne peut être que comme de manifestations toutes livresques, qu’ignorent les planches et la salle – cette évolution, non seulement restant distincte de l’autre, très distincte, mais encore s’y opposant.
« Chez les animaux vivant en société, écrit Darwin, la sélection naturelle transforme la conformation de chaque individu de telle sorte qu’il puisse se rendre utile à la communauté ; à condition toutefois, ajoute-t-il, que la communauté profite du changement. » – Ici la communauté ne profite pas… L’artiste non joué s’enferme dans son œuvre, se dérobe à l’évolution générale et finit par s’y opposer. Toutes les œuvres dont je parle sont des œuvres de réaction.
Réaction contre quoi ? – Je dirais volontiers : contre le réalisme, mais ce mot réalisme, auquel on a déjà prêté tant de sens, ne tarderait pas à me gêner moi-même grandement. La plus habile mauvaise foi que j’y pourrais mettre ne suffirait pas à convaincre de réalisme les œuvres de M. Rostand par exemple, ni d’anti-réalisme les comédies de Molière ou les drames d’Ibsen. Réaction, disons plutôt : contre l’épisodisme. Oui, faute d’un meilleur, épisodisme me paraît le mot préférable. Car l’art ne consiste pas dans l’emploi de figures héroïques, historiques ou légendaires ; non plus qu’il n’est nécessairement inartistique d’occuper la scène avec des bourgeois contemporains. Pourtant le mot de Racine a du vrai, que je lis dans la préface de Bajazet : « Les personnages tragiques doivent être regardés d’un autre œil que nous ne regardons d’ordinaire les personnages que nous avons vus de près. On peut dire, ajoute-t-il, que le respect que l’on a pour les héros augmente à mesure qu’ils s’éloignent de nous. » On peut dire aussi, me permets-je d’ajouter à mon tour, que ce respect pour les personnages représentés n’est peut-être pas indispensable. Le choix que fait l’artiste de figures distantes de nous vient plutôt de ce que le temps, ou quelque distance que ce soit, n’en laisse parvenir à nous qu’une image dépouillée déjà de tout ce qu’elle put avoir d’épisodique, de bizarre et de passager, ne laisse subsister d’elle que sa part de vérité profonde sur laquelle l’art peut œuvrer. Et le dépaysement que l’artiste cherche à produire en éloignant de nous ses personnages indique précisément ce désir : nous donner son œuvre d’art pour une œuvre d’art, son drame pour un drame, simplement – et non courir après une illusion de réalité qui, lors même qu’elle serait obtenue, ne servirait qu’à faire avec la réalité pléonasme. Et n’est-ce pas, presque à leur insu, ce même désir qui poussait nos classiques à s’astreindre aux trois unités : faire de l’œuvre dramatique une œuvre délibérément et manifestement artistique ?
Chaque fois que l’art languit, on le renvoie à la nature, comme on mène un malade aux eaux. La nature, hélas ! n’y peut mais ; il y a quiproquo. Je consens qu’il soit bon parfois que l’art se remette au vert, et s’il pâlit d’épuisement, qu’il cherche dans les champs, dans la vie, l’espoir d’une vigueur nouvelle. Mais les Grecs nos maîtres savaient bien qu’Aphrodite ne naît point d’une fécondation naturelle. La beauté ne sera jamais une production naturelle : elle ne s’obtient que par une artificielle contrainte. Art et nature sont en rivalité sur la terre. Oui, l’artiste embrasse la nature, il embrasse toute la nature, et l’étreint ; mais se servant du vers célèbre il pourrait dire : « J’embrasse mon rival, mais c’est pour l’étouffer. »
L’art est toujours le résultat d’une contrainte. Croire qu’il s’élève d’autant plus haut qu’il est plus libre, c’est croire que ce qui retient le cerf-volant de monter, c’est sa corde. Or, sans corde, il ne pourrait pas s’élever. La colombe de Kant qui pense qu’elle volerait mieux sans cet air qui gêne son aile ne sait pas qu’il lui faut, pour voler, cette résistance de l’air où pouvoir appuyer son aile. C’est sur de la résistance de même que l’art doit pouvoir s’appuyer pour monter. Je parlais des trois unités dramatiques, mais ce que je dis à présent est vrai tout aussi bien pour la peinture, pour la sculpture, la musique et la poésie. L’art n’aspire à la liberté que dans les périodes malades ; il voudrait être facilement. Chaque fois qu’il est vigoureux, il cherche la lutte et l’obstacle. Il aime faire éclater ses gaines, et donc il les choisit serrées. N’est-ce pas dans les périodes où déborde le plus la vie, que sentent l’usage des formes les plus strictes les plus pathétiques génies ? De là l’usage du sonnet, lors de la luxuriante Renaissance, chez Shakespeare, chez Ronsard, Pétrarque, Michel-Ange même ; l’emploi des tierces-rimes par Dante ; l’amour de la fugue chez Bach ; cet inquiet besoin de la contrainte de la fugue dans les dernières œuvres de Beethoven. Que d’exemples citer encore ? Et faut-il s’étonner que la force d’expansion du souffle lyrique soit en raison de sa compression ; ou que ce soit la pesanteur à vaincre qui permette l’architecture ?
Le grand artiste est celui qu’exalte la gêne, à qui l’obstacle sert de tremplin. C’est au défaut même du marbre que Michel-Ange dut, raconte-t-on, d’inventer le geste ramassé du Moïse. C’est par le nombre restreint des voix dont il pouvait à la fois disposer sur la scène que, contraint, Eschyle dut d’inventer le silence de Prométhée lorsqu’on l’enchaîne au mont Caucase. La Grèce proscrivit celui qui ajouta une corde à la lyre. L’art naît de contrainte, vit de lutte, meurt de liberté.
L’artiste, s’applaudissant d’abord de faire gagner au drame en expression ce que le drame perdit aussitôt en beauté, diminua peu à peu l’espace qui sépare la scène de la salle. Évolution fatale, semble-t-il ; cette « distance » que réclamait Racine, entre le spectateur et la figure représentée, l’acteur aussi fit de son mieux pour la diminuer et pour humaniser le héros. Il rejeta tour à tour masque, cothurne, tout ce qui faisait de lui quelque chose d’étrange, et que l’on devait regarder, pour reprendre le mot de Racine, « d’un autre œil que nous ne regardons d’ordinaire les personnages que nous avons vus de près ». Il supprima jusqu’au costume de convention qui, sortant la figure dramatique de l’époque représentée, et l’abstrayant pour ainsi dire, n’en laissait précisément subsister que ce qu’elle a de général et d’humain. S’il y eut là progrès peut-être, ce fut du moins progrès bien dangereux. Sous prétexte de vérité, on rechercha l’exactitude. Costumes, accessoires, décors, s’efforcèrent de préciser le lieu du drame et le moment, sans souci qu’un Racine n’eût eu qu’un souci tout contraire. On lit dans Gœthe : « Il n’y a point, à proprement parler, de personnages historiques en poésie ; seulement, quand le poète veut représenter le monde qu’il a conçu, il fait à certains individus qu’il rencontre dans l’histoire l’honneur de leur emprunter leurs noms pour les appliquer aux êtres de sa création[3]. » Je prends ces lignes telles qu’elles sont citées par Victor Hugo dans une des notes de son Cromwell. « On s’étonne, dit-il, de lire ces lignes dans M. Gœthe. » Aujourd’hui, nous nous étonnons peut-être moins.
Mais l’auteur, dans ce cas, a contre lui l’acteur. Talma, devant jouer le Mahomet de Voltaire, crut bien faire d’étudier d’abord celui de l’histoire tout un mois. Il raconte lui-même comment, « ayant trouvé de trop grandes disparates entre celui qu’il avait conçu et celui que Voltaire lui présentait, il avait immédiatement renoncé à un rôle qu’il lui aurait été impossible de rendre sans sortir de la vérité ». Je cite le texte même des souvenirs de Guiraud ; je n’inventerais pas mieux. – Cela va bien parce que le Mahomet de Voltaire n’est pas une bonne pièce ; mais…… Lors d’une répétition de Britannicus, on reprochait à un de nos plus grands acteurs d’aujourd’hui de ne pas interpréter son rôle d’une manière conforme à celle que peut-être eût désirée Racine – « Racine ?… qui est-ce ? – s’écria-t-il. Moi je ne connais que Néron[4]. »
L’indispensable collaboration de l’acteur particularise donc où l’auteur généralisait. Je ne puis accuser l’acteur ; l’œuvre d’art dramatique n’est pas une œuvre d’abstraction ; les caractères sont prétexte à généralisation, mais sont toujours d’une vérité particulière ; et le théâtre, ainsi que le roman, est le lieu des caractères.
Mesdames et Messieurs, c’est une extraordinaire chose que le théâtre. Des gens comme vous et moi s’assemblent le soir dans une salle pour voir feindre par d’autres des passions qu’eux n’ont pas le droit d’avoir – parce que les lois et les mœurs s’y opposent. Je propose à votre méditation un mot extraordinaire de Balzac ; on le lit dans la Physiologie du mariage : « Les mœurs, – dit-il, – les mœurs sont l’hypocrisie des nations. » – Veut-il dire, peut-être, que ces passions, que représente l’acteur, ne sont pas en nous supprimées par les mœurs, mais cachées ? que nos mouvements mesurés ne sont que pour donner le change ? que c’est nous, qui sommes les comédiens (hypocritès en grec, vous le savez, veut dire acteur), que notre politesse n’est que feinte, et qu’enfin la vertu, cette « politesse de l’âme » comme l’appelle Balzac encore, que la vertu n’est qu’en décor ? Serait-ce de là que viendrait en partie notre plaisir au théâtre : entendre parler haut des voix qu’en nous la bienséance étouffe ? – Parfois – mais plus souvent l’homme regarde les passions sur la scène comme d’affreux monstres domptés. Il a cette admirable faculté de devenir bientôt ce qu’il prétend être et c’est là ce qui faisait écrire à Condorcet (je suis heureux de m’abriter derrière un nom si grave) : « L’hypocrisie des mœurs, vice particulier aux nations modernes de l’Europe, a contribué plus qu’on ne croit à détruire l’énergie de caractère qui distingue les nations antiques[5]. » L’hypocrisie des mœurs n’a donc pas toujours existé.
Oui, l’homme devient ce qu’il prétend être ; mais prétendre être ce que l’on n’est pas, c’est une prétention toute moderne ; précisons : c’est proprement la prétention chrétienne. Je ne dis pas que l’intervention de la volonté ne puisse rien dans la formation ou la déformation de l’être ; mais le païen ne croyait pas devoir être différent de ce qu’il était. L’être ne se banalisait pas, par contrainte, mais se poussait à bout, par vertu ; chacun n’exigeait de soi que soi-même, et s’apposait, sans se déformer, sur le dieu. De là le grand nombre de dieux ; aussi nombreux que les instincts des hommes. Ce n’était pas par libre choix que l’homme se vouait à tel dieu ; le dieu reconnaissait dans l’homme son image. Parfois il advenait que l’homme, lui, se refusait à la voir ; et le dieu, méconnu dans l’homme, se vengeait, comme il advient terriblement pour Penthée, dans les Bacchantes d’Euripide.
Les païens peu souvent considéraient les qualités de l’âme comme des biens qui pussent s’acquérir ; mais, ainsi que celles du corps, plutôt comme des propriétés naturelles. Agathocle était bon, Chariclès courageux, tout aussi naturellement que l’un avait l’œil bleu, l’autre noir. La religion, pour eux, ne dressait pas, au sommet d’une croix ou sur terre, devant eux, tel faisceau de vertus, tel fantôme moral auquel il importât de ressembler, sous peine d’être pris pour impie ; l’homme type n’était pas un, mais légion, ou plutôt il n’y avait pas d’homme type. – Le masque, dès lors sans emploi dans la vie, était réservé pour l’acteur.
Il importe lorsqu’on parle de l’histoire du drame – il importe avant tout de se demander : « Où est le masque ? – Dans la salle ou sur la scène ? – Dans le théâtre ? ou dans la vie ? » – Il n’est jamais qu’ici ou là. Les plus splendides époques de l’art dramatique, celles où le masque triomphe sur la scène, sont celles où l’hypocrisie disparaît de la vie. Au contraire, celles où triomphe ce que Condorcet appelle « l’hypocrisie des mœurs » sont celles même où l’on arrache le masque à l’acteur, où on lui demande, non plus tant d’être beau que d’être naturel ; c’est-à-dire, si je comprends bien, de prendre exemple sur les réalités, sur les apparences du moins, que le spectateur lui propose, – c’est-à-dire sur une humanité monotone ou déjà masquée. L’auteur, du reste, et qui se pique aussi de naturel, se chargera de lui fournir du drame à cet usage : un drame monotone, masqué – un drame enfin où le tragique de situations (car il faut toujours du tragique) remplacera peu à peu le tragique de caractères. – C’est une chose à considérer dans le roman naturaliste, celui qui prétend copier la réalité, cette inquiétante pénurie de caractères. Quoi d’étonnant ? Notre société moderne, notre morale chrétienne font tout ce qu’elles peuvent pour les empêcher. « La religion antique, écrivait déjà Machiavel, ne béatifiait que les hommes de gloire mondaine, comme les capitaines d’armée, fondateurs de république, tandis que la nôtre a glorifié plutôt les hommes humbles et contemplatifs que les actifs. Elle a placé le souverain bien dans l’humilité, dans l’abjection, dans le mépris des choses mondaines, tandis que l’autre le plaçait dans la grandeur d’âme, dans la force du corps et dans ce qui rend audacieux les hommes. La nôtre les veut forts pour endurer, non pour accomplir des actions fortes. » Avec de tels caractères – si ce sont là des caractères encore, quelles actions dramatiques restent possibles ? – Qui dit drame dit caractères, et le christianisme s’oppose aux caractères, proposant à chaque homme un idéal commun.
Aussi le drame purement chrétien à vrai dire n’existe pas. Les Saint-Genest, les Polyeucte peuvent bien s’intituler, s’ils veulent, drames chrétiens. Ils sont chrétiens en effet par tout l’élément chrétien qui y entre, mais ne sont drames qu’en raison de l’élément non chrétien que l’élément chrétien combat.
Une autre raison pour quoi le théâtre chrétien n’est pas possible, c’est que le dernier acte s’en passe de toute nécessité dans la coulisse, je veux dire dans l’autre vie. Gœthe l’a bien senti : c’est en plein ciel que s’achève le second Faust. C’est en plein ciel de même que se joue, je suppose, le sixième acte de Polyeucte, le sixième acte de Saint-Genest. Que si ni Corneille ni Rotrou ne l’écrivirent, ce n’est pas seulement par respect des trois unités, mais parce que Polyeucte, Pauline, Saint-Genest, laissant au seuil du paradis tomber toute la passion par quoi se soutenait le drame, chrétiens parfaits, complètement décaractérisés, n’ont, en vérité, plus rien à dire.
Mesdames et Messieurs, je ne propose pas un retour au paganisme. Je constate simplement de quoi meurt notre tragédie : de la disette de caractères. Le christianisme, hélas ! n’est pas seul responsable dans ce travail de nivellement qui faisait dire à Kirkegaard : « Le nivellement n’est pas de Dieu, et tout homme de bien doit connaître des moments où il est tenté de pleurer sur cette œuvre de désolation. » – À ceux sur qui les désirs sont vainqueurs, il n’est pas malaisé de croire aux dieux. Ils sont vrais dieux tant qu’ils gouvernent ; pour les convaincre de fausseté il est nécessaire déjà que l’unité d’une raison despote les supplante. C’est l’invention d’une moralité qui fit de l’Olympe un désert. Le monothéisme est en l’homme avant d’être dieu au dehors. C’est en lui-même qu’avant de projeter sa foi dans la nue l’homme sent un ou plusieurs dieux. Paganisme ou christianisme, c’est d’abord une psychologie, avant d’être une métaphysique. Le paganisme fut tout à la fois le triomphe de l’individualisme et la croyance que l’homme ne peut se faire autre qu’il est. Ce fut l’école du théâtre.
Mais, encore une fois, ce n’est pas l’impossible retour au paganisme que je viens proposer ici ; je ne viens pas non plus froidement constater la mort du théâtre – mais, par l’examen de ce qui de nos jours le tue, discerner ce qui le ferait vivre, car ce n’est pas la décadence de l’art dramatique, mais sa renaissance, à laquelle je crois et que j’entrevois, qui m’importe.
Le moyen d’arracher le théâtre à l’épisodisme, c’est de lui retrouver des contraintes. Le moyen de le faire habiter à nouveau par des caractères, c’est de l’écarter à nouveau de la vie.
Je dirais assez volontiers : Qu’on nous redonne la liberté des mœurs, et la contrainte de l’art suivra ; qu’on supprime l’hypocrisie de la vie, et le masque remontera sur la scène. Mais puisque les mœurs ne veulent encore rien entendre, alors donc que l’artiste commence. J’ai quelque espoir que les mœurs suivront ; voici pourquoi :
Il est évident que de nouvelles formes de sociétés, de nouvelles distributions de richesses, d’imprévus apports extérieurs sont pour beaucoup dans la formation des caractères ; mais je crois qu’on est porté à s’exagérer cependant leur importance formatrice : je la crois plutôt révélatrice simplement. Tout a toujours été dans l’homme d’une manière plus ou moins découverte ou cachée – et ce que les temps nouveaux y découvrent encore, éclot sous le regard, mais y sommeillait de tout temps. De même que je crois qu’il existe encore à notre époque des Princesse de Clèves, des Onuphre, des Céladon, je crois très volontiers qu’il existait déjà, bien avant qu’ils n’apparussent dans les livres, des Adolphe, des Rastignac, et même des Julien Sorel. Bien plus, je crois que, l’humanité l’emportant après tout sur la race, on peut trouver ailleurs qu’à Pétersbourg, je veux dire à Bruxelles ou à Paris, des Nejdanoff, des Muichkine et des Prince André. Mais, tant que les voix de ceux-ci n’ont pas retenti ou dans le livre, ou sur la scène, elles étouffent sous le manteau des mœurs, attendant leur heure. On écoute le monde, et on ne les entend pas, parce que le monde n’entend que ceux dont il reconnaît la voix, et parce que ces voix neuves sont étouffées. On regarde le manteau noir des mœurs, et on ne les voit pas ; bien mieux – bien pis, veux-je dire – ces formes neuves de l’humanité ne se connaissent pas elles-mêmes. Que de Werther secrets s’ignoraient, qui n’attendaient que la balle du Werther de Gœthe pour se tuer ! Que de héros cachés qui n’attendent que l’exemple du héros d’un livre, qu’une étincelle de vie échappée à sa vie pour vivre, que sa parole pour parler ! N’est-ce pas là, Mesdames et Messieurs, ce que nous espérons du théâtre : qu’il propose à l’humanité de nouvelles formes d’héroïsme, de nouvelles figures de héros ?
Et je rencontre ici une dernière difficulté : notre société ne permet guère aujourd’hui qu’une seule forme d’héroïsme (si c’est de l’héroïsme encore) : l’héroïsme de résignation, d’acceptation. Voilà pourquoi, lorsqu’un puissant créateur de caractères comme Ibsen étend sur les figures de son théâtre le triste manteau de nos mœurs, il condamne du même coup ses plus héroïques héros à la banqueroute. Oui, son admirable théâtre, forcément, ne nous présente d’un bout à l’autre que des banqueroutes d’héroïsme. Comment eût-il fait autrement, sans s’éloigner de la réalité – puisque aussi bien, si la réalité permettait l’héroïsme – j’entends l’héroïsme apparent, théâtral – on le saurait. Voilà pourquoi cette tâche hardie de Pygmalion, de Prométhée, je la crois réservée à ceux qui délibérément feront un fossé de la rampe, écarteront à neuf de la scène la salle, de la réalité la fiction, du spectateur l’acteur et du manteau des mœurs le héros.
Voilà pourquoi mes yeux se tournent pleins d’attente et de joie vers ce théâtre non joué dont je vous parlais tout à l’heure, vers ces pièces, d’année en année plus nombreuses et qui bientôt j’espère trouveront une scène où monter. Chaque tour de roue de l’histoire porte au jour ce qui la veille était invisible dans l’ombre. « Le temps lent et infini, dit l’Ajax de Sophocle, manifeste à la lumière toutes choses cachées, et cache les choses manifestes, et il n’est rien qui ne puisse arriver. » Nous attendons de l’humanité des manifestations nouvelles.
Parfois ceux qui prennent la parole la gardent terriblement longtemps ; des générations muettes encore cependant s’impatientent en silence. Il semble que ceux qui parlent se rendent compte, malgré la prétention qu’ils ont de représenter toute l’humanité de leur temps, que d’autres attendent et qu’après que ces autres auront pris la parole eux ne l’auront plus… de longtemps. La parole aujourd’hui est à ceux qui n’ont pas encore parlé. Qui sont-ils ?
C’est ce que nous dira le théâtre.
Je songe à la « pleine mer » dont parle Nietzsche, à ces régions inexplorées de l’homme, pleines de dangers neufs, de surprises pour l’héroïque navigateur. Je songe à ce qu’étaient les voyages avant les cartes et sans le répertoire exact et limité du connu. Je relis ces mots de Sindbad : « Nous vîmes alors le capitaine jeter à terre son turban, se frapper la figure, s’arracher la barbe, se laisser choir au beau milieu du navire, en proie à un chagrin inexprimable. Alors tous les passagers et les marchands l’entourèrent et lui demandèrent : Ô capitaine ! quelle nouvelle y a-t-il donc ? Le capitaine répondit : Sachez, bonnes gens ici assemblés, que nous nous sommes égarés avec notre navire, et nous sommes sortis de la mer où nous étions, pour entrer dans une mer dont nous ne connaissons guère la route. » Je songe au vaisseau de Sindbad, – et qu’en quittant la réalité le théâtre aujourd’hui lève l’ancre.
[1] Quatre conférences furent prononcées cette année à la Société de la Libre Esthétique. Les trois premiers conférenciers s’étant occupés de l’évolution de la poésie, de la peinture et de la musique, je fus invité à parler sur l’évolution du théâtre. Il me parut ensuite que cette conférence, en guise de préface, ici, ne paraîtrait pas déplacée.
[2] Ces préoccupations existent, il est vrai, pour le roman aussi ; mais, outre qu’elles y sont beaucoup moins nuisibles, parce que le roman est une espèce littéraire indécise, multiforme, et omnivore, le romancier qui se laisse guider par elles s’échappe de la littérature d’une manière plus avérée. Et de quelque outrecuidante réclame qu’il le fasse précéder ou suivre, un mauvais livre écrit pour la vente ne se présente pas, après tout, d’une manière beaucoup plus impertinente qu’un bon. Bien mieux : le puffisme même avertit ; quand un Champsaur fait annoncer que son Arriviste, dès avant la mise en vente, en est à son… XXXème mille, le public sait à quoi s’en tenir et sur le livre et sur l’auteur. Le roman n’en impose jamais comme l’œuvre théâtrale en impose ; le dramaturge n’est du reste jamais seul en cause, mais aussi les acteurs, et le directeur, et ses frais. Un critique littéraire sérieux ne lit même pas les livres de médiocrité équivalente à celle des pièces auxquelles nos premiers critiques dramatiques croient devoir consacrer plusieurs colonnes.
[3]Ueber Kunst und Alterthum.
[4] On s’indigne beaucoup de l’orgueil des acteurs. Il me semble assez naturel, et je trouve que les artistes en parlent bien à leur aise, eux dont l’œuvre prétend à une éternité de durée. Le comédien ne peut créer que d’éphémères figures, semblables à ces statues de neige que Pierre de Médicis força Michel-Ange de modeler, dans ses jardins tout un hiver. Je me souviens des mots d’un grand acteur qui, dans sa loge, un soir, alla gifler un illustre critique dont un feuilleton l’avait, le matin même, injustement malmené, prétendait-il. « Messieurs les écrivains, lui dit-il, votre œuvre a le temps devant soi ; mais nous acteurs, si vous, écrivains, ne nous rendez pas justice le jour même, à quel tribunal en appellerons-nous ? – et qu’est-ce que pourra penser de nous l’avenir ? »
Faut-il s’étonner si l’acteur tâche, et tâche avant tout d’exister ; fût-ce parfois aux dépens de l’auteur.
[5] Vie de Voltaire.