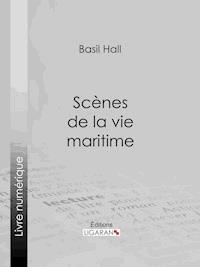
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Diverses circonstances concoururent à me donner de très bonne heure ce qu'on appelle « le goût de la mer ». En premier lieu, ma mère me mit au monde au bruit d"une tempête. Telle était la violence du vent, la pluie battait les murailles et le toit avec une telle force, qu'on se préparait à transporter l'accouchée dans une partie plus solide de notre demeure, qui tremblait du grenier à la cave."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU TRADUCTEUR.
L’auteur de ces esquisses, contemporain et compatriote de sir Walter Scott, a conquis dans les trois royaumes une renommée égale à celle des romanciers de la vie maritime. Le capitaine Basil Hall n’a cependant jamais recours aux artifices de la fiction pour nous intéresser. Tout est vrai dans ses récits, les faits et les descriptions. Le naturel du style ajoute encore à ce charme de vérité si rare aujourd’hui dans la littérature et les arts.
Voici déjà plusieurs années que je révélai ce talent original aux lecteurs français par des fragments insérés dans la Revue dont j’étais le directeur. Un de mes collaborateurs réunit depuis ces extraits en un corps d’ouvrage qui parut sous le litre de Mémoires et Voyages, formant quatre volumes in-8°, qu’on ne trouve plus dans le commerce. En réimprimant aujourd’hui les Scènes de la vie maritime, j’ai cru pouvoir en élaguer quelques chapitres. Un volume à part contiendra les souvenirs du voyage aux Indes. Les deux ouvrages, quoique parfaitement distincts, se complètent néanmoins l’un par l’autre.
Le capitaine Basil Hall a bien voulu approuver dans le temps cette traduction, dont la grande difficulté consistait à trouver les équivalents français des termes techniques de la marine anglaise. Malgré les conseils que voulut bien me donner un confrère de l’indulgent capitaine, je ne doute pas que quelques inexactitudes ne puissent être encore relevées par les critiques compétents ; mais j’espère aussi que le mérite de l’ouvrage triomphera une fois, encore de ce qui n’a point empêché le succès des éditions précédentes.
AMÉDÉE PICHOT.
Paris, mai 1853.
Diverses circonstances concoururent à me donner de très bonne heure ce qu’on appelle « le goût de la mer. » En premier lieu, ma mère me mit au monde au bruit d’une tempête. Telle était la violence du vent, la pluie battait les murailles et le toit avec une telle force, qu’on se préparait à transporter l’accouchée dans une partie plus solide de notre demeure, qui tremblait du grenier à la cave. En effet, les mugissements des vagues sur la côte voisine, le sifflement de l’ouragan dans la forêt, l’ébranlement de la maison, firent, dans cette nuit mémorable, une impression si vive sur tous ceux qui étaient là présents, qu’aussitôt que je fus en âge de comprendre la parole, tout ce que j’entendis raconter de ma naissance commença à jeter dans mon esprit les semences de ma vie future. Longtemps avant que je me fusse embarqué dans mes premières culottes, je pressentis que ma destinée serait de vivre sur la mer ; et, comme chacun m’encourageait dans cette sorte d’instinct, je grandis avec la presque certitude d’être marin, comme un fils aîné grandit, en Écosse, avec celle de devenir le propriétaire du champ paternel, parce que cet enfant sait bien vite qu’il jouira un jour, grâce au code du pays, du privilège de la substitution.
Lorsque je fus mis au collège d’Édimbourg, je passais mes vacances à la campagne sur une des côtes d’Écosse les plus propres à favoriser les inclinations nautiques. Pendant les longs et ennuyeux mois qui précédaient et suivaient ces six semaines délicieuses de liberté, au lieu de condamner mon intelligence à comprendre les règles abstraites de la grammaire, unique but que se proposait dans la vie notre digne professeur, je retournais, par l’imagination, à cette côte rocailleuse, à ces grèves pittoresques, à ce rivage bordé de fer, comme on l’appelle dans la langue maritime, le long duquel j’errais avec tant de bonheur pendant mes douces vacances.
Le contraste qui s’offrait sans cesse à ma pensée entre la routine boiteuse de la discipliné scolastique et la glorieuse liberté de la plage, me privait même de presque tout l’intérêt que j’aurais pu trouver dans les jeux qui remplissaient l’intervalle des classes pour les autres enfants. À force de rouler nuit et jour dans ma tête ces idées, je devins sombre et si malheureux, que le simple souvenir de ce que j’éprouvais alors me fait souvent frissonner, quoique plus de trente ans aient passé depuis sur ma tête. Le maître de ma classe était, je crois, aussi brave homme qu’on peut l’être ; mais il se serait cru bien coupable envers sa profession, qu’il estimait la première du monde, s’il avait toléré qu’aucun écolier eût un grain de sensibilité de plus ou une plus grande indépendance de pensée que ses camarades. Encore moins pouvait-il comprendre qu’aucun de nous prétendit avoir des caprices d’imagination dont l’objet fût situé au-delà des limites de la cour de récréation.
Une seule fois, pendant mon séjour dans ces « limbes, » comme les catholiques d’Espagne appellent le purgatoire des enfants, il me fut adressé quelques paroles de bienveillance par le chef du collège. Il me prit à part, et, d’un ton si peu usité dans le gouvernement despotique des écoles, qu’il me fit tressaillir, il me dit : « Comment se fait-il, mon enfant ; que vous soyez toujours si mélancolique, et qu’on ne vous voie jamais jouer avec les autres ? » Je lui répondis que la réclusion du collège était trop triste ; que je ne pouvais souffrir d’être toujours traité comme si je n’avais pas des idées à moi et un instinct particulier à suivre ; que ce n’était pas du nombre des heures des classes que je me plaignais, mais de leur distribution gênante, etc. « Laissez-moi, monsieur, lui dis-je, choisir mes heures et mes sujets d’étude, et je travaillerai de bon cœur, même plus longtemps. »
Il sourit, me donna une petite tape caressante sur la tête, et me fit observer que les heures et la discipline de la maison ne pouvaient être changées pour faire plaisir à un enfant capricieux. Je le savais déjà, et n’étais pas absurde au point de supposer qu’une école publique pût se régler sur mes idées de visionnaire ; tout ce que je demandais, c’était qu’on eut quelques égards pour mon caractère, et qu’on fît quelquefois plier la règle devant une exception.
Quelques fausses idées de l’avenir troublaient aussi ma jeune tête ; car je ne pouvais avoir des idées bien justes du bonheur et de la liberté, d’un monde que je ne connaissais que par ouï-dire. Il me tomba un jour sous les yeux l’ode de Gray, « Sur une vue lointaine du collège d’Éton, » poème rempli sans doute d’images très poétiques, beau d’expression et de pensées, mais plus propre à faire naître le découragement que l’espérance, en nous disant que les jours du collège sont incontestablement plus heureux que ceux de la vie ultérieure. Je ne sais ce que les progrès des lumières ont pu produire depuis lors pour y remédier ; mais de mon temps, et dans le collège où j’étais, l’époque de l’enfance, pour moi du moins, était si triste, que je me souviens, après avoir lu l’ode en question, de m’être écrié avec désespoir : « S’il est vrai que la vie hors du collège doive être plus malheureuse que celle-ci, hélas ! fi quoi bon venir au monde ? »
C’est avec cette disposition mélancolique que je lus maint autre poète ou prosateur, et, à mon grand mécontentement, je trouvai très rarement dans ces livres une perspective plus consolante. Il m’a fallu bien des années de vicissitudes et d’épreuves dans la vie actuelle pour découvrir la fausseté de presque toutes ces assertions sur le bonheur comparatif de l’école, et pour me convaincre que tout dépend essentiellement de nous-mêmes, puisque, dans tout le cours de nos années, la somme exacte de notre bonheur correspond au degré de bonne humeur avec lequel nous remplissons nos devoirs. Il m’a toujours semblé que c’était calomnier notre nature et mésuser des dons de la Providence que de déclarer que les premiers jours de la vie doivent nécessairement être les plus heureux. Le vrai, le grand jour de la vie doit se trouver à une époque plus avancée, lorsque les facultés de l’homme sont, beaucoup plus mûres, et la volonté laissée libre.
Quoi qu’il en soit, je ne perdais jamais une minute pour m’éloigner du collège, dès que nos examens annuels étaient terminés. On s’imagine bien que je ne jouais jamais un rôle bien brillant dans ces épreuves périodiques. Je me contentais de me placer un peu au-dessus du milieu, en partie parce que là aussi se tenaient quelques écoliers que j’aimais, et en partie parce que le banc qui nous était réservé se trouvait près du feu. Aussitôt que le terme de ma captivité était expiré, je courais au bureau de la diligence, et je ne me sentais parfaitement satisfait qu’une fois bien assis sur l’impériale, « à côté de mon ami le garde, » et roulant sur la grande route. Arrivé à la campagne, mon premier soin était toujours d’aller chercher sur la plage quelques pêcheurs, qui s’engageaient volontiers à me faire faire une promenade en mer le lendemain matin. Après une nuit de plaisirs anticipés, je me voyais ordinairement, au lever du soleil, dans un bateau de pêche, à une demi-lieue de la côte, entouré d’esprits sympathiques, je veux dire de compagnons qui n’avaient aucune idée de grammaire, et qui consentaient, soit pour mon argent, soit pour reconnaître l’estime que je faisais de leur profession, à me considérer comme quelqu’un, et non plus comme un simple zéro, ne servant qu’à faire nombre dans l’école, sans avoir aucune valeur par moi-même.
À tout évènement, ces braves gens s’amusaient tant de mon enthousiasme pour leur métier, qu’ils prenaient plaisir à nourrir ma jeune imagination du récit des périls et des travaux de la vie navale, dont la joyeuse agitation rejetait dans l’ombre d’un triste contraste les ennuyeuses règles de la syntaxe. Dans ces expéditions, néanmoins, j’étais toujours cruellement tourmenté du mal de mer, car on devine bien que les bateaux de nos pêcheurs n’étaient pas aussi commodes qu’un bâtiment de guerre ; et ils contenaient généralement une telle dose d’eau saumâtre et de débris de poissons pourris, que mon goût pour la mer avait souvent à lutter désavantageusement contre la révolte de mon estomac : je dois même avouer que je sortis plus d’une fois du bateau, enchanté d’appuyer le pied sur la terre ferme, et de respirer une atmosphère moins poissonneuse, et faisant du bout des lèvres le serment qu’on ne m’y prendrait plus.
Mais cette légère infidélité à mon élément chéri n’était que passagère ; car elle durait rarement au-delà du temps qu’il fallait pour gravir l’extrême bord du banc à pic qui formait, le rempart de la côte. De cette hauteur la vue s’étendait d’un côté jusqu’au golfe de Forth, avec mainte montagne au-delà, et l’océan Germanique sous mes pieds, tandis que de l’autre, dans la direction du levant, j’apercevais le noble promontoire appelé Fast-Castle, et mieux connu sous le nom de « Rocher du Loup (Wolf crag) » dans le roman de la Fiancée de Lammermoor. Pour ma jeune imagination, c’était là le plus sublime des sites du monde ; aujourd’hui même, après avoir erré pendant plus d’un quart de siècle sur la surface du globe, et vu de mes yeux quelques-uns des plus beaux spectacles de la nature, je n’ai rien changé à cette opinion, si ce n’est que j’admire ce site davantage encore. Dans le fait, il finit en général beaucoup de temps et des moyens multipliés de comparaison pour arriver à une juste conception de ce qui est vraiment grand et beau, et pour apprécier comme tel ce qui souvent se trouve à notre porte. Cela s’applique à d’autres choses peut-être que le paysage ; mais ce n’est que du paysage que je veux parler aujourd’hui, et certainement on ne peut rien imaginer de plus remarquable que la vue dont on jouit du lieu en question. La mer, étant sur cette côte une grande route commerciale, est communément couverte de vaisseaux de toutes les formes, de toutes les dimensions, et je pourrais, ajouter de toutes les couleurs ; car, ce que la lumière et les ombres du ciel ne font pas, les marins le font eux-mêmes en bariolant leurs voiles et en peignant leurs navires. Tandis que tous ces bâtiments passaient et disparaissaient à mes yeux, les uns après les autres, au-delà de l’horizon, j’éprouvais le plus vif désir de les suivre sur ces vastes mers dont j’avais lu tant de récits, où l’on perd la terre de vue pendant des mois entiers, où chaque nouvelle nuit nous apporte de nouvelles étoiles, où chaque oiseau et chaque poisson, aussi bien que chaque souffle d’air, indiquent un autre climat et presque un autre monde.
En attendant, mes opérations en matière maritime étaient nécessairement limitées à la mare de la ferme, où, assisté d’un obligeant garçon charpentier, je me hasardai à tenter mon premier voyage. Notre vaisseau consistait en deux ou trois soliveaux et quelques planches liées ou clouées en travers. Nous eûmes bientôt trouvé notre mât en enlevant un poteau à la clôture la plus voisine ; mais il fut beaucoup plus difficile de se procurer une voile ; car la toile était une matière trop au-dessus de nos finances et de notre crédit. Enfin mon ingénieux compagnon, qui, soit dit en passant, se distingua plus tard comme constructeur de navires, me suggéra l’idée d’employer une des couvertures dont le jardinier se servait pour protéger ses plantes contre le froid. C’est ainsi que peu à peu notre brave vaisseau fut enfin construit et gréé. Tout étant prêt le second jour, de nos travaux, et le vent favorable, nous partîmes d’une extrémité de cette mer Méditerranée ; après un heureux voyage de dix minutes, et « par la grâce de Dieu, » pour me servir du style des connaissements ou lettres de cargaison, plutôt que par notre habileté, nous abordâmes à l’autre extrémité, sans aucune avarie sérieuse.
Le plaisir que ce voyage primitif me causa n’a guère été surpassé depuis. C’était le premier bonheur sans mélange que j’eusse éprouvé, et il m’ouvrait tout à coup une nouvelle perspective d’espoir et de résolution, qui me rendit le lourd fardeau de la vie de collège un peu moins intolérable qu’auparavant. Après cet essai, on devine quels voyages au long cours fit ma jeune imagination, évoquant tour à tour les périls et les jouissances de la mer, le capitaine Cook et Robinson Crusoé, dont je me figurais être l’émule et le continuateur.
Je ne pouvais guère penser alors que les réalités de la vie atteindraient jamais à ces rêves de l’imagination. Et cependant, quelque enthousiaste que je fusse, je n’ai cessé de rencontrer depuis, dans mes courses à travers le monde, des choses plus curieuses, et, sous tous les rapports, plus intéressantes que celles que j’attendais ; ou, si l’objet, de ma curiosité m’a quelquefois déçu, je me suis mis à en poursuivre un autre, qui a toujours fini par récompenser et au-delà ma nouvelle ardeur. Déjà, dans mon enfance, chaque année de nouveaux incidents, la plupart tristes et décourageants, il est vrai, venaient entretenir cette curiosité insatiable sur la côte où je passais mes vacances. À dix lieues, ou à trente milles géographiques, de la maison où j’étais né, est situé le Bell-Rock, juste au-delà de l’embouchure du Tay, tout près du bord septentrional du grand détroit appelé le Firth, ou golfe du Forth. À l’époque dont je parle, Bell-Rock passait avec raison pour un des plus formidables écueils qu’eussent à rencontrer les navigateurs de ces mers ; car sa tête restait plongée sous les flots pendant la plus grande partie de la marée montante, et il ne se révélait jamais en aucun temps sur sa surface. Tout ce qu’on pouvait faire était de se garder de son approche, ou, comme disent les marins, de laisser au récif un large cadre. En conséquence, les navires, dans leur continuelle terreur de ce fatal rocher, ne se contentaient pas de mettre entre eux et lui un espace de dix ou même de vingt milles, mais ils s’écartaient de plus en plus vers le sud, de manière à coudoyer le rivage ; aussi, lorsque le Vent tournait subitement au nord, comme il arrivait souvent, les marins trop prudents s’exposaient à s’engager dans une baie profonde, à l’ouest de Fast-Castle. Si la brise fraîchissait avant qu’ils pussent tirer au large, ils payaient cher leurs appréhensions du Bell-Rock, en heurtant sur des bas-fonds aussi dangereux, beaucoup plus étendus et inévitables. C’est ainsi qu’à cette époque, trois, quatre et quelquefois six navires faisaient ordinairement naufrage, chaque hiver, à un mille ou deux de notre porte.
Il n’est pas beaucoup de spectacles qui parlent plus à l’imagination qu’un vaisseau échoué sur une côte, et surtout sur une côte comme celle-là, bordée de récifs qui s’étendent au loin et n’offrent aucun abri. Le malheureux vaisseau reste démâté, battu par les vagues, avec son équipage au désespoir se cramponnant aux mâtures ou aux agrès, et poussant des cris de détresse qui se perdent dans le mugissement de la mer, tandis qu’à chaque nouvelle lame diminue le nombre des naufragés, jusqu’à ce qu’ils disparaissent tous : enfin le brave navire est mis en pièces, et la côté, sur une lieue d’étendue, se couvre de planches et de mâts brisés, de caisses entrouvertes, et de tous les débris de la précieuse cargaison, sous le fret de laquelle quelques heures auparavant le vaisseau voguait avec assurance et fierté sur la plaine des flots.
Mais ce serait bien se méprendre que de supposer que le spectacle de ces désastres, et encore moins la description des périls de la navigation, puissent en rien détourner une jeune tête de sa préférence instinctive pour une profession qui offre des séductions aussi vives et aussi variées que celle du marin. Quant à moi, chaque nouveau naufrage dont j’étais témoin ne servait qu’à m’exciter de plus en plus à poursuivre le but de tous mes rêves.
Je me souviens cependant d’avoir éprouvé une émotion solennelle, qui parfois approchait de la terreur, en voyant les vagues se dresser sur ces malheureux navires dévoués au naufrage, et les fracasser peu à peu, à mesure que la marée avançait. Mais il y avait au fond de mon cœur une confiance et un charme inconnus qui l’emportaient sur ces faiblesses passagères. On raconte encore aujourd’hui parmi nos pêcheurs une histoire dont je suis le héros. Je contribuai, selon eux, à sauver un équipage, en engageant quelques hommes de la campagne à transporter sur une charrette un bateau qu’il fallait aller chercher de l’autre côté de la montagne. On ajoute que je n’avais que quelques sous dans ma poche, et que, l’offre de cet argent ne pouvant suffire pour déterminer le charretier à se détourner de sa route, je déclarai hardiment que j’étais autorisé par mon père à pro mettre cinq guinées. Alors le charretier consentit à laisser mettre la cargaison inaccoutumée sur sa voiture, et le bateau arriva à temps. Je n’ai aucun souvenir, je l’avoue, de cet incident ; mais quelque chose de ce genre pouvait bien avoir eu lieu ou être supposé même par les pêcheurs mes bons amis et mes admirateurs. Ce qu’il y a de certain, c’est que, ne me sentant pas avec eux un être aussi inutile au monde que je le paraissais au collège, je dus m’attacher par des liens de plus en plus forts à la profession que je m’étais choisie.
Les générations futures de ma famille n’auront plus ce triste motif d’encouragement pour ceux de leurs enfants qui se destineront à la marine ; les naufrages dont j’étais si souvent le témoin ne se renouvellent guère plus, heureusement pour le commerce et l’humanité. Le fatal Bell-Rock, cause indirecte de tant de malheurs, a été dernièrement converti en une des plus précieuses sécurités que puisse recevoir la navigation. La science, à force de persévérance, est parvenue à ériger un phare de cent vingt pieds de haut sur ce formidable récif. Le nocher, au lieu de faire tout son possible pour éviter le Bell-Rock, se félicite lors qu’il peut apercevoir l’étoile tournante qui brille à son sommet, et que la diversité de ses couleurs fait aisément distinguer. Grâce à cette clarté amie, il peut se diriger en toute sûreté vers le port, malgré la nuit la plus obscure.
En revenant de ces scènes d’une vie active à la plus pittoresque des cités, la vieille ville d’Édimbourg, j’étais plongé dans les ténèbres dix fois épaisses de mon collège. Le hasard me fit tomber un jour sur le passage où Shakespeare décrit le mousse qui dort à la cime du mât. Cette idée allait si bien à l’imagination d’un futur marin, elle me parut si poétique, comme elle l’est réellement, que je n’eus pas de repos que je ne me fusse procuré un exemplaire de tout le théâtre du poète. Je le lus d’un bout à l’autre, au grand dommage, j’ai presque honte de le dire, de tout le petit respect que je pouvais avoir pour les classiques. J’eus bientôt appris par cœur « la Tempête, » la partie nautique principalement, et je jurai une éternelle amitié au contremaître de la pièce, dont le savoir, par parenthèse, quelque étrange qu’il soit, est sur tous les points parfaitement correct. Où Shakespeare a-t-il pris tout cela ?
En ce temps-là aussi, alors que mon imagination faisait un bizarre amalgame de naufrages vrais ou supposés avec les difficultés de la syntaxe latine, un jour de promenade, je rencontrai mon père dans la rue, près de la maison de feu lord Duncan.
« Je vous trouve à propos, mon petit maître matelot, me cria-t-il ; je veux, vous faire voir le héros de Camperdown. »
Je fus donc présenté comme un futur camarade à ce grand capitaine, dont le noble aspect était si bien d’accord avec sa haute renommée, que je sentais croître de plus en plus mon respect pour lui.
« Vous n’avez pas mauvais goût de vouloir être marin, jeune homme, me dit Sa Seigneurie avec bienveillance, et, si vous voulez venir avec moi, je vais vous montrer quelque chose pour vous engager à persister dans votre vocation. »
Ce disant, il me conduisit dans une autre pièce où était suspendu un pavillon qu’il avait pris à l’amiral de Winter, le 11 octobre 1797. Je ne pouvais voir ce trophée sans intérêt ; mais je fus plus enchanté encore de la franchise et de la bienveillance du vieux marin. Je ne pus m’empêcher de penser que, si un tel homme croyait pouvoir faire attention à un enfant, cet enfant avait, droit à un peu plus d’égards qu’on ne lui en témoignait au collège. Je me souviens que, le lendemain matin, je répandis un torrent de larmes en rentrant, après ce jour de congé, dans le lieu que je regardais comme une prison, et où je comparais la réception du maître de la classe avec celle de l’amiral.
À quelque temps de là, un autre jour de congé, je rencontrai le professeur Playfair, de l’université d’Édimbourg, dans une maison de campagne. Ce philosophe, aimable et savant, avait le bonheur rare d’être également chéri de la jeunesse et des vieillards. Il gagnait l’affection des enfants non seulement par l’incomparable douceur de son caractère, mais encore par les encouragements généreux qu’il donnait à leurs dispositions naissantes, tandis que, parmi les érudits et les hommes de lettres, il ne se faisait pas moins admirer par l’étendue et la variété de ses connaissances que par la facilité, la clarté et l’éloquence de son expression, quand il parlait des sciences les plus abstraites.
Je le trouvai, un matin, assis par terre, prenant la hauteur du soleil avec un quart de cercle ou sextant de poche, au moyen d’un horizon artificiel, qu’il avait composé en répandant un peu de thériaque dans un vase. Lui ayant témoigné la plus vive curiosité de savoir quelle opération magique l’occupait, il m’expliqua tout de suite ou plutôt essaya de m’expliquer l’objet de ses recherches. Au lieu de couper court à mes questions en me répondant que la chose était au-dessus de ma portée, il s’interrompit, et chercha à me faire comprendre jusqu’à quel point ces observations se rattachaient aux besoins de la vie navale. Le lendemain, il me donna un exemplaire de l’Astronomie de Bonnycastle, que je possède encore, et je crois pouvoir faire dater de cette conversation mon goût pour l’astronomie nautique, étude qui a été pour moi une source continuelle de vives jouissances, et qui (on le verra par la suite) me fut, de plus, d’un grand secours dans ma profession. Mais il est temps de sortir du collège, et de raconter ma première campagne…
Je serais fâché si ce que je viens de dire engageait quelque écolier paresseux à choisir comme remède une profession aussi dure que celle de marin. Il serait bon qu’il eût pour la préférer à une autre quelques motifs plus sérieux. Quant à moi, je ne doute pas que notre système de discipline collégiale n’ait subi d’utiles améliorations ; et j’avoue en outre qu’à l’époque même de mes études, si je n’étais pas content, la faute en était plus à l’écolier qu’à l’école ; mais j’ajouterai que j’avais la tête si remplie de voyages, que, même si j’avais eu l’honneur d’être élevé à Éton avec toute la jeune noblesse d’Angleterre, j’aurais encore soupiré après le jour de ma sortie définitive.
Il est clair qu’aucun enfant, quelque instruit qu’on le suppose, ne saurait se former une idée correcte de la profession qu’il veut embrasser. Or, il n’est aucun métier où le désappointement soit aussi grand que celui du marin, parce qu’il n’en est aucun dont l’imagination se fasse un tableau plus poétique avant de le connaître par expérience ; ai-je besoin de dire quel contraste il y a entre le bien-être ou les comforts du chez soi et les discomforts du navire ? sans parler de la mauvaise chère, des pénibles travaux, du mal de mer et de la discipline.
Dans la plupart des autres carrières, on peut calculer d’avance avec plus ou moins de précision les inconvénients et les peines que rencontrera un jeune homme ; mais qui dira ce qui attend le marin dans sa vie aventureuse ? il faudrait parcourir en imagination le globe entier pour en rappeler une partie : il peut se perdre sur un vaisseau à trois ponts, ou être entassé dans un canot comme un hareng ; il peut être rôti à la Jamaïque, ou gelé au Spitzberg ; il peut être en croisière ou prendre part à une action six jours de suite au milieu d’une flotte, et rester isolé tout le septième ; il peut aller consumer au loin ses plus belles années dans d’ennuyeux loisirs, ou être employé sur les côtes du pays natal ; il peut recevoir des nouvelles de ses amis tous les jours, ou, comme il m’est arrivé une fois, rester quinze mois sans lire une lettre ou une gazette. Il peut avoir un commandant trop facile, ce qui est un grand mal, ou tomber sous un de ces capitaines toujours de mauvaise humeur qui, pour parler l’argot des midshipmen, retiennent chacun à bord « avec la crainte du Seigneur et du manche à balai. » Bref, il peut naviguer vingt ans sans trouver deux jours et deux visages semblables. Tout cela, fort agréable pour quelques esprits, ne laisse pas que d’en contrarier beaucoup d’autres : les tempéraments débiles y succombent généralement, et les âmes faibles se troublent de cette complication d’évènements et d’une existence si sévère. Mais, d’un autre côté, telle est la variété des objets sur la mer, que, si un jeune homme est seulement assez robuste pour supporter la veille du quart et autres fatigues indispensables, s’il a d’ailleurs un caractère assez fort pour persévérer, dans l’espoir de voir un jour s’offrir à lui l’occasion d’utiliser ses talents naturels ou son zèle, il se félicite enfin de n’avoir pas cédé au premier découragement et de n’avoir pas prématurément battu en retraite.
J’ignore ce que d’autres ont éprouvé en ces occasions ; mais je dois confesser qu’en dépit de tout mon enthousiasme, quand vint le jour de quitter tout de bon ma famille et mes amis pour me lancer irrévocablement et seul dans une vie nouvelle, je ressentis une défiance de moi-même et une inquiétude si imprévues, que je ne savais qu’en penser. J’avais choisi moi-même mon état, il est vrai ; je n’avais jamais cessé de soupirer après mon départ du collège : et cependant, le moment arrivé, je regrettai presque d’avoir été pris au mot. Pour la première fois, j’apprenais le sens du mot responsabilité, et j’avais devant les yeux toute la honte qui suit la non-réussite. Moi, dont toutes les pensées au collège me transportaient d’avance dans les régions inconnues pour lesquelles j’allais me mettre en route, je sentis mon cœur défaillir en entendant s’arrêter devant la porte la voiture où je devais entrer. « Que deviendrai-je, me dis-je, si les descriptions sombres de ces mélancoliques auteurs appelés poètes sont de véritables tableaux de la vie, si notre existence d’ici-bas n’est qu’une succession de malheurs, si la carrière du marin ne vaut pas mieux que la prison du collège ? Quelle figure ferai-je lorsque, de détresse en détresse, je me verrai réduit à supplier mon père de me rappeler sous le toit paternel pour y manger le pain de la paresse, ou pour chercher dans une autre profession des ennuis non moins grands que ceux de la mer et de la classe ? »
J’eus bien soin toutefois de ne laisser rien paraître de ces doutes alarmants ; mais ce fut le cœur gros que je pris congé de ces lieux chéris où j’avais passé de si heureuses vacances, et qui me semblaient les plus beaux sites du monde ; opinion dont mes longs voyages, je l’ai déjà dit, ne m’ont pas fait revenir. Naturellement, j’eus une dernière entrevue avec mes amis les pêcheurs, que j’avais longtemps crus les hommes les plus instruits de ma connaissance, uniquement parce qu’ils en savaient plus long que moi sur les câbles et sur les termes de marine. Je ne puis dire que ces braves gens aient soutenu la contre-épreuve de mon retour aussi heureusement que la côte pittoresque près de laquelle ils demeuraient. Je me souviens qu’après ma première campagne, je descendis sur la grève en uniforme et non sans un petit mouvement de vanité pour montrer ma supériorité navale à ces pauvres amis, qui, pendant cet intervalle, étaient restés en quelque sorte fixés à leurs rochers, comme leurs coquillages. Leur accueil fut très flatteur pour moi ; mais leur connaissance bornée des détails de leur profession me fit souvenir avec étonnement du temps où je les avais admirés comme des maîtres dans la science nautique.
Le 16 mai 1802, je partis pour Édimbourg, et mon père me dit le lendemain : « Vous êtes maintenant à flot dans le monde ; il faut tenir un journal : voici un cahier de papier blanc et une plume pour commencer. » Je vais transcrire un spécimen de ce début, que je ne croyais guère destiné à l’honneur de l’impression.
« 17 mai : – Départ pour Londres. – Déjeuner à Dunglas et changement de chevaux. – Belford : changé de chevaux. – Dîner à Alnwick. – Coucher à Morpeth. – Levé de bonne heure. – Halte à Durham. – Pris les devants sur la chaise de poste. – Observé des chariots à charbon près de Newcastle. – Les roues sont construites de manière à descendre la hauteur sur des choses où elles s’engrènent. Le cheval suit le chariot pour le remonter quand il sera déchargé, etc. » – Le reste n’est guère moins insignifiant. Je donnerais beaucoup pour avoir enregistré, au lieu de ces dates et de ces notes, l’histoire naïve de mes impressions d’alors.
Nous nous rendions à Londres, ce grand foyer d’où partent tous les rayons du monde anglais ; je devais m’embarquer sous le pavillon de sir André Mitchell, alors à l’ancre dans la Tamise, et à la veille d’aller croiser à la station d’Halifax. Mais je ne trouve rien dans mon journal qui mérite d’être extrait, et je ne me souviens d’aucun incident qui m’émût alors vivement, si ce n’est l’opération de revêtir pour la première fois l’uniforme d’aspirant de marine. Je ne vis pas sans un vif plaisir briller la laine de mon poignard, et je m’admirai dans mon frac ; mais je voyais surtout dans ce changement de costume la preuve que c’était bien sérieusement que j’allais entrer dans une carrière nouvelle. Ce fut donc avec une heureuse disposition à la gaieté que je fis ma première apparition sur le pont d’un des vaisseaux de Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne.
Voici mon maigre journal de ce jour-là : – « Allé à Deptford, en fiacre, après déjeuner. – Rencontré dans la rue le capitaine du Léandre, – Allé avec lui au bureau des registres du vaisseau. – Inscrit mon nom dans je ne sais quel livre. – Allé chez le capitaine, qui me donna une liste de certaines choses dont j’avais besoin. – Pris un bateau, et monté à bord du Léandre pour la première fois. – Retourné à Londres, et allé au théâtre d’Adelphi, etc. »
Dans la plupart des autres professions, la transition d’un genre de vie à l’autre est plus ou moins graduelle ; mais, dans celle de la marine, elle est si brusque et si peu préparée, qu’il faut qu’un enfant soit bien philosophe ou bien stupide pour ne pas se sentir d’abord très près d’être accablé du changement. Aux douceurs et aux caresses de la maison paternelle succèdent tout à coup pour lui le régime grossier du vaisseau et la parole rude d’étrangers. La sollicitude dont il s’est vu entouré jusque-là, quelque sévère qu’on suppose la discipline domestique, est la tendresse même, comparée à la complète indifférence avec laquelle on reçoit à bord un novice ou un « petit pleureur, » comme on le nomme. Si même il a quelques connaissances parmi ceux de son âge et de son rang, il en retire peu de consolations, et, en général, ces amis sont plus disposés à rire de la mélancolie d’un nouveau venu qu’à l’encourager quand son pauvre petit cœur est sur le point de se briser.
Il arriva que je ne connaissais personne à bord, excepté deux aspirants qui se trouvaient dans les mêmes circonstances que moi. Je fus aussi présenté à un vieux grognard de contremaître, aux soins de qui, bien contre son gré, j’avais été recommandé par un ami commun, un capitaine sous lequel il avait autrefois servi. Quant à notre excellent officier commandant, il avait bien autre chose faire que de s’occuper des chagrins d’une douzaine d’enfants confiés à sa charge.
Je fus donc étourdi et abattu par le sentiment de mon isolement, après que mon père m’eut serré la main en quittant le vaisseau. Je me souviens du désespoir avec lequel je regardai autour moi, quand je compris toute mon insignifiance : « Et serai-je jamais capable, me dis-je, de remplir aucun rôle sur ce vaste théâtre ? Comment faire ? Par où commencer ? Qui consulter ? » Il y a sans doute un vif plaisir dans la nouveauté ; mais on peut en avoir trop à la fois, et certes, si on me demandait mon avis, je recommanderais qu’on n’introduisît que graduellement un novice dans sa demeure future, et qu’on le plaçât, si c’était possible, sous les auspices d’une personne plus, âgée que lui, qui, lui portant intérêt, pût adoucir les inutiles rigueurs de ce redoutable changement. Je manquais de cette préparation, et je n’avais ni ami ni personne à bord qui se souciât de moi le moins du monde. J’étais aussi très petit pour mon âge ; j’avais un accent écossais très marqué, et j’étais d’ailleurs un peu têtu de ma nature. La chambre de discipline est sans doute un excellent endroit pour dompter un aspirant de ce caractère ; mais j’ai vu maintes jeunes plantes plus délicates que moi écrasées par la sévérité de cette impitoyable discipline. Peut-être est-ce pour le mieux, parce que les jeunes gens qui ne peuvent ou ne veulent pas supporter ce traitement rude font tout aussi bien, pour eux et pour les autres, de chercher un autre état.
Il est une pratique dont je me suis toujours bien trouvé, que je recommande par conséquent : c’est de ne pas présenter le mauvais côté des choses quand on écrit à sa famille ; on s’habitue plus vite à être heureux en disant l’être, et il y a moyen de ne pas inquiéter les siens sans trahir la vérité. Ainsi je me rappelle, comme s’ils étaient d’hier, les évènements contenus dans la lettre suivante, écrite le lendemain du jour où je fus abandonné à ma destinée, parmi des étrangers, dans le monde nouveau d’un vaisseau de guerre. J’étais loin d’être heureux, et j’aurais pu facilement attrister mes parents en appuyant sur ce qui m’était le plus désagréable. J’agis différemment.
« À bord du Léandre, 12 juin 1802.
MON CHER PÈRE,
Après vous avoir quitté, je suis descendu dans la salle des gamelles ; c’est une pièce de vingt pieds de long environ, avec une table au milieu et des sièges de bois tout autour. Il y avait beaucoup de tasses et de saucières sur la table. Un homme entra, et versa de l’eau chaude dans la théière. Nous sommes quatorze assis en même temps. On rit beaucoup dans ce trou noir, où nous n’avions que deux chandelles. On descend ici quand on veut, et puis on remonte sur le pont.
Vers les dix heures du soir, on nous servit à souper du pain, du fromage et une espèce de pouding que nous trouvâmes excellent. Quelque temps après j’allai me coucher dans un hamac qui n’était pas le mien, le mien ne devant être prêt qu’aujourd’hui. Je me trouvai assez drôlement couché et bercé là, n’ayant qu’un pied d’intervalle entre mon visage et le plafond. Aussi me suis-je cogné plus d’une fois la tête contre les poteaux de ce dortoir, où dorment les aspirants, et où je dormis fort peu, je vous assure, au milieu du bruit que faisaient tous ceux qui allaient et venaient dans les ténèbres ; puis, à peine avais-je fermé l’œil, qu’arrivait un des maîtres pour appeler ceux qui étaient de quart pendant la nuit ; et il faut, à ce qu’il paraît, s’habituer à ne s’éveiller que pour son tour de garde. J’aurais enfin dormi le matin ; mais mon sommeil a encore été interrompu par le travail des matelots.
Il y a une grande ouverture qui descend des ponts jusqu’au fond de la cale, où on laisse tomber les tonneaux. Le pied de mon hamac était juste à côté de cette ouverture, de sorte que je voyais sans cesse les tonneaux monter et descendre près de moi. Je me levai à sept heures et demie, et entrai dans le birth (notre chambre de gamelle) : nous y attendîmes le déjeuner jusqu’à huit, lorsque l’homme qui sert à table survint, rouge de colère, en disant qu’au moment où il faisait chauffer la bouilloire sur l’étuve, le capitaine d’armes était venu jeter de l’eau sur le feu pour l’éteindre, parce qu’on chargeait de la poudre à bord. Ainsi il fallut nous passer de déjeuner. Nous avions cependant encore du pain et du beurre, que nous commencions à manger, lorsque le capitaine d’armes descendit lui-même pour nous enlever nos chandelles. Il nous fallut donc achever notre pain sec dans l’obscurité.
Je montai ensuite sur le pont, et m’y promenai en regardant appareiller les bâtiments de la compagnie des Indes. À onze heures, un de mes camarades et moi nous allâmes demander au lieutenant s’il voulait nous permettre de descendre à terre dans le petit canot, ce qui nous fut accordé, et nous nous y embarquâmes avec quelques autres aspirants. Nous entrâmes dans une auberge où nous nous dédommageâmes avec du café, du beurre et des petits pains, de notre déjeuner du matin ; puis nous allâmes voir l’église d’Artford ; et, ayant rejoint le canot à travers champs, nous revînmes à bord, etc. »
Les gens du métier remarqueront dans cette lettre un curieux mélange de mots profanes et de mots techniques, mais le tout passable toutefois pour vingt-quatre heures d’expérience, si on ne veut pas surtout être trop sévère sur le mot ouverture, employé au lieu d’écoutille.
Dans une autre lettre, écrite quelques jours après, je faisais grimper les matelots aux mâts comme des chats. Dans une troisième, je mentionnais avec deux points d’admiration que nous avions fait voile, et que je m’étais trouvé en pleine mer pour la première fois ! ! Je me louais de mes camarades et du maître d’école, homme très aimable, qui avait beaucoup voyagé, mais qui ne commencerait ses leçons que lorsque nous aurions fait déraper notre ancre pour Halifax.
L’épître suivante, écrite de Spithead, est assez caractéristique.
« À bord du vaisseau de Sa Majesté le Léandre, Spithead, 18 juin.
« Je suis plus content de ma position que je ne l’espérais lors de ma première entrée à bord. Nous avons dans notre gamelle quatre Écossais, six Anglais et deux Irlandais, de manière que nous formons une très agréable compagnie à table. Nous déjeunons à huit heures du matin et dînons à midi. À déjeuner on nous sert du thé et du biscuit de mer ; à dîner nous avons du bœuf, du porc ou du pouding. Quand nous mouillons près d’un port, il y a toujours des bateaux qui viennent avec toutes sortes de végétaux et de la viande fraîche, que nous leur avons bientôt achetés, ainsi que du pain mollet.





























