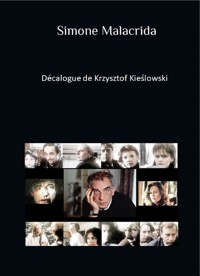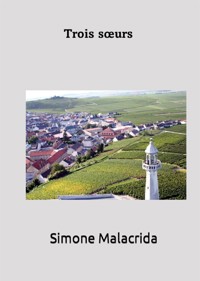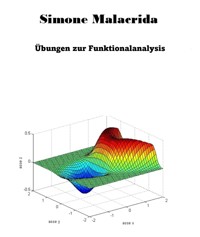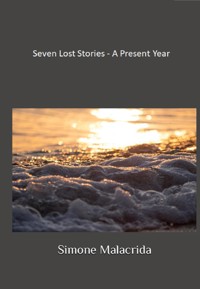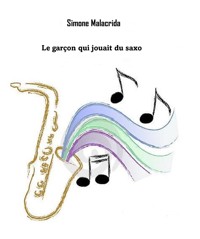2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Simone Malacrida
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un siècle revécu en sept récits appartenant à un passé aujourd'hui perdu, dans lesquels se déroulent des histoires de femmes et d'hommes, dans leur diversité, avec quelques thèmes communs.
La liberté et la volonté, la tradition et l'innovation, les certitudes et les doutes d'une terre ancestrale, sauvage et profonde comme l'est la Sardaigne, revivent aujourd'hui encore dans les pensées de ses anciens habitants, dans des lieux qui, après tout, n'ont jamais changé.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table des Matières
SIMONE MALACRIDA
« Sept histoires disparues - Un siècle révolu »
Simone Malacrida (1977) | Ingénieur et écrivain, il a traité de la recherche, de la finance, des politiques énergétiques et des installations industrielles.
INDICE ANALYTIQUE
NOTE DE L'AUTEUR:
Un siècle revécu en sept récits appartenant à un passé aujourd'hui perdu dans lesquels se dévoilent des histoires de femmes et d'hommes, dans leur diversité, avec des thèmes communs. | Liberté et volonté, tradition et innovation, certitudes et doutes d'une terre ancestrale, aussi sauvage et profonde que soit la Sardaigne, revivent encore aujourd'hui dans les pensées de ses habitants passés, dans des lieux qui, finalement, n'ont jamais changé.
LIBERTÉ
I
II
III
VOLONTÉ
IV
V
VI
TRADITION
VII
VIII
IX
INNOVATION
X
XI
XII
SÉCURITÉ
XIII
XIV
XV
DOUTE
XVI
XVII
XVIII
TERRE
XIX
XX
XXI
SIMONE MALACRIDA
« Sept histoires disparues - Un siècle révolu »
Simone Malacrida (1977)
Ingénieur et écrivain, il a traité de la recherche, de la finance, des politiques énergétiques et des installations industrielles.
INDICE ANALYTIQUE
LIBERTÉ
I
II
III
VOLONTÉ
IV
V
VI
TRADITION
VII
VIII
IX
INNOVATION
X
XI
XII
SÉCURITÉ
XIII
XIV
XV
DOUTE
XVI
XVII
XVIII
TERRE
XIX
XX
XXI
NOTE DE L'AUTEUR:
Le livre contient des références historiques très spécifiques à des faits, des événements et des personnes. De tels événements et de tels personnages se sont réellement produits et ont existé.
En revanche, les principaux protagonistes sont le fruit de la pure imagination de l’auteur et ne correspondent pas à des individus réels, tout comme leurs actions ne se sont pas réellement produites. Il va sans dire que, pour ces personnages, toute référence à des personnes ou à des choses est purement fortuite.
Un siècle revécu en sept récits appartenant à un passé aujourd'hui perdu dans lesquels se dévoilent des histoires de femmes et d'hommes, dans leur diversité, avec des thèmes communs.
Liberté et volonté, tradition et innovation, certitudes et doutes d'une terre ancestrale, aussi sauvage et profonde que soit la Sardaigne, revivent encore aujourd'hui dans les pensées de ses habitants passés, dans des lieux qui, finalement, n'ont jamais changé.
“We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher, leave them kids alone”
LIBERTÉ
“I look inside myself
And see my heart is black
I see my red door
I must have it painted black”
I
Orgosolo, printemps 1856
––––––––
“May you always do for others,
And let others do for you.”
––––––––
Le blanc incomparable de la fleur d'asphodèle recouvrait la clairière surplombant la pente douce sur laquelle Franco conduisait le troupeau.
Il savait que dans la vallée les fleurs avaient fleuri au cours des mois précédents, entre début mars et mi-avril, mais dans la zone du Supramonte, tout semblait avoir ralenti, comme il convenait à sa nature.
Réfléchi et calme.
Peu bavard et enclin à l'action.
La première quinzaine de mai a été idéale, les campagnes n'étant pas encore desséchées par la sécheresse estivale, qui produisait, même en haute altitude, une certaine sécheresse des sols et des herbes.
Ses moutons n'auraient pas pu goûter les pousses d'herbe fraîche, légèrement humides de l'humidité de la nuit.
Un simple appel, un de ceux codifiés depuis des générations, suffisait à convoquer ses enfants.
Pietro, l'aîné, se démarquait déjà nettement des animaux, avec l'éclat de ses dix ans, tandis que Massimo, de deux ans son cadet, avait encore des traits d'enfant.
Comme pour tout le monde, il était normal que les enfants, en particulier les garçons, suivent les traces de leur père au travail et soient occupés.
Cependant, cela ne veut pas dire que Franco a oublié combien il était important pour lui et ses frères d'avoir une certaine culture.
Contrairement à presque tous les bergers qu’il a connus, il n’y avait aucun analphabète dans sa famille.
Son père Ettore avait pris soin de les faire étudier par le jeune curé arrivé du Piémont, le même qui maintenant, presque âgé, enseignait les mêmes choses à ses enfants.
En plus de savoir lire et écrire, quelques rudiments de comptes mathématiques et quelques notions de géographie, notamment du Royaume de Sardaigne.
Mais s'il y avait une chose que Franco devait à Don Francesco, c'était bien la diction.
On ne lui avait pas appris à s'exprimer dans aucun dialecte, encore moins dans l'incompréhensible piémontais.
"Nous parlerons en italien et vous apprendrez en italien."
Ce qu'était l'Italien quand Franco avait dix ans, en 1831, était un mystère pour tout le monde.
Quelqu’un savait clairement ce qu’était l’Italie.
Zone géographique, plus ou moins délimitée au nord par les Alpes et au sud, à l'est et à l'ouest par les différentes mers.
Un héritage historique commun.
Et une culture de base assez similaire.
Sur le plan politique, on ne le savait pas, étant donné qu'il existait au moins une quinzaine de petits États plus ou moins gouvernés par d'autres puissances.
Mais l’italien en tant que personne et en tant que langue ne pouvait être défini.
Chacun parlait sa propre langue.
En Sardaigne même, un Barbaricino différait d'un Ogliastrino ou d'un Gallurese.
En effet, il était même possible de comprendre, après quelques mots, qui venait de Fonni ou de Gavoi et n'était pas d'Orgosolo, ou quelqu'un qui venait de la ville la plus proche, à savoir Nuoro.
En tout cas, Franco avait appris à parler cette langue étrange, celle utilisée par les seigneurs et les notables, en particulier tous ceux qui avaient affaire aux Piémontais et aux Piémontais eux-mêmes qui s'installaient en Sardaigne.
Sachant qu'il possédait une faculté de ce type, il n'avait pas le moins du monde soulevé la question de ses enfants.
Il aurait renoncé à une partie de leur aide, surtout l'après-midi, pour les envoyer chez Don Francesco, au moins jusqu'à l'âge de quatorze ou quinze ans, lorsque leur physique aurait grandi et que leur aide aurait été décisive.
Pour l'instant, Franco se sentait en pleine forme et ne se sentait pas fatigué.
Le moment viendrait où ses enfants devraient le soutenir et ensuite le mettre de côté dans ses travaux extérieurs, comme il l'avait fait avec Ettore.
Son père s'occupait désormais des tâches ménagères, préparant tout le nécessaire à l'accueil et à la croissance du troupeau.
En revanche, pour Ettore, il ne restait plus que Franco.
Eleonora, la plus jeune fille, avait épousé un autre berger local, dont le troupeau paissait dans la zone nord d'Orgosolo, vers les montagnes qui surplombent Nuoro, tandis que Franco allait vers le sud.
La fille avait assumé le rôle parfait d'épouse, tel que le conçoit le code de Barbagia, un mélange de règles qui régissaient la vie commune à Barbagia.
Pour cette raison, il la voyait peu et il ne se mêlait pas souvent de ses affaires.
Le gendre, Giuseppe, était très traditionaliste et complètement différent de Franco.
Il n'y avait pas de mésentente entre les deux, notamment en raison de leur attitude envers les traditions et envers les Piémontais.
L'autre fils, Carlo, était décédé des années plus tôt.
Elle avait suivi Franco aux leçons de Don Francesco et, en secret, avait transmis ce qu'elle avait appris à sa sœur Eleonora, contestant ouvertement la coutume selon laquelle les femmes ne devraient avoir accès à aucune forme d'éducation.
Carlo se sentait dirigé vers d'autres tâches et non lié à son pays natal.
Bien que les enseignements de Don Francesco et de la famille d'Ettore aient toujours été basés sur un profond sentiment religieux, Carlo avait autre chose en tête.
Il en savait plus que quiconque sur ce qui se passait dehors.
Mais pas en dehors d’Orgosolo, mais en dehors de la Sardaigne.
Il ne voyait aucune frontière naturelle, politique et culturelle.
Il pensait à l'Italie.
Ainsi, à la fin de 1848, année qui à Orgosolo s'était déroulée à l'identique de beaucoup d'autres, il annonça son départ.
"Je vais à Rome".
Il a dit à Ettore étonné et à Franco tout aussi déconcerté, déjà marié et père de deux nouveau-nés.
Carlo n'avait jamais voulu obéir aux règles.
Il n'avait pas cherché d'épouse et ne voulait pas de famille.
Il est reparti avec un sac à moitié vide.
Le même sac était le seul objet revenu de Rome.
Quelques mois plus tard, à la fin du printemps et au début de l'été 1849, Carlo Monni fut l'un des nombreux tués lors de la défense de la République romaine.
Depuis, on parle peu de lui dans la famille.
Nous ne voulions pas déplaire à Ettore, qui n'a plus jamais été le même après le décès de son fils.
Pietro fut le premier à arriver chez son père.
Il savait déjà quoi faire.
Pas besoin de mots inutiles, il fallait conserver le souffle pour conduire le troupeau.
Une dizaine de moutons s'étaient détachés et il fallut les ramener vers les autres.
De légères intrusions suffisaient à créer des désaccords et le début d’événements qui deviendraient alors incontrôlables.
Ainsi sont nés les principes de la disamistade .
Il était difficile d'expliquer cela à une personne étrangère.
Surtout, le fait qu'il se transmettait de génération en génération et grandissait en paroles et en actes.
« Ici, ce n'est pas comme en Gallura », disait Franco, même si au fond il ne croyait pas trop aux paroles prononcées.
Il suffisait de plus de personnes comme son beau-frère Giuseppe pour faire de la Barbagia une terre de conflits comme l'était la Gallura.
Et puis tout le monde aurait oublié les Vasa et les Mamia, noms sur toutes les lèvres, même si personne n'en parlait ouvertement.
Il y avait une sorte de silence sur certains événements.
Il n'aurait pas fallu en parler.
Il en était de même pour les Piémontais.
Ils étaient là et c'était un fait.
Les frapper de plein fouet en contrevenant à leurs lois aurait été considéré comme du banditisme.
Collaborer avec eux aurait été considéré comme une trahison des origines.
La majorité les a donc simplement ignorés.
Ne pas les laisser entrer dans la vie quotidienne.
Méfiance mutuelle.
Peter a compris la tâche qui lui était assignée.
Il se mit à marcher à grands pas aux côtés du troupeau.
Les courses étaient interdites pour que les moutons aient peur.
Il a commencé à sentir son cœur résonner dans ses oreilles et sa respiration devenir courte, avec une respiration difficile.
Pour autant, il n’a pas reculé.
Il était inconcevable que le jeune homme ne corresponde pas aux dispositions de son père.
Comment pouvait-elle le regarder dans les yeux ?
Et puis il a senti qu'il devait donner l'exemple à son frère Massimo, qui l'avait toujours considéré comme un point de comparaison.
Ce que faisait Pietro était imité par Massimo, qui ne s'était jamais demandé s'il existait quelque chose qui lui appartenait vraiment ou si toute sa courte vie avait été consacrée à l'exercice de l'imitation.
"Allez."
Il commença à élever la voix.
Les premiers moutons dispersés se mirent au trot, presque conscients de ce qu'ils avaient fait.
Rassuré par le résultat partiel, Pietro ne s'arrête pas.
"Retournez à votre place."
Mieux qu'un chien de garde, avec des manières plus douces et sans effrayer le troupeau, en quelques minutes le problème a disparu.
Il savait que le troupeau était toute leur vie.
Tout ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas dépendre de la gestion du troupeau.
Tout d’abord, le lait était utilisé pour l’alimentation directe et pour la production de fromage.
À son tour, le fromage était consommé en famille, mais surtout revendu.
On obtenait alors la laine du mouton, qui était également cardée et utilisée par les femmes pour l'habillement et le surplus était revendu.
Et enfin la viande.
En quelques occasions, presque toutes d'origine religieuse, un mouton ou un agneau était abattu pour des banquets.
Certains animaux qui n'étaient plus très productifs en lait ont été vendus à l'abattage.
Tout se déroulait selon les anciennes coutumes et selon l'alternance des saisons.
Les années sèches réduisaient la production mais augmentaient la qualité du fromage, qui pouvait ainsi être moins vieilli, économisant du temps entre la transformation et les revenus.
Dans ce cadre, il y avait des choses qui pouvaient mal tourner.
Son père Franco, un phare constant pour les deux frères, avait résumé tout cela en quelques mots simples :
« Famine, maladie et guerre. »
Trois choses à éviter.
La famine pourrait conduire à une décimation du troupeau, tout comme la maladie.
Directement ou indirectement, cela aurait affecté les hommes et donc leur famille.
La vie semblait si fragile et si imprévisible.
C'était comme si chaque petite odeur naturelle s'était filtrée du troupeau avant de retomber sur eux et c'est pour cela qu'il fallait prendre soin des animaux.
Pour éviter que la famille ne se ruine.
"Mais des trois, la pire est la guerre."
Peter ne comprenait pas très bien ce que signifiait la guerre.
Du moins, il limite tout cela au contexte qu'il connaît, celui d'Orgosolo.
La guerre était l'inimitié entre les familles et les crimes qui en découlaient.
Il n'avait pas compris que derrière l'expression de son père se cachait tout le mécontentement et le désespoir d'un homme qui avait vu son frère périr pour un idéal abstrus.
«Pour les puissants et les maîtres», avait-il prononcé.
Pour cette raison, Franco avait prévu de vivre en paix.
Sans déranger personne.
Et c’est pour cette raison qu’il parlait peu.
« Les mots sont dangereux. Si elles sont mal interprétées, elles sont le début de tout conflit.
S’ils ne sont pas à leur place, ils sont le début de tous les malentendus.
Pietro comprit, contrairement à Maximus, qu'il s'agissait d'une opinion unique.
Par Franco Monni et pas quelque chose d'universel.
Il y avait d’autres personnes qui voyaient les choses différemment.
L'un d'eux était son oncle Giuseppe.
Il avait imposé un mode de vie différent de celui qu'avaient connu les deux garçons.
Tout d'abord, aucun des cousins de Pietro n'avait jamais vu celui de Don Francesco.
L'oncle Giuseppe, ne sachant ni lire ni écrire, n'aurait jamais toléré que ses enfants soient plus capables que lui.
Il avait déjà dû subir la honte que sa femme Eleonora, une femme, possédait une faculté similaire, mais il avait abandonné face à la beauté évidente de la jeune fille.
Elle était la seule à avoir des traits délicats.
Un visage rond et non carré.
Des traits gracieux, comme une princesse de conte de fées.
Elle ne ressemblait à personne dans le village, ni à ses frères, ni à ses parents et, dans leur cœur, tous les habitants d'Orgosolo pensaient qu'elle venait d'un autre endroit.
Cette fille enchanteresse n'avait toujours eu d'yeux que pour Giuseppe et cela suffisait à convaincre un homme déterminé et déterminé d'enterrer la hache de guerre et de se laisser enchanter par le rosolio de l'amour.
A part cela, Giuseppe représentait exactement le contraire de Franco.
Tradition et code.
Jamais un mot en piémontais ou en italien, mais uniquement dans le dialecte local.
Jamais ami des prêtres et des gardes, c'est ainsi qu'il appelait quiconque représentait le pouvoir de la Savoie.
Les gardes n'étaient pas seulement des soldats ou des voyous, mais aussi divers gouverneurs, notaires, avocats et bureaucrates.
Même les Sardes qui collaboraient avec eux étaient des gardes.
Pietro n'avait encore rien demandé à son père ni à Don Francesco.
Le temps des questions inconfortables viendrait, mais pas maintenant.
Tout comme il aurait aimé connaître l'histoire de l'oncle Carlo.
Une fois qu'il eut terminé sa tâche avec les moutons, il retourna à la position qui lui était assignée.
Il s'agissait simplement de contrôler le troupeau jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, puis de rentrer chez lui.
Il s'agissait d'un grand espace situé à l'extérieur de la ville d'Orgosolo, près de la Fonte Su Cantaru.
C'était là que vivait la majeure partie de la ville, où vivaient Franco et son épouse Grazia, avec leurs enfants et les parents de Franco.
A côté du corps principal, une grande et épaisse clôture partiellement recouverte par une charpente en bois rassemblait le troupeau pendant la nuit.
Il n’y avait aucun prédateur, à part les autres hommes.
Le vol de bétail était une pratique consolidée, mais toujours considérée avec méfiance.
Habituellement, le vol n’était jamais la première étape d’une disamistade.
On n'est passé au vol qu'après quelques désaccords verbaux ou regards déplacés.
Pour rester à l'écart de tout, Franco avait volontairement quitté la ville, quoique sur une très courte distance.
C'était une façon de mettre en valeur une différence.
Je suis là, mais je ne partage pas certaines manières d'être.
Cela le plaçait en marge de la société, peu apprécié dans ces cercles traditionalistes ni même chez ceux qui voyaient l'avenir de leur famille et de leur carrière dans le Piémont.
En restant à mi-chemin, il a été mal vu par les deux factions qui se détestaient, même s'il n'était ouvertement en conflit avec personne.
Il pensait que c'était juste.
Pour sa survie et celle de sa famille.
S’il y avait une chose qui tenait à Franco, c’était l’avenir de sa famille et de sa terre.
Il n'était pas de ces hommes qui ne pensaient qu'à eux-mêmes et aux contingences du moment.
« Je veux qu’il reste plus de moi que ma mémoire. Un exemple et une manière d’être.
Il l'avait avoué à plusieurs reprises à sa femme Grazia, la seule à avoir recueilli ses confidences au cours des longues conversations du soir dans la chambre.
À cet endroit, une personnalité différente s’est révélée en lui.
Laissant de côté la confidentialité et sirotant des mots, dans le lit nuptial finement marqueté de bois de chêne résistant, Franco s'est dépouillé de son rôle.
Il croyait que sa femme Grazia avait le don d’écoute et de non-jugement.
Il était tombé amoureux d'elle en fixant ses yeux sombres, dans lesquels il avait entrevu les siens.
Il ne pourrait jamais dire où l’un finissait et où commençait l’autre.
Grace, délicate et petite, écoutait les paroles de son mari et ne répondait généralement pas.
Il attendrait un jour ou deux, puis reviendrait sur le sujet.
Il y avait donc toujours des dialogues décalés, Franco se consacrant à de nouvelles descriptions et Grazia revenant sur ce qui avait été dit quelques jours auparavant.
C'était leur façon d'être complices et de se tailler un espace à eux, sans aucune présence des autres, pas même celle de leurs enfants.
Personne ne connaissait ce secret.
"Ce qu'il adviendra de nous?"
La question constante et pressante de Franco, à laquelle ni l'un ni l'autre n'ont jamais trouvé de réponse définitive.
Le monde de l’élevage ovin semblait inchangé depuis des siècles, transmis depuis la nuit des temps sans nouveauté.
En réalité, il y avait de grandes différences et il aurait suffi d'aller à Nuoro pour les saisir.
Les Piémontais, désormais conquérants malgré le titre de « Royaume de Sardaigne » pendant plusieurs siècles, se forgeaient un rôle d'architectes de l'Italie et Franco en était davantage conscient par les discours passés de son défunt frère, qui croyait fermement au le destin de la patrie.
« Quelle patrie ?
Il s'était demandé plusieurs fois dans son cœur.
La patrie est la terre qui accueille sa famille.
La patrie est Orgosolo et la Sardaigne.
Mais le Piémont ne pouvait même pas être appelé Patrie, dont les rois et les administrateurs n'avaient même pas pensé aux Sardes, compris comme population avec ses besoins.
Quel avenir avait le pays de Franco dans le grand jeu des puissances ?
Et puis toutes les différences par rapport au passé.
En Barbagia, depuis des temps immémoriaux, tout le monde se promenait avec un couteau à la taille.
N'importe qui, bien sûr un homme, un homme.
Le couteau était un outil très utile pour sculpter le bois, couper des branches, rompre le pain et le fromage.
De plus, c'était un instrument de défense, avant celui d'attaque.
Et cela démontrait la personnalité de celui qui le possédait.
Tout le monde s'occupait de son entretien, de la lame et du manche, de la pointe et du fourreau.
Un vrai père devait apprendre à ses enfants comment en fabriquer un et comment l'améliorer.
Le couteau était considéré comme un élément très important de la personne.
Mais il y avait aussi des armes à feu.
Beaucoup moins romantique et beaucoup moins personnalisable.
Et la puissance des armes à feu était incontestable.
Les gardes et les hommes de main piémontais devinrent forts grâce aux fusils et aux petits canons avec lesquels ils pouvaient assiéger des communautés entières.
Et parmi les bergers, l'habitude de porter sur l'épaule un fusil, peut-être ancien, de ceux désaffectés par les armées, s'était répandue.
Il était interdit de posséder une arme à feu, mais en Barbagia, il aurait été difficile de désarmer un berger, non pas par obstination et ténacité, mais par nature.
Ce sont les montagnes elles-mêmes qui constituaient un refuge.
Le Supramonte était un lieu impénétrable aux étrangers, j'entendais même par là les habitants de Sassari et de Cagliari.
Dans tout cela, Franco n’a trouvé ni réponses ni réconfort.
Il aurait voulu garantir à ses enfants une plus grande sécurité, non pas tant du présent que du futur.
À quoi ressemblerait leur vie dans trente ans, une fois qu’ils auraient une famille et seraient pères ?
Et ses petits-enfants verraient le nouveau siècle, quelque chose d’inouï.
Face à cela, il n'avait aucune certitude et ne se donnait pas non plus la paix.
Au cours des longues heures passées à garder le troupeau, il méditait souvent, ce qui ne faisait qu'accroître son caractère réfléchi et le peu de mots qu'il échangeait avec les autres.
Ses enfants trouvaient le comportement de leur père très digne de respect.
Quiconque parlait trop n’était pas bien vu.
Un prêtre pouvait le faire, précisément parce qu'il ne s'inscrivait pas dans la logique de la société Barbagia.
Un prêtre répondait à Dieu et non aux hommes.
Et Don Francesco, en termes de pomposité, était sans égal.
Qu’il s’agisse de Dieu ou de notions humaines, il ne s’est pas retenu.
«Et que pouvons-nous dire de...» était sa phrase d'introduction typique.
Au début, Pietro et Massimo pensaient qu'il était fou et comptaient les fois où Don avait commencé un discours de cette manière.
Quarante-deux en moins d'une heure.
Ils échangèrent des regards de satisfaction et de complicité, sans éclater de rire.
C'était réservé au moment où ils revenaient de la paroisse à leur domicile.
Ils riaient aux éclats à chaque petite chose.
C'était leur façon d'être encore des enfants, dans un monde qui voulait qu'ils grandissent vite et qui n'était certainement pas adapté aux joies typiques de l'enfance.
Il était facile de comprendre combien la vie était difficile et sans aucun espoir de rédemption, contrairement à ce qui était écrit dans les livres et à ce que Don Francesco proposait de temps en temps.
« Et que pouvons-nous dire de Rome ?
Des questions rhétoriques, uniquement pour introduire de nouvelles explications, puisque ceux qui étaient en face d'eux n'étaient certes pas capables de répondre mais seulement d'assimiler ce que disait le prêtre sans aucun esprit critique.
Ni Franco ni Grazia n'auraient jamais pu espérer quelque chose de mieux pour leurs enfants que l'éducation primaire de Don Francesco.
Par rapport à tous les autres enfants, ils étaient certainement plus avantagés, surtout par rapport aux enfants de Giuseppe et Eleonora.
Le fait que nous soyons deux et que nous circulions toujours en couple était un avantage.
Dans ces régions, l’unité familiale était primordiale.
Personne n’aurait défié ses frères s’il était uni.
Des désaccords et des querelles surgissaient soit au sein de diverses familles, soit entre différentes factions, précisément parce qu'il existait des divisions.
C'est ce qu'on disait de la Gallura et qui pénétrait peu à peu dans la mentalité des Barbagia.
Un rythme lent qui remontait les montagnes depuis la plaine avec des témoins exceptionnels, comme Giuseppe.
Franco n'avait pas grand-chose à voir avec lui.
C'était le mari de sa sœur.
Fin de l'histoire.
Lorsqu'elle leur rendait visite, c'était pour rendre visite à Eleonora, étant donné qu'il était beaucoup plus difficile pour une femme mariée de décider de voyager de manière indépendante à travers le pays.
Il existait des conventions non écrites et strictement codifiées que quelqu'un comme Giuseppe croyait éternelles et absolument valables.
C'est pour cette raison que Franco ne voyageait jamais seul, mais généralement avec ses enfants et parfois même avec Grazia ou son père.
Une visite familiale ne pouvait être refusée.
"Retournons."
C'était le signal convenu.
Pietro et Massimo se placèrent aux flancs du troupeau pour le diriger vers la partie raide de la pente.
Cela aurait été un voyage constant, sans aucun arrêt.
Franco faisait défiler les moutons, les examinant un à un avec ses yeux.
S’il y avait quelque chose d’inhabituel, il aurait dû le remarquer immédiatement.
Il fallait prévenir à temps un accident ou une maladie.
Chaque problème, s’il n’était pas maîtrisé, même minime, aurait été amplifié.
Il a fait la queue pour s'assurer que rien ne s'échappait.
C'était à Peter d'ouvrir la voie.
Son fils aîné connaissait désormais son chemin, du moins tout en restant dans les environs d'Orgosolo.
Les pistes étaient facilement reconnaissables à un œil exercé, même à un jeune enfant.
Le cas aurait été différent s'il avait dû organiser un transfert vers le lac Olai ou une transhumance au-delà du Supramonte.
Dans ce cas, il prendrait la tête et dirigerait les opérations.
Il a pris un verre à sa cantine.
L'eau était une denrée primaire et précieuse tant pour les humains que pour les animaux.
Il fallait toujours garder à l’esprit l’emplacement des sources naturelles et des abreuvoirs artificiels.
Massimo se plaça du côté gauche, laissant le côté droit sans surveillance puisqu'il était bordé par les bois qui le surplombaient.
Bien que indisciplinés par nature, les moutons ne seraient pas entrés dans un enchevêtrement de plantes ayant devant eux des champs herbeux et des prairies incultes.
C'était dans leur nature de ne pas être courageux.
Sans rien dire, le groupe gravit la première pente.
Du haut de celui-ci, on voyait clairement le village perché d'Orgosolo et un œil attentif aurait déjà pu voir l'emplacement de la maison de Franco et Grazia, précisément en raison de l'isolement souhaité et recherché.
Dans l'esprit des enfants, il n'y avait aucune pensée sur l'avenir avec ses soucis associés, mais seulement deux demandes tout à fait compréhensibles.
La nourriture.
Et l'après-midi.
Les premiers seraient prêts dès qu'ils franchiraient le seuil de la maison.
Le pain, le fromage et les légumes ne manquaient jamais.
C'était la marque de la vie à la campagne et du métier de berger.
Pas de privilèges citadins, pas de délices qu'ils n'auraient même pas pu imaginer, mais une pure simplicité.
Et puis, une fois le repas dévoré, ils partaient à pied vers la paroisse de Don Francesco, tandis que Franco poursuivait les tâches de garde du troupeau et de transformation du lait tiré tôt le matin.
Une visite des caves pour vérifier l'affinage des fromages puis une nouvelle fois en extérieur, jusqu'au coucher du soleil.
Profiter des heures de lumière du jour était essentiel étant donné que le soir et la nuit, il était impossible de réaliser une quelconque activité, malgré la lumière de la cheminée et du foyer, principalement pendant la dure saison hivernale.
«Maintenant, j'accélère le pas», se dit Pietro.
Il sentait déjà la faim lui serrer le ventre.
Si tel avait été sa volonté, il aurait vidé le garde-manger en quelques jours, mais les doses étaient organisées par Grazia, qui savait faire durer les provisions pour l'hiver sans gaspiller les accumulations considérables de l'été.
C'était à elle de dicter le timing de la maison.
Franco remarqua le changement de rythme, mais ne dit rien.
Il connaissait ses enfants par cœur et se souvenait de l'époque où il était à leur place et de sa voracité d'enfant.
A ce sujet, il n'avait jamais fait de commentaires à leur égard.
Il ne se sentait pas autoritaire, même s'il jouissait de l'autorité.
Personne ne se serait plaint de ce changement, ni lui, ni Massimo, ni les moutons qui auraient continué à suivre ceux qui les précédaient.
Le Soleil était déjà haut et illuminait toute la plaine et les montagnes.
Sous l’éclat de la lumière, toutes les couleurs semblaient fanées.
Pour mieux profiter de la nature, il fallait attendre tard ou se lever tôt.
Dans ces moments-là, vous pouviez remarquer tous les reflets.
Du vert et du bleu.
Du marron et du rouge.
Jaune et même blanc.
Rochers et prairies.
Fleurs et plantes.
Tout parlait au cœur de ceux qui savaient recevoir de tels signaux.
Non pas des poètes ni des hommes de lettres, mais des bergers.
D'ailleurs, Notre Seigneur n'est-il pas né parmi les bergers ?
Et la bonne nouvelle n’avait-elle pas été révélée à la postérité elle-même ?
Les Saintes Écritures, si pleines de sens, résonnaient dans la maison de Franco et Grazia à un rythme incessant, bien au-delà des rites et des traditions du peuple.
C'est pour cette raison que Don Francesco n'avait pas refusé d'éduquer Franco d'abord, puis ses enfants.
Des familles qui craignent Dieu, sans aucun souci.
Pas de révolutionnaires, pas de libéraux ou de socialistes et même pas de bandits.
Des gens simples.
Doux comme l'étaient les moutons.
Il est enseignable grâce à des bergers individuels, comme l'étaient les curés envoyés dans des zones aussi inaccessibles et inaccessibles.
Ailleurs, cela aurait été différent.
En ville ou sur le continent.
Sans parler de Rome, centre du christianisme.
Une cité-État gouvernée par une main autocratique et semi-dictatoriale, inconsciente et inconsciente du destin futur immédiat.
Ils arrivèrent en vue de la maison et chaque rituel prit sa propre signification.
Lavez-vous les mains et secouez la poussière.
Se jeter sur la nourriture.
Je remercie le Seigneur.
Échanger des regards sans parler.
Se retrouver unis, tous ensemble, en famille.
Peu de choses suffisaient aux âmes simples.
À partir de ce moment, chacun empruntera des chemins différents.
Pietro et Massimo furent les premiers à partir.
Tout le monde connaissait leurs engagements et leur exubérance et personne n’y prêtait attention.
Le temps des difficultés viendrait aussi pour eux, mais ce n’était pas cela.
En quittant la maison, après avoir fait ses adieux à Grazia, qui n'avait d'yeux que pour ses propres bijoux, se fondant dans l'une de ses affectueuses étreintes maternelles, les deux frères se dirigèrent vers la leçon habituelle.
De quoi auraient-ils parlé en cette première quinzaine de mai ?
De l'histoire ?
De la langue ?
De géographie ?
D'une opération de compte ?
Au-delà de cela, on ne le savait pas.
Ils ignoraient complètement une grande partie de ces connaissances.
Les sciences physiques et chimiques, la philosophie, la théologie, les langues étrangères et anciennes, la biologie et la médecine.
Tout cela n’aurait pas aidé et aurait même suscité des doutes et des questions.
Il fallait une introduction générale, rien de plus.
Aucune mention du présent.
Ni aux Rois ni aux Révolutions.
Un monde en soi immuable leur était présenté.
Ignorant ces subterfuges, ils s’estimaient déjà chanceux.
Et ils l’étaient, après tout.
Vivre dans un présent ailleurs, obscurcissant presque un passé glorieux et sombre, sans avenir à venir.
Un métier déjà décidé.
Un chemin identique à lui-même.
Avant que les rayons du soleil aient fini d'éclairer le sol, Don Francesco aurait fini sa leçon et ils seraient rentrés chez eux.
Dans les bras sûrs de la terre qui les avait engendrés.
Dans le grand et doux ventre de la Barbagia Supramonte.
Une maison refuge pour les âmes simples, endormies sous les cendres millénaires des traditions transmises.
Des gens honnêtes et francs, durs et vrais, comme l'était leur père.
Franco Monni, l'un de ces hommes qui, peut-être à son insu, pourraient être considérés comme véritablement libres.
“Now your pictures that you left behind.
They are just memories of a different life.”
II
Orgosolo, printemps - automne 1860
––––––––
“Hello darkness, my old friend,
I've come to talk to you again.”
––––––––
La nouvelle, bien que médiatisée et tardive par rapport à ce qui s'était réellement passé, est arrivée jusqu'au domicile de Franco Monni.
S'étant largement répandue, d'abord dans les grandes villes, puis lentement dans les villages et hameaux, elle s'est glissée entre les vallées et les pentes, les remontant d'embouchure en embouchure.
Les rares qui savaient lire avaient récité ce qui était écrit dans les journaux et les autres se limitaient à rapporter.
En arrivant aux portes d'Orgosolo, on pourrait dire qu'il n'y avait aucun endroit qui n'en soit conscient.
Franco l'a appris grâce à son père Ettore, qui était plus habitué, faute de temps, à fréquenter la ville.
Ni de son beau-frère Giuseppe, qui avait été un des premiers à l'apprendre dans les environs, ni de Don Francesco, qui ne parlait jamais de ces choses ni avec les jeunes étudiants de l'après-midi ni avec les sacristains et les fidèles. de sa communauté.
Et certainement pas par les gardes piémontais, qui n'auraient pas aimé une éventuelle agitation.
Quelque part, un mot étrange résonnait lorsqu'il était prononcé en Barbagia.
Révolution.
Les rares fois où une telle parole avait été répandue, les anciens ont transmis les guerres, surtout à la fin du siècle précédent, avec les attaques françaises au nord et au sud de la Sardaigne, dont les premières furent dirigées par un jeune capitaine qui ensuite il deviendrait empereur.
Franco n'avait entendu ce mot qu'une seule fois.
Dit par son frère Carlo en 1848.
Et il a associé tout cela à sa mort.
Cela ne valait pas la peine de risquer quoi que ce soit pour la révolution.
En revanche, les bergers et les agriculteurs les plus conservateurs, les plus proches des idées de son beau-frère Giuseppe, n'auraient jamais parlé ouvertement de révolution, mais plutôt de révolte, ou plutôt de libération.
Des Piémontais et des Savoyards, évidemment.
De leurs lois absurdes qui avaient effacé toute autonomie et toutes les particularités de la Sardaigne.
"Que pensez-vous que je fais ici avec les voyous et les gardes ?" c'est pourquoi le beau-frère avait fait taire Franco à plusieurs reprises avec une telle expression.
Mais maintenant, les choses semblaient différentes.
Il y avait un nom qui, à lui seul, enflammait les cœurs et les fantasmes.
Giuseppe Garibaldi.
Oui, c'est lui.
Un étranger, après tout.
Quelqu'un dont on disait qu'il était né ailleurs, avait grandi sur un autre continent, avait épousé une autre femme et qui était ensuite retourné en Italie pour faire la révolution.
Celui de 1848 à Rome, qui échoua lamentablement.
Pour cette raison, Franco n'avait pas de sentiments amicaux à son égard, même s'il ne l'avait jamais connu ni rencontré.
Et ce malgré ce qui se dit depuis quelques années.
Il était devenu Sarde.
C’est-à-dire qu’il n’avait pas simplement acheté un terrain pour devenir maître ou conquérant.
De la Gallura, avec les nouvelles de la guerre entre les Vasa et les Mamia et de la répression piémontaise, étaient également arrivées des histoires, peut-être des légendes.
On racontait que Garibaldi avait demandé conseil et aide aux agriculteurs et aux bergers de Caprera.
Qu'il a travaillé avec eux.
Qu'il a mangé avec eux.
Comme l'un d'entre eux et non comme un général hautain.
Peut-être était-il le seul sur le continent à ne pas être un voyou.
Pour vraiment comprendre le peuple sarde et ses besoins.
Mais aujourd'hui, cet homme bouleverse tout le paysage politique et social, non pas parce qu'il a pris à cœur le sort des Sardes, en les libérant des Piémontais, mais parce qu'il s'est mis à la tête d'un groupe de volontaires et avait débarqué en Sicile, une autre grande île, si différente de la Sardaigne en termes d'histoire, de culture, de domination et d'attitude mentale.
"Il finira par tout remettre aux Savoie, les rendant encore plus puissants", se plaignit Giuseppe, qui était en effet admiré par tant d'ardeur et de courage, mais qui aurait préféré que tout cela se concrétise par une marche depuis l'île de Caprera vers Tempio Pausania puis sur Olbia et Nuoro puis, en suivant le cours du Tirso, jusqu'à Oristano, coupant la Sardaigne en deux.
Des montagnes, ils seraient descendus dans l'Ogliastra, en prenant la côte est, tandis qu'à l'ouest, ils se seraient dirigés, en remontant la côte, vers Alghero et Sassari.
Enfin, la manœuvre de convergence sur Cagliari.
Ils l’auraient nommé dictateur intérimaire et établi une République.
Libre et indépendant.
Avec sa propre langue et son propre drapeau.
Et avec ses propres lois.
Fini les voyous et les gardiens, fini les abus et la domination.
Cependant, rien de tout cela n’était arrivé.
La nouvelle que tout le monde avait à la bouche était que Garibaldi et ses chemises rouges défiaient le Royaume des Deux-Siciles.
Pour faire quoi?
L'Italie, disait-on.
Franco y a réfléchi longtemps, comme autrefois.
Lors des longues matinées en montagne à la tête du troupeau, en compagnie de ses enfants.
À présent, Pierre était devenu puissant.
Nous commencions à voir des signes de l’homme qu’il serait.
Une construction trapue mais robuste, avec des pattes solides et un tronc solide.
Cheveux noirs et hérissés.
Il aurait fait un excellent marcheur.
Franco était fier de lui et se comprenait à chaque regard, même s'il n'en disait rien.
Massimo, en revanche, était encore dans une époque de transformation.
Ses traits semblaient plus délicats, il devait ressembler à sa mère.
Il était néanmoins animé d'un fort esprit de volonté, concevant une émulation totale envers son frère.
Si Pierre faisait vingt pas d’un coup, il devait lui aussi faire le même nombre.
C'était comme si, aux yeux de ce jeune homme, la différence d'âge n'avait pas d'importance, puisqu'il se sentait investi d'une mission identique.
Être bergers.
L'entreprise imprudente de Garibaldi ne pouvait que rappeler le souvenir de Carlo.
"Mon frère aurait été là, parmi eux."
Franco en était certain.
Charles aurait porté la chemise rouge, allant se battre pour un idéal inconnu, peut-être pour renforcer la même monarchie qu'il avait combattue à Rome et qui dominait son pays depuis des siècles.
Incohérence?
Certes, mais l’envie d’agir aurait été prédominante.
Alors que les troupes de Garibaldi étaient déjà sur le point d'entrer dans Palerme, Franco restait encore avec les premières nouvelles du débarquement et se demandait si tout cela aurait pu être un succès militaire.
Il a fallu des semaines pour que la nouvelle parvienne, mais elle arriverait.
Comme tout ce qui est important, le temps de décalage était secondaire, lorsqu’on le mesurait par l’horloge de la vie agricole.
Qu'est-ce que quelques semaines ?
Peut-être que l’hiver ne serait pas arrivé l’année précédente ou suivante ?
Ou n’y aurait-il pas de nouveaux agneaux ni de vente de lait et de fromage ?
Tout continuerait de la même manière, presque sans changement.
Ce n’est qu’en faisant abstraction d’une perspective décennale ou générationnelle que des variations et des différences ont pu être remarquées.
C'était une manière comme une autre de posséder des certitudes.
À propos de votre vie et de votre famille.
À la maison, Franco ne parlait pas de tout cela.
Son épouse Grazia ne posait pas de questions et son père Ettore était satisfait de ce qu'il avait appris en ville.
De ses fils, seul Pierre aurait pu comprendre.
Et peut-être que peu de temps après, le garçon aurait entendu parler des exploits du général qui vivait en Sardaigne.
L'aurait-il mythifié ?
Ou aurait-il tout pris avec un haussement d’épaules alors que nous apprenons des événements de la vie loin de nous ?
Certes, le caractère républicain et en partie socialiste alarmait les notables et même les prêtres.
Don Francesco, parmi le petit cercle de connaissances de confiance à qui il pouvait tout dire, s'adressait toujours à lui ainsi :
"Le diable rouge".
Et toute la bureaucratie sarde qui voyait une opportunité commerciale dans le Piémont ne pouvait qu'approuver.
Ainsi, tandis qu’ailleurs se construisait une idée de révolution qui en dérangeait beaucoup, d’autres œuvraient pour que rien ne change.
Non seulement en Sicile, mais même en Sardaigne, une île où une expérience sans précédent aurait peut-être été possible.
« Grand-père, peux-tu nous parler d'oncle Carlo ?
C'est Pietro qui a pris Ettore à part un jour de la mi-juin.
Les exploits de Garibaldi grandissaient et Pietro était curieux d'avoir des nouvelles.
Il ne poserait jamais une telle question à son père.
Il savait qu'il ne parlait pas beaucoup et qu'il y avait des sujets interdits, qu'on ne partageait avec personne.
Hector, releva le chapeau qui lui couvrait constamment la tête.
Il se redressa comme si un coup de poing l'avait frappé au creux du ventre.
Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pensé à son fils disparu.
Il n'avait même jamais vu le corps et personne n'était allé au cimetière de Rome où étaient enterrés les morts de ce conflit.
La dernière image qu'il avait de Carlo était celle d'un jeune homme audacieux avec un sac sur l'épaule.
Que voulaient maintenant ses petits-enfants ?
Pourquoi cette question ?
Qu’est-ce qui les intéressait ?
Il regarda un point devant lui.
Une zone insignifiante de terre battue, identique aux autres.
Les cours de Pietro et Massimo étaient terminés, mais le soleil irradiait encore abondamment l'extérieur de la maison.
C'était la période la plus lumineuse de l'année et cela présentait des avantages évidents, mais à ce moment-là, Ettore aurait aimé que l'obscurité tombe soudainement, comme cela arrive en novembre.
Sa torture aurait alors pris fin.
Mais non.
Ses petits-enfants se tenaient devant lui, attendant.
S'il s'agissait d'un de leurs pairs, ils l'auraient déjà poussé et tiré par la manche pour le réveiller, mais il fallait avoir du respect pour une personne âgée.
Un peu comme un membre de la famille.
Vous ne deviez jamais l'interrompre ou parler avant qu'il ait commencé.
Les questions étaient légitimes, mais les réponses étaient à la discrétion des adultes et, à ce moment-là, il n'y avait plus de plaintes à formuler.
Un adulte pouvait répondre ou non et il fallait l'accepter, simplement par un jeu de regards.
Ettore leva les yeux et commença.
Il devait le faire.
Il avait toujours su que, tôt ou tard, quelqu'un viendrait déterrer le passé.
Il avait imaginé que c'était Franco, mais avec le temps, il a compris comment son fils avait déjà développé une relation avec Carlo au fil des années et il n'était certainement pas nécessaire de lui rappeler à quoi ressemblait son frère.
"Tu sais, quand ton oncle est né..."
Ettore avait commencé à décortiquer sa propre mémoire.
Il avait les bras étendus sur les côtés, pendants sur les côtés de la chaise, presque en signe de capitulation.
« ...nous vivions au village, dans la maison que je vous ai indiquée à plusieurs reprises.
J'ai tout de suite compris qu'il était différent de ton père.
Il n’était pas couvert d’épais poils noirs, mais seulement de quatre poils.
En grandissant, la diversité s’est accrue.
Votre père est aussi lié à cette terre et à son souffle que Carlo a vécu ailleurs.
Nous le voyions souvent regarder une colline plus haute que les collines voisines et regarder l'horizon.
Vers la vallée, vers Nuoro, vers l'intérieur.
Un jour, il a pris son sac, une bouteille d'eau et un morceau de pain et de fromage et s'est mis à marcher.
Nous avons constaté son absence au bout de quelques heures, il a dû partir la nuit.
Il n'est revenu que quatre jours plus tard.
Il avait dormi à ciel ouvert pendant quatre nuits et s'était élevé si haut qu'il pouvait voir la mer.
Je ne l'ai jamais vu et ton père non plus.
Et toi?"
Pietro et Massimo secouaient la tête.
Peu de gens à Orgosolo avaient vu la mer.
Hector continua :
« Cependant, il ne se contentait pas de voir les choses d’en haut. Il était descendu de la montagne et s'était approché de la côte, jusqu'à ce que, toujours d'une hauteur, il puisse la dominer du regard.
Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais à partir de ce jour, il a changé.
Une fois rentré chez lui, son discours a changé.
Il parlait de moins en moins du pays et de plus en plus de choses lointaines.
Il a marché jusqu'à Nuoro juste pour obtenir des nouvelles de première main, inédites et sans avoir à attendre l'heure habituelle.
C’était considéré comme étrange, vous savez.
Pietro avait bien en tête ce que voulait dire son grand-père.
Il n’en fallait pas beaucoup pour paraître étrange.
Un geste ou une expression, une manière de faire ou de penser.
Et d'après ce qu'il entendait, oncle Carlo était vraiment étrange, peut-être la seule personne différente de toutes celles qu'il avait rencontrées jusqu'à présent.
Massimo, même s'il ne comprenait pas complètement le sens de ce qu'il entendait, n'a pas manqué un mot.
Hector s'arrêta.
Il inspira profondément l'air chaud de l'après-midi mêlé de poussière soulevée par le vent.
Il sentit les odeurs classiques de sa terre.
Un mélange de quelque chose d'indescriptible et qu'aucun Piémontais n'avait jamais pu capturer.
Il devait en finir à ce stade.
« Pendant trois ans, ça a continué comme ça.
Personne ne savait ce qui l'intéressait ni ce qu'il avait en tête, jusqu'au jour où il commença à parler de l'Italie.
De ce qui se passait dans diverses villes, inconnu de nous tous.
Il a laissé passer le printemps et l'été, puis à l'automne nous avons entendu un nom familier.
Rome.
C'est là qu'il irait.
Il est parti avec peu de choses, mais je me souviens du sourire.
Un sourire jamais vu ici.
Personne n’en a jamais eu, pas même les messieurs et les riches, pas même les mariés le jour de leur mariage.
Un sourire insouciant d’un autre monde.
C'est l'image que j'ai de votre oncle.
Et puis il y a eu les lettres que ton père nous lisait à tous.
Des lettres qu’il a encore, je pense cachées dans la malle de sa chambre.
Pietro et Massimo savaient à quoi faisait référence leur grand-père.
Dans la chambre de leurs parents, il y avait une malle en bois, constamment fermée à clé.
Les choses précieuses étaient là.
Le collier de grand-mère, aujourd'hui décédée depuis longtemps.
L'argent économisé.
Certificats de propriété de la maison et des terrains.
Les lettres de l'oncle Carlo.
Ni Pietro ni Massimo n'avaient jamais lu ces écrits et personne n'avait trouvé le temps de leur parler, ni jugé nécessaire de le faire.
L'histoire pouvait être considérée comme terminée, mais Ettore voulait en ajouter davantage.
«Je ne sais pas si c'est bien de vivre comme ton oncle Carlo ou comme nous.
Si cela vaut la peine de se casser le dos pour la terre et les animaux ou de se faire tuer pour des idées.
Qui suis-je pour juger ?
Je ne suis ni prêtre ni homme de main.
Je sais seulement que s'il était vivant, ton oncle serait avec Garibaldi aujourd'hui.
Je sais que ce nom fait peur à beaucoup, mais pas à Carlo.
Carlo aurait été là, pour être à nouveau embroché, pour défendre des villes et libérer des villages complètement inconnus de nous, grossiers et ignorants. »
Ettore semblait épuisé.
Comme si dix ans de vie lui avaient été retirés de la poitrine.
Pietro comprit la situation et s'approcha de son grand-père.
Elle aurait aimé le serrer dans ses bras, mais cela n’était pas conforme au comportement correct.
Puis il serra Massimo dans ses bras.
"Merci grand-père."
C'était la seule chose qu'il pouvait penser à dire.
Après cet épisode, il n’y a eu aucun changement notable dans la journée normale en famille.
Tout s'est déroulé comme toujours.
Grazia a notamment supervisé la croissance de ses enfants.
Bientôt, bien plus tôt que son mari ne l'aurait imaginé, Pietro et Massimo quitteraient la maison.
Dans peu de temps, ils grandiraient définitivement pour former une famille et au moins l’un d’eux élirait résidence ailleurs.
Il semblait que peu de temps s'était écoulé depuis leur mariage, mais ce n'était pas le cas.
Les efforts et la sueur avaient marqué les visages de Grazia et Franco, plus aussi frais et reposés qu'ils l'étaient autrefois.
Il s’agissait d’accomplir une tâche, la même pour laquelle nous sommes venus au monde et qui nous a été transmise.
La chaleur commençait à être insupportable.
Il était si difficile de trouver le juste équilibre entre l’hiver rigoureux et l’été caniculaire.
Tout change, rien ne reste figé.
Quand comprend-on que la mutation s’est produite ?
Pas tout de suite.
Les membres et les sens mettent du temps à s'adapter, s'opposant à une inertie constante, toujours présente en chacun.
Ce n'est qu'avec la progression de l'habitude qu'il se plie.
Et quand on croit avoir trouvé une nouvelle dimension et qu'on se dit tout à fait à l'aise, presque sans le moindre soupçon, le voilà, encore une fois, toujours lui.
Changement.
Il suffit d'un coup de vent ou d'une tempête.
Si peu, mais c'est le signal.
L'été s'estompe.
Pas rapidement ni d'un trait net, mais avec une gradation infinie de nuances.
Les yeux et les oreilles, le nez et la bouche ne peuvent pas dire quand cela se termine, et c'est pourquoi nous avons recours au calendrier.
Cette manière tout à fait humaine de fixer le temps qui passe.
Une vie mesurée.
Celui de tout le monde.
Franco n'a pas fait exception à la règle, pas plus que ses enfants.
Cependant, la perspective était différente.
Pour ces derniers, le monde était devant eux.
Découvertes et croissance.
Amour et famille.
Travail et idées.
Mais pour Franco, tout semblait désormais réglé.
Il s'était taillé un rôle, le sien, celui qu'il avait choisi plus ou moins consciemment.
D’ici un an, il aurait quarante ans.
La plénitude de la maturité.
En fait, quelqu’un aurait pu commencer à le prendre comme point de référence.
Pas tellement sur la communauté.
Son désir de s'isoler de tout, de la campagne et du code, de la tradition et des Piémontais, était une nouvelle voie, empruntée par peu de personnes.
« Lâches », c'est ainsi que Giuseppe les appelait, les séparant des deux autres catégories.
Les traîtres et les justes, dont il sentait qu'il faisait partie.
Aux yeux des étrangers, cependant, cette terre semblait inchangée depuis des générations, avec un pouvoir d'intervention humaine vraiment limité.
Oui, bien sûr, les maisons et les villages, les quelques chemins de terre et les clôtures.
Mais ce n'était pas comme ailleurs.
"Mais pas pour longtemps", avait souligné Giuseppe.
Il connaissait bien l'avidité du conquérant, de celui qui veut piller une terre.
Les bois et le bois étaient ce à quoi il pensait principalement.
À juste titre, sans bien comprendre les conséquences de ce que Garibaldi s’apprêtait à faire.
Cependant, même ce Sarde volontaire n’aurait pas pu imaginer l’avenir, faute de moyens et de connaissances.
C'était inconnu de tous.
Et c'était peut-être une bonne chose.
Chacun doit vivre à son rythme.
Avec la fin de la saison estivale, la nouvelle des victoires des chemises rouges remontait vers les montagnes.
Le Royaume des Deux-Siciles s’effondre.
"Ce révolutionnaire finira par faire le jeu du roi."
Giuseppe cracha par terre avec dégoût.
Comment pourrait-on affronter un roi d’Italie ?
Parce que ça prenait forme.
Qui l'aurait arrêté ?
Comment des bergers, même organisés, pourraient-ils s’opposer aux voyous d’une monarchie nationale ?
Bataille perdue.
Franco n'a pas réfléchi plus loin.