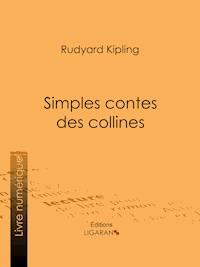
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Extrait : "Elle était la fille de Sonoo, un homme des collines de l'Himalaya et de sa femme Jadéh. Une année, leur maïs ne rendit pas et deux ours passèrent la nuit dans leur unique champ de pavots, qui était juste au-dessus de la vallée du Sudledge, sur la rive de Kotgarh. Aussi, à la saison prochaine, ils se firent chrétiens et apportèrent leur bébé à la mission pour le faire baptiser."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans l’Inde septentrionale, il y avait un monastère appelé le Chubára de Dhunni Bhagat. Personne ne se rappelait qui était Dhunni Bhagat ni quelle profession il exerçait en son temps. Il avait vécu sa vie, ramassé un peu d’argent et, comme c’est le devoir d’un bon Hindou, dépensé le tout à édifier une œuvre de piété – le Chubára. Cela abondait en cellules aux murs de briques, avec d’éclatantes peintures qui représentaient des dieux et des rois et des éléphants, et des prêtres décrépits venaient s’y asseoir et méditer sur la fin dernière des choses : les allées étaient pavées de briques, et les pieds nus de milliers de fidèles y avaient creusé de vraies rigoles. Des bouquets de manguiers s’élançaient d’entre les briques ; de grands arbres se penchaient au-dessus de la manivelle du puits qui geignait tout du long de la journée ; et des armées de perroquets passaient à tire d’aile à travers les arbres. Les corneilles et les écureuils étaient ici domestiqués, car ils savaient bien que pas un prêtre ne les toucherait jamais.
De cent milles à la ronde, mendiants errants, vendeurs de charmes et vagabonds en odeur de sainteté venaient visiter le Chubára et s’y reposer. Mahométans, Sikhs et Hindous frayaient sur un pied d’égalité à l’ombre des arbres. Ils étaient vieux, et quand l’homme est parvenu aux tourniquets de la Nuit, tous les dogmes du monde lui semblent merveilleusement semblables et décolorés.
Je tiens la remarque de Gobind le borgne. C’était un saint homme qui vivait sur une île au milieu d’une rivière et qui deux fois le jour jetait en pâture aux poissons de petites boulettes de pain. Dans la saison des grandes eaux, quand des cadavres bouffis venaient s’échouer au pied de l’île, Gobind veillait à ce qu’ils fussent pieusement, brûlés, pour l’honneur de l’humanité et en prévision du compte qu’il rendrait un jour à Dieu.
Mais quand les deux tiers de l’île furent emportés par une crue soudaine, Gobind vint à travers la rivière jusqu’au Chubára de Dhunni Bhagat, lui, son vase à boire de cuivre jaune avec la corde du puits autour du goulot, sa courte béquille à reposer le bras semée de clous brillants, sa paillasse, sa grande pipe, son parasol et son haut chapeau en pain de sucre où se balançaient des plumes de paon. Il s’enveloppa de sa courtepointe rapiécée où se mêlaient toutes les couleurs et tous les tissus connus, s’assit dans un coin ensoleillé du silencieux Chubára, et, appuyant le bras sur sa béquille court-emmanchée, il attendit la mort. On lui apportait des aliments et des poignées de fleurs de souci et en retour il donnait sa bénédiction. Il était presque aveugle, et sa figure était couturée, ridée et plissée au-delà de toute croyance, car il avait vécu dans son temps, qui était avant que les Anglais fussent arrivés à plus de cinq cents milles du Chubára de Dhunni Bhagat.
Quand nous eûmes bien lié connaissance, Gobind me disait des contes, d’un ton de voix qui rappelait à s’y méprendre le roulement lointain de lourds canons sur un pont de bois. Ses contes étaient vrais, mais pas un sur vingt ne pourrait être imprimé dans un livre anglais, parce que les Anglais ne pensent pas comme les indigènes. Ils rêvent sans fin à des choses qu’un indigène chasserait de sa pensée jusqu’à une occasion favorable ; et un sujet qui n’arrêtera pas une seconde leur attention occupera l’esprit d’un indigène jusqu’à l’occasion favorable : le résultat c’est que, d’un bord à l’autre d’un profond abîme de malentendu, indigènes et Anglais se regardent effarés, sans espoir de s’entendre.
– Et quel est votre métier honoré ? me dit Gobind un dimanche soir. De quelle façon gagnez-vous votre pain quotidien ?
– Je suis, dis-je, un kerani – un qui écrit avec une plume sur du papier, sans être au service du gouvernement.
– Alors qu’écrivez-vous ? dit Gobind. Approchez-vous, car je ne puis voir votre visage, et la lumière manque.
– Je prends pour sujet de mes écrits tout ce qui est à la portée de mon intelligence et bien des choses qui passent mon intelligence. Mais par-dessus tout je traite de la Vie et de la Mort, et des hommes et des femmes, et de l’Amour et du Destin, selon la mesure de mes talents, mettant le conte dans la bouche d’un, deux ou plusieurs personnages. Puis, par la grâce de Dieu, les contes se vendent et il m’en revient de l’argent par quoi je me maintiens en vie.
– Précisément, dit Gobind. C’est là le travail du conteur de bazar ; mais lui parle tout franc aux hommes et aux femmes et il n’écrit rien du tout. Seulement quand l’histoire a piqué la curiosité des auditeurs et que les catastrophes vont fondre sur les bons, il s’arrête tout court et il exige qu’on le paie avant de reprendre son récit. En est-il ainsi dans votre corps de métier, mon fils ?
– J’ai entendu parler de quelque chose d’analogue quand un conte est très étendu, et qu’il se vend comme un concombre, par petites tranches.
– Ah ! c’est moi qui étais jadis un diseur d’histoires renommé, quand j’allais mendiant sur la route qui va de Koshin à Etra ; c’était avant le dernier pèlerinage que j’ai fait, et que je ferai jamais, à Orissa. J’ai raconté bien des histoires et j’en ai entendu raconter bien d’autres dans les maisons de repos, le soir quand on était gai après la marche de la journée. Mon cœur me dit qu’en matière de contes, les grandes personnes ne sont que de petits enfants, et que le plus vieux conte est aussi le plus aimé.
– Chez vous, c’est vérité, dis-je. Mais les gens de mon peuple désirent des contes nouveaux, et quand tout est écrit, voilà qu’ils se lèvent et déclarent que l’histoire serait meilleure, contée autrement, et ils mettent en doute la vérité des faits ou votre part d’invention.
– Mais quelle folie est la leur ! dit Gobind, brandissant sa main noueuse. Une histoire qui est racontée est une histoire vraie tant qu’en dure le récit. Et quant aux remarques de ces gens-là – vous savez ce que Bilas Khan, qui était le prince des conteurs, a répondu à quelqu’un qui le raillait dans la grande maison de repos qui est sur la route de Jhelum : « Continue, mon frère, et finis ce que j’ai commencé », et le railleur reprit le récit, mais n’ayant ni voix ni talent à apporter à la tâche il dut bientôt s’arrêter, et les pèlerins à souper le nourrirent d’injures et de coups de bâtons la moitié de cette nuit-là.
– Non, mais chez nous, du moment qu’on a donné de l’argent, c’est le droit de l’acheteur ; tout comme nous nous en prendrions au vendeur de souliers de la mauvaise qualité de nos souliers, s’ils s’usaient trop vite. Si jamais je fais un livre, vous le verrez et vous serez juge.
– Et le perroquet dit à l’arbre qui tombait : « Attends, frère, que j’aille te chercher un support ! » dit Gobind avec un petit rire de froide ironie. Dieu m’a donné quatre-vingts ans, et peut-être quelques années de plus. À cet âge, je ne puis guère regarder au-delà de la journée qui m’est mesurée à nouveau chaque jour, comme par faveur. Hâte-toi.
– De quelle façon convient-il que je me mette à la tâche, dis-je, ô chef suprême de ceux qui égrènent des perles avec leur langue ?
– Comment le saurais-je ? Pourtant – il médita un instant – comment ne le saurais-je pas ? Dieu a créé bien des têtes, mais dans le monde entier, chez ton peuple ou chez le mien, il n’y a qu’un cœur. Ce sont tous des enfants en matière de contes.
– Mais il n’y en a pas de si terribles que les petits, quand on déplace un mot ou que, racontant l’histoire une seconde fois, on oublie de mentionner ne fût-ce qu’un unique diablotin.
– Oui, j’ai raconté, moi aussi, des histoires aux petits, mais voici ce que tu dois faire… – Le regard de ses vieilles prunelles tomba sur les peintures éclatantes du mur, sur le dôme bleu et rouge et sur les flammes des poinsettias au-delà. – Parle-leur d’abord des choses que tu as vues et qu’ils ont vues aussi. Ainsi leur connaissance suppléera à tes imperfections. Parle-leur de ce que tu es seul à avoir vu, puis de ce que tu as entendu dire, et puisque ce sont des enfants, parle-leur de batailles et de rois, de chevaux, de diables, d’éléphants et d’anges, mais ne manque pas de leur parler d’amour et autres choses du même genre. La terre entière est pleine de contes pour qui écoute et ne chasse pas les pauvres de sa porte. Les pauvres sont les meilleurs conteurs qu’il y ait ; car il leur faut mettre leur oreille contre le sol chaque soir.
Après cette conversation, l’idée germa dans ma tête, et Gobind montrait de l’insistance à s’informer de la santé du livre.
Plus tard, après une absence de plusieurs mois, il arriva que je devais partir, pour aller très loin, et je vins dire adieu à Gobind.
– C’est un adieu pour tout de bon maintenant, dis-je, car je pars pour un très long voyage.
– Et moi aussi. Pour un plus long que le tien. Mais le livre ? dit-il.
– Il naîtra quand son temps sera venu, s’il en est ainsi ordonné.
– Je souhaiterais le voir, dit le vieil homme, se rencognant sous sa courtepointe. Mais cela ne sera pas. Je meurs dans trois jours, la nuit, un peu avant l’aurore. Le terme de mes ans est accompli.
Neuf fois sur dix un indigène calcule sans se tromper le jour de sa mort. À cet égard il a la prescience des bêtes.
– Alors tu t’en iras en paix, et c’est une bonne nouvelle, car tu as dit que la vie n’a pas de plaisirs pour toi.
– Mais il est dommage que notre livre ne soit pas né. Comment saurai-je que mon nom y est mentionné ?
– Parce que je promets qu’en tête du livre, précédant tout le reste, on verra ceci écrit : « Gobind, sadhu, de l’île de la rivière et attendant Dieu dans le Chubára de Dhunni Bhagat, a parlé le premier de ce livre », dis-je.
– Et a donné son avis – l’avis d’un vieillard. Gobind, fils de Gobind du village de Chumi dans le tehsil de Karaon, district de Mooltan. Cela aussi sera-t-il écrit ?
– Cela sera écrit aussi.
– Et le livre ira par-delà l’Eau Noire jusqu’aux maisons de ton peuple, et tous les sahibs connaîtront mon nom, moi qui ai quatre-vingts ans ?
– Tous ceux qui liront le livre le connaîtront. Je ne puis répondre des autres.
– C’est là une bonne nouvelle. Appelle à haute voix tous ceux qui sont dans le monastère, et je veux leur dire cela.
En rangs serrés ils approchèrent, faquirs, sadhus, sunnyasis, byragis, nihangs et mullahs, prêtres de toutes les confessions, exhibant toutes les variétés de loques, et Gobind, appuyé sur sa béquille, parla, tant et si bien que leur cœur se gonfla visiblement d’envie et qu’un ancien à cheveux blancs invita Gobind à penser plutôt à sa fin dernière qu’à une renommée périssable due à des bouches étrangères. Alors Gobind me donna sa bénédiction et je m’en allai.
Ces contes ont été recueillis de tous côtés, et ils viennent de toutes sortes de gens, prêtres du Chubára, Ala Yar le ciseleur, Jiwun Singh le charpentier, hommes à peine entrevus sur des bateaux à vapeur ou dans des trains tout autour du monde, femmes filant à la porte de leurs chaumières dans le crépuscule, officiers et gentlemen déjà morts et enterrés, et j’en dois quelques-uns, mais ce sont de tous points les meilleurs, à mon père. La plupart de ces contes ont paru dans des magazines ou des journaux, et j’adresse mes remerciements aux rédacteurs en chef de ces publications ; mais quelques récits sont nouveaux de ce côté-ci de l’eau, et il y en a qui n’avaient pas encore vu le jour.
Les histoires les plus remarquables sont, bien entendu, celles qui ne paraissent pas – pour des raisons trop claires.
Voyez, vous avez rejeté l’Amour ! Quels sont ces dieux auxquels vous me commandez de plaire ? Les Trois en Un, l’Un en Trois ? Non pas ! Je retourne aux dieux de mon peuple. Il se peut qu’ils me donnent plus de bien-être que votre Christ glacé et vos Trinités emmêlées.
(Le Converti.)
Elle était la fille de Sonoo, un homme des collines de l’Himalaya et de sa femme Jadéh. Une année, leur maïs ne rendit pas, et deux ours passèrent la nuit dans leur unique champ de pavots, qui était juste au-dessus de la vallée du Sudledge, sur la rive de Kotgarh. Aussi, à la saison prochaine, ils se firent chrétiens et apportèrent leur bébé à la mission pour le faire baptiser. Le chapelain de Kotgarh donna à la petite le nom d’Élisabeth, que les paharis des collines prononcent « Lispeth ».
Plus tard, le choléra entra dans la vallée de Kotgarh et emporta Sonoo et Jadéh, et Lispeth devint moitié servante moitié demoiselle de compagnie, à Kotgarh, chez la femme du chapelain d’alors. Ceci se passait après le règne des missionnaires moraves en cet endroit, mais avant que Kotgarh eût tout à fait oublié son titre de maîtresse des collines du nord.
Le christianisme fit-il du bien à Lispeth ? Les dieux de son peuple en auraient-ils fait autant pour elle dans tous les cas ? Je n’en sais rien, mais elle devint charmante en grandissant. Quand une fille des collines devient charmante, elle vaut la peine qu’on fasse cinquante milles par de mauvais chemins pour aller l’admirer. Lispeth avait un visage grec, – un de ces visages comme on en peint si souvent et comme on en voit si rarement. Elle était pâle, avec des tons d’ivoire, et, eu égard à sa race, extrêmement grande. De plus, elle possédait des yeux qui étaient admirables ; et si elle n’avait pas porté les abominables cotonnades chères aux missions, vous auriez cru, en la rencontrant soudain au penchant des collines, que c’était la Diane des Romains qui s’en, allait à la chasse.
Lispeth se fit vite au christianisme, et ne s’en débarrassa pas quand elle devint femme, comme font quelques filles des collines. Les gens de sa race la détestaient, parce que, disaient-ils, elle était maintenant une blanche et se lavait tous les jours ; et la femme du chapelain ne savait pas que faire d’elle. On ne peut pas demander à une déesse imposante, haute de cinq pieds six pouces dans ses souliers, de laver des assiettes et des plats. Elle jouait avec les enfants du chapelain et enseignait à l’école du dimanche, et lisait tous les livres de la maison, et devenait de plus en plus belle, comme les princesses dans les contes de fées. La femme du chapelain dit que le jeune fille devrait entrer en service à Simla, s’y faire garde-malade ou quelque chose de comme il faut. Mais Lispeth ne voulait pas entrer en service. Elle se trouvait très heureuse où elle était.
Il n’y avait pas beaucoup de voyageurs à cette époque, mais quand il en venait, Lispeth se retirait dans sa chambre et donnait un tour de clé, crainte qu’on ne l’emmenât à Simla ou quelque part dans le monde inconnu.
Un jour – elle avait dix-sept ans depuis quelques mois – Lispeth sortit pour faire un tour. Elle ne marchait pas à la manière des dames anglaises, qui font un mille et demi dans la campagne et reviennent en voiture. Elle couvrait de vingt à trente milles dans ses petites promenades de digestion, battant tout le pays entre Kotgarh et Narkunda. Cette fois-là elle revint à la nuit noire et descendit pas à pas la pente abrupte qui mène à Kotgarh, avec quelque chose de lourd dans les bras. La femme du chapelain sommeillait dans le salon quand Lispeth rentra, soufflant avec difficulté et épuisée par le poids de son fardeau. Lispeth le déposa sur le sofa, et dit simplement : « Voici mon mari. Je l’ai trouvé sur la route de Bagi. Il s’est blessé. Nous le soignerons et quand il sera rétabli votre mari nous unira. »
Lispeth n’avait jamais encore exprimé ses vues sur la question du mariage, et la femme du chapelain poussa un cri d’horreur. Toutefois il fallait s’occuper tout d’abord de l’homme qui était sur le sofa. C’était un jeune Anglais, et sa tête avait été entamée jusqu’à l’os par une arête ébréchée. Lispeth dit qu’elle l’avait trouvé en descendant la colline et qu’elle l’avait rapporté. Il respirait drôlement et avait perdu connaissance.
On le mit au lit et le chapelain, qui savait un peu de médecine, lui donna ses soins ; et Lispeth attendit derrière la porte dans le cas où on aurait eu besoin d’elle. Elle expliqua au chapelain que c’était là l’homme qu’elle voulait épouser ; et le chapelain et sa femme lui reprochèrent sévèrement l’inconvenance de sa conduite. Lispeth écouta tranquillement et répéta sa première proposition. Il faut une forte dose de christianisme pour détruire les instincts barbares de l’Orient, comme par exemple de tomber amoureux à première vue. Lispeth, ayant trouvé l’homme qu’elle adorait, ne voyait pas pourquoi elle devrait garder le silence sur le choix qu’elle avait fait. Elle allait soigner cet Anglais jusqu’à ce qu’il fût suffisamment rétabli pour l’épouser. Tel était son programme.
Après une quinzaine de jours de fièvre bénigne et de fluxion, l’Anglais parvint de nouveau à joindre ses pensées bout à bout et il remercia le chapelain et sa femme et Lispeth – surtout Lispeth – de leurs bons soins. Il voyageait en Orient, dit-il ; on ne parlait pas de globe-trotters dans ces jours-là : c’était au moment où la flotte de la compagnie péninsulaire était encore jeune et chétive ; et il était venu de Dehra Dun pour faire la chasse aux plantes et aux papillons dans les collines de Simla. Par conséquent personne à Simla ne le connaissait. Dans son idée il était tombé du haut d’un rocher en se penchant pour arracher une fougère qui poussait sur un tronc pourri, et ses coolies avaient dû voler ses bagages et s’enfuir. Il voulait retourner à Simla quand il se sentirait un peu plus fort. Il en avait fini avec les excursions dans les montagnes.
Il ne se pressa pas de s’en aller ; et ses forces ne revenaient que lentement. Comme Lispeth refusait d’accepter les conseils du chapelain ou de sa femme, le chapelain parla à l’Anglais et lui dit où en était le cœur de Lispeth. Le jeune homme rit beaucoup et dit que c’était très joli et romanesque, mais que comme il avait une fiancée en Angleterre, il imaginait que les choses n’iraient pas plus loin. Certainement il se conduirait avec prudence. Il le fit. Pourtant il se plaisait à causer avec Lispeth, à se promener avec Lispeth et à lui dire des choses gentilles, et à lui donner des noms d’affection, tandis qu’il reprenait ses forces pour le départ. Tout cela n’avait aucune importance à ses yeux, mais c’était tout l’univers de Lispeth. Elle fut très heureuse tant que dura la quinzaine, parce qu’elle avait trouvé un homme à aimer.
Étant une sauvage de naissance, elle ne prenait pas la peine de cacher ses sentiments, et l’Anglais s’en amusait. Quand il partit, Lispeth l’accompagna en haut de la colline jusqu’à Narkunda, bouleversée et misérable. La femme du chapelain, qui était une bonne chrétienne avec une aversion décidée pour tout ce qui ressemblait à un esclandre ou à un scandale – elle n’avait plus aucune autorité sur Lispeth – avait prié l’Anglais de dire à Lispeth qu’il allait revenir l’épouser. « Ce n’est qu’une enfant, vous comprenez, et au fond, j’en ai peur, une païenne », dit la femme du chapelain. En conséquence de quoi, pendant les douze milles qu’ils firent pour arriver au sommet de la colline, l’Anglais, le bras passé autour de la taille de Lispeth, ne cessa d’assurer la jeune fille qu’il reviendrait l’épouser ; et Lispeth le lui fit promettre encore et encore. Elle pleura sur le haut de la chaîne de Narkunda jusqu’à ce qu’il eût disparu le long du sentier de Muttiani.
Alors elle sécha ses larmes et rentra à Kotgarh, et dit à la femme du chapelain : « Il va revenir m’épouser. Il est allé prévenir ses parents. » Et la femme du chapelain abonda dans ce sens et dit à Lispeth : « Il reviendra. » Au bout de deux mois Lispeth montra de l’impatience et on lui dit que l’Anglais était allé, par-delà les mers, en Angleterre. Elle savait où était l’Angleterre, parce qu’elle n’avait lu que fort peu de manuels de géographie ; mais, bien entendu, étant une fille des collines, elle ne comprenait pas du tout ce que pouvait être la mer. Il y avait dans la maison une vieille mappemonde découpée en jeu de patience. Lispeth s’en était amusée pendant qu’elle était petite. Elle la tira de son réduit, et rassembla les morceaux le soir à la veillée, et pleura silencieusement, et essaya de deviner où était son Anglais. Comme elle n’avait aucune idée des distances ou des bateaux à vapeur, ses imaginations restaient dans le vague. Elle n’eût du reste rien gagné à être plus précise : car l’Anglais ne songeait nullement à revenir épouser une fille des collines. Il l’oublia complètement en faisant la chasse aux papillons dans l’Assam. Il écrivit plus tard un livre sur l’Orient. Le nom de Lispeth n’y figure pas.
Au bout de trois mois, Lispeth fit un pèlerinage quotidien à Narkunda, pour voir si son Anglais arrivait le long de la route. Cela la soulageait, et la femme du chapelain la voyant plus heureuse s’imagina qu’elle commençait à oublier sa folie barbare et si contraire à la modestie. Un peu plus tard, ces promenades cessèrent de faire du bien à Lispeth, et son caractère s’aigrit beaucoup. La femme du chapelain pensa que le moment était venu de lui dire ce qu’il en était réellement de toute l’affaire – comme quoi l’Anglais ne lui avait promis son amour que pour la tranquilliser, n’avait jamais pensé à tenir cette promesse – et comme quoi c’était mal et inconvenant à Lispeth de songer à épouser un Anglais, qui était fait d’une argile supérieure, sans compter qu’il était fiancé à une jeune fille de sa propre race. Lispeth répondit que tout cela était évidemment impossible, car il lui avait dit qu’il l’aimait, et la femme du chapelain avait de sa propre bouche affirmé que l’Anglais allait revenir.
– Puisque vous m’avez dit cela, lui et vous, comment cela peut-il être faux ? demanda Lispeth.
– Ce n’était qu’un prétexte pour vous tranquilliser, mon enfant, dit la femme du chapelain.
– Alors, vous m’avez menti, dit Lispeth, vous et lui.
La femme du chapelain baissa la tête et ne répondit rien. Lispeth aussi resta silencieuse pendant un moment, puis elle descendit dans la vallée et revint habillée en fille des collines, – outrageusement sale, mais sans anneau dans le nez et sans boucles d’oreilles. Ses cheveux étaient tressés en une longue natte, à grand renfort de fil noir, comme c’est la coutume des femmes des collines.
– Je retourne chez les miens, dit-elle. Vous avez tué Lispeth. Il n’y a plus que la fille de la vieille Jadéh – la fille d’un pahari et la servante de Tarka Devi, – vous n’êtes tous que des menteurs, vous autres Anglais.
Quand la femme du chapelain se remit du coup que lui avait porté Lispeth en lui annonçant qu’elle passait aux dieux de sa mère, la jeune fille était partie. Elle ne revint jamais.
Elle embrassa avec passion la vie de son peuple mal lavé, comme pour rattraper le temps qu’elle avait passé loin de lui ; et sans beaucoup attendre elle se maria avec un bûcheron qui la battit à la manière des paharis, et sa beauté se fana bientôt.
« Il n’y a pas de loi par quoi on puisse expliquer les excentricités des pains, dit la femme du chapelain, et je crois que Lispeth avait toujours été au fond du cœur une infidèle. » Vu que Lispeth avait été reçue dans le sein de l’Église d’Angleterre à l’âge mûr de cinq semaines, cette affirmation ne fait aucun honneur à la femme du chapelain.
Lispeth était une très vieille femme quand elle mourut. Elle conserva jusqu’à sa mort une maîtrise parfaite de l’Anglais, et quand elle était suffisamment ivre, on pouvait parfois l’amener à conter l’histoire de ses premières amours.
Il était difficile, alors, de se rendre compte que cette créature chassieuse et ridée, de tout point semblable à un paquet de chiffons carbonisés, avait jadis été « Lispeth de la mission de Kotgarh ».
Dieu sait ce qui fondra sur nous cette nuit. Douloureuse, oppressée, la Terre est dans l’attente, sans sommeil, les yeux ouverts ; et nous, qui fûmes créés de la Terre, nous tressaillons aux souffrances de notre mère.
(Au cachot.)
Aucun homme ne saura jamais la vérité exacte sur cette histoire ; quoique les femmes se la répètent parfois en chuchotant, après une danse, quand elles arrangent leurs cheveux pour la nuit et comparent la liste de leurs victimes. Un homme, bien entendu, ne peut assister à ces cérémonies. Aussi, l’histoire doit-elle être contée du dehors, dans l’obscurité, tout de travers.
Ne faites jamais l’éloge d’une sœur à sa sœur, dans l’espérance que vos compliments arriveront à destination et ainsi vous prépareront la voie pour plus tard ; quand on est sœur, on est femme d’abord et sœur ensuite. Et vous vous apercevrez que vous vous faites du tort.
Saumarez savait cela quand il se décida de proposer le mariage à mademoiselle Copleigh l’aînée. C’était un homme bizarre, de très peu de mérite au jugement des hommes, quoiqu’il fût très populaire auprès des femmes et eût assez de fatuité pour en approvisionner tout un conseil de vice-roi et en laisser encore assez pour l’état-major du général en chef. Il était dans le service civil. Beaucoup de femmes s’intéressaient à Saumarez, peut-être parce qu’il les traitait haut la main. Frappez un cheval sur le naseau au début de vos relations, il ne vous portera peut-être pas dans son cœur, mais il prendra toujours le plus vif intérêt à vos mouvements à partir de ce jour. Mademoiselle Copleigh l’aînée était gentille, grassouillette, elle avait du charme et elle était jolie. Sa sœur n’était pas si jolie, et, du point de vue des hommes qui ne tenaient pas compte de l’avis donné ci-dessus, il y avait dans son attitude quelque chose de désagréable et d’antipathique. Les deux jeunes filles avaient, à peu de chose près, la même taille et elles se ressemblaient extraordinairement d’expression et de voix ; quoiqu’on ne pût hésiter un seul instant à dire laquelle était la plus charmante.
Elles venaient de Behar. Aussitôt qu’elles arrivèrent à notre station, Saumarez décida d’épouser l’aînée. Du moins, nous le croyions tous, ce qui revient au même. Elle avait vingt-deux ans et il en avait trente-trois, avec un traitement et des indemnités qui atteignaient presque quatorze cents roupies par mois. Ainsi, ce mariage, tel que nous l’arrangions, était de tous les points de vue excellent. Saumarez était son nom et sommaires ses procédés, comme le dit un jour l’un d’entre nous. Ayant couché par écrit sa résolution, il nomma un comité spécial d’un membre pour l’examiner, et il résolut de prendre son temps. Dans notre argot désagréable, les petites Copleigh « chassaient à deux. » C’est-à-dire qu’on ne pouvait avoir affaire à l’une sans que l’autre fût de moitié. Les deux sœurs s’aimaient beaucoup, mais leur mutuelle affection avait parfois des inconvénients. Saumarez tint la balance rigoureusement égale entre elles, et personne autre que lui n’aurait pu dire de quel côté inclinait son cœur, quoique chacun le devinât. Il allait souvent à cheval avec elles, et dansait avec elles, mais il ne réussit jamais à les détacher l’une de l’autre pendant un temps appréciable.
Les femmes disaient que, si les deux jeunes filles se tenaient toujours ensemble, c’est qu’elles se méfiaient extraordinairement l’une de l’autre, chacune d’elles craignant que sa sœur ne mît son absence à profit. Mais un homme n’a rien à voir avec ces racontars. Saumarez, quelles que fussent ses intentions, se taisait, conduisant sa cour avec toute l’application possible, sauf, bien entendu, les droits de son travail et de son polo. Sans le moindre doute, les deux jeunes filles l’aimaient.
Comme les chaleurs s’approchaient et que Saumarez ne faisait aucun signe, les femmes dirent que le désappointement se lisait dans les yeux des jeunes filles, qu’elles avaient l’air très lasses, inquiètes, irritables. Les hommes sont tout à fait aveugles en ces matières, à moins qu’ils ne tiennent plus de la femme que de l’homme, auquel cas peu importe ce qu’ils disent ou pensent. Moi, je soutiens que ce sont les chaudes journées d’avril qui avaient pâli les joues des petites Copleigh. On aurait dû les envoyer de bonne heure dans les collines. Personne, homme ou femme, ne se sent l’étoffe d’un ange quand les chaleurs approchent. La cadette devint plus sarcastique, pour ne pas dire plus aigre, dans ses remarques, et le charme de l’aînée s’atténua notablement : on y sentait l’effort.
La station où se passaient toutes ces choses n’était pas des plus petites, mais elle était loin du chemin de fer et elle souffrait d’un manque d’attention. Il n’y avait ni jardins, ni concerts, ni amusements qu’il vaille la peine de mentionner et il fallait presque une journée de chemin pour aller danser à Lahore. On était très reconnaissant de la moindre distraction qui se présentait.





























