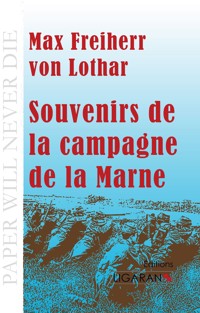
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Souvenirs de la campagne de la Marne" est un livre captivant qui nous plonge au cœur des événements dramatiques de la Première Guerre mondiale. Écrit par
Lothar Clemens Hausen,
Max Freiherr von et
Friedrich Max Kircheisen, ce récit offre un témoignage unique et poignant de leur expérience sur le front de la Marne.
Les auteurs, tous trois officiers allemands, nous transportent dans les tranchées et les champs de bataille de cette région emblématique de la guerre. À travers leurs souvenirs, ils nous font revivre les moments intenses et les émotions vécues lors de cette campagne cruciale.
Le livre nous plonge dans l'atmosphère de l'époque, décrivant avec précision les conditions de vie difficiles des soldats, les combats acharnés et les stratégies militaires mises en place. Les auteurs nous font également part de leurs réflexions sur la guerre, ses conséquences et son impact sur la société.
"Souvenirs de la campagne de la Marne" est un ouvrage qui se distingue par son authenticité et sa sincérité. Les auteurs ne cherchent pas à glorifier la guerre, mais à partager leur vécu et à témoigner des horreurs auxquelles ils ont été confrontés. Leur plume est empreinte d'une profonde humanité, nous rappelant que derrière les uniformes se trouvent des hommes, avec leurs peurs, leurs doutes et leurs espoirs.
Ce livre est un véritable voyage dans le temps, nous permettant de mieux comprendre les enjeux et les réalités de la Première Guerre mondiale. Il constitue une lecture incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la mémoire de cette période sombre de notre histoire.
"Souvenirs de la campagne de la Marne" est un témoignage poignant et bouleversant, qui nous rappelle l'importance de préserver la paix et de ne jamais oublier les sacrifices consentis par ceux qui ont combattu sur les champs de bataille.
Extrait : Au début de la seconde décade du XXe siècle, l'Europe se partageait entre les groupements de puissances suivants : 1. L'Allemagne, forte militairement et économiquement, l'Autriche-Hongrie malade, et la Turquie à demi-morte. 2. La gigantesque Russie, abondamment pourvue de soldats et de ressources naturelles; l'Angleterre, qui régnait sur le monde entier ; (...)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Avertissement des Éditions Ligaran
L’ouvrage que vous détenez est la réédition d’un ouvrage ancien. Malgré tout le soin que nous avons apporté à sa réalisation, il se peut que vous y trouviez quelques défauts et anomalies : certaines coquilles peuvent subsister ; le texte a pu bénéficier d’un effort de modernisation du français afin d’en améliorer son intelligibilité ; les gravures et les images étant celles d’origine, la qualité de ces dernières n’est pas toujours optimale.
Parmi les livres publiés aux Éditions Ligaran, certains contenus peuvent heurter le public par le vocabulaire utilisé ou les idées exposées ; ceci doit se comprendre et s’inscrire dans le contexte de l’époque.
Les Éditions Ligaran déclinent toute responsabilité relative à d’éventuelles omissions, inexactitudes ou erreurs qui pourraient exister dans les contenus.
Préface
Le colonel général baron von Hausen a commandé la IIIe armée allemande depuis sa formation, le 3 août 1914 jusqu’au 12 septembre 1914, date à laquelle une sérieuse atteinte de typhus l’éloigna du front. Cette troisième armée (XIe, XIIe et XIXe corps actif, XIIe corps de réserve) était entièrement saxonne ; le général von Hausen affirme qu’en publiant ses souvenirs, il a voulu la défendre contre les bruits fâcheux qui avaient attribué à sa conduite le repli général des armées allemandes en septembre 1914.
Le récit du général von Hausen est intéressant à comparer avec celui du général von Bülow, commandant la IIe armée, et qui était son voisin de droite ; du général von Kluck, qui commandait la Ire armée formant elle-même l’extrême droite de l’armée allemande ; le témoignage du major général von Tappen, chef du bureau des opérations du Grand Quartier Général allemand, et du général von Kühl chef d’État-Major de la Ire armée. Von Kluck confirme et précise les témoignages des commandants des Ire, IIe et IIIe armées. La bataille des frontières et la bataille de la Marne apparaissent ainsi clairement vues de l’aile Est des armées allemandes.
Par l’ouvrage du général Lanrezac, commandant la 5e armée française, nous savons dans quelles conditions la droite française s’est repliée après la bataille de Charleroi : c’est par l’ordre du général Lanrezac, dont la droite se trouvait en l’air, par suite du recul de la 4e armée sa voisine ; menacé d’être tourné et coupé, il dut chercher en arrière la liaison avec l’ensemble des armées françaises.
Par l’ensemble des publications nouvelles du côté allemand, nous allons saisir le moment où le repli allemand, aveu de la défaite, a été ordonné.
Dans le grand mouvement de conversion de la droite allemande à travers la Belgique, les Ire et IIe armées déployaient leurs mouvements sur la rive gauche de la Marne ; Liège pris et Namur investi, elles se portaient sur la Sambre, de Namur à Charleroi, pendant que la IIIe armée Von Hausen atteignait la Meuse, de Namur à Givet. La 5e armée Lanrezac s’alignait le long de la Sambre, et se trouvait ainsi dans une tenaille formée par les Ire, IIe armées déployées face au sud, et la IIIe armée déployée face à l’ouest. La gauche de l’armée Lanrezac n’avait qu’une liaison insuffisante avec la petite armée anglaise du maréchal French, sa droite était gardée par une division de réserve qui défendait les passages de la Meuse, face à l’est, et avait devant elle les quatre corps d’armée saxons.
Le Haut Commandement allemand se rendait parfaitement compte des avantages que présentaient la base en équerre qui se trouvait à sa disposition dans cette partie du front. Son ordre du 20 août portait : « l’attaque de la IIe armée contre l’ennemi à l’ouest de Namur devra coïncider avec l’attaque de la IIIe armée contre la ligne de la Meuse, de Namur à Givet, les commandants d’armée se concerteront à cet effet ». À cette date le général von Hausen croit qu’il a devant lui les 1er, 2e et peut-être le 10e corps français ; et le général von Bülow pense n’avoir affaire qu’à trois divisions de cavalerie. C’est seulement le 23 que le concert prescrit par le G.Q.G. allemand a pu se réaliser, et la IIIe armée s’engage.
Nous saisissons mal, dans les Souvenirs du général von Hausen, le motif de ses lenteurs et de ses indécisions pendant cette journée. Il avait pris pied sur la rive gauche, en cinq ou six points différents, et paraissait attendre que l’avance de la IIe armée facilitât le passage de ses gros. La XXIVe division qui était seule en force sur la rive gauche, s’était emparée d’Onhaye, qui commandait tous ces passages entre Hastières et Dinant, et aurait pu faire tête-de-pont pour toute la IIIe armée ; mais elle s’en laissa débusquer par deux bataillons de la 8e brigade, envoyés à la rescousse par le général d’Esperey. Le général von Hausen, sans doute mal renseigné par ses subordonnés, affirme à tort que cette division a cédé le terrain devant « des forces supérieures ».
Une division du XIXe corps sous le commandement du général Götz von Olenhüsen, avait reçu la mission de forcer le passage de la Meuse, au sud de Givet. Ce mouvement aurait pu séparer complètement les 4e et 5e armées françaises, et cette rupture de front eût été grosse de conséquences. Mais il se laissa amuser par quelques arrière-gardes sur la rive droite de la Meuse, s’arrêta à Fumay devant cette rivière qu’il ne franchit qu’après beaucoup d’hésitation ; sur la rive droite, sa marche fut retardée les jours suivants par quelques compagnies d’un régiment de réserve qui lui disputèrent adroitement le terrain. En résumé, dans la bataille de Charleroi, la IIIe armée allemande ne joua pas le rôle auquel l’appelaient sa position stratégique et la prédominance de ses forces, mais sa présence en arrière du flanc droit de l’armée Lanrezac constituait une menace, qui, jointe au recul des Anglais en arrière de Mons, plaçait la 5e armée française dans la situation la plus dangereuse, d’où elle ne pouvait échapper que par une prompte retraite qui commença le 24.
* * *
Pendant la bataille de la Marne, l’armée saxonne combattit avec une grande bravoure et obtint quelques succès, mais ces succès se déroulaient loin du point critique où se décidait le sort de la bataille, et comme ils n’étaient pas suffisants pour amener une rupture du front, la IIIe armée dut se replier par ordre en même temps que la ligne allemande.
Le Haut Commandement allemand, en approuvant le mouvement de von Klück qui obliquait vers le sud-est et négligeait Paris, avait prescrit l’échelonnement de la Ire armée au nord de la Marne, et aux Ie et IIe armées un changement de front vers l’ouest, qui aurait eu pour résultat de couvrir le flanc droit des armées d’invasion pendant qu’elles eussent anéanti le centre français. Mais ces ordres étaient donnés alors que la Ire armée avait déjà franchi la Marne, et seul un corps d’armée se trouvait disponible pour s’opposer au premier mouvement de l’armée Maunoury vers l’Ourcq le 5 septembre. Dès le 7, von Kluck se trouva obligé de ramener de sa gauche à son extrême droite, les IIe et IXe corps ; de ce fait un trou se forma entre les Ire et IIe armées. Le IXe corps avait d’ailleurs été fortement bousculé le 6 vers Escardes-Courgivaux, et le VIIe qui le remplaçait dans la ligne de bataille continuait à céder le terrain devant les attaques françaises. La gauche de l’armée d’Esperey remportait donc un succès tactique en refoulant la droite de l’armée von Bülow, et les trois corps de l’armée britannique n’ayant devant eux que la cavalerie von der Marwitz, s’avançaient en accentuant ce mouvement de débordement et en menaçant en même temps la droite et les arrières de la Ire armée von Kluck.
Le 8 septembre, von Bülow n’a plus qu’une ressource : organiser la retraite à laquelle il vient d’être contraint. C’est à ce moment qu’arrive à son quartier général le lieutenant-colonel Hentsch (agent de liaison du G.Q.G.), qui approuve cette décision et, d’accord avec von Bülow, en tire toutes les conséquences : c’est le repli général qui s’impose. On lira dans l’étude critique de M. Frédéric Kircheisen le récit de son entrevue avec le général von Kühl dans l’après-midi du 9, d’après le journal de marche de la Ire armée.
Le lieutenant-colonel Hentsch apporte la communication suivante : « La situation n’est pas favorable, la Ve armée est fixée devant Verdun, les VIe et VIIe devant Nancy et Epinal, la IIe armée n’est plus que scorie. La retraite derrière la Marne est inévitable. L’aile droite de la IIe armée n’a pas rétrogradé, mais a été refoulée. Il est donc nécessaire de décrocher les armées toutes à la fois et les ramener : la IIIe au nord de Châlons ; les IVe et Ve par Clermont-en-Argonne et sans perdre la liaison sur Verdun. La Ire armée doit donc aussi reculer, direction Soissons, Fère-en-Tardenois, au pis-aller plus loin, même sur Laon, La Fère ».
En outre, le 10 à la première heure, le général von Bülow, envoyait au G.Q.G. la communication suivante : « D’accord avec Hentsch, la situation est jugée comme suit : Retraite de la Ire armée derrière l’Aisne, commandée par situation stratégique et tactique. IIe armée doit appuyer Ire armée au Nord de la Marne, faute de quoi aile droite des armées sera enfoncée et enroulée… ». Le Haut Commandement répondait immédiatement en subordonnant la Ire armée au commandement de la IIe et, dans l’après-midi, donnait ses ordres de repli aux IIIe, IVe et Ve armées : la bataille de la Marne était gagnée.
Le général von Hausen nous raconte les rudes combats que son armée saxonne renforcée d’une division de la Garde, livra du 6 au 10 septembre à la 9e armée française. Il a raison de dire que ni lui, ni son armée, n’ont aucune responsabilité dans le repli sur la rive droite de la Marne, mais il s’avance un peu quand il affirme que « le 9 septembre il était en train d’ouvrir au centre du front ennemi une brèche qui aurait peut-être suffi pour changer la face des choses ». Après avoir rompu de quelques pas, le général Foch se trouvait à même d’opposer à l’attaque qui se préparait une résistance renforcée. Son voisin le général d’Esperey avait déjà mis à sa disposition le 10e corps, et il pouvait dire à ses troupes le 9 dans un ordre célèbre « la situation est excellente… j’ordonne de nouveau de reprendre l’offensive ». Le général von Hausen était donc fort loin de la décision qu’il croyait entrevoir.
En réalité l’évènement s’était produit ailleurs : à la gauche de l’armée d’Esperey qui s’avançait par Escardes, Montmirail, Thillois. Les témoignages allemands que nous venons de citer sont formels : « L’aile droite de la IIe armée n’a pas rétrogradé, mais a été refoulée… »
« IIe armée doit appuyer Ire armée au nord de la Marne, faute de quoi aile droite des armées serait enfoncée et enroulée… »
* * *
Les dernières publications allemandes, et en particulier les Souvenirs du général von Hausen ne présentent pas seulement l’intérêt de nous fixer enfin sur les manœuvres et le moment qui ont décidé la Victoire de la Marne ; nous y constatons également les fautes d’organisation et de commandement qui ont fait pencher du côté français le plateau de la balance. Le G.Q.G. allemand placé à Coblence, puis à Luxembourg, était trop éloigné pour apprécier sainement la situation, prendre ses décisions en connaissance de cause et donner ses ordres à temps. Chacune des armées manœuvrait pour son compte avec des liaisons tout à fait insuffisantes avec ses voisines, et avec l’arrière. La mésintelligence entre les commandants d’armée est flagrante ; elle se constate journellement dans les ouvrages de von Klück, von Bülow et von Hausen. Dans ces conditions, la subordination momentanée d’un État-Major d’armée à un autre n’était qu’un palliatif insuffisant.
Le général von Hausen aurait souhaité qu’un commandement de groupe d’armées coordonnât l’action des Ire, IIe, IIIe et IVe armées allemandes. Il hésite à affirmer si cette organisation du groupe d’armées doit être permanente ou simplement occasionnelle et prise en vue d’opérations déterminées, mais paraît pencher pour la première solution.
Au cas particulier, le commandement de l’aile droite allemande aurait dû être organisé. L’éloignement du Grand Quartier Général, et la difficulté des liaisons, encore bien imparfaites au début de la campagne, rendait le Groupe d’armées indispensable. Par contre, l’expérience a montré au cours de la dernière guerre que la permanence de cet organe si lourd est à rejeter absolument. Dans les armées allemandes, il a surtout servi à placer dans une situation honorifique les membres des familles régnantes : Kronprinz Allemand, Kronprinz de Bavière, duc de Wurtemberg. Les questions de personnes jouent un rôle capital. On voit le Kronprinz prendre le commandement direct des attaques contre Verdun en février 1916, par-dessus la tête du commandant de l’armée, puis, le succès tardant à couronner ses efforts, il organise un commandement des attaques sur la rive droite et un autre sur la rive gauche de la Meuse. En mars 1918, Lüdendorff choisit un terrain d’attaque à cheval sur deux commandements de groupes d’armées : ceux des deux Kronprinz. « Je tenais à exercer la plus grande influence sur la bataille, dit-il dans ses Souvenirs de guerre, ce qui était délicat quand elle était dirigée par un seul groupe d’armées, toute intervention était dans ce cas trop facilement taxée d’ingérence oiseuse de l’autorité immédiatement supérieure », et, tout en se défendant d’être courtisan, il étale une joie sans mélange « d’amener son Altesse Impériale le Kronprinz à prendre part à la première grande bataille offensive sur le front occidental ». En outre, le Haut Commandement avait à diriger sur des fronts très éloignés : Pologne, Galicie, Roumanie, Italie, des opérations qui concentrèrent à certaines époques toute son attention.
Mais sur le front français, qui diminuait d’étendue à mesure qu’augmentait le front anglais, et où l’intérêt dynastique n’existait point, le groupe d’armées n’a eu que des inconvénients. La volonté du général en chef ne se transmettait pas avec toute son énergie, son action s’en trouvait retardée et émoussée. Dans la guerre moderne l’armée est un organisme de plus en plus compliqué et qui exige un personnel de plus en plus nombreux ; lui superposer inutilement un autre organisme au moins aussi compliqué avec un personnel au moins aussi nombreux, qui tous deux ne vivent qu’au détriment des armées, c’est une faute.
Le groupe d’armées ne sera donc qu’une organisation de circonstance, créé dans un but de coordination, et avec un état-major très restreint.
* * *
Dans ses Souvenirs, le colonel général von Hausen se plaint de la morgue prussienne et déplore qu’après son départ de l’armée saxonne, le Haut Commandement l’ait morcelée sans motif militaire. Guéri en mai 1915, il ne fut plus employé au cours de la campagne, et c’est sans invraisemblance qu’il attribue cet ostracisme à la volonté de donner la préférence, dans les hauts postes de commandement qui étaient sans cesse créés, aux généraux prussiens et bavarois, pendant la guerre comme pendant la paix, et il ajoute : « Le représentant de l’armée saxonne n’a pas pu avoir le dessus sur le G.Q.G. et le Cabinet prussien ». Il affirme que les troupes saxonnes ont été très péniblement impressionnées par cette injuste déconsidération qui paraissait peser sur leurs chefs.
En dehors des faits purement militaires, il cherche à justifier les troupes saxonnes des atrocités qu’elles ont commises en Belgique, notamment à Dinant, et il voit partout des francs-tireurs, même dans le département de l’Aube. La fatigue des longues marches, les grandes chaleurs, l’émotion des premiers combats mettaient les troupes dans un état de surexcitation nerveuse qui les prédisposaient aux suggestions collectives de leur méfiance naturelle ; les bruits répandus avec intention étaient donc accueillis sans contrôle, et la pratique de fusiller sans jugement et d’incendier sans enquête, fut établie par le Haut Commandement ; le viol et le pillage s’ensuivirent très naturellement dans la troupe.
Les troupes saxonnes se montrèrent particulièrement barbares. En très grande majorité protestantes, elles s’acharnèrent contre les couvents et les prêtres isolés. Il est presque toujours impossible de déterminer à distance le prétexte de chaque cruauté. Les notes journalières que la plupart des soldats inscrivirent sur des carnets de route au début de la campagne sont tombées entre les mains de troupes françaises, et c’est une source de renseignements précieux. Nous savons par exemple qu’au charmant petit village Le Gué d’Ossus, un cycliste tomba maladroitement et fit partir un coup de fusil ; ce fut le signal du massacre et de l’incendie du village. En reprenant le village d’Onhaye nos troupes trouvèrent le cadavre du bourgmestre près de son coffre-fort éventré.
Le but avoué du Haut Commandement allemand était de propager la terreur en provoquant la fuite des populations épouvantées, et de démoraliser ainsi successivement la Belgique et la France. Il pensait de cette façon arriver plus vite à la paix.
* * *
On lira avec intérêt l’étude critique de M. Frédéric Kircheisen qui contient des vues générales sur l’ensemble des opérations. Le lecteur mettra lui-même au point le récit de la bataille de Charleroi et de la bataille de la Marne. L’auteur interprète les évènements d’une manière bien curieuse et il a beaucoup de peine à sortir des contradictions qu’il accumule. Mais parmi ses erreurs de faits il faut signaler cette affirmation que les troupes et le commandement français n’ont pas considéré la bataille de la Marne comme une victoire au moment où elle s’est livrée.
Il est vrai que le communiqué français, très modeste a toujours eu peur du mot « Victoire », mais ni le pays ni l’armée, ni ses chefs, ne se sont trompés sur la signification des évènements qui se sont déroulés du 6 au 13 septembre. Les troupes françaises ont eu le sentiment de la victoire à partir du moment où elles ont fait demi-tour pour passer à l’offensive. Beaucoup d’unités n’avaient pas encore combattu et brûlaient de le faire ; d’autres n’avaient remporté que des succès et cependant s’étaient trouvées entraînées dans le mouvement général de repli dont l’exécution s’était imposée au Haut Commandement. Le recul de l’ennemi devant leur progression n’a fait qu’accentuer ce sentiment.
Quant au Haut Commandement, le général d’Esperey disait à la 5e armée : « Soldats, sur les mémorables champs de Montmirail, de Vauchamps et de Champaubert, qui, il y a un siècle, furent témoins des victoires de nos ancêtres sur les Prussiens de Blücher, votre vigoureuse offensive a triomphé de la résistance des Allemands ; ce premier succès n’est qu’un prélude ». Le général Maunoury disait à ses troupes : « Grâce à vous, la Victoire est venue couronner nos drapeaux ». Enfin l’ordre du jour du général Joffre du 12 septembre a été publié dans le monde entier : « La bataille qui se livre depuis cinq jours s’achève par une victoire incontestable. La retraite des Ire, IIe et IIIe armées allemandes s’accentue devant notre gauche et notre centre. À son tour la IV° armée ennemie commence à se replier au nord de Vitry et de Sermaize. Partout l’ennemi laisse sur place de nombreux blessés et des quantités de munitions, partout on fait des prisonniers ; en gagnant du terrain, nos troupes constatent la trace de l’intensité de la lutte et l’importance des moyens mis en œuvre par les Allemands pour essayer de résister à notre élan. La reprise vigoureuse de l’offensive a déterminé le succès, tous officiers, sous-officiers et soldats avez répondu à mon appel, vous avez bien mérité de la Patrie. »
Général Mangin.
Avertissement
Tôt ou tard la guerre mondiale devait éclater. Les armées étaient équipées, les caisses remplies, et on ne manquait pas d’hommes. Partout en Europe régnait le mécontentement, par suite du développement excessif de la civilisation. Il suffisait d’une étincelle pour amener l’explosion. L’étincelle fut l’assassinat du prince héritier d’Autriche par un fanatique.
La diplomatie allemande, à vrai dire la diplomatie d’un seul, a obtenu ce résultat que, haïs et craints, nous nous trouvâmes à peu près isolés quand éclata la guerre mondiale. Un pays dont la situation géographique est aussi défavorable que celle de l’Empire allemand n’aurait jamais dû s’exposer au danger d’être contraint de faire la guerre sur trois fronts. Que la prochaine guerre dût être une guerre économique, c’était à prévoir. Et une telle guerre exige non seulement des hommes, mais aussi du fer, du charbon et des matières premières de toutes sortes, dont seuls disposent la Grande-Bretagne, les États-Unis d’Amérique, la Russie, la Chine et le Japon. Et aucun de ces pays ne manqua dans les rangs de nos adversaires !
Coupés de l’Océan, du câble sous-marin, privés de la plupart des matières premières, nous devions succomber. Nous devions, comme le disait Kitchener, vaincre jusqu’à en mourir !
Comme il fallait s’attendre, dans une guerre future, à un règlement des comptes avec l’Angleterre – car c’était là le principal ennemi de l’Allemagne – à laquelle se joindrait aussi la France avide de revanche, c’eût été pour nous une question vitale de nous rapprocher de la Russie.
Mais on préféra s’allier à l’Autriche-Hongrie, déchirée par des luttes de races, et même conclure une alliance avec l’Italie, qui n’attendait qu’une occasion pour se soustraire à la tutelle allemande. Le tait que ce pays devint aussitôt esclave de l’Entente, et que plus tard il implorera certainement le pardon de l’Allemagne, ne peut être pour nous autres, Allemands d’aujourd’hui, qu’une bien faible consolation.
On ne peut pas non plus épargner à l’État-Major Général prussien le reproche d’avoir, dans son orientation politique, trop compté sur l’Office des Affaires étrangères et de s’être engagé dans une guerre où les chances de gagner étaient pour nous presque nulles.
On peut affirmer sans crainte que, malgré nos innombrables victoires, rien ne s’est réalisé de ce qu’on avait désiré et espéré. Seul un miracle pouvait nous sauver. Mais le miracle ne s’est pas produit. L’Autriche-Hongrie s’affaissa et la Russie entra en lice quelques semaines plus tôt que nous ne l’avions supposé. Et ainsi l’édifice savamment érigé à l’ouest s’écroula aussi.
À cela s’ajoutèrent, au début de la guerre, les fautes, du type le plus élémentaire, dont l’État-Major Général prussien se rendit coupable. Et c’est ainsi que dès septembre 1914 nous perdîmes la guerre non seulement en France, mais en Galicie et en Prusse-Orientale, car les destinées de l’Allemagne et de l’Autriche étaient étroitement liées. Et c’était doublement dur pour nous.
L’armée et le peuple avaient attendu une décision rapide dans l’ouest. On avait annoncé victoires sur victoires et on les avait bruyamment célébrées à l’intérieur. Puis les communiqués cessèrent, faisant place aux légendes.
Les Français « complètement battus » avaient résisté et avaient passé à l’offensive. Sur la Marne, on en vint à une lutte de quatre jours, après laquelle les armées allemandes, sans être battues, commencèrent la retraite et occupèrent de nouvelles positions.
Le Haut Commandement allemand n’a jamais rien voulu savoir d’une bataille de la Marne. Nulle part on ne trouve ce nom. Et pourtant il est devenu aussi connu dans le reste du monde que le mot « boche », le sobriquet international forgé en France pour nous désigner, nous autres Allemands. Nous seuls nous ne le connaissons pas, comme nous ne savons pas non plus combien on nous hait…
Dans les fascicules publiés par l’état-major allemand sur la guerre mondiale, il est bien question des combats sur l’Ourcq, mais jamais de la bataille de la Marne. Une défaite est une conception qui n’existait pas avant 1918 dans le vocabulaire de l’État-Major Général allemand. En décembre 1915, le premier en Allemagne, je publiai une brochure sur les batailles de la Marne, mais elle fut interdite quelques jours après son apparition, bien que j’y représentasse absolument notre point de vue.
Les faits y parurent si bien présentés qu’on crut à l’étranger qu’il s’agissait d’un récit officiel de l’État-Major allemand, sortant de la plume d’un officier de l’entourage de Moltke ou de Kluck.
Comme les hautes sphères militaires évitaient scrupuleusement de laisser transpirer quoi que ce fût au sujet des évènements qui se déroulèrent en France au commencement de septembre, il était très compréhensible que toutes sortes de légendes se répandissent dans le peuple allemand.
Il eût été facile à l’État-Major de les infirmer.
Mais au contraire il désirait que l’opinion publique restât sur une fausse piste.
Pour beaucoup ce fut fort à propos que, au cours de la marche en avant, le chef de la 3e armée, le colonel-général baron von Hausen, tomba gravement malade du typhus, et fut, de ce fait, relevé provisoirement de son commandement le 12 septembre.
L’Empereur avait attendu jusqu’au 10 septembre pour lui exprimer télégraphiquement « ses félicitations pour ses succès obtenus dans des circonstances particulièrement difficiles », félicitations qu’il voulait d’abord lui apporter personnellement.
Le baron von Hausen qui, aujourd’hui encore, malgré les épreuves de ces cinq pénibles années, se trouve dans les meilleures conditions intellectuelles et physiques, avait, après son complet rétablissement, un droit particulier à un poste en rapport avec ses hautes capacités militaires.
Du fait qu’on ne le lui accorda pas, bien qu’à différentes reprises il eût demandé à être rappelé à l’activité, on peut conclure qu’on était heureux d’avoir trouvé un bouc émissaire.
Les créateurs de légendes firent un rapprochement naturel entre la mise en disponibilité du baron von Hausen, en septembre 1914 et les échecs sur la Marne, dont le Haut Commandement d’alors fut la seule et unique cause. Et ainsi l’on en arriva à rendre la 3e armée et son chef responsables de la bataille perdue.
Que d’absurdités j’ai entendu raconter à ce sujet, même par des gens raisonnables. Chacun prétendait m’informer exactement de tout ce qui s’était alors passé sur la Marne. Un jour, on m’assura très sérieusement – et ce fut le propos le plus extravagant que j’entendis – que plus de 20 000 Saxons avaient été faits prisonniers au camp de Châlons. Chose étrange d’ailleurs, nos ennemis eux-mêmes n’en savaient rien. Il est établi par les documents que le nombre des disparus de la 3e armée – y compris donc les morts et blessés non retrouvés – ne s’élevait guère à plus de 3 000 hommes.
Occupé à écrire une histoire de la guerre, j’ai cherché à réunir tous les matériaux, même ceux que nos adversaires ont ou n’ont pas publiés.
Nos ennemis ayant célébré la bataille de la Marne comme une grande victoire sur les Allemands jusqu’alors invincibles, il me parut très intéressant de pouvoir établir en quoi consistait, à proprement parler, cette grande victoire, d’autant plus que la censure française était maniée beaucoup plus libéralement que la nôtre.
Or je lus avec grande surprise que les choses s’étaient passées tout autrement qu’on ne voulait le faire croire.
Les possibilités de vaincre du côté franco-anglais étaient très minimes, et même beaucoup de Français considèrent les évènements qui se sont passés au début de septembre sur la Marne comme une véritable énigme. En effet l’aile gauche française courait le grand danger d’être débordée par Kluck, et, au centre, le Généralissime français craignait encore plus que la ligne de bataille ne fût enfoncée. Or qui commandait les troupes allemandes en cet endroit ? Le Général baron von Hausen !
C’est de mes efforts pour présenter sous son vrai jour le rôle joué, dans la bataille de la Marne, par les deux commandants d’armée les plus marquants, que sortit l’étude déjà mentionnée plus haut. À la suite de sa publication, une correspondance s’engagea entre les chefs de la 1re et de la 3e armées et moi, et finalement M. le colonel-général baron von Hausen me confia la publication de ses notes, aussi vivantes et simples qu’objectives, sur son activité militaire, notes d’une importance capitale pour l’intelligence des opérations de la 3e armée allemande pendant la campagne de la Marne.
Nous sommes encore entièrement bridés par l’histoire officielle. On ne sait encore que fort peu de choses sur la marche véritable de la guerre. J’ai donc cru devoir rapporter dans leurs grandes lignes les évènements qui précédèrent la bataille de la Marne, afin de faire mieux comprendre ainsi les notes du colonel-général. Et je ne pouvais le faire qu’en effleurant aussi les évènements qui se déroulèrent sur les autres théâtres de la guerre, et sans lesquels on ne peut comprendre la bataille de la Marne.
Telle fut l’origine de l’introduction qui va suivre. Nous devons et nous pouvons tirer de grandes leçons de nos échecs. Des années 1806 et 1807 sortit l’Allemagne des guerres de délivrance. Les années 1870 et 1871 créèrent une France nouvelle. Mais chez nous, les vainqueurs, elles déposèrent le germe de cet orgueil qui a tant contribué à nous mener au désastre. Espérons que les années 1914 à 1918 créeront une Allemagne nouvelle. Nous ne sommes pas encore un peuple anéanti. Nous voulons continuer à vivre. Et pour cela il nous faut avoir confiance en nous-mêmes, travailler et rester unis. Arrière la légendaire discorde allemande, les éternelles luttes fratricides auxquelles nous devons déjà la guerre de Trente Ans, dont les suites nous rongent encore aujourd’hui plus que jamais !
Il ne faut pas que ce mal se transforme en un cancer qui ravage le peuple allemand.
Ne craignons donc pas d’avouer en quoi nous avons commis des fautes, ni de dévoiler sans réserve ce qui nous a conduits au désastre.
Berlin, octobre 1919.
Frédéric M. Kircheisen.
Étude critique
La situation politique des États au début de la guerre et nos fautes diplomatiques. – La lamentable stratégie autrichienne des trois cinquièmes et des deux cinquièmes, cause principale de la perte de la guerre. – Les défaites en Galicie. – Tannenberg. – Était-il nécessaire pour nous d’envoyer prématurément des troupes vers l’est ? – Les succès du mois d’août dans l’ouest, – Les batailles de la Marne. – Pourquoi avons-nous perdu la campagne de la Marne ?
I
Au début de la seconde décade du XXe siècle, l’Europe se partageait entre les groupements de puissances suivants :
1. L’Allemagne, forte militairement et économiquement, l’Autriche-Hongrie malade, et la Turquie à demi-morte.
2. La gigantesque Russie, abondamment pourvue de soldats et de ressources naturelles ; l’Angleterre, qui régnait sur le monde entier ; la France, animée d’un ardent patriotisme, toujours prête à la revanche contre l’Allemagne ; enfin la Serbie, petite, mais expérimentée dans l’art de la guerre.
3. La Hollande, la Suisse, le Danemark, la Suède, la Norvège, l’Espagne et le Portugal, états neutres, les uns pour des raisons militaires et géographiques, les autres par nécessité économique ou par tendance naturelle.
4. L’Italie, la Belgique, la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie, dont la position et l’attitude étaient incertaines.
Au premier groupement auraient dû se joindre :
L’Italie, parce qu’elle avait un traité d’alliance formelle avec l’Allemagne et l’Autriche, et que, se trouvant être la puissance la plus centrale de la Méditerranée, elle devait regarder comme son adversaire naturel la France impérialiste, en rivalité intense avec elle ;
La Bulgarie, ennemie héréditaire de la Serbie, et qui, de tout temps, avait été favorable à la politique balkanique de l’Autriche et de l’Allemagne ;
La Roumanie qui, comme la Bulgarie, possédait un souverain issu d’une maison princière allemande. Elle avait conclu avec l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne une alliance défensive secrète – bien qu’elle eût des sympathies pour la France. – Enfin, en cas de conflit avec les puissances centrales, ne se trouvait-elle pas dans l’obligation de faire la guerre sur trois fronts.
L’attitude de la Grèce était douteuse. Bien que le roi fût un grand admirateur de l’Allemagne et que le peuple se tînt en majorité fortement serré derrière lui, il y avait dans le pays un nombreux parti francophile. Mais une diplomatie allemande, habile et consciente du but à atteindre, aurait dû gagner même ce parti.
Seule, la Belgique devait chercher à se joindre au second groupement de puissances, aussi bien par affinité de race, que parce que l’Allemagne, grande puissance industrielle, lui faisait courir un danger bien plus grand que la France. Le fait d’avoir, du côté de la France, une frontière deux fois plus longue que du côté allemand, et par conséquent très difficile à défendre vers l’ouest, avait son importance. – Au cas d’une guerre contre la France et l’Angleterre, il fallait, du côté belge – abstraction faite d’autres complications – compter avec la perte du riche État du Congo.
En réalité, la Bulgarie seule se mit du côté des empires centraux pendant que tous les autres États, naturellement aussi la Belgique et même l’Italie, étroitement alliée aux puissances centrales, passèrent dans le camp de l’Entente. La diplomatie allemande avait de nouveau subi une grande défaite.
Pour tout homme perspicace, il était clair qu’en cas de guerre générale européenne le groupement se ferait selon toute apparence de cette manière-là : seule la Wilhelmstrasse l’ignorait, et par suite l’état-major allemand qui, pour l’orientation politique, s’en remettait malheureusement trop à l’Office des Affaires étrangères.
Si par surcroît le Portugal, les États-Unis, une poignée d’autres républiques américaines, même le Japon et la Chine, se sont rangés aux côtés des adversaires des empires centraux, nous le devons aux dirigeants allemands d’alors, avant tout au secrétaire d’État von Jagow et à son successeur Zimmermann. Leurs fautes néfastes n’ont été malheureusement que trop peu reconnues jusqu’ici en Allemagne.
La conflagration générale qui dévasta l’Europe pendant cinq ans et engendra une haine telle que le monde n’en avait jamais connu – ce qui d’ailleurs n’est nullement consolant pour notre « culture » si vantée – devait nécessairement éclater tôt ou tard. On ne peut encore analyser les causes qui déterminèrent la catastrophe, car un faux patriotisme, une haine aveugle et aussi la soif de s’enrichir facilement par la guerre ont privé les hommes, même les plus réfléchis, de tout esprit critique.
Chaque État est responsable de la guerre directement ou indirectement ; c’est là chose essentiellement humaine.
On fait preuve de manque de sens historique et d’intelligence quand on rend responsable de la guerre un pays déterminé ou qu’on en cherche la cause dans un évènement unique.
Les plus dépourvus d’esprit critique sous ce rapport sont les Français. Mais chez nous aussi, tout homme qui a jeté un regard sur un journal, ou a pris part à une réunion publique, veut porter un jugement. Seule une longue éducation historique permet de se former une opinion objective. Seul, un très petit nombre de spécialistes en recherches historiques peut y arriver, mais non le profane qui, le plus souvent, puise ses connaissances dans les quotidiens tendancieux. Non, non ! À ceux qui sont si vite prêts à formuler un avis sur une question de culpabilité, on ne peut assez rappeler que des causes innombrables contribuent à rendre finalement l’atmosphère tellement opaque qu’il en sort un casus belli, surtout de nos jours où, somme toute, chacun craignait la guerre et ses conséquences incalculables qui se révélèrent en effet encore bien plus horribles qu’on ne l’aurait jamais imaginé !
L’examen détaillé de la guerre mondiale fait ressortir, en quelque sorte, les conflits particuliers suivants :
1. Angleterre contre Allemagne et Allemagne contre Angleterre. Oppositions insurmontables. La lutte pour le commerce mondial et l’hégémonie sur l’Océan. C’est la guerre principale, à laquelle s’adjoignent ou se subordonnent toutes les autres.
2. France contre Allemagne et réciproquement. Grande opposition, bien que surmontable : cession de l’Alsace-Lorraine à la France, la grande blessure dont la France saignait depuis 1871.
3. Russie contre Autriche-Hongrie. Objet du litige : Constantinople et l’hégémonie dans les Balkans. Il était possible d’aplanir les oppositions, parce qu’on pouvait conclure un compromis et qu’en outre :
4. Entre la Russie et le puissant allié de l’Autriche-Hongrie, l’Empire allemand, il n’existait aucun motif plausible de guerre : l’Allemagne était appelée à jouer le rôle d’un médiateur entre les deux puissances. Ce n’est que quand la Russie mobilisa contre l’Autriche-Hongrie et ne suspendit pas la mobilisation malgré les protestations de l’Allemagne que celle-ci se vit forcée de déclarer la guerre à la Russie.
5. Autriche-Hongrie contre Serbie et Serbie contre Autriche-Hongrie. Opposition insurmontable : la Serbie élevait des prétentions sur les territoires de la double monarchie habités par des sujets de race serbe, et l’Autriche-Hongrie, plus développée comme civilisation, habitée par plus de Serbes que le royaume indépendant, demandait, avec le droit du plus fort, que la petite Serbie, tel un état vassal, se subordonnât à ses désirs. En outre la Serbie se trouvait sur le chemin de Constantinople et offrait ainsi aux appétits autrichiens un obstacle désagréable.
6. Italie contre Autriche-Hongrie. Opposition surmontable par la cession à l’Italie des provinces de la monarchie danubienne où l’on parlait l’italien.
7. Pour la Turquie il n’existait aucun motif véritable de guerre. Mais elle prit pourtant part à la campagne, parce que ses chefs, qui voyaient tout leur salut dans l’Allemagne, espéraient se dédommager en Asie de la perte de leurs provinces des Balkans.
Les puissances qui plus tard participèrent à la guerre mondiale poursuivaient plus ou moins des buts purement égoïstes. Elles se placèrent tout simplement aux côtés du groupe de puissances dont elles escomptaient la victoire. De la sorte elles purent mettre, à leur entrée dans la coalition, des conditions qui, d’une façon générale, furent intégralement remplies.
Les États-Unis, en prenant part à la guerre, et cela contre l’Allemagne, ont commis une grande faute politique que tout le monde reconnaîtra bientôt de l’autre côté de l’Océan.
Mais l’État qui commit la plus grande imprudence fut l’Italie. Si ce pays s’était tenu éloigné de la guerre, ou avait gardé seulement vis-à-vis des Empires centraux une neutralité bienveillante, il eût tiré du conflit européen le plus grand profit.
Comme cela paraît manifeste, d’après ces brèves indications, un règlement de comptes sanglant devait se produire tôt ou tard entre l’Allemagne et l’Angleterre ; entre les autres puissances un compromis pacifique eût sans doute été possible, sûrement entre l’Allemagne et la Russie, peut-être aussi entre l’Allemagne et la France et entre l’Autriche et la Russie, si les gouvernants avaient eu véritablement l’intention de s’entendre.
Malheureusement nos hommes d’État d’alors étaient des moins aptes à peser les conséquences qui résulteraient pour nous d’un choc des deux groupes de puissances de l’Europe : ce fut ainsi que nous allâmes vers l’abîme.
II
Telle était la situation politique de l’Europe en 1914. Même si l’on pouvait oublier les énormes fautes que notre diplomatie commit quotidiennement pendant cette lutte des nations, il n’en faudrait pas moins reconnaître que la guerre aurait dû être autrement conduite qu’elle ne le fut en réalité.
Pour examiner la chose de plus près, quittons la Wilhelmstrasse et rendons-nous au Moltkeplatz, à l’État-major général chargé de la direction de la guerre.
Bien que l’Autriche-Hongrie ne fût pas précisément considérée comme un état vassal de l’Allemagne, c’était cependant, sans aucun doute, une chose entendue entre les deux puissances, que l’État-major allemand prendrait la direction des opérations dans le cas d’une guerre européenne.
Comment, dès lors, put-on admettre à la Moltkeplatz que, du côté autrichien, on conduirait simultanément une offensive sur deux fronts. C’est, à vrai dire, une question oiseuse ; car à Berlin même on commit une faute analogue ! Non pas que, du côté allemand, on voulût faire une guerre offensive simultanément à l’ouest et à l’est ! Non. Mais on ne se tint pas, en Prusse-Orientale, sur la défensive absolue, comme on l’avait prévu à l’origine. Bien plus, on envoya des renforts de l’Ouest vers l’Est, avant que la décision fût intervenue en France.
La situation défavorable créée aux Empires centraux par la diplomatie avait ce résultat que l’Allemagne aussi bien que l’Autriche-Hongrie devait se défendre sur trois fronts : l’Allemagne à l’ouest, à l’est et au nord (mer du Nord et Baltique) ; l’Autriche-Hongrie à l’est, au sud (Serbie et Monténégro, plus tard aussi Roumanie), et au sud-ouest (Adriatique, plus tard encore Italie). Les deux pays ne formaient qu’un seul bloc, puisque leur quatrième frontière était commune. On n’exagère donc pas en disant que les puissances centrales ont fait la guerre sur quatre fronts. Or, aucun pays de la terre – sauf peut-être les États-Unis d’Amérique – ne saurait mener une guerre sur quatre fronts avec l’espoir d’une victoire finale ; par suite, les Empires centraux devaient ou bien à tout prix éviter la guerre, ou bien jouer leur va-tout sur une seule carte. Et ils ne pouvaient le faire que si chacun d’eux concentrait toutes ses forces sur un seul front et gardait sur les autres fronts la plus stricte défensive.
Le problème militaire se présentait différemment pour l’Allemagne et pour l’Autriche-Hongrie. L’Allemagne devait se ruer immédiatement sur son adversaire le plus important, le plus fort et le plus rapide, et anéantir son armée. Cet adversaire en 1914 c’était la France.
Un tel résultat était dans le domaine des possibilités.
La conséquence immédiate eût été la suppression, dans la Triple Entente, de l’adversaire principal. En plus, les États dont le dessein était de se ranger du côté de l’Entente auraient bien vite renoncé à leur projet.
La tâche de l’Autriche-Hongrie consistait essentiellement à détruire quelques armées ennemies jusqu’à ce que des renforts allemands devinssent libres dans l’ouest, puis à combiner avec le camarade allemand une offensive contre le colosse russe ; pour le reste, à fixer le plus grand nombre possible de forces adverses.





























