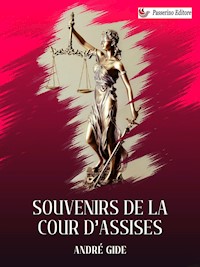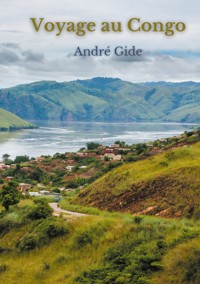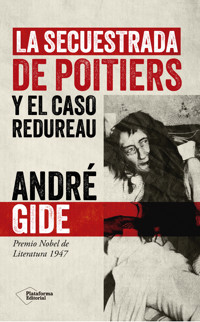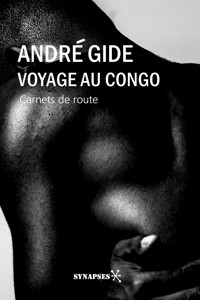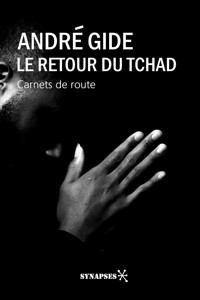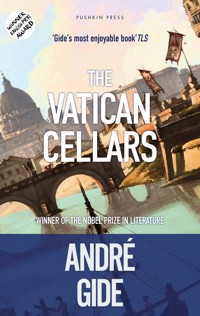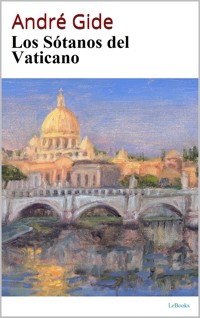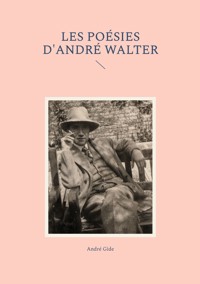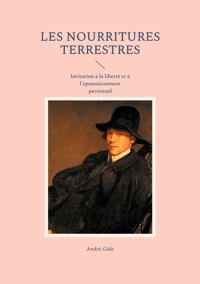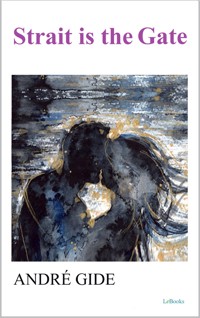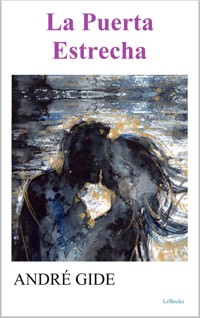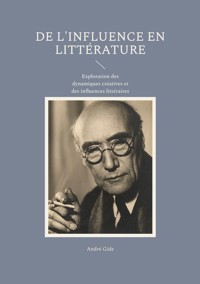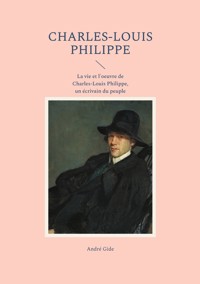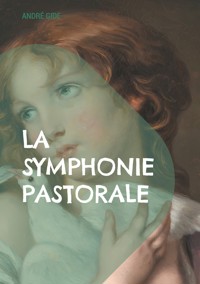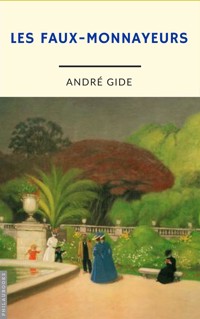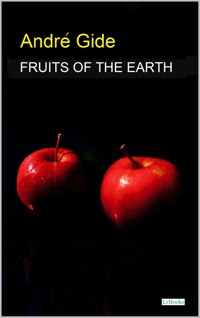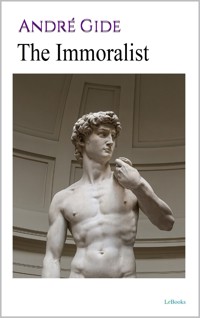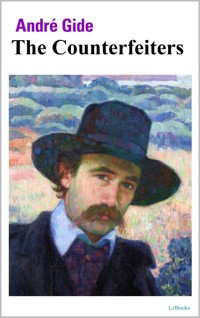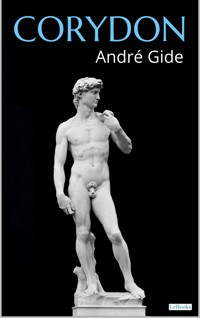Lundi.
On procède à l’appel des jurés.
Un notaire, un architecte, un instituteur retraité ; tous les
autres sont recrutés parmi les commerçants, les boutiquiers, les
ouvriers, les cultivateurs, et les petits propriétaires ; l’un
d’eux sait à peine écrire et sur ses bulletins de vote il sera
malaisé de distinguer le oui du non ; mais à part deux
je-m’en-foutistes, qui du reste se feront constamment récuser,
chacun semble bien décidé à apporter là toute sa conscience et
toute son attention.
Les cultivateurs, de beaucoup les
plus nombreux, sont décidés à se montrer très sévères ; les
exploits des bandits tragiques, Bonnot, etc. viennent d’occuper
l’opinion : « Surtout pas d’indulgence », c’est le mot d’ordre,
soufflé par les journaux ; ces Messieurs les jurés représentent la
Société et sont bien décidés à la défendre.
L’un des jurés manque à l’appel.
On n’a reçu de lui aucune lettre d’excuses ; rien ne motive son
absence. Condamné à l’amende réglementaire : trois cents francs, si
je ne me trompe. Déjà l’on tire au sort les noms de ceux qui sont
désignés à siéger dans la première affaire, quand s’amène tout
suant le juré défaillant ; c’est un pauvre vieux paysan sorti de la
Cagnotte de Labiche. Il soulève un grand rire général en expliquant
qu’il tourne depuis une demi-heure autour du Palais de Justice sans
parvenir à trouver l’entrée. On lève l’amende.
Par absurde crainte de me faire
remarquer, je n’ai pas pris de notes sur la première affaire ; un
attentat à la pudeur (nous aurons à en juger cinq). L’accusé est
acquitté ; non qu’il reste sur sa culpabilité quelque doute, mais
bien parce que les jurés estiment qu’il n’y a pas lieu de condamner
pour si peu. Je ne suis pas du jury pour cette affaire, mais dans
la suspension de séance j’entends parler ceux qui en furent ;
certains s’indignent qu’on occupe la Cour de vétilles comme il s’en
commet, disent-ils, chaque jour de tous les côtés.
Je ne sais comment ils s’y sont
pris pour obtenir l’acquittement tout en reconnaissant l’individu
coupable des actes reprochés. La majorité a donc dû, contre toute
vérité, écrire « Non » sur la feuille de vote, en réponse à la
question : « X… est il coupable de… etc. » Nous retrouverons le cas
plus d’une fois et j’attends pour m’y attarder, telle autre affaire
pour laquelle j’aurai fait partie du jury et assisté à la gêne, à
l’angoisse même de certains jurés, devant un questionnaire ainsi
fait qu’il les force de voter contre la vérité, pour obtenir ce
qu’ils estiment la justice.
La seconde affaire de cette même
journée m’amène sur le banc des jurés, et place en face de moi les
accusés Alphonse et Arthur.
Arthur est un jeune aigrefin à
fines moustaches, au front découvert, au regard un peu ahuri, l’air
d’un Daumier. Il se dit garçon de magasin d’un sieur X…; mais
l’information découvre que M. X… n’a pas de magasin.
Alphonse est « représentant de
commerce » ; vêtu d’un pardessus noisette à larges revers de soie
plus sombre ; cheveux plaqués, châtain sombre ; teint rouge ; œil
liquoreux, grosses moustaches ; air fourbe et arrogant ; trente
ans. Il vit au Havre avec la sœur d’Arthur ; les deux beaux-frères
sont intimement liés depuis longtemps, l’accusation pèse sur eux
également.
L’affaire est assez embrouillée :
il s’agit d’abord d’un vol assez important de fourrures, puis d’un
cambriolage sans autre résultat, en plus du saccage, que la
distraction d’une blague à tabac de 3 francs, et d’un carnet de
chèques inutilisables. On ne parvient pas à recomposer le premier
vol et les charges restent si vagues que l’accusation se reporte
plutôt sur le second ; mais ici encore rien de précis ; on
rapproche de menus faits, on suppose, on induit…
Dans le doute, l’accusation
solidarise les deux accusés ; mais leur système de défense est
différent. Alphonse porte beau, a souci de son attitude, rit
spirituellement à certaines remarques du président :
— Vous fumiez de gros
cigares.
— Oh ! fait-il dédaigneusement,
des londrès à 25 centimes !
— Vous ne disiez pas tout à fait
cela à l’instruction, dit un peu plus tard le président. Pourquoi
n’avez-vous pas persisté dans vos négations ?
— Parce que j’ai vu que ça allait
m’attirer des ennuis, répond-il en riant.
Il est parfaitement maître de lui
et dose très habilement ses protestations. Ses occupations de
« placier » restent des plus douteuses. On le dit « l’amant » d’une
vieille fille de 60 ans. Il proteste : « Pour moi, c’est ma
mère ».
L’impression sur le jury est
déplorable. S’en rend-il compte ? Son front, peu à peu, devient
luisant…
Arthur n’est guère plus
sympathique. L’opinion du jury est que, après tout, s’il n’est pas
bien certain qu’ils aient commis ces vols-ci, ils ont dû en
commettre d’autres ; ou qu’ils en commettront ; que, donc, ils sont
bons à coffrer.
Cependant c’est pour ce vol
uniquement que nous pouvons les condamner.
— Comment aurais-je pu le
commettre ? dit Arthur, je n’étais pas au Havre ce jour-là.
Mais on a recueilli, dans la
chambre de sa maîtresse les morceaux d’une carte postale de son
écriture, qui porte le timbre du Havre du 30 octobre, jour où le
vol a été commis.
Or voici comment se défend Arthur
:
— J’ai, dit-il en substance,
envoyé ce jour-là à ma maîtresse non pas une carte, mais deux ; et
comme les photographies qu’elles portaient étaient « un peu
lestes » (elles représentaient en fait l’Adam et l’Ève de la
cathédrale de Rouen), je les avais glissées, image contre image,
dans une seule enveloppe transparente, après y avoir mis double
adresse, les avoir affranchies toutes les deux et avoir percé
l’enveloppe aux endroits des timbres, pour en permettre la double
oblitération. Au départ, un seul des timbres aura sans doute été
oblitéré. A l’arrivée au Havre l’employé de la poste a oblitéré
l’autre ; c’est ainsi qu’il porte la marque du Havre.
C’est du moins ce que j’arrivais
à démêler au travers de ses protestations confuses, bousculées par
un Président dont l’opinion est formée et qui paraît bien décidé à
ne rien écouter de neuf. J’ai le plus grand mal à comprendre, à
entendre même ce que dit Arthur, sans cesse interrompu et qui finit
par bredouiller ; le jury, qu’il ne parvient pas à intéresser,
renonce à l’écouter.
Son système pourtant se tient
d’autant mieux qu’il est peu vraisemblable qu’un aigrefin aussi
habile que semble être Arthur, ait laissé derrière lui — que
dis-je ? créé, le soir d’un crime, une telle pièce à conviction ?
De plus, s’il était au Havre lui-même, quel besoin avait-il
d’écrire à sa maîtresse, au Havre, quand il pouvait aussi bien
aller la trouver ?